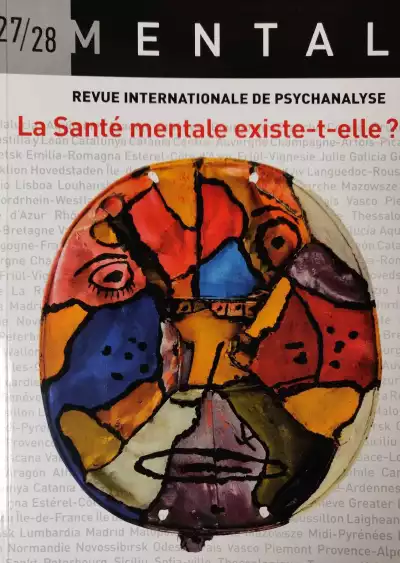Parler avec son corps
Jacques-Alain Miller
"Mental n°27/28"
-
Parler avec son corps
Jacques-Alain Miller
Dans deux ans, nous nous retrouverons pour PIPOL 6 et, comme aujourd'hui, nous le ferons autour d'une formule. Le signifiant santé mentale nous a rassemblés cette année. Quel sera, en 2013, le signifiant qui fera couple avec lui ? Voilà ce que j'ai cherché pour vous. Je vous rendrai compte de mes réflexions à ce sujet en conclusion de ce Congrès.
La santé mentale n'existe pas
La santé mentale, soyons francs, nous n'y croyons pas. Nous avons néanmoins avancé ce terme, parce qu'il nous a paru pouvoir faire médiation entre le discours analytique et le discours commun, celui de la masse. L'écho que la tenue de ce Congrès a connu dans la presse belge montre que, de ce point de vue, nous avons visé juste. Tout le monde comprend ce que nous avons mis en question. Il nous a évidemment fallu, pour y arriver, ruser. Nous avons inscrit le terme de santé mentale dans une question dont nous avions déjà la réponse. Non, la santé mentale n'existe pas, on en rêve, c'est une fiction !
Chacun a son grain de folie
Sous cette question, il y avait donc notre réponse : chacun a son grain de folie. Nous en avons témoigné en désignant sa place dans notre pratique. Non pas chez notre patient, mais chez nous-mêmes, analystes, thérapeutes. Il y a là comme une leçon que nous nous sommes donnée à nous-mêmes et qu'il serait bien de ne pas oublier à l'avenir. En psychanalyse, le cas clinique n'existe pas ! Pas davantage que la santé mentale. Exposer un cas clinique, comme si c'était celui du patient, c'est une fiction. C'est le résultat d'une objectivité qui est feinte. Nous sommes impliqués dans le cas, ne serait-ce que par l'effet du transfert. Nous sommes dans le tableau clinique et ne saurions défalquer notre présence ni nous rendre aveugles à ses effets.
Sans doute, essayons-nous de comprimer cette présence, d'abraser ses particularités, de rejoindre l'universel de ce que nous appelons le désir de l'analyste. Le contrôle, la pratique de ce qu'on appelle à l'occasion la supervision, sert à laver ces scories rémanentes qui interfèrent dans la cure. Mais dès que nous parvenons à effacer ce qui nous singularise comme sujet, c'est alors l'analysant qui nous revêt — nous, son interlocuteur — des atours de son fantasme. L'identité qu'il attribue à cet interlocuteur ne saurait être soustraite du tableau.
Vous êtes donc obligés de vous peindre vous-même dans le tableau clinique. Tout comme Vélasquez se représente lui-même le pinceau à la main, au milieu des êtres dont il peuple la toile des Ménines, avec la désorientation qui s'ensuit : il devient dès lors insituable, sauf à être conçu comme divisé. Ce tableau, vous le savez, a retenu l'attention de Lacan[1] à la suite de Michel Foucault[2]. En psychanalyse, dirais-je, tout cas clinique devrait avoir la structure des Ménines.
Je pousserais l'apologue jusqu'à relever que ce qui nous est offert sur la toile de Vélasquez — que nous la contemplions au musée du Prado à Madrid ou à partir d'une reproduction — c'est ce que voit le maître lui-même. À savoir, le couple royal. Le maître, lui, n'est pas représenté. Il est gommé, effacé, comme tombé, comme chu. À son reflet près que l'on distingue au fond du tableau, il ne reste du maître que sa place, cette place même où le tout-venant, où chaque spectateur vient s'inscrire. De même, dirais-je, dans l'expérience analytique, la place du maître certes subsiste, mais il n'est plus là pour l'occuper.
La santé mentale relève du discours du maître
Que reste-t-il de la santé mentale quand le maître n'y est plus ?
L'inexistence de la santé mentale en l'homme n'a cessé de faire l'objet de la déploration philosophique. On a peint l'homme asservi à ses illusions, ses passions, ses appétits. Pour s'évertuer à rétablir en lui l'ordre et la mesure, on l'a peint foncièrement déséquilibré. On appelait jadis la santé mentale, sagesse ou vertu. On faisait appel également, afin de l'établir, à l'amour pour un autre, un grand Autre divin. Ce n'était sans doute pas la plus mauvaise voie. La santé mentale est en effet, pourrait-on dire, une idée théologique qui suppose une bonne volonté de la nature, une bienveillance qui œuvre pour le bien-être ou le salut de tout ce qui existe.
Cependant, il suffit de parcourir l'immense littérature à laquelle je viens de faire une rapide allusion, pour s'apercevoir que cette santé mentale suppose toujours que vienne à dominer une partie de l'âme — sa partie rationnelle ou divine. La santé mentale relève depuis toujours du discours du maître. Elle est depuis toujours affaire de gouvernement. Et c'est son destin immémorial qui s'accomplit, aujourd'hui, dans sa prise en charge directe par tous les appareils de la domination politique.
La domination de la partie rationnelle de l'âme a pris aujourd'hui la forme du discours de la science. C'est à travers son emprise sur la science que le maître, qui n'est pas quelqu'un ni quelques-uns, mais un discours, prône la santé mentale et se soucie de la protéger, de la rétablir, de la diffuser parmi ce qu'on appelle les populations — terme dont je me suis aperçu que Davide Tarizzo le faisait résonner puissamment tout à l'heure[3].
On croit que la science s'accorde au réel et que le sujet est apte à s'accorder à son corps et à son monde comme au réel. L'idéal de la santé mentale traduit l'effort immense qui est fait aujourd'hui pour accomplir ce que j'appellerais une rectification subjective de masse, destinée à harmoniser l'homme avec le monde contemporain, à combattre et à réduire ce que Freud a nommé, de façon inoubliable, le malaise dans la civilisation[4].
Ce qui existe, c'est l'Un-tout-seul
Pourtant, si faible que soit sa voix dans le tintamarre contemporain, le discours analytique fait objection et n'est pas sans puissance. Il tient sa puissance, d'abord, de ce qu'il est démassifiant. À mesure que s'étend et croît la massification, s'intensifie aujourd'hui l'aspiration à la démassification. Le discours analytique, parce qu'il procède un par un, fait droit à l'exigence de singularité. Je dirais qu'il est, par là, accordé à l'individualisme démocratique que diffuse la civilisation contemporaine.
Jadis, on parlait « d'indications pour la psychanalyse » quand on pensait pouvoir sélectionner les sujets en fonction de leur aptitude clinique au discours analytique. Aujourd'hui, être écouté par un psychanalyste vaut comme un droit de l'homme. Il reste au psychanalyste à s'en arranger et à modeler sa pratique en fonction de ce qui est requis de lui.
La psychanalyse accompagne le sujet dans ce qu'il élève de protestations contre le malaise civilisationnel. À l'occasion, elle se retrouve en compagnie de ce qu'ont de meilleur l'humanisme voire la religion. Tout un chacun sait aujourd'hui qu'il trouvera dans la psychanalyse une rupture dans les injonctions conformistes dont il est pressé de toutes parts. Tout un chacun sait que s'il fait appel au discours analytique, celui-ci se mettra en branle pour lui seul : pour lui, l'Un-tout-seul, comme disait Lacan, détaché de son travail, sa famille, ses amis et ses amours. Sa solitude et son exil, c'est ce que le sujet trouve dans la psychanalyse. Oui, il y trouve son statut d'exilé par rapport au discours de l'Autre. Ce n'est pas l'Autre avec un grand A qui est au centre du discours analytique, c'est l'Un-tout-seul. Sans doute, Lacan a-t-il commencé par ordonner l'expérience analytique au champ de l'Autre, mais pour démontrer ensuite qu'en définitive cet Autre n'existe pas, pas plus que n'existe la santé mentale. Ce qui existe, c'est l'Un-tout-seul.
Un-tout-seul, une psychanalyse commence par-là. Quand on n'a plus d'autre recours que de s'avouer exilé, déplacé, mal à l'aise, en déséquilibre au sein du discours de l'Autre. Et c'est pour chercher dans l'analyse un Autre autre, un Autre qu'on a le loisir d'inventer à sa mesure, un Autre supposé savoir ce qui tracasse l'Un-tout-seul. Mais, nous le savons, cet Autre est destiné à se dissiper, à s'évanouir jusqu'à ce que demeure l'Un-tout-seul, une fois qu'il est instruit de ce qui le tracasse, qu'il est éclairé, comme nous disons, sur le sens de ses symptômes. Dirais-je alors qu'au terme de l'expérience analytique, je ne suis plus dupe de mon inconscient et de ses artifices ?
C'est que le symptôme, une fois délesté de son sens, n'en continue pas moins d'exister, mais sous une forme qui n'a plus de sens. Je m'avancerai plus avant dans l'ironie où je me suis engagé, en disant que c'est là la seule santé mentale que je suis capable d'acquérir. Elle suppose précisément que j'atteigne au champ d'où le mental s'est évanoui, pour laisser dénudé le réel.
Le franchissement du mental
Pour atteindre à ce champ que je dis, à ce champ ultime, il faut avoir franchi l'imaginaire, le mental de l'imaginaire, qui est toujours conditionné par la perception de la forme du semblable. Le mental de l'imaginaire est l'unité mentale fondamentale, l'unité fonda-mentale — ce mot d'esprit ne passe pas à travers toutes les langues — que Lacan illustre avec le stade du miroir. L'âme, pour Aristote, était l'unité supposée des fonctions du corps. Ce que nous traduisons, à partir de l'expérience du miroir, comme une âme spéculaire parcourue d'une tension essentielle où s'échangent incessamment les places du maître et de l'esclave. C'est dans ce stade du miroir que s'enracinent la prévalence du discours du maître et sa paranoïa foncière, qui fait de l'ego une instance grosse de délire que ne saurait réduire aucune rectification autoritaire.
Pour atteindre à ce champ, que je dis champ ultime, il faut encore franchir le symbolique et le mental du symbolique. Le mental du symbolique, c'est la réfraction du signifiant dans l'âme spéculaire. Cette réfraction, c'est ce qu'on appelle le signifié. Celui-ci est essentiellement fuyant, nuageux, indéterminé, métonymique, et susceptible sans doute de donner lieu à des métaphores, à des effets de signification. On peut même, ce signifié, l'appeler la pensée.
Votre pensée, la mienne ont leur routine : elles tournent en rond. On refoule la pensée et elle fait retour. On dit que c'est l'inconscient quand on la déchiffre et on dit que, dans le déchiffrage, on atteint une vérité. Mais attention la vérité, c'est toujours du sens, c'est-à-dire du mental, des idées que l'on se fait. Lacan a uni d'un lien essentiel la vérité au mensonge. Le champ ultime que je dis est au-delà du mensonge du mental. Là où se découvre la partie la plus opaque de ce que Freud nommait la libido.
La libido a un sens qui est essentiellement inconscient. Ce sens de la libido, c’est le désir. Le désir est articulé au symbolique ; il se déprend des signifiants comme étant leur signifié. Il affole l'âme spéculaire, il anime les symptômes. Mais, dans l'analyse, le désir connaît une déflation, il se dégonfle, s'étale comme ce semblant qu'on appelle le phallus et qui sert à penser le rapport entre les sexes. Le désir, comme le rapport sexuel, ne sont que vérité menteuse, mensonge du mental.
Le corps ne parle pas, il sert à parler
Sous le désir, une fois traversé son écran fantasmatique, il y a ce qui ne ment pas et qui n'est pas une vérité. C'est ce que nous appelons — le terme a été rappelé — la jouissance. Le désir est le sens et le semblant de la libido, son mensonge mental. La jouissance est ce qui, de la libido, est le réel. Elle est le produit d'une rencontre hasardeuse du corps et du signifiant. Cette rencontre mortifie le corps, mais elle en détache aussi une parcelle de chair dont la palpitation anime tout l'univers mental. L'univers mental ne fait que réfracter indéfiniment la chair palpitante sous les guises les plus carnavalesques, et il la dilate jusqu'à lui donner la forme articulée de cette fiction majeure que nous appelons le champ de l'Autre.
Cette rencontre s'avère marquer le corps d'une trace inoubliable. C'est ce que nous appelons l'événement de corps. Cet événement est un avènement de jouissance qui, jamais, ne revient à zéro. Pour se faire à cette jouissance-là, il faut du temps dans l'analyse. Il faut du temps, surtout, pour s'y faire sans la béquille, l'écran, les artifices de l'inconscient symbolique et de ses interprétations. Ici, nous disons qu'il s'agit de l'inconscient réel, celui qui ne se déchiffre pas, mais qui, au contraire, motive le chiffrage symbolique de l'inconscient. Le corps ne parle pas, il jouit en silence, dans ce silence que Freud décernait aux pulsions. Mais c'est avec ce corps que l'on parle, à partir de cette jouissance une fois pour toutes fixée. L'homme parle avec son corps. Lacan le dit : il parlêtre de nature.
Eh bien, ce corps qui ne parle pas, mais qui sert à parler — ce corps, moyen de la parole —, voilà ce qui en toute rigueur fait couple avec la santé mentale qui n'existe pas. Si la santé mentale n'existe pas, c'est parce que le corps jouissant, la chair exclut le mental en même temps qu'elle le conditionne, l'affole et l'égare. Si l'homme a inventé le rapport sexuel, c'est pour voiler l'horreur de cette chair parcourue d'un frémissement qui ne cesse pas et qui est, comme disait Angélus Silésius, « sans pourquoi »[5].
Ce « parler avec son corps », chaque symptôme, chaque événement de corps le trahit, le traduit. Ce parler avec son corps est à l'horizon de toute interprétation comme de toute résolution des problèmes du désir. Nous le savons, les problèmes du désir peuvent être mis en équation, nous le savons depuis que Lacan s'est évertué à le faire. Et cette équation sans doute a des solutions, c'est ce que Lacan a appelé la passe.
Mais la jouissance au niveau de l'inconscient réel ne saurait être mise en équation et elle demeure insoluble. Freud l'a su, avant que Lacan ne l'admette. Avec les symptômes, il y a toujours du reste. Aussi n'y a-t-il pas pour une analyse de fin absolue. L'analyse dure tant que l'insoluble reste impossible à supporter. Elle s'achève quand l'homme s'en satisfait tel quel.
Voilà donc, ce qu'en me torturant la cervelle, j'ai tiré d'une réflexion sur l'inexistence de la santé mentale. Ce qui à proprement parler fait couple avec l'inexistence de la santé mentale, c'est « parler avec son corps ». Il est possible que ce soit trop difficile pour PIPOL 6. Si c'est le cas, vous aurez l'occasion de le dire. Et ne craignez rien, nous trouverons alors autre chose !
Texte non relu par l’auteur
[1]. Lacan J., Le Séminaire, livre XIII, « L’objet de la psychanalyse », leçons des 11, 18, 25 mai 1966, inédit.
[2]. Foucault M., Les mots et les choses, Paris, Gallimard, 1966.
[3]. Tarrizo D., dans ce même numéro, pp. 105-124.
[4]. Freud S., Malaise dans la civilisation, Paris, PUF, 1971.
[5]. Silésius A., Le Pèlerin chérubinique, Paris, Cerf I Albin Michel, 1994.