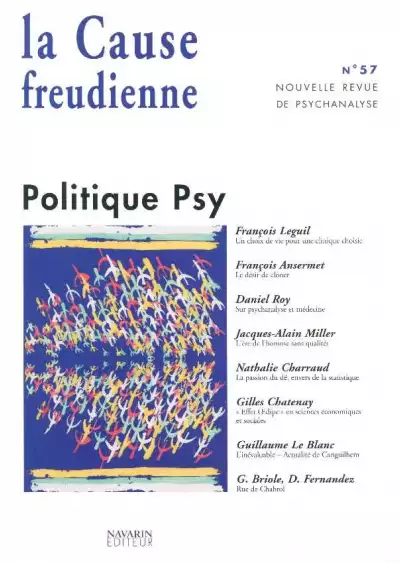-
L’ère de l’homme sans qualités
Jacques-Alain Miller
Invectives
Je vais commencer par une lecture qui m’a amusé pendant ces vacances*. C’est une lettre de Pétrarque qui s’appelle « Invectives contre un médecin »[1], et cela commence ainsi. « Qui que tu sois, toi qui as réveillé ma plume endormie et tiré le lion de son sommeil, osons le dire, par tes fâcheux aboiements, tu vas rapidement t’apercevoir que déchiqueter la renommée d’autrui, parce que la langue te démange, est une chose, mais que savoir défendre la sienne en est une autre! [...] Mais puisque tu me contrains à ce que je n’aurais jamais condescendu à faire de ma propre initiative, puisqu’il faut que je dise quelque chose, je répondrai donc à certains de tes propos, en demandant pardon à mon lecteur, s’il m’arrive d’employer un ton contraire à mes habitudes. Car tu débites un si grand nombre d’imbécillités que celui qui les jugerait dignes de répondre pourrait passer sans peine pour un plus grand imbécile. »
Le contexte de la lettre de Pétrarque a tout à fait son intérêt : cela se joue autour du pape. Il se trouve qu’« en septembre 1351 Clément VI tomba gravement malade. Le poète lui transmit alors un message oral par l’intermédiaire de l’un de ses proches : il devait éviter de se confier à plusieurs médecins et n’en choisir qu’un seul. Le pape demanda à Pétrarque de lui écrire ses recommandations, feignant de ne pas les avoir comprises probablement pour susciter la polémique et offrir un divertissement à la cour papale. Pétrarque lui envoya donc la Fam., V, 19 en date du 15 mars 1352, violente critique de la médecine et de ceux qui la pratiquaient. »[2]
Cette lettre familière nous donne une idée de la relation au quatorzième siècle entre la médecine et la société au témoignage du non seulement poète mais aussi penseur qu’est Pétrarque.
« Je sais que ton lit est assailli par les médecins ; voilà la première raison que j’ai d’être inquiet. C’est à dessein qu’ils sont en désaccord entre eux, car ils ont honte d’avoir l’air de suivre les traces d’un autre s’ils n’apportent rien de nouveau. Il est hors de doute, comme l’affirme Pline avec élégance, que tous ces individus guettant la gloire par n’importe quelle nouveauté trafiquent avec désinvolture sur nos existences... que la médecine est le seul art où l’on accorde aussitôt sa confiance au premier venu se prétendant médecin, alors que l’imposture y est plus redoutable que partout ailleurs. » C’est l’époque charlatanesque de la médecine, qui explique, par des raisons de structure extrêmement profondes, l’émotion qui semble saisir le médecin aujourd’hui, à l’idée que des charlatans soignent, puisque l’accusation de charlatanerie à l’endroit des médecins est multiséculaire.
« Les médecins s’instruisent à nos risques et périls, poursuivent leurs expériences grâce à des morts ; seul le médecin jouit d’une impunité totale s’il commet un homicide. Considère, Père très Clément, la troupe de ces créatures comme une armée d’ennemis. Souviens-toi en guise d’avertissement de la courte épitaphe que ce célèbre malheureux avait ordonné de graver sur son tombeau : “J’ai péri, victime d’une armée de médecins”. Mais comme nous n’osons plus vivre sans médecins, sans lesquels pourtant, d’innombrables nations vivent sans doute mieux et en meilleure santé, choisis-en un parmi eux qui se distingue non par sa science mais par sa droiture. » L’éthique, la déontologie... « À présent, ils oublient leur profession. [...] Pour conclure : évite le médecin qui brille par son éloquence et non par son diagnostic, tiens-le pour un homme qui veut attenter à ta vie, un assassin, un empoisonneur! »[3]
Pétrarque signale ce désir d’originalité chez les médecins qui s’appliquent à être en désaccord pour faire valoir leur innovation. C’est évidemment tout à fait le contraire qui a saisi la médecine devenue scientifique mettant au premier plan l’accord des praticiens entre eux. Ce qui est venu à dominer et anime le mouvement actuel qui gagne le secteur dit de la santé mentale. C’est sans doute le noyau dur de ce qui fait cette discipline nouvelle à laquelle nous avons affaire: l’épidémiologie en santé mentale.
I - L’homme quantitatif
1. L’invincible Un
L’enregistrement
La polémique est nécessaire, il ne faut pas l’abandonner dans les lieux qui conviennent, mais essayons de comprendre, conformément à la parole de Spinoza : « Ne pas se lamenter, ne pas se réjouir, sed intelligere. » Comprendre ce qui a lieu, comprendre le phénomène dont nous sommes nous-mêmes partie prenante, ne serait-ce qu’au titre de nous y opposer, c’est ce que je voudrais faire. Ces périodes troublées, agitées, sont très activatrices des neurones. Il y a une archéologie à faire.
L’enregistrement, auquel semble se rallier comme un seul homme la majorité du Sénat de la République – ce n’est pas fait encore –, s’inscrit clairement dans le même contexte que celui de l’idéologie de l’évaluation. Comme elle, l’enregistrement met devant les yeux le « devenir unité comptable » du sujet. Il y a un « devenir unité comptable » qui va bien au-delà de M. Mattei, du groupe UMP du Sénat, et autres éminentes personnalités. Devenir unité comptable et comparable, c’est la traduction effective de la domination contemporaine du signifiant-maître sous sa forme la plus pure, la plus stupide : le chiffre 1.
Cet écrivain prophétique qu’est Robert Musil l’a fort bien aperçu, quand la profonde réflexion qu’il a menée sur la pensée statistique l’a conduit à intituler son grand roman L’Homme sans qualités [4]. L’homme sans qualités est celui dont le destin est de ne plus avoir aucune autre qualité que d’être marqué du 1 et, à ce titre, de pouvoir entrer dans la quantité. Le secret du titre de Musil est que l’homme sans qualités est l’homme quantitatif.
Nous n’avons pas besoin de défiler pour chanter « Nous sommes tous des hommes quantitatifs », nous sommes tous quantifiables et quantifiés. Cela peut ne pas nous plaire, mais le mode actuel, le mode contemporain de gestion de la société passe par la quantification, la faisant même régner de façon exclusive, puisque le discours universel n’a plus d’autres qualités, d’autres identifications à nous proposer qui surclassent le 1 du rangement, le 1 qui nous rend comptables et comparables.
Lacan nous l’a annoncé: le signifiant-maître est le signifiant du maître, mais le maître et l’esclave sont des catégories qui ont disparu du discours juridique, et ne sont plus que des souvenirs. Pourquoi, me dit-on, les psychothérapeutes ne s’enregistreraient-ils pas dans les préfectures, puisque les chiropracteurs le font bien, les VRP, les cartomanciennes, et récemment – discrètement – les psychologues ? Il s’impose à tout le monde d’être enregistré à la préfecture. C’est le devenir préfecture de l’État.
De la même façon que, dans le devenir unité comptable, se dégage l’essence du signifiant-maître qui était auparavant revêtu d’atours splendides, l’État dénudé révèle ce qui est sa matrice, comme le disait Hegel, comme l’a repris Lacan : la police. De la même façon que le signifiant-maître révèle son essence dans le chiffre 1, l’État, en nous dirigeant en rangs serrés vers les préfectures, nous indique ce qui fait, ce qui est, le support, le pivot de sa structure. On en excepte les médecins et les psychologues, qui sont déjà enregistrés d’une certaine façon, et l’on étendra cela volontiers aux psychanalystes dont les noms figureront sur des annuaires d’associations analytiques. Comment les reconnaîtra-t-on ? Comment les définira-t-on ? Voyez les décrets d’application, qui peuvent être n’importe quoi.
Le signifiant-maître comme unité comptable est à la fois le plus stupide des signifiants-maîtres qui aient paru sur la scène de l’Histoire, le moins poétique, mais c’est aussi – reconnaissons-le – le plus élaboré, puisqu’il est justement nettoyé de toute signification. Il conduit à ce qui est apparemment une nécessité des sociétés contemporaines qui est l’établissement des listes. Lacan l’avait signalé pour « l’âne-à-liste » – de ce jeu de mots vient le nom d’un journal que j’ai récemment fait reparaître –, mais c’est la société, l’État, qui est cet « âne-à-liste ». Il lui faut des listes, il lui faut nous mettre en listes : passagers d’avion ou cartomanciennes, psychothérapeutes, c’est le même principe. Cela ne fait que commencer et va marquer – prenons-en le pari pour ce que nous en connaîtrons – le XXIe siècle, qui sera le siècle des listes.
C’est peut-être même beaucoup plus profond que ce que l’on dénonce sous le terme de marchandisation. On parle du règne de l’argent, auquel on oppose les valeurs spirituelles, humanistes. L’argent, l’équivalent symbolique universel, n’est qu’une forme, une réalisation du signifiant-maître comptable. Comment vous évaluer lorsque les qualités ont disparu ? Il ne reste que l’évaluation quantitative monétaire. Ce n’est pas que le commercial domine. Il ne domine pas du tout. Ce qui domine, c’est cette spiritualisation du signifiant-maître qui s’incarne dans le chiffre 1, dont il faut rendre compte de l’apparition. Lacan s’y efforçait, difficilement, dans son Séminaire XX. Comment le signifiant un est-il advenu ? Il se posait la question, parce que nous pouvons maintenant saisir qu’il anticipait que ce signifiant un viendrait à gouverner le sujet, et que l’agrégat social, le lien social serait gouverné par le un. C’est donc un produit extrêmement élaboré.
C’est ce règne de la quantité qui se traduit par l’évaluation financière. Le processus le plus profond, c’est la réduction du signifiant-maître à l’os du un, à des finalités, qu’il faut isoler comme telles, qui sont des finalités de contrôle.
Restons à distance de l’émotion, de l’émoi. Le contrôle, la société le réclame. Il peut se faire que les chargés d’organiser cette société mettent en jeu ce contrôle d’une façon maladroite, comme dans l’affaire qui nous occupe. C’est un manque de tact que de rapprocher le mot de psychothérapie et celui de préfecture. Ceux qui le font n’ont pas de doigté – heureusement, peut-être. Cela choque. S’ils étaient plus habiles, peut-être le feraient-ils passer plus facilement. Mais, au point où je voudrais développer mes considérations aujourd’hui, c’est secondaire. La société réclame des contrôles et il y a une dynamique du contrôle. Elle réclame de savoir quels sont les ingrédients des aliments que l’on ingère. Quoi de plus légitime? Dans cette inquiétude de chacun, le désir de contrôle est déjà là.
L’écriture
Je me suis demandé d’où venait le mot de contrôle. Cela m’a permis d’apprendre que c’était un mot du quatorzième siècle. Je n’ai pas eu le temps de chercher précisément, mais je supposerais que c’est dans les milieux de la bureaucratie royale en train de se mettre en place que cela a commencé à émerger ou que c’est attesté. Contrôle vient de contrerole, le rôle étant un registre, dans un sens ancien du mot rôle. Le contrerole, c’est un registre tenu en double pour vérifier un premier registre. Vous tenez un registre, et vous avez un second registre pour vérifier le premier, c’est le contrerole. En particulier, le contrerole est l’état nominatif des personnes appartenant à un corps, en particulier à un corps militaire.
Le mot de rôle lui-même est plus ancien, du douzième siècle. Il est issu du latin médiéval rotulus, rouleau, parchemin roulé. C’est un rouleau, une feuille roulée, où l’on consignait les actes notariés, les affaires du tribunal. Dans notre expression « à tour de rôle », ce n’est pas du tout le rôle de théâtre, mais « à votre tour selon la liste du registre, selon votre place hiérarchique, quand votre tour arrive selon la liste tenue qui est un rôle ». Cela a bien sûr pris le sens des parties d’une pièce de théâtre qui correspond à un personnage ou le nom du personnage lui-même, avec toutes les expressions qui s’ensuivent : par exemple « il me laisse le beau rôle ».
Le registre, mot du treizième siècle, lui, qui vient du latin regerere, et qui a donné regestus, rapporté, inscrit. Regerere, c’est porter en arrière, reporter, transcrire, et spécialement noter pour garder le souvenir[5].
Il faut là s’apercevoir que l’on fait fausse route quand on parle de notre époque comme celle de la domination des images. Sans doute la production des images est-elle prévalente, prégnante, extrêmement multipliée, multiforme. Elles dominent par leur séduction, exercent une captation qu’essaye de manier le discours politique. Mais en fait, l’os de l’affaire reste l’écriture, sous la forme de l’enregistrement. C’est ce que dénonçait le philosophe italien Agamben récemment dans la presse[6]. Le corps lui-même, le corps contemporain, est exhibé sous des formes magnifiques, stylisé dans les images de publicité, les images cinématographiques, télévisuelles. L’image est exaltée, mais c’est l’écriture, le dépôt électronique du un par un comptable, qui est effectif. Le corps est transformé en écriture, c’est-à-dire que l’on cherche dans votre corps ce qui fait écriture. J’aurais voulu pouvoir vous épater en vous citant les propos, les recherches, la philosophie de M. Bertillon, français, celui qui a découvert que nous portions tous dans notre main une écriture indélébile, qui a trouvé en son temps une marque, un symbole, un signifiant indélébile[7]. M. Bertillon est un homme qui avait réfléchi, à la préfecture de Police, haut lieu de l’esprit. N’oublions pas que Gaëtan Gatian de Clérambault a exercé la clinique sous l’auvent de la Préfecture de Police, et Lacan aussi. On pouvait vraiment y apprendre la clinique, parce que passaient là, pour troubles de l’ordre social, les différents troubles mentaux, comme on dit aujourd’hui. Dans la foulée de M. Bertillon, on est allé plus loin, et l’on a trouvé, en particulier dans l’œil, des indices scripturaires susceptibles d’être traduits et de vous identifier de la naissance à la mort. Une aspiration qui anime toute la civilisation contemporaine depuis la révolution industrielle.
Bentham a été le premier à dire: « Il faudrait que chacun ait un chiffre qu’il conserve de la naissance à la mort, pour que l’on s’y retrouve. » Cela a donné la carte d’identité.
Je félicitai la dernière fois les Anglais d’avoir résisté à la carte d’identité et je soupçonnai M. Blair de vouloir l’introduire[8]. J’ai appris depuis que l’introduction de la carte d’identité en Grande-Bretagne était prévue pour 2007. Et c’est paraît-il le peuple le plus photographié de la terre : des caméras de surveillance sont placées dans les rues de Londres, de telle sorte que le Londonien moyen est filmé ou photographié en moyenne cinq cents fois par jour.
La société de la peur
Nous y sommes. Nous y sommes encore beaucoup plus que je ne pouvais le penser en 2003. Nous entrons, début 2004, dans le XXIe siècle, dans l’époque de la surveillance. Ce n’est pas sûr que ce soit « surveiller et punir », mais c’est une société où le mot d’ordre est « surveiller et prévenir ». Nous sommes dans l’époque de la prévention : sanitaire et aussi bien guerrière. Faire la guerre à un pays avant qu’il ne vous ait fait la guerre est dans le même esprit que de dépister la maladie mentale avant qu’elle ne se soit manifestée [9].
Les faits qui se regroupent depuis le début de ce siècle nous indiquent qu’un grand chapitre a commencé à s’écrire des grandes peurs du XXIe siècle. La peur des psychothérapeutes est une petite peur à côté. On joue à se faire peur, mais ce sont les notes qui s’organiseront ensuite en une symphonie. Ce que l’éminent sociologue allemand Ulrich Beck appelle gentiment la société du risque [10], c’est la société de la peur. Le sujet, au début du vingt-et-unième siècle, est en danger. Manger, respirer, se déplacer, se faire soigner, cela se fait sous l’égide du danger et de la précaution à prendre. On réclame, au moins en France, mais très généralement à l’État, qui n’est plus l’État-providence d’avant, l’État maternel, un État auquel on demande de se resserrer sur ses tâches propres. C’est l’idée de l’État stratège [11]. Et quelle est la tâche propre fondamentale de l’État ? La police. Donc, on réclame un État policier.
La société s’éprouve comme étant en danger. Nous entendons, sous différentes formes, un « SOS société ». C’est ce que masque, sous le nom de risque, Ulrich Beck, peut-être pour ne pas ajouter à la panique. Nous allons devenir des sociétés de la peur et de la panique. J’essaye de construire là-dessus pour que nous gardions par rapport à ça, et même lorsque nous sommes nous-mêmes les vermines à exterminer ou les inclassables à classer, un certain savoir de la configuration dans laquelle nous sommes entrés, et que telle ou telle initiative puisse dérouter ou retarder le processus.
C’est essentiel. Carl Schmidt, dont on peut dire beaucoup de mal par ailleurs, avait bien isolé dans l’histoire la fonction de ce qu’il appelait « le retardateur », celui qui arrive à retarder des processus inévitables. Quand on retarde, on gagne du temps; d’autres facteurs peuvent entrer en jeu, et ainsi le fatal peut être contourné. C’est pourquoi de savoir qu’il est inévitable que telle logique s’applique n’implique pas du tout que l’on désarme.
2. Quételet
Ironie des Lumières
C’est là que je me suis dit que je pouvais profiter de l’occasion de cette recherche archéologique dans laquelle je voulais m’engager pour vous faire connaître, parce que j’imagine qu’on ne l’apprend pas dans les classes, un grand esprit qui me paraît un des grands noms à l’origine de ce à quoi nous avons affaire avec l’homme quantitatif, et qui est Quételet.
J’ai quelque chose de commun avec Quételet. Cela m’avait d’ailleurs conduit à m’y intéresser un peu davantage. Quételet était belge – ce n’est pas mon cas –, et professeur à l’Université de Gand, seule université au monde qui, par erreur sans doute, a jugé bon, jadis, de me nommer docteur honoris causa. Dans le remerciement que j’avais apporté à l’Université de Gand, j’avais cité parmi les augustes de cette université, Quételet.
Quételet était astronome et il a eu l’idée d’appliquer les conceptions et les méthodes valables en astronomie aux sociétés humaines, dans la première moitié du XIXe siècle. Il est le plus éminent à l’origine de l’approche statistique du phénomène social, cette approche statistique qui est celle que nous propose l’épidémiologie en santé mentale. On s’aperçoit du changement de régime de pensée qui a eu lieu entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Au XVIIIe, on a accumulé, d’une façon fort distrayante – qui m’a toujours enchanté, dont je porte la marque – un nombre énorme d’informations, de descriptions des sociétés différentes des nôtres. On sent déjà ce mouvement-là présent chez Montaigne, qui va chercher ses références dans les auteurs de l’Antiquité pour montrer la diversité des coutumes et des lois humaines, mais, au XVIIIe, multiplication de récits de voyageurs, d’aventuriers, de missionnaires. On accumule toute une littérature sur la diversité humaine, la diversité des mœurs, des us et coutumes, des religions, des régimes politiques, des lois, et on commence à l’élaborer de façon éminente. Pensez à L’Esprit des lois de Montesquieu, qui se prêtait au mot d’esprit: « M. Montesquieu n’a pas fait l’esprit des lois mais de l’esprit sur les lois. » C’est très injuste, mais cela signale qu’au XVIIIe siècle, l’accumulation de ces données sur les sociétés mettait en valeur la contingence, montrait qu’il n’y avait pas de nécessité dans nos mœurs à nous, nous invitait à nous distancier de nos pratiques, et était marquée par un certain esthétisme. Dans un petit speech au théâtre Hébertot [12], j’ai dit que les philosophes du XVIIIe, ayant l’idée de l’unité de la nature humaine, ont mis au registre de la comédie humaine le fait qu’ici on s’habille comme ça et là-bas autrement, qu’ici on se gouverne de cette façon et là-bas d’une façon différente, qu’ici on mange de ça et que là-bas c’est interdit. Si l’homme est un, s’il y a une unité de la nature humaine, la diversité relève de la comédie humaine.
Au XVIIIe, l’accumulation de ces données comparatives introduisait une posture ironique, en définitive très socratique, et, on peut dire, très psychanalytique. C’était une façon de se déprendre de ces identifications et d’apprendre qu’il n’y a pas que nous, qu’il n’y a pas que cette façon de faire. Cette approche avait un effet de dissolution sur tout l’imaginaire entourant les signifiants-maîtres. Vous êtes chrétiens, mais d’autres sont musulmans, d’autres révèrent les animaux. La substance imaginaire, la chair imaginaire du signifiant-maître, au dix-huitième siècle, se desséchait et tombait en lambeaux. Ce moment si délicieux d’ironie, que j’aime répéter comme je peux, est aussi une étape dans le processus qui va vers la simplification du signifiant-maître. Le squelette apparaît : c’est le chiffre 1. L’ironie dissolvante des Lumières est un moment du processus historique qui conduit au moment présent où règne l’invincible 1.
Le réel social
L’esprit du XIXe est tout à fait différent. Ce n’est plus l’ironie, mais, si l’on veut, le progrès de l’esprit scientifique s’avançant sur ces données, cherchant et construisant des régularités. On pourrait dire que c’est parti de l’observation. Il y a des régularités qui concernent les naissances, les morts, les mariages, les crimes. Il y a des régularités sociales, des patterns, des configurations régulières, et ces régularités ont invité à chercher des lois dans l’univers social. C’est ce que Montesquieu a esquissé avec esprit, et ce que l’on a commencé à aborder par les moyens de la quantification, avec la conviction qu’il y avait un savoir inscrit dans le social, et donc que le social était un réel au même titre que le réel de la physique.
C’est là un pas plus loin que Descartes, qui réservait cette recherche du savoir mathématique inscrit dans le réel à l’univers physique, aux sciences naturelles, et à la physique mathématique. Pour ce qui était de l’ordre social et politique, son conseil était de se rallier au signifiant-maître en vigueur dans votre propre société, de ne pas commencer à faire le malin, le savant, avec le signifiant-maître. Cela restait le point de vue de Montaigne. Dieu sait si les semblants sociaux ne lui paraissaient pas nécessaires. Il savait que c’étaient des semblants. Sa morale était que la prudence veut que l’on se conforme à l’esprit de sa société en ce qui concerne l’organisation sociale. On voit Descartes, lui, s’avancer dans le discours scientifique, mais, en même temps, dans le domaine social et politique, conserver la réserve montaignienne.
Comment cette barrière a-t-elle été franchie ? Je n’ai pas tout à fait les moyens de reconstituer cette archéologie de mémoire. Il faudrait faire une place spéciale à l’économie politique, déjà au XVIIIe siècle, à l’esprit écossais. Il y a certainement des choses à trouver chez Adam Ferguson et dans l’école écossaise, mais c’est au début du XIXe siècle et à partir du moment où la révolution industrielle opère un sensationnel transfert de population de la campagne vers les villes que cela devient un impératif social que de disposer d’informations statistiques sur la population.
Marx a décrit ce déplacement de la campagne à la ville d’une façon sensationnelle, poétique. Cela a été remanié par des historiens, mais cela reste, dans ses grandes lignes, très fondé : le processus des enclosures ou closure. S’accumule dans les villes une population nouvelle, salariée, appauvrie, et qui constitue un risque social. Ce sont des immigrés de l’intérieur. Ces immigrés, que nous voyons ici avec terreur arriver des pourtours méditerranéens de l’Europe, venaient à l’époque de la campagne. Les invasions d’immigrés, c’étaient les invasions de ruraux s’accumulant dans les villes. Cela a provoqué un mouvement épistémique, le désir de disposer d’informations quantitatives sur la société et sur ce que l’on s’est mis à appeler la population.
Ah, ce mot de population ! Ce n’est pas le peuple, la population. Le peuple, que l’on a évoqué dans la Révolution française comme principe de souveraineté, c’est un signifiant-maître. La population, c’est autre chose. Ce sont des corps, qui sont là, un agrégat de corps naissant, vivant, s’accouplant et mourant, et éventuellement s’agressant les uns les autres. On voit revenir, dans tous les écrits de cette période, la naissance, la mort, le mariage, le crime. Population, c’est comme peuplade, mais sur une vaste étendue, et considérée du point de vue bio-politique. D’ailleurs, un des mots qui m’avait fait tiquer dans le discours d’une éminente épidémiologiste qui nous avait rendu visite, était l’adjectif « populationnel », très employé en effet en épidémiologie. Je lui ai dit: « Comment, on parle comme ça chez vous : “populationnel” » ? Elle m’a aussitôt répondu : « Moi, je ne parle pas comme ça, ce sont les Québécois. » Non! Le point de vue populationnel est présent dans le discours statistique depuis le début du XIXe siècle. Il n’y a pas à s’en excuser.
Statistiques
J’aurais aimé pouvoir vous citer un ouvrage du XVIIIe siècle, que j’ai bien lu, jadis, au temps de mes études, l’Essai sur le Principe de population [13] de cet éminent esprit qu’était le révérend Malthus. Il a laissé son nom au malthusianisme d’une façon bien injuste, comme le marquis de Sade a donné naissance au sadisme, et Sacher-Masoch au masochisme. J’aurais aimé pouvoir vous le citer et moi-même le relire du point de vue de ce que l’affaire actuelle m’a permis d’apercevoir.
Il y a vraiment deux tendances qui s’opposent et que Lacan nous aide à repérer. D’un côté, vous avez eu au XIXe siècle une sociologie qui a pris comme principe les normes et les institutions, les représentations collectives, comme s’imposant, bien que ce ne soit pas son vocabulaire, disons à une population donnée. C’est le point de vue d’Émile Durkheim, à qui Lacan s’est référé parce que, en effet, cela donne une représentation sociologique du grand Autre, un discours fait de croyances, d’institutions qui s’imposent et qui structurent une population. C’est dans cette direction que Lacan a été d’emblée, il a été durkheimien, au moins dans son article de l’Encyclopédie [14]. On a là une esquisse de ce qu’il développera plus tard comme étant l’ordre symbolique. Mais vous avez une autre sociologie, celle qui triomphe dans l’épidémiologie en santé mentale, qui, elle, ne part pas d’en haut, mais d’en bas. Elle ne part pas du grand Autre, mais des actions de l’individu et de la multitude bigarrée de ces actions individuelles, et elle considère au contraire que les normes et les institutions résultent de cette multitude d’actions individuelles, et donc cherche, par le calcul statistique, à isoler les régularités, et part en effet du quantitatif.
La première approche part du contenu significatif, tandis que la seconde part du quantitatif. Quételet s’avance comme astronome vers la société – les planètes ne parlent pas – et armé de la statistique et du principe de distribution des erreurs des observations dans l’astronomie. Il dit : « Je n’ai pas de théorie, je n’ai pas de système, j’observe, je note. » Ce deuxième point de vue est celui de « l’Autre n’existe pas », dans notre langage. C’est le point de vue : le grand Autre résulte de frayages continués du sujet. C’est le deuxième point de vue de Lacan, conforme au deuxième Wittgenstein, que l’on voit émerger dans le Séminaire Encore [15].
D’ailleurs, la sociologie durkheimienne, qui a toujours pris un point de vue sur le tout, fonctionnaliste, un macro point de vue, a toujours résisté à la pensée distributionnelle et probabiliste. Le point de vue de « l’Autre n’existe pas » est un point de vue micro, c’est-à-dire qui recueille des données quantitatives et qui étudie des distributions, des moyennes, et des dispersions et des déviations par rapport à la moyenne. Elle étudie des distributions et, étudiant des distributions, elle peut définir des moyennes, un spectre de dispersions, et des déviations par rapport à la moyenne, cela, sans référence à aucun contenu significatif, ni à aucun absolu. On ne dit pas : « L’homme doit avoir 1,72 m ». On ne l’impose pas. On relève la taille des mâles de tel âge et l’on dit : « La moyenne est de 1,72 m. Ceux qui n’ont pas 1,72 m sont petits et ceux qui ont plus sont grands. » C’est un des grands exemples de Quételet que d’avoir étudié la taille. C’est très fondé. Vous n’imaginez pas l’enthousiasme qui entourait les études de Quételet. L’épidémiologie en santé mentale fait exactement la même chose aujourd’hui, sauf que cela porte sur la santé mentale.
On constate tout le long de la première moitié du XIXe siècle que l’on accumule les données quantitatives. Il y a une passion pour ça, justement parce qu’il y a eu rupture et recomposition du lien social, et que cette rupture et cette recomposition du lien social se sont traduites par un danger pour la stabilité sociale, un danger pour la sécurité – et toute la première moitié du XIXe siècle est occupée par comment assurer la sécurité –, et aussi un danger sanitaire.
La littérature en porte toutes les marques. Le Bonheur dans le crime de Barbey d’Aurevilly a été écrit dans ce contexte-là. De quoi parle Stendhal dans Le Rouge et le Noir, chronique de 1830 ? Il parle d’une histoire, lue dans les journaux, d’un valet de ferme, devenu l’amant de la patronne, et l’ayant tuée. C’est ensuite la naissance du détective, Edgar Poe... Vous n’avez rien de comparable dans la littérature du XVIIIe où, au contraire, quand il y a des crimes, ce sont des petits délits amusants, ou des petits empoisonnements distrayants et esthétiques. Tout devient noir à partir du XIXe, parce que nous sommes dans ce contexte de criminalité.
Je n’ai pas retrouvé non plus dans mes livres la grande référence historienne là-dessus, le livre de Louis Chevalier, paru en 1955, Classes laborieuses et Classes dangereuses [16], qui donne le panorama de l’époque. J’en parlerai à partir de mes notes de mon concours d’agrégation. Il explique que cette période du début du XIXe est marquée par la volonté de tout quantifier, tout mesurer, tout savoir, sous le fouet du danger. Nous en sommes là. Nous revivons le début du XIXe avec les moyens du XXIe . J’avais des drôles de lectures à l’époque, ayant plus de temps pour lire. Je faisais référence au docteur Parent-Duchâtelet, un médecin français, qui a en particulier consacré en 1836 un ouvrage très savant, De la prostitution dans la ville de Paris... [17], où il fait des statistiques sur les prostituées parisiennes. C’est un ouvrage de référence pour la statistique.
En Angleterre, passons sur le rôle éminent qu’ont joué les utilitaristes, les élèves de Bentham, et la création, en 1857, par lord Brougham, un benthamien éminent, de l’Association de Sciences sociales. C’est l’époque où se créent les sociétés statistiques – Quételet est encore un chercheur individuel –, on fait des équipes pour réunir les données et les traiter. Et, en France, on commence à publier tous les ans des recueils de chiffres statistiques. Tous les ans, à partir de 1827, vont sortir les données quantitatives sur les crimes commis, ceux qui sont élucidés, les punitions dont les criminels ont été frappés. Cela laisse de l’espoir. Cette mode a battu son plein dans la première moitié du XIXe et cela a un peu décru dans la seconde moitié, mais c’est resté présent.
Avant Quételet, des études avaient déjà observé les régularités statistiques dans les variables démographiques, en particulier concernant la mortalité et le sex ratio à la naissance, qu’évoque Lacan dans « L’étourdit » [18]. On étudie le nombre comparé des filles et des garçons à la naissance. On s’est mis à traiter tous les domaines de la vie sociale de cette façon-là: le crime, le suicide, les naissances adultérines, la fréquentation des églises, la fréquentation de l’école, la pauvreté, même les donations philanthropiques. On s’est mis à noter tout cela et à faire des comparaisons. Il y a un ouvrage de 1833 sur la criminalité qui s’intitule Essai sur la statistique morale de la France [19].
L’homme moyen
Quételet, lui, qui a écrit un ouvrage qui s’appelle Le Système social, avait l’idée qu’il allait fonder une science nouvelle de physique sociale. Il a promu ce qui, à mon avis, reste toujours le principe de l’épidémiologie en santé mentale : la théorie de l’homme moyen. Il s’est aperçu, en étudiant les chiffres sur la taille des recrues militaires, que la taille des recrues obéissait à une courbe de Gauss, et que les erreurs d’observation obéissaient à la distribution normale des erreurs de mesure en astronomie. Avec ces données sensationnelles, vraiment intelligentes, il a posé les principes d’une sorte d’astronomie sociale.
De la même façon que l’on a reconnu l’existence, pour le déplacement des corps célestes, entre guillemets « d’une force de gravitation », c’est-à-dire d’une formule mathématique à quoi obéit leur orbite, on doit en même temps réserver la place d’une multitude de petites forces de perturbation qui font que l’on ne rencontre jamais exactement à sa place mathématique le corps céleste. Il y a toujours une légère perturbation, les observations astronomiques ont toujours quelque chose de hasardeux. On va chercher dans une zone du ciel à partir des calculs, et puis, c’est toujours un petit peu à côté.
« Mon » Quételet a posé que, dans l’univers social et moral des représentations de l’individu, il y a l’équivalent de la gravitation, et c’est ce qu’il appelait « le penchant ». Des penchants qui obligent à une distribution normale en courbe de Gauss. Il distingue le penchant au crime, le penchant au suicide, ou le penchant au mariage. Il repère par exemple que le taux de crime est plus élevé chez les mâles de vingt à vingt-neuf ans. Ils sont au top niveau pour le crime ! Il y a de la même façon des âges où se font les mariages. Il conclut que l’on peut trouver dans l’univers moral du comportement de l’individu les mêmes lois que celles de la mécanique céleste, et qu’il faut tenir compte à ce moment-là des petites forces de perturbation qui font que le calcul n’est jamais tout à fait exact et qu’il y a toujours un décalage.
Ces penchants sont pour lui des formes de l’instinct et, par rapport à ça, la volonté humaine lui paraît, dans l’ordre normal, d’intensité zéro. C’est une force peu utilisée et elle n’intervient que comme une de ces minimes forces de perturbation par rapport à la régularité orbitale des penchants. Ce qui lui paraît donc la base de la stabilité de l’ordre social, c’est l’homme moyen, ce sont les propriétés statistiques qui sont stables des principales actions humaines, du mariage et du crime.
Cela a été amplement critiqué. Un présociologue allemand, Drobisch, dans La statistique morale[20], a critiqué l’homme moyen comme une fiction mathématique abstraite. Max Weber aussi se réfère à Quételet et critique cette volonté de donner une analyse astronomique des événements de la vie, mais c’est surtout Durkheim qui, à la fois, se réfère à Quételet et, en même temps, lui oppose un autre point de vue qui est l’extériorité de l’ordre social aux individus, alors que Quételet le trouve dans les régularités des actions humaines.
La célèbre étude de Durkheim sur le suicide s’inscrit dans cette polémique [21]. Il fait une analyse beaucoup plus fine que l’approche globale quantitative de Quételet, puisqu’il distingue les taux de suicide selon des qualités très fines : selon les groupes religieux, le sexe, la profession, l’âge, et selon le statut marital. Mais la pointe et la motivation de l’étude fameuse de Durkheim sur le suicide s’inscrit dans ce contexte de Quételet. C’est une polémique avec Quételet, avec ce point de vue astronomique. Durkheim et Quételet sont d’accord sur beaucoup de choses. Ce sont des déterministes et donc ils posent que, dans l’univers social, rien ne se produit au hasard et que la société est régie par des lois. Et même, Durkheim admet que l’on peut définir le normal et le pathologique sans idéal : le normal c’est la moyenne, le pathologique c’est la déviation par rapport à la moyenne. Ce point de vue est très laïque, parce que cela conduit à dire que le crime est normal. Il y a une régularité du crime, ce qui est anormal, c’est quand il y en a un peu trop ou pas assez. Quand il n’y en a pas assez, ça manque d’énergie. C’est ce que disait un Stendhal. Quand les Italiens étaient dans les régimes des principautés, ils se poignardaient gaillardement, ensuite est arrivée la démocratie, et ils ont perdu toute flamme. C’est un point de vue extrêmement laïque, mais qui est la dictature de la moyenne.
Avant de venir ici, pour agir sur la moyenne du sénateur UMP, j’ai appelé mon ami François Ewald pour lui signaler l’état désastreux de notre campagne parlementaire. Il m’a promis de faire l’impossible. Ensuite, je lui ai dit: « Dépêchons-nous de finir, parce que je vais parler un petit peu de Quételet. » Nous sommes tombés d’accord sur la grandeur de Quételet. Et il m’a dit: « L’idée de Quételet revient à installer un jugement perpétuel de la société par elle-même. » Cela m’a paru très juste. En effet, la moyenne est un idéal secrété par la statistique quantitative elle-même. Cela ne vient d’aucune prescription, d’aucun commandement, ce sont les chiffres eux-mêmes qui vous donnent un idéal, celui de la norme, distinct de celui de la loi. La loi garde toujours son ancrage dans un grand Autre. C’est la loi divine, la loi de l’État, qui à un moment s’impose d’au-dessus, de l’extérieur. Alors que la moyenne – c’est beaucoup plus doux, c’est invisible – vient de vous, de la combinaison de vos décisions individuelles, ou de vos propriétés individuelles, et puis cela se dégage insensiblement et l’on ne peut pas s’y opposer. Dans cette petite discussion, François Ewald me disait: « Ce qui faisait peur à Michel Foucault dans le règne de la norme, c’est que la norme n’a pas d’extérieur. » C’est congruent avec ce que j’évoquai la dernière fois [22] : on peut se rebeller contre la loi – c’est ce que nous faisons –, on ne le peut pas contre la moyenne, contre la dictature de la norme.
Isoler cette référence à la norme nous permet de voir que, même si elle se dégage de la statistique, décider de se conformer à la norme, de faire de la norme la loi, est un choix politique. C’est là que nous pouvons opposer quelque chose à nos statisticiens en santé mentale, qui peut être le vecteur d’une intervention proprement politique : faire de la norme la loi et pourchasser tous les déviants par rapport à la norme est un facteur de stagnation. Cela s’oppose précisément à ce qui serait l’ambition de certains, l’innovation. Pour préserver l’innovation d’une société, il est essentiel que la norme ne soit pas la loi. Il est après tout logique que ce soit formulé à partir du discours psychanalytique.
II - L’objet-machine
1. Événement
Hold-up
Ce cours porte bien sur la question : comment en est-on arrivé là ? Il y a comme un effet de « c’était donc encore plus vrai que nous pouvions le dire ». D’un côté, il n’y a rien dans ce qui se passe pour nous surprendre puisque c’est annoncé de toutes les façons possibles, et en même temps, quand cela arrive, l’événement amène avec lui, toujours, un élément qui déconcerte, qui rend perplexe. La lecture que j’ai faite d’emblée de ce qui arrivait, c’est que l’on avait médité les moyens de réduire, d’asphyxier et de faire disparaître la psychanalyse, projet qui montre au moins que l’on n’a pas pensé que l’évolution simple des choses y conduirait, qu’il fallait au moins donner un coup de pouce.
Qu’est-ce que la psychanalyse pour mériter cette entreprise? Qu’est-ce que la psychanalyse pour enrayer cette entreprise et pour apparaître, au moins aujourd’hui, pour le moment, comme un noyau de résistance à cette entreprise?
Un personnage de Balzac, qui s’appelle Vautrin, formule ce beau principe: « Il n’y a pas de principes, il n’y a que des événements ». C’est un principe d’opportunisme, dont, dit-on, le prince de Bénévent, Talleyrand, aurait été pour Balzac l’inspirateur. Nous qui avons des principes, nous constatons qu’il n’est pas simple de faire qu’ils dominent les événements. L’événement, quelle que soit sa force, quelle que soit la surprise qu’il peut amener avec lui, dès que l’on prend un peu de recul, apparaît situé dans une structure et inscrit dans un processus.
En prononçant le nom de Quételet [23], j’ai voulu mettre un nom propre – j’ai choisi celui-là, en supposant qu’il ne vous était pas familier – à l’origine du processus qui a fait naître, se répandre et dominer un nouveau type d’hommes, ceux que Robert Musil appelait « les hommes sans qualités». Dans ce que Quételet a aperçu sont entrées sa réflexion sur la statistique, sur le calcul des moyennes, et l’importance qu’il a donnée à l’émergence de la psychologie quantitative. Ce qui produit l’homme sans qualités, c’est la quantification, l’entrée de sa personne dans le calcul. Le mot de « personne » va jusqu’à ce qu’on appelle couramment le psychisme et dont le nom de psychanalyse porte pour son malheur encore la trace. C’est seulement le respect des semblants qui a fait que Lacan a conservé ce nom, qui lui paraissait un héritage de l’histoire, si peu conforme que ce nom ait été à ce que Lacan a structuré de la pratique freudienne. Il faudra peut-être un jour que l’on apprenne à s’en passer, de ce nom.
Nous assistons à un véritable hold-up [24] sur le nom de « psychothérapeute », qui n’est pas le nôtre sans doute. Mais nous voyons comment cela se passe quand, à un moment donné, la puissance de l’État, sa main, peut s’abattre sur un signifiant et décider de lui donner un nouveau sens, un nouvel usage et de nouveaux agents. Quelles que soient les différences fines que nous pouvons faire entre psychanalyse et psychothérapie [25], ces deux mots portent le stigmate du psychisme. On a touché à ça, à une zone qui, après les psychiatres et les psychologues, s’est trouvée pendant un temps une zone, sinon protégée, plutôt pas protégée, c’est-à-dire protégée de trop d’intérêts qu’on lui porte. Il faut une obtusion particulière pour que des collègues aient formulé, si l’on en croit une dépêche de l’AFP de ce matin, qu’ils étaient rassurés [26]. Tout au contraire, il faut se demander combien de temps le nom de « psychanalyste » ne sera pas protégé, combien de temps ces protecteurs à venir le laisseront d’un libre usage, dont on peut constater à quel point il a été, dans l’ensemble, dans la moyenne, assuré par des agents qui, tout indignes qu’ils aient été des idéaux freudiens, assuraient vaille que vaille la fonction. Nous sommes entrés dans un moment où nous avons à nous poser la question de comment nous serons amenés à nous appeler, peut-être, un jour, pour continuer de faire ce que nous voulons.
La mort de l’absolu
L’entrée de la personne dans la quantification se traduit par ce que Musil appelait un « désenchantement ». C’est au cours d’un épisode de son grand roman où son héros Ulrich se trouve conduit – Ulrich qui croit à la science, qui a médité la statistique – au poste de police. Comme le dit Musil, de façon exquise : « Il demeura capable d’apprécier, même en cet instant, le désenchantement que la statistique faisait subir à sa personne, et la méthode de signalement et de mensuration que le policier lui appliquait l’enthousiasma comme un poème d’amour inventé par Satan. » Ulrich est ravi de constater que « l’opérateur dissèque sa personne en éléments insignifiants, dérisoires », et puis, à partir de ces éléments peut le recomposer et « le rendre à nouveau distinct des autres et le reconnaître à ces traits ». Cette opération ici policière, c’est l’opération scientifique décomposée en éléments insignifiants. C’est bien ce à quoi, sur le langage, la linguistique a procédé aussi bien, et l’on est conduit à distinguer le signifiant et le signifié conformément à l’orientation stoïcienne. Cette décomposition, élémentaire quand elle s’effectue sur les grands nombres, a pour effet une évaporation de ce que, des siècles durant, on a appelé la liberté.
C’est là que s’inscrit, que s’impose, ce que l’on pourrait appeler la loi de Quételet, à l’ombre de quoi Musil écrit son propre poème romanesque. « Plus le nombre des individus est grand, dit Quételet, plus la volonté individuelle s’efface et laisse prédominer la série des faits généraux qui dépendent des causes d’après lesquelles croît, existe et se conserve la société. » C’est ici la constatation, courante, que vous prenez individuellement la décision qui vous convient concernant vos vacances, et que la SNCF est en mesure de calculer grosso modo le nombre de voyageurs qui montera dans ses trains, et d’ajouter des wagons supplémentaires s’il y a lieu. Le fait de ces calculs qui nous environnent rend l’individu infime et lui prescrit un nouveau type de destin qui était inconnu des Grecs, le destin statistique, qui pèse sur l’écriture de Musil, avec comme effet de faire s’évaporer l’unique et de le remplacer par le typique. C’est, chez Musil, comme on le sent monter au cours du vingtième siècle, « l’étonnement, le ravage, la déploration de filiation romantique des intellectuels, des écrivains, des artistes, devant ce qui émerge comme l’homme des masses », disait Ortega y Gasset. Musil écrit que l’influence croissante des masses, du grand nombre, rend l’humanité toujours plus moyenne. Il y a un accroissement spécifique de la civilisation, de ce qui est moyen. J’emploie le mot de civilisation en écho au titre de Freud, et sans qu’il soit question ici de refoulement. Une montée en puissance des valeurs moyennes, des valeurs médianes s’accomplit irrésistiblement, et nous allons vivre le triomphe des valeurs médianes. C’est une version de la mort de l’absolu, le remplacement de l’absolu par la moyenne, c’est-à-dire par le calcul statistique, de telle sorte que Musil peut parler du vrai comme supplanté par le probable.
L’incomparable
Voilà le cadre, le contexte que nous n’avions pas isolé et dans lequel la psychanalyse a surgi. Lacan disait que la condition de l’événement-Freud était la reine Victoria. C’est une façon imagée, emblématique de signaler qu’il avait fallu une recrudescence sociale du refoulement pour que se produise ce qui, dans ce contexte, doit s’appeler une libération de la parole. On l’observe chez les patientes de Freud, elles trouvent en Freud, et elles le forment à l’être, un interlocuteur, un auditeur pour ce qu’elles ne peuvent pas dire ailleurs. Docile à leur désir de dire, Freud s’est petit à petit conformé à ce qui pour nous, de façon plus désenchantée, est la position de l’analyste, position où ce qui est refoulé peut venir à se dire autrement que par le pur et simple retour du refoulé, peut venir à se dire de façon à se dénouer. Freud prévoyait que les sociétés victoriennes s’effriteraient et que la psychanalyse y serait pour quelque chose. Il anticipait, dans son fameux texte de 1910 [27] que j’ai déjà commenté, une Aufklärung sociale, le triomphe des Lumières dans la société, qui ferait que ce qui ne pouvait pas se dire, s’exhiber, se massifier, dans des régimes victoriens, trouverait à se frayer la voie.
Beaucoup est accompli dans ce sens dans les sociétés où nous vivons. C’est pourquoi je suggère que ce n’est pas seulement en rapport avec la reine Victoria que la psychanalyse a été possible ou qu’elle s’est trouvée nécessaire, mais que c’est à cause de Quételet, moins spectaculaire, sans doute, que la reine Victoria. La psychanalyse est apparue à l’époque de l’homme sans qualités, et nous ne sommes pas sortis de cette époque. Nous y entrons plus que jamais, décidément. Aucune Aufklärung ne nous en protège, puisque le règne du calcul, s’avancer avec chiffres et mesures dans le domaine du psychisme, peut aussi bien se recommander de l’esprit des Lumières. Pas de préjugés !
C’est sans doute parce que la pression du grand nombre, l’émergence de l’homme sans qualités, s’est trouvée insupportable que la psychanalyse a pris en charge la clinique, l’art du un par un. Elle a pris en charge non pas le un par un de l’énumération, mais la restitution de l’unique dans sa singularité, dans l’incomparable. C’est la valeur prophétique, poétique, de la recommandation technique de Freud, d’écouter chaque patient comme si c’était la première fois, en oubliant l’expérience acquise, c’est-à-dire sans le comparer et sans penser qu’aucun mot venant de sa bouche est du même usage que celui d’un autre, et même pas soi-même, et donc de s’installer dans l’expérience analytique dans l’étrangeté de l’unique.
Cela me paraît assez convaincant. Il y a en effet un jeu, une corrélation, une compensation entre la domination croissante de la statistique et cet art singulier qui a connu pendant un temps une expansion universelle dans les sociétés qui pratiquaient ce calcul des grands nombres. Un Bion a poussé les choses jusqu’à dire: « Oubliez tout du même patient. Que chaque séance soit comme une première fois, soit une émergence. » En même temps, c’est bien la même époque, celle de Freud ou de Quételet, celle de l’homme sans qualités, puisque la psychanalyse ne fonctionne que sur le fondement du déterminisme le plus échevelé. Ce que Lacan a cristallisé dans le signifiant du sujet supposé savoir.
L’association libre, la méthode qui consiste à partir de n’importe quel énoncé comme au hasard, n’est pensable que parce qu’il y a à l’horizon la notion qu’il s’agit d’une association déterminée. Donc, il s’accomplit aussi bien dans l’opération analytique la même volatilisation de la liberté individuelle que dans le calcul statistique. L’association libre apparaît strictement conditionnée. Du côté de l’analyste – c’est là que Lacan voyait le fondement même de la certitude de l’analyste –, il s’agit de repérer, démontrer des régularités dans l’énoncé hasardeux, Lacan disait « comme de prime-saut » de l’analysant. Ce sont non seulement les lois de la parole qui seraient là en question, les lois du signifiant, mais bien des lois internes au discours du patient, et qui permettent de dégager des constantes et les lois propres de son discours.
2. La pratique du questionnaire
Cases à cocher
Pour continuer à repérer ces éléments qui s’ordonnent de l’époque, on peut mettre en corrélation avec la méthode de l’association libre cette pratique que nous ne connaissons encore sans doute qu’à son début, qui est en train de se répandre, d’atteindre jusqu’aux entours de notre acte, celle du questionnaire. C’est peut-être encore un peu lointain pour nous, mais la génération qui arrive y sera formée. Je l’ai appris dans l’effarement, dans les tout derniers jours de l’an 2003, le 29 décembre, en lisant la circulaire diffusée par le Bulletin officiel de l’Éducation nationale le 11 décembre. Cela m’a été apporté par Gabriel, comme l’Ange Gabriel, Gabriel Chantelauze, que la décision était prise, entre le ministère de l’Éducation nationale et celui de la Santé, de faire remplir à partir de la rentrée prochaine aux enfants de troisième des questionnaires de santé mentale. Ce n’est pas l’œuvre d’un impulsif, c’est médité, fondé dans la pensée de l’administration.
En écoutant, en observant le débat qui a eu lieu au Sénat ce lundi, j’ai été heureux d’entendre résonner dans l’hémicycle, ce boyau de la démocratie, une voix, celle de M. Jean-Pierre Sueur, sénateur et agrégé de grammaire, qui a interpellé ce qu’il a pu à propos de ce que pouvait avoir d’exorbitant cette décision [28]. Si cela se fait, les générations montantes seront formées dès leur plus jeune âge à penser, à se penser, en termes de questionnaire. Je ne peux pas préjuger du questionnaire que ce sera : « T’arrive-t-il d’être triste? » Et l’on coche la case : un peu, jamais, rarement, souvent, beaucoup, tout le temps.
La pratique du questionnaire a des fondements sans doute extrêmement complexes. Dans le tohu-bohu actuel, je n’ai pas eu le temps de remonter à la naissance du questionnaire, à la façon dont il s’est mis en forme. Cela suppose d’interroger le sujet, de lui donner la parole, de le solliciter, soit un mouvement qui est contraire à celui d’une médecine qui se passe de plus en plus du témoignage du sujet. Au moins formellement, cela a quelque chose à voir avec la psychanalyse. On lui dit : « Parle », ou plutôt: « Écris ». On l’invite à répondre, mais il est déjà alors enchâssé dans un appareil d’écriture, dans un dispositif qui fait que sa réponse sera nécessairement comparable à celle d’un autre, qu’elle soit la même, différente, dans la moyenne... On saura que 40 % des élèves sont tristes de temps en temps. Le résultat ou l’ineptie du résultat ne fait rien à l’affaire. Du seul fait que l’on place le sujet dans ce dispositif d’écriture, il est déjà destitué de ce qu’il a d’unique. S’il déchire la feuille, ne répond pas, il sera dans le pourcentage des réfractaires. Il y a là quelque chose qui n’a pas d’extérieur.
Le moment viendra peut-être où l’on brûlera les questionnaires, et l’école avec, et où l’on refusera d’imprimer les questionnaires avec les petites cases, parce qu’elles auront notre peau, les petites cases que l’on coche. Pas la nôtre, celle de ceux à venir. Voilà l’instrument dont on a vu arriver l’usage. On ne cochait pas des petites cases auparavant. On a constaté que c’était très commode pour obtenir des réponses calibrées, sans rhétorique. Cet instrument comporte que tout, dans l’existence, est affaire de plus ou de moins, et que ce plus ou moins ne vient pas dans un continuum, mais par unités discrètes. On compose une chaîne signifiante de zéros et de un, une chaîne signifiante binaire, proprement digitale. Vous entrez alors dans le calcul statistique, un calcul de moyennes. Il n’y a rien qui explique mieux la prévalence de la moyenne que la petite case vide où vous avez à marquer votre empreinte sous les espèces de la coche, cette coche que Lacan avait repérée comme préhistorique de l’animal abattu. L’animal abattu, c’est vous !
Le béhaviorisme
Parmi les fauteurs de cette ère, il faut mettre en bonne place Watson, le créateur du behaviorism, comportementalisme en français. Pendant longtemps, on n’a dit le mot qu’en anglais pour marquer que « très peu pour nous ! », mais j’ai repris les textes originaux de Watson, l’introduction de la seconde édition de son ouvrage Behaviorism [29]. Il dit en toutes lettres : « Si, en tant que psychologue, vous entendez demeurer scientifique, vous devez décrire le comportement de l’homme dans des termes qui ne sont pas différents de ceux que vous utiliseriez pour décrire » – que choisit-il de dire? – « le comportement du bœuf que vous égorgez ».
Vous voyez que, même quand je me laisse emporter, j’ai des références. Le questionnaire, qui est gros d’une chaîne signifiante, qui vous fait chaîne signifiante, est aussi l’incarnation, la matérialisation, d’un langage qui veut être univoque. D’où le soin apporté à l’établissement du questionnaire, pour qu’il soit entièrement désambiguïsé. La standardisation opère sur le langage lui-même, et l’on voit que, de façon binaire, la pratique du questionnaire s’oppose terme à terme à la pratique analytique, qui au contraire intensifie l’ambiguïté. L’art de l’analyse est que, dans le contexte de la séance analytique, chaque mot soit gros d’un multiple de significations, que l’analyste ait pour discipline de savoir qu’il ne pas sait ce que vous dites, qu’il a à apprendre votre langue à vous, votre usage unique de la langue. Cela n’est possible qu’à condition que vous-même soyez, par rapport à votre dit, dans cette position d’étrangeté. L’élaboration du questionnaire vise, à l’opposé, à constituer avec la langue courante un métalangage univoque. Toutes les questions sont là infinies, ce pourquoi il y a des éditions de questionnaires. Monsieur X critique le questionnaire de Monsieur Y, parce que la question est toujours tendancieuse, elle n’est jamais suffisamment univoque. Si la pratique du questionnaire se répand depuis le berceau, cela finira par avoir un effet de standardisation sur la langue. Pour pouvoir lui faire ce que vous voulez, il faut que vous parliez son langage à elle. Il s’agit de cela dans le questionnaire: l’opérateur vous oblige à parler son langage.
Dans l’analyse, c’est le non-savoir ce que ça veut dire qui produit l’effet de sujet supposé savoir, tandis que votre parole est rapportée à elle-même. S’il y a déterminisme, c’est un déterminisme de l’unique. Alors qu’ici le sujet n’est pas supposé, c’est le savoir en personne qui se présente. On pourrait parler de remplissage des cases, comme le rituel qu’impose le sacré du savoir, à qui vous apportez ici ce qu’il vous demande. Vous acceptez de vous réduire à une combinatoire de petites coches, et là vous devenez « l’homme sans qualités ». Toutes vos qualités passent dans les petites cases, et l’on peut vous composer à partir de ça. Il n’y a pas de meilleure représentation du sujet barré de Lacan que la petite case qu’on coche, qui n’est qu’une variable. Quand vous remplissez le questionnaire, vous confessez que vous n’êtes rien de plus qu’une variable du questionnaire. On peut discuter la référence éthologique qui a été la première référence du comportementalisme et que vous voyez par exemple dans « le bœuf qu’on égorge ». Il faudra que j’illustre un jour l’emblème du comportementalisme : the ox that you slaughter. Je ne connais de l’œuvre de Watson que ce livre, mais peut-être pourrait-on trouver le rapport qu’il avait avec la boucherie.
Il prévoit la résistance, l’indignation. Il y rétorque, d’une façon qui n’est pas antipathique, dont on voit la parenté d’époque avec Freud, que le behaviorism, comme la psychanalyse, sont de ces disciplines qui ont apporté à l’ère de l’homme sans qualités la désidéalisation. L’image est sanguinolente, mais cela participe de ce grand mouvement de désidéalisation dont la psychanalyse fait partie, et dont on a pu lui reprocher de s’écarter en sublimant le langage. Mais, dans les thérapies, le comportementalisme, le cognitivisme, et les thérapies que l’on a voulu en déduire, ce n’est pas l’animal qui est le modèle, mais bien plutôt la machine, l’objet-machine.
3. L’idéal de la santé mentale
Encombrement
On a appelé un certain nombre d’objets, parce qu’on les trouvait futiles, des gadgets. Il s’agit d’objets nés de l’industrie, qui incorporent du calcul. Le rapport que je veux mettre en évidence est le rapport du sujet à des objets qui comportent une incorporation symbolique. C’est trop peu dire. Ce sont des objets nés du symbolique. Les objets nés du symbolique, qui sont des objets construits, déduits, calculés, produits massivement, au moins de très nombreux exemplaires, c’est un nouveau genre de réel apparu avec la révolution industrielle, un réel qui est le produit de la mesure et du chiffre – pas d’un savoir-faire –, et ils sont des sous-produits du discours scientifique, et reposent sur une mise au travail du chiffre. C’est ce que Lacan visait, à un temps de son enseignement, lorsqu’il évoquait l’envahissement de la vie par le réel, et ce réel nous est devenu, selon son expression, extrêmement incommode.
C’est attraper le malaise dans la civilisation d’une autre manière que Freud, c’est-à-dire non pas à partir du refoulement, à partir de l’incommodité où se trouveraient les pulsions en raison du refoulement. C’est attraper ce malaise dans la civilisation en partant de ce qu’il est dominé par le discours scientifique, qui a la propriété de faire foisonner le réel d’une façon toute spéciale. Lacan l’a dit dans une conférence en Italie, prenant l’exemple même de la table du conférencier: « Cette table est quelque chose qui a une tout autre insistance que cela n’a jamais pu avoir dans la vie antérieure des hommes. » Ce n’est pas grand-chose, mais, déjà, c’est un objet qui n’est plus façonné par la main de l’homme, il n’est plus relatif à un savoir-faire. Par un certain nombre de médiations, il est fils du chiffre et de la mesure. C’est un appareil et l’appareil remplace la chose. Il ne s’agit pas là du refoulement qui incommode, il s’agit de la machine en tant qu’elle reconfigure le monde et qu’elle a un effet d’envahissement et d’encombrement. La psychanalyse compense. Lacan évoquait la psychanalyse elle-même comme une réponse à cet encombrement du réel, comme un moyen d’y survivre. Cela lui paraissait fonder la nécessité des analystes. La nécessité n’implique pas la probabilité mais elle indique malgré tout une façon de prendre les impasses de la civilisation : il faut commencer, pour rester analyste, par se dérober à devenir ce genre d’objet-là, pris dans la mesure et le chiffre.
Ils ne nous demandent pas grand-chose : « Faites-nous la liste. » Que ça ! Mais ce qui s’avance, dans cette demande, c’est l’invitation, et en même temps la promesse : « Devenez comme des machines. Vous serez comme des machines. » C’est une promesse, par exemple, que l’on pourra vous réparer, vous reprogrammer, on pourra toucher au logiciel. S’avance aussi la grande promesse ! On en est aux banques d’organes, mais on évoque déjà, quand on saura les produire, les supermarchés d’organes. Cela sera sur des présentoirs. J’ai vu cela représenté dans, non pas des utopies, mais des projections. Que faut-il pour qu’on arrive en effet à ce qu’on se promène et qu’on dise : « À combien est ce foie? ». Cela sera le vôtre. On partira avec et on se le fera placer. Tout ce qui tourne autour du clonage tourne autour de l’idéal machine. Pour que cela se réalise, il faut d’abord avoir été réduit à l’état d’homme sans qualités, il faut commencer par cocher les petites cases. Quand Lacan signale que ce réel est incommode, voire insupportable, c’est la définition même du réel, comme impossible à supporter. C’est la définition même que Lacan donnait de la clinique : « Le réel comme impossible à supporter. » D’une certaine façon, la clinique est partout, et c’est bien parce que le réel est de plus en plus difficile à supporter que l’on assiste à la promotion de la santé mentale.
Adaptation
Il y a là aussi une histoire, une archéologie à faire, qui devra attendre des jours plus sereins. Avant d’en chercher l’archéologie, saisissons la logique ici à l’œuvre. La santé mentale, c’est l’idéal d’un sujet pour lequel le réel cesserait d’être insupportable. Quand on part de cela, on ne trouve que des troubles mentaux, des dysfonctionnements. Il faut que la langue, la nôtre, ne se laisse pas gagner par ce syntagme de trouble mental. Le concept de trouble mental véhicule avec lui la notion de santé mentale, et c’est ce concept de trouble mental qui a défait les superbes entités nosologiques héritées de la clinique classique. Le trouble mental, c’est une unité, c’est ce qui ensuite peut être cerné, repéré, par la méthode des petites cases.
Ce n’est pas absurde. J’ai eu l’occasion de signaler en passant que le concept lacanien du sinthome répondait à la même exigence de passer sous les constructions nosologiques pour isoler des unités discrètes de fonctionnement. Le sinthome, c’est le trouble mental considéré en tant que l’on en tire de la jouissance. C’est plutôt ce qui vous fait trouver le réel supportable, ce qui vous permet de jouir du réel.
Pourquoi n’avait-on pas avant cet idéal de la santé mentale? On n’avait pas non plus l’OMS Il faut s’intéresser à l’OMS, l’Organisation Mondiale de la Santé. Avec ce que j’ai vu de l’organisation de la santé en France, je suis persuadé que c’est terrifiant, l’organisation mondiale de la santé. Il se cherche là la réponse universelle au malaise dans la civilisation. Pourquoi n’avait-on pas auparavant cette promotion de la santé mentale? C’est que l’on pouvait s’imaginer que le monde était fait pour l’homme, et donc penser que la relation était naturellement harmonique. L’harmonie ferait rire aujourd’hui. Il y a des ersatz. Les gens s’échappent pour aller trouver une petite zone d’harmonie, respirer du bon air, ne pas voir leurs congénères, la nature, ce qu’il en reste, mais le concept qui a supplanté celui d’harmonie et qui a dominé l’imaginaire pendant des siècles, c’est celui de l’adaptation.
Cela dit tout. Il faut s’adapter. C’est d’ailleurs le seul critère de la santé mentale, et celui qui a voulu l’introduire tout de suite dans la psychanalyse, parce que c’était quelqu’un de très malin, c’était Heinz Hartmann. Il a fait une monographie sur l’adaptation, qui est un de ses premiers écrits [30]. L’adaptation, cela traduit précisément le fait que nous avons à vivre dans un monde qui n’est plus fait pour l’homme, dans la mesure même où il est de plus en plus fait par l’homme. Lacan pouvait dire : « Les gens sont mangés par le réel. » On pourrait voir cette petite case à cocher comme une bouche qui va vous croquer.
Un réel de semblant
Le réel dont il s’agit ici, est-ce le réel? C’est un réel, dans la mesure où il est impossible à supporter. Lacan dit: « C’est le réel auquel les gens sont capables d’accéder. » Ils sont capables d’accéder à ce réel qu’ils ont produit à partir du calcul et du chiffre, et ils se sont faits à partir de là une vie d’enfer. C’est un réel « matérialisé » – Lacan emploie cet adjectif. Il faut encore entendre de quel matérialisme il s’agit. Ce matérialisme est aussi un artificialisme. C’est bien ce qui animait la polémique discrète de Lacan avec Lévi-Strauss, qui lui pensait que la combinatoire de la structure telle qu’il la mettait en œuvre, par exemple, concernant la pensée sauvage, que cette combinatoire faite d’une complexification de relations binaires, reflétait la structure du cerveau æ il avait scandalisé à l’époque en concluant dans ce sens æ, et même, reflétait la structure de la matière, qu’elle en était comme le doublet. Ce n’est pas un matérialisme artificialiste, un matérialisme style dix-huitième, mais un matérialisme primaire.
Lacan opposait à cela des arguments qu’il tirait de Lévi-Strauss lui-même: il n’y a pas seulement le monde et la matière tels quels, il y a aussi le lieu où les choses se disent, et qu’il appelait la scène. Il faut encore que le monde monte sur la scène, et là, il est pris dans une autre structure. C’est ce que Lacan appelait le grand Autre. Le lieu de l’Autre est le lieu où, quelles que soient la structure de la matière, les lois de la physique et même de la statistique sociale, cela vient se dire. C’est d’ailleurs pourquoi, sans doute, il y a autant de références au théâtre chez Lacan. Le théâtre est comme le redoublement de la scène sur laquelle le monde doit monter. C’est le langage qui empêche de réduire le monde à l’immanence. Du fait du langage, l’immanence est travaillée par une transcendance, qui est un effet du langage. C’est ce que traduit le graphe de Lacan à deux étages, qu’il y a un au-delà attaché au fonctionnement même du langage, un effet de transcendance [31]. Si on détache l’effet de transcendance, on obtient l’instance de Dieu le Père, on l’imagine antérieur et créateur, alors que, pour Freud et Lacan, Dieu n’est pas créateur, mais créé, créé par le langage. Et s’il existe, c’est tout au plus d’une ex-sistence, d’une subsistance à partir du langage.
Le monde est reconfiguré par la scène selon les lois du signifiant. Ce sont des lois propres, celles du signifiant, distinctes des lois physiques ou statistiques. Lacan pouvait utiliser les exemples mêmes de Lévi-Strauss. Il y a le calendrier chronologique, et quand vous dites certaines dates, elles sont chargées de signification. Si vous dites le 2 décembre, le 18 juin, au moins dans un contexte culturel, ce sont des dates qui marquent, et qui répondent à d’autres fonctions, qui ont une autre présence, une autre instance qu’une date purement chronologique.
On saisit au moins l’imaginarisation qui s’empare de la chose telle quelle, mais, à un pas au-delà, la science elle-même, à mesure qu’elle opère sur une réalité, fait disparaître celle-ci. Lacan prenait, à partir du langage, l’exemple des éléphants dans son Séminaire I. L’explication scientifique de quoi que ce soit ne laisse, comme résidu de ce dont il s’agit, qu’une combinatoire d’éléments signifiants. Elle volatilise même tout ce qui pouvait au départ vous accrocher dans la recherche et la substance même de la chose. Quand l’explication scientifique aboutit, elle fait même disparaître la cause pour la remplacer par la loi. La science remplace la cause par le signifiant, elle aboutit à la création de semblants. Ce qui prouve son efficacité, c’est qu’elle puisse reproduire. Il y a un effet de reproduction interne à l’opération scientifique. Ce réel qui envahit, et qui n’est pas le réel, peut-être peut-on dire qu’il est d’autant plus oppressant et insupportable que c’est un réel de semblant.
Affirmation de soi
On bute sur ceci que n’ont pas le même régime le signifiant, qui est universalisable, reproductible, démontable, qui est en dernière analyse du semblant, et le petit a qui n’est pas universalisable mais au contraire marqué par la singularité de la rencontre. D’où l’impossible de ce qui s’écrit S2 dominant petit a, et qui est la ligne supérieure du discours de l’université, disait Lacan, l’impossible de l’ambition de maîtriser la jouissance par le savoir. Il y a un maître caché, qui est la décision même d’instaurer le signifiant comme maître. Le résultat de l’opération, et le résultat qui est attendu de cette maîtrise de la jouissance par le savoir, est incarné dans tous ces questionnaires de santé mentale. Il ne s’agit que de ça : maîtriser les émois, les émotions, la singularité de l’expérience, par un petit appareil de savoir ultraréduit, et dont le produit est de vous transformer en homme sans qualités, en homme quantitatif, en espérant vous faire rejoindre, mais c’est impossible, le signifiant-maître.
Quelle est la clef de toutes les thérapies cognitivo-comportementalistes ? C’est quelque chose qui s’appelle l’affirmation de soi. Par quelque biais qu’on le prenne, l’attracteur de toutes les théories comportementalo-cognitivistes, c’est l’affirmation de soi. Une fois que l’on vous a produit comme homme sans qualités, on vous fait maître de vous-même. La promesse va loin. On vous promet le pouvoir illimité sur vous-même.
Il y a des techniques pour ça. Je me réfère à un manuel qui en est à sa troisième édition [32]. Cela vise particulièrement les personnes qui sont victimes de perturbations des compétences sociales. Y a-t-il des personnes qui n’ont pas des perturbations de leurs compétences sociales ? Cela peut aller jusqu’aux grands timides. Le problème, c’est qu’avec les grands timides, il est très difficile de faire des thérapies en groupe. Je vais vous en expliquer les principes qui ne valent que si vous supportez la vie de groupe: « Souvent on doit faire précéder les groupes d’affirmation d’une phase de thérapie cognitive individuelle, car la plupart des patients sont trop fragiles pour aborder le groupe. Cungi (1996) a développé un programme de thérapie par un livre qui propose une suite d’exercices pratiques. Cette méthode est en cours d’évaluation. »
Voici le cœur des techniques d’affirmation de soi : « Les techniques d’affirmation de soi préparent le sujet à affronter les situations sociales difficiles, elles s’enracinent dans une conception démocratique des relations humaines et peuvent se résumer à sept messages principaux. » Il faut les répéter avec insistance, souvent, pour vous reconditionner, et vous sécuriser. L’autothérapie est une partie fort importante de ce que l’on peut apprendre. « Premièrement, soyez respecté par les autres. Deuxièmement, affirmez vos droits. » Nous faisons ça, Monsieur! « Troisièmement, ne cherchez pas à être toujours aimé par tous. » J’ai essayé et je n’ai pas réussi. « Quatrièmement, ayez une image positive de vous-même. Cinquièmement, luttez contre la dépression en agissant. » Vous n’y aviez pas pensé! « Sixièmement, affrontez les autres. Septièmement, peu importe l’échec, l’important est de s’affirmer. »
Voilà un effort sensationnel pour combler l’abîme entre $ et S1.
III - Une conscience de soi
L’autoévaluation...
J’ai pris la peine de regarder le Bulletin numéro 38 de novembre dernier du Comité national d’Évaluation des universités [33] (CNE), fondé et présidé d’abord par Laurent Schwartz, et qui est confronté à la constitution de l’espace européen dans l’enseignement supérieur. Il s’agit de faire, des collectivités d’enseignement supérieur – et c’est généralisable à toutes les collectivités qui travaillent, aux établissements, aux centres de soins – des sujets autonomes définis comme des sujets responsables au sens où ils s’engagent à accomplir une tâche et qu’ils sont capables de répondre de ces engagements. Il y a un effort, à travers l’évaluation, pour transformer en sujet du collectif. Être responsable, c’est être capable de répondre devant un Autre. Le paradoxe est que le fait de faire de ces collectifs des sujets et de leur assigner une autonomie responsable, fait du même coup émerger un Autre d’autant plus exigeant qu’il est leur partenaire. Je cite une phrase de cette littérature un peu ingrate: « Dans la perspective d’une autonomie grandissante, le nombre des partenaires auxquels il conviendra de fournir des informations fiables et pertinentes augmente. »
Voilà un Autre, l’Autre qu’il faut informer, auquel il faut transmettre du savoir, qui est en inflation constante. C’est un Autre qui exige non seulement que l’on fasse, que l’on opère, que l’on agisse, mais que l’on fasse la démonstration. On doit démontrer que l’on assume ses responsabilités, que l’on respecte ses engagements, et ce, au meilleur coût. C’est un espace où les collectifs sont des sujets qui ont continuellement à faire la démonstration sous le regard de l’Autre que l’on peut leur faire confiance, exactement faire la démonstration pour donner confiance. Ils l’appellent « la logique de la démonstration ». Cela me paraît le cœur de ce que l’on aperçoit dans l’évaluation au pas suivant de celui que j’avais évoqué précédemment. Les deux pôles en sont la démonstration et la confiance. Cela ne veut dire qu’une seule chose : ces collectifs sujets ont affaire à un Autre qui est méfiant par structure, et devant lequel il faut s’exonérer en permanence, se justifier en permanence d’exister et de fonctionner.
Le discours de Laurent Schwartz du 10 mai 1985 pour l’installation du Comité national d’Évaluation [34] ne parle que de confiance, de liberté, de courage, d’objectivité, de transparence. Il assure que le Comité d’Évaluation n’exerce pas un contrôle policier. Cela donne confiance! Cela met en valeur que, pour que ces collectifs soient des sujets, l’étape majeure de cette subjectivation du collectif est l’autoévaluation. On lit la recommandation qu’elle soit toujours, dans un collectif, confiée à une instance spécifique qui assure en permanence le pilotage du collectif.
Cela ne veut dire qu’une seule chose : il s’agit de doter le collectif d’une conscience de soi. L’autoévaluation confiée à une instance qui, en permanence, pilote le collectif, je n’arrive à la conceptualiser que comme une conscience de soi objectivable sous la forme d’un savoir transparent et communicable à l’Autre. Avec le résultat que toute activité du collectif – et cela descend évidemment aux éléments individuels – doit être doublée en permanence du savoir de l’activité. Vous avez une tâche à faire, des soins à distribuer, votre activité spécifique en tant que collectif doit être doublée de l’activité d’élaboration du savoir de cette activité. C’est aristotélicien. Il s’agit de créer une âme au collectif, de le doter d’une âme. On pourrait même dire – peut-être est-ce pour cela qu’il y a de tels enthousiasmes religieux pour l’évaluation – que cela fait partie du processus de conscientisation de l’humanité, au sens de Teilhard de Chardin. Le collectif accède à la conscience à travers le processus d’évaluation. En termes aristotéliciens, on dote le collectif d’une âme. À l’horizon, l’autoévaluation dote le corps du collectif d’une âme qui le pilote.
... et son impasse
Faisons encore le pas de nous apercevoir que c’est un mode tout à fait inédit de formation de l’unité des collectifs. Nous connaissons le mode isolé par Freud dans sa Massenpsychologie, celui de la formation de l’unité du collectif par identification, et, dans les termes de Lacan, on discute de savoir si c’est au signifiant-maître ou par le biais de l’objet a. Il s’agit ici d’autre chose : essayer de donner au collectif son unité par le savoir, S2. Cela n’avait jamais été tenté, alors que toutes ces formations collectives, y compris celle que Lacan étudie dans « La psychiatrie anglaise et la guerre», à partir de Rickmann et Bion, passent par la fonction du leader, du un-en-plus [35]. Cette fonction est absolument absente de tous ces traités d’évaluation, parce que l’on essaie d’obtenir la subjectivation du collectif uniquement par le savoir, et par un savoir homogène. La fonction du plus-un ou du moins-un est strictement impensable dans ce cas.
Cette évaluation, l’élaboration du savoir de soi de l’activité, a elle-même un coût. Elle coûte et distrait des ressources au collectif où elle s’implante, devant elle-même justifier son existence dans le rapport coût-profit. Ils sont obligés de noter que le premier effet de l’implantation de l’évaluation dans un collectif est de le désorganiser et de l’appauvrir, et doivent ajouter : « L’évaluation doit diffuser une culture économique pour que ses avantages économiques soient identifiés et supérieurs au coût financier qu’elle engendre. » Si, dans ce paysage de ruines et de cauchemars, doit luire un espoir, cela vient de l’impasse intrinsèque de cette opération d’évaluation. Premièrement, il n’est pas possible d’obtenir la subjectivation des collectifs uniquement par le savoir. C’est un rêve proprement bureaucratique. Deuxièmement, ce rêve est mangé dans l’effectivité par le paradoxe de l’évaluation, c’est-à-dire l’appauvrissement immédiat et le chaos qu’introduit l’évaluation sous prétexte de mettre de l’ordre.
Il est beaucoup plus lucide de constater, comme le faisait Lacan, un peu après sa « Psychiatrie anglaise et la guerre », que les règles d’autonomie de la conscience de soi, même transposées au collectif, sont condamnées par l’avènement du discours sur le savoir [36]. L’empire du savoir est contradictoire avec ce rêve rémanent de l’autonomie de la conscience de soi. L’évaluation ne fait que traduire ce rêve d’autonomie, déjà lui-même défait par l’époque où nous sommes, celle d’un savoir au contraire anonyme et impersonnel. C’est un effort désespéré pour restituer une conscience de soi au collectif, alors qu’il lui est impossible d’émerger dans le règne du savoir.
* Texte et notes établis par Catherine Bonningue à partir des leçons des 14 et 21 janvier et 4 février 2004 de L’orientation lacanienne III, 6, enseignement prononcé dans le cadre du Département de psychanalyse de Paris VIII et de la Section clinique de Paris Saint-Denis. Le début du cours du 4 février (l’exposé d’Éric Laurent ainsi que le commentaire de J.-A. Miller) a été publié dans Quarto, n° 82, revue de l’École de la Cause freudienne en Belgique.
[1] Pétrarque, Invectives, Paris, Jérôme Millon, 2003, p. 45.
[2] Ibid., p. 7.
[3] Ibid., pp. 7-8.
[4] Musil R., L’Homme sans qualités, Paris, Seuil, Points poche, 1956. Cf. Bouveresse J., La voix de l’âme et les chemins de l’esprit, Dix études sur Robert Musil, Paris, Seuil, 2001.
[5] Cf. Rey A., Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 2000.
[6] Article paru dans Le Monde daté du dimanche lundi 11-12 janvier 2004 et cité par Philippe Sollers au Grand Meeting de la Mutualité du 10 janvier 2004.
[7] Alphonse Bertillon est né en 1853 au sein d’une famille dont plusieurs membres ont été démographes. Vers 1880, il inventa l’anthropométrie judiciaire, une méthode d’identification des criminels fondée sur une vingtaine de mesures anthropométriques qui permettait de fournir une description unique et infalsifiable d’une personne. La méthode qu’il mit au point prit le nom de bertillonnage. Alphonse Bertillon est embauché en 1879 à la préfecture de Police pour établir les fiches signalétiques des malfaiteurs. Il va imaginer un « signalement anthropométrique » propre à chaque détenu. Cette technique consiste en une énumération méthodique et systématique des caractéristiques physiques invariables d’un individu : taille, envergure, largeur et longueur de la tête, couleur de l’iris, longueur du médius, de l’auriculaire et du pied gauche. Le 1er juillet 1887 est officiellement créé le « service d’identification des détenus » naturellement confié à A. Bertillon. Cette méthode s’impose très rapidement à travers le monde : les États-Unis l’adoptent dès 1888, relayés par plus d’une cinquantaine de pays au cours de la décennie suivante. Cette méthode va très vite être complétée par « la photographie anthropométrique » constituée des clichés de face et de profil des détenus pris sous certaines conditions rigoureuses (appareil et siège fixe, éclairage constant). Cette méthode efficace sera pourtant remplacée, au début du XXe siècle, par l’empreinte digitale, d’un maniement plus facile et d’un coût moins onéreux. Vers 1914, peu avant sa mort, Alphonse Bertillon suggéra aux artistes de mettre leurs empreintes sur leur travail afin d’empêcher la fraude. Un article à ce sujet a paru dans le Matin sous le titre « Bertillonnage, on ne truquera plus les œuvres d’art », dans lequel un certain nombre d’artistes célèbres dont Rodin déclaraient être favorables à ce système.
http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/documentation/reportages/liaisons76/p20.pdf.
[8] Cf. leçon du 10 décembre 2003, publiée dans Miller J.-A. & Milner J.-C., Voulez-vous être évalué ?, Paris, Grasset, 2004.
[9] Cf. le rapport de l’INSERM sur Le dépistage des troubles mentaux chez les enfants et les adolescents, paru en décembre 2002, une synthèse de ce rapport est disponible sur le site de l’INSERM depuis début 2003.
[10] Cf. Beck U., La société du risque, Sur la voie d’une autre modernité, Paris, Aubier, 2001.
[11] Cf. Bauby P., L’état stratège, Paris, Les Éditions ouvrières, coll. Portes ouvertes, 1991.
[12] Cf. Miller J.-A., « L’ironie des Lumières », Théâtre Hébertot, 10/11/2003 : La question des Lumières, La règle du jeu, n° 24, 2004.
[13] Cf. Malthus T. R., Essai sur le principe de population (1798), Paris, Garnier-Flammarion, 1992.
[14] Cf. Lacan J., « Les complexes familiaux dans la formation de l’individu » (1938), Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, pp. 23-84 ; texte publié pour la première fois dans le tome VIII de L’encyclopédie française.
[15] Cf. Lacan J., Le Séminaire, Livre XX, Encore, Paris, Seuil, 1973.
[16] Cf. Chevalier L., Classes laborieuses et classes dangereuses, à Paris, pendant la première moitié du XIXe siècle, Collection civilisation d’hier et d’aujourd’hui, 1958.
[17] Cf. Parent-Duchâtelet A., La prostitution à Paris au XIXe siècle, Paris, Seuil, 1981.
[18] Cf. Lacan J., « L’étourdit » (1973), Autres écrits, op. cit., p. 460.
[19] Cf. Guerry A.-M., Essai sur la statistique morale de la France, Paris, Crochard, 1833.
[20] Cf. Drobisch M. W., Die Moralische Statistik und die Menschliche Willensfreiheit, Leipzig, L. Voss, 1867.
[21] Durkheim É., Le suicide, Paris, PUF, Quadrige, 2002.
[22] Cf. leçon du 10 décembre 2003, publiée dans Voulez-vous être évalué ?, op. cit.
[23] Lambert-Adolphe Quételet (Gand, 1796 - Bruxelles, 1874) étudia l’astronomie à l’Observatoire de Paris et la théorie des probabilités avec Laplace. Il fut docteur en Sciences de l’Université de Gand, puis professeur aux Athénées royaux de Gand et de Bruxelles. Dans Sur l’homme et le développement de ses facultés, ou Essai d’une physique sociale (1835), Quételet présenta sa conception de l’homme moyen comme valeur centrale autour de laquelle les mesures d’une caractéristique humaine étaient groupées suivant une courbe normale. Influencé par Pierre Laplace et Joseph Fourier, Quételet fut le premier à utiliser la courbe normale autrement que comme répartition d’erreurs. Ses études sur la consistance numérique des crimes suscitèrent une large discussion entre liberté et déterminisme social. Pour son gouvernement, il rassemblait et analysait les statistiques sur le crime, la mortalité, et il apporta des améliorations dans les prises de sanctions. Son travail suscita une grande controverse parmi les sociologues du XIXe. À l’Observatoire de Bruxelles, qu’il établit en 1833 à la demande du gouvernement belge, il travailla sur les données statistiques, géophysiques et météorologiques, étudia les pluies de météores et établit des méthodes de comparaison et d’évaluation des données. Quételet organisa la première conférence internationale de statistique en 1853. La mesure d’obésité utilisée internationalement est l’indice de Quételet. C’est QI = (poids en kilogrammes)/(hauteur en mètres). Si QI > 30, alors une personne est officiellement obèse.
[24] Cf. les bulletins de l’Agence lacanienne de presse, La guerre des palotins, notamment le n° 10, du 20 janvier 2004 (site : www.forumpsy.org).
[25] On pourra se reporter notamment au texte de J.-A. Miller « Psychanalyse pure, psychanalyse appliquée à la thérapeutique et psychothérapie », La Cause freudienne, n° 48, Paris, diffusion Seuil, 2001, pp. 7-35.
[26] Cf. note de Pontalis.
[27] Cf. Freud S., « Les chances d’avenir de la thérapie psychanalytique » (1910), Œuvres complètes, Paris, PUF, 1993, pp. 63-73. Ce texte a été commenté par J.-A. Miller dans L’orientation lacanienne III, 4 « Réflexions sur le moment présent », leçon du 6 février 2002.
[28] Débat du Sénat du lundi 19 janvier 2004 sur l’amendement Accoyer-Giraud-Mattei, dont on a pu lire la transcription sur le site du Sénat.
[29] Watson J. B., Behaviorism, trad. franç., Le behaviorisme, Paris, Éd. du Centre d’études et de promotion de la lecture, 1972.
[30] Cf. Hartmann H., La psychologie du moi et le problème de l’adaptation, Paris, PUF, 1968.
[31] Cf. Miller J.-A., L’orientation lacanienne II (1997-98), leçon du 28 janvier 1998
[32] Cottraux J., Les thérapies comportementales et cognitives, Paris, Masson, 1998.
[33] Cf. http://www.cne-evaluation.fr/WCNEpdf/bulletin38.pdf.
[34] Ce discours est accessible sur le site du CNE.
[35] Cf. Lacan J., « La psychiatrie anglaise et la guerre » (1947), Autres écrits, op. cit., p. 107.
[36] Nous n’avons pas trouvé la référence précise. Peut-être J.-A. Miller fait-il référence au « Discours de Rome » (1953), Autres écrits, op. cit., pp. 138 et suivantes.