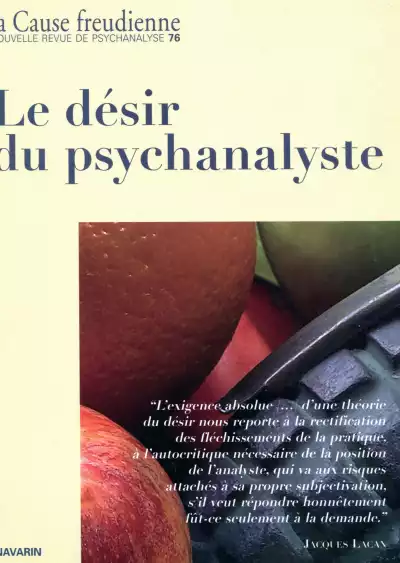Le paradoxe d’un savoir sur la vérité
Jacques-Alain Miller
"Revue de la Cause freudienne n°76"
-
Le paradoxe d’un savoir sur la vérité[*]
Jacques-Alain Miller
J’ai commenté une transformation[2], celle qui fait passer le rapport entre savoir et vérité à une formule sensiblement différente, puisque c’est cette fois-ci sous la barre que se trouve inscrit le savoir, tandis que sur la ligne supérieure est inscrit le dit – le mot d’enseignement ou celui d’énoncé convenant aussi bien.

J’ai présenté cette transformation dans la suite d’un effort pour essayer d’apprendre quelque chose d’une proposition de Lacan. Je la rappelle : « Ce qu’il [le psychanalyste] a à savoir, peut être tracé du même rapport “en réserve” selon lequel opère toute logique digne de ce nom. Ça ne veut rien dire de “particulier”, mais ça s’articule en chaîne de lettres si rigoureuses qu’à la condition de n’en pas rater une, le non-su s’ordonne comme le cadre du savoir. »[3]
Il y a dans le texte édité une faute d’impression, puisque le mot chaîne est au singulier alors que rigoureuses est au pluriel. Comme je ne crois pas que ce soient les lettres qui soient rigoureuses, il convient de rétablir un s au mot chaîne.
Cette proposition répond à un déplacement de définition de l’inconscient, qui va de l’inconscient défini comme vérité du sujet à l’inconscient défini comme savoir. Ce déplacement, il faut exactement le mesurer pour avoir chance de s’y retrouver dans cette affaire du non-savoir.
Lacan a pu définir l’inconscient comme la vérité qui parle – disant exactement que Freud est celui « qui a su laisser, sous le nom d’inconscient, la vérité parler » : c’est page 868 des Écrits que vous trouvez cette formule. Cependant, tous ses développements subséquents vont au-delà de cette formulation, la mettent en cause et questionnent l’identification ou l’équivalence de l’inconscient et de la vérité. Ces développements ultérieurs trouvent leur assise d’une définition qui peut paraître exactement opposée : celle de l’inconscient comme savoir. Il y a là une imbrication, une complication qui n’est pas facilement soluble par un ordonnancement chronologique, selon lequel une formulation surclasserait l’autre. Ce qui, dans cette transformation, est en débat est beaucoup plus essentiel et ne permet pas de dire qu’on en soit sorti.
La vérité contre le savoir
Commençons par animer un petit peu le premier versant du problème, celui où l’inconscient défini comme vérité met en question le savoir, la fonction du savoir. Quand on revendique le non-savoir, d’une certaine façon, on s’inscrit sous ce registre-là. On peut même aller jusqu’à dire que le fait qu’on ait fait slogan du non-savoir dans la psychanalyse – et ce, du vivant de Lacan – n’a pas joué pour rien dans ce déplacement théorique qu’il opère. Même si sa motivation ne se réduisait pas à cela, la définition de l’inconscient comme savoir a tout de même été posée comme un garde-fou à l’endroit d’une théorisation hystérique de la psychanalyse. L’hystérisation technique du sujet dans l’expérience a en effet une propension à miner l’élaboration de la théorie analytique. Je crois que l’on retrouve, dans les Écrits, la trace de ce qui – au moins en partie – a motivé pour lui ce déplacement d’accent, qui a poussé dans les coulisses le thème du non-savoir d’où il a, périodiquement, tendance à ressortir.
La notion de l’inconscient défini comme vérité fait du savoir de l’analyste le symptôme de son ignorance, précisément de son ignorance de la vérité de l’inconscient. À partir du moment où l’inconscient est assimilé à la vérité, la vérité refoulée fait retour comme savoir, un retour qui, du même coup, la maquille, la dénature, la voile, la dissimule ; de telle sorte que c’est de là qu’on s’autorise à interroger tout savoir quant à sa vérité et, précisément, qu’on dénie la vérité au savoir quelconque. Le savoir est en lui-même un non-rapport à la vérité, il fait figure de bâillon de la vérité. C’est pour museler la vérité que le savoir est venu au monde, qu’il est distribué, contrôlé, étalonné. À cet égard, tous les appareils d’enseignement pourraient être traités de la même façon : comme autant de refoulements de l’inconscient.
Cette vue peut avoir sa pertinence à l’âge de la science, si on se représente cet âge comme une prééminence du savoir ; au point qu’on pourrait présenter la psychanalyse comme recherche et débridement de la vérité refoulée. Si les politiques voulaient bien s’analyser – et les scientifiques également, et pourquoi pas les professeurs et tous ceux qui sont établis sur du savoir –, peut-être que ça les conduirait à une position de renoncement à l’endroit d’un savoir dont, après tout, on n’a pas tort d’attendre le pire. Dans ce contexte, la psychanalyse apparaîtrait comme une voie de salut pour l’humanité.
Cette revendication de la vérité contre le savoir est un lieu commun qu’on peut retrouver tout au long de la pensée occidentale, qui peut même être pratiqué et pris au sérieux par le relais de la pensée orientale et donné ainsi en exemple à un Occident affairé dans la recherche du savoir. Ce lieu commun, c’est la suspicion portée sur le savoir au nom de la vérité. La vérité serait éludée par tout savoir en tant que tel : lieu commun de la critique du formalisme du savoir, de son caractère abstrait, déconnecté de la réalité vivante – savoir livresque qui s’acquiert par automatisme, par des méthodes pédagogiques qui en elles-mêmes brident, maîtrisent, dominent le sujet dans sa vérité.
Dans la critique par Lacan de l’Institut de psychanalyse créé en France en 1953 – comportant la notion d’un cursus de formation, avec contrôle à la clef, etc. –, on retrouve les échos de cette critique traditionnelle du savoir formel et abstrait au nom de la vérité. Les textes les plus enthousiastes de Lacan concernant la fonction de la vérité datent de cette époque, de la polémique menée contre la formalisation de la formation psychanalytique. Cela continue jusqu’à ce jour et trouve à s’assurer et à se fonder dans la pratique analytique elle-même, dans l’expérience analytique – comme nous disons pour marquer qu’on ne sait pas à l’avance, que cette expérience, il faut la faire, et qu’elle s’abstient dans l’ensemble de prendre la tournure de l’endoctrinement que serait l’imposition d’un savoir préalable. Quand elle ne s’en abstient pas, elle est critiquée à ce titre.
On peut en effet critiquer, comme étant un effet d’endoctrinement ou une dénaturation de l’expérience analytique – qui devrait se manifester dans son ouverture à une vérité imprévue, à une vérité à venir –, tout ce qui apparaît comme tel dans les cas publiés d’un analyste. Il est classique, chez les psychanalystes internationaux de l’IPA, de reprendre les cas freudiens – par exemple celui de l’Homme aux rats – et de critiquer, dans la pratique de Freud lui-même, l’endoctrinement du sujet auquel il se serait livré – quand il communique, par exemple, au sujet un certain nombre de connaissances, d’élaborations théoriques, dont les malins d’aujourd’hui considèrent qu’il n’y a pas lieu de les présenter ainsi au patient. À cela d’ailleurs, dans la même veine, Lacan répond que ces formules que Freud pouvait transmettre au patient n’étaient justement pas, à cette date, du savoir déjà là et que si Freud pouvait se livrer à ce qui nous paraît être, à nous, endoctrinement, c’est dans la mesure où pour lui – et pour le patient –, il ne s’agissait nullement d’un savoir acquis et déjà mâché ; au contraire, ces formules avaient valeur de vérité, puisque Freud était dans le temps même de les inventer, dans le mouvement de l’invention de la psychanalyse.
La transformation de la vérité en savoir
Il n’est pas simple de répartir en deux classes, extérieures l’une à l’autre, ce qui serait de l’ordre de la vérité et ce qui serait de l’ordre du savoir. Savoir et vérité ne se laissent pas répartir en deux classes, puisque ce qui, au moment naissant, se présente comme vérité, devient savoir en s’enregistrant et en se déposant. Lorsque la vérité dépose ses armes, elle s’enregistre comme savoir. C’est un mouvement que l’on peut constater, ne serait-ce que dans l’histoire de la science. Il y a une extraordinaire implication subjective qui est nécessaire au temps de l’invention et qui, ensuite, se distribue aux enfants des écoles d’une façon tout à fait automatique. Songez à la théorie des ensembles, au moment de sa naissance, à ce qu’elle a coûté subjectivement à son inventeur, aux combats que cette vérité nouvelle a comportés. Si vous le comparez à la façon dont c’est maintenant transmis aux petits, vous saisissez qu’il y a un facteur temps qui opère.
Nous retrouvons ce facteur temps. Il faut en effet bien voir que l’essentiel de la polémique psychanalytique – là où vraiment elle se déchaîne – concerne le temps. Il y a à prendre en considération une affaire tout à fait spéciale entre la psychanalyse et le temps. Cela va de la fameuse durée des séances jusqu’à la durée totale d’une analyse. C’est une question qui mérite d’être posée : qu’est-ce que le temps dans la psychanalyse ?
Si nous restons dans le registre du savoir et de la vérité, nous avons une définition très simple de ce non-savoir qui fait notre thème : la vérité est non-savoir. Cela a comme conséquence que la vérité ne s’apprend pas. On peut, d’une certaine façon, soutenir que l’analyste ou l’analyse ait à apprendre au sujet à dire la vérité, mais ça ne passe pas par une pédagogie. C’est ce qui, à l’occasion, peut d’emblée faire limite à l’expérience analytique. Quand Lacan rappelle les conditions d’éthique qui peuvent être celles de l’analysibilité d’un sujet, il les fait porter de façon tout à fait élective sur les rapports du sujet et de la vérité.
La vérité ne s’apprend pas mais, à l’occasion, ça se prophétise. En tout cas, ça se profère. La vérité semble passer par la bouche de celui qui profère, sans pour autant lui appartenir. Il y a de grandes figures classiques de ces proférations de la vérité, connexes à une dépossession du sujet. C’est précisément au moment où le sujet lui-même ne s’appartient plus, ne se maîtrise plus, que la vérité peut être supposée se dire par sa bouche. C’est de toujours qu’ont été connues les affinités de la vérité et de l’inconscient. De toujours, on a pu constater qu’une baisse des fonctions de contrôle peut être nécessaire – à l’occasion provoquée artificiellement par l’ingestion d’un certain nombre de substances, comme le vin lorsqu’il s’agit du banquet, ou provoquée par des conditionnements physiques destinés à conduire le sujet dans des zones un peu indécises de la conscience de soi – pour que, sur les lisières de l’inconscience, la vérité puisse fulgurer. La vérité apparaît, de toujours, comme un manque au savoir. Elle peut prendre la forme de tous ces personnages supposés extérieurs au savoir, que ce soit la femme ou l’enfant, etc.
Cela met donc à l’horizon la notion paradoxale – mais c’est ce qui a l’air d’être le plus intéressant – d’un savoir sur la vérité. Ne serait-ce qu’à partir de là, on peut dire que le mouvement de recherche de Lacan va dans le sens de formuler ce que pourrait être un savoir sur la vérité. Ce qu’il a baptisé passe, au moment de la fin de l’analyse, n’est pas seulement moment de vérité, mais bien – c’est là son paradoxe – la possibilité d’un savoir sur cette vérité. Entre le moment interne de la passe – interne à l’expérience – et son moment externe, dit de procédure – qui est un moment de vérification –, il y a l’attente de ce qu’une vérité puisse se compléter d’un savoir sur celle-ci, l’attente et aussi l’exigence – exigence fort paradoxale – que soit, précisément là, surmonté ce qui peut apparaître d’antinomie entre vérité et savoir.
Cette notion est matérialisée dans les schémas des quatre discours, parmi lesquels le discours analytique se distingue d’inscrire le savoir à une place formelle dite place de la vérité. Le paradoxe en est saillant dès lors qu’on se réfère à la première formule, celle qui met le savoir au-dessus et la vérité en dessous. Là, c’est bien d’une barre mise sur le savoir que la vérité se laisse espérer, au point que le savoir lui-même puisse paraître lié à la fermeture de l’inconscient comme vérité. Il y a, en effet, une élaboration de savoir qui a lieu dans la psychanalyse et qui peut paraître, à Lacan lui-même, d’un aloi fort douteux : l’accent n’étant autant mis sur le savoir que pour renforcer la fermeture de l’inconscient.
D’où les difficultés pratiques des analystes avec la pédagogie de la théorie analytique, qui ont conduit les classiques orthodoxes – et les conduisent encore malgré le ridicule – à demander et à requérir de leurs analysants de s’abstenir, pour favoriser l’ouverture de l’expérience, d’avoir recours à un savoir livresque de la psychanalyse. Ils ont l’idée un peu magique que le savoir en lui-même serait la fermeture de l’expérience, qu’il serait contraire à la vérité de l’expérience. C’est une façon un peu primaire de mettre en place les relations difficiles du savoir et de la vérité. On pourrait paraphraser Kant, quand il dit : « J’ai fixé ses limites au savoir pour laisser place à la foi. »[4] L’association libre consisterait à dire : « J’ai fixé ses limites au savoir pour laisser place à la vérité », et précisément à une vérité qui se profère, à la vérité du Je parle, à la vérité qui ne se mesure plus à rien d’autre, et certainement pas à l’exactitude.
La formule de Lacan que j’ai rappelée la dernière fois[5] : « l’analyse [progresse essentiellement] dans le non-savoir »[6], veut dire qu’elle progresse essentiellement dans l’ordre de la vérité, dans l’ordre du Je ne sais pas. Ça laisse problématique ce que serait le Je sais final d’une analyse, d’une analyse qui aurait précisément progressé dans le non-savoir, dans la vérité. Pourquoi cette expérience de vérité, de vérité en tant qu’antinomique au savoir, donnerait-elle lieu, in extremis, à un Je sais final ? Et ce Je sais, qui peut le formuler ? La question a son importance, extrême, puisqu’il s’agit de savoir si la passe progresse elle aussi essentiellement dans le non-savoir, si la passe est une expérience de vérité, comme l’analyse, ou si elle est supposée établir un autre rapport avec la vérité que le rapport qui prévaut dans le cours de l’expérience analytique. Ce que nous pouvons aussi qualifier d’expérience – celle de la passe en tant que distincte de l’expérience de l’analyse – ne suppose-t-il pas que le sujet y entretienne un autre rapport à la vérité que dans le cours de son analyse, et, paradoxalement, un rapport de savoir avec la vérité ?
La docte ignorance
Le terme de docte ignorance est venu à propos de l’intertitre de Lacan Ce que le psychanalyste doit savoir : ignorer ce qu’il sait[7]. J’ai dit, la dernière fois, que je ferais référence à Nicolas de Cues, auteur d’un traité qui s’intitule De la docte ignorance, et qui, consulté par les moines de l’abbaye de Tegernsee, s’est mis, en 1452, à leur écrire pour leur parler de la docte ignorance[8].
Qu’est-ce que la docte ignorance ? C’est la notion d’une certaine articulation nécessaire entre le savoir et l’ignorance, la notion que savoir et ignorance ne sont pas extérieurs l’un à l’autre, qu’il y a un point, justement au plus haut du savoir, où le savoir coïncide avec l’ignorance. Nicolas de Cues présente les choses en faisant intervenir le terme d’amour. Il se questionne sur le point de savoir en quel sens l’amour sait ou l’amour ignore. Bien entendu, à l’horizon, ce qui le motive dans cette construction, c’est d’essayer de saisir et de situer l’amour de Dieu, l’amour du sujet pour Dieu. Il insiste sur le fait de l’inaccomplissement de l’amour, sur la distinction de l’amour et de la possession, à savoir que l’amour est un mouvement qui va vers, vers un terme, mais un terme qu’il ne peut saisir. Il insiste donc sur le caractère infini ou indéfini de l’amour dans sa progression. L’amour est défini comme un mouvement qui cesserait si le terme final était atteint, de telle sorte que, n’y étant pas encore et ayant toujours à progresser, l’amour est foncièrement une ignorance. On n’aime que ce que l’on ignore. Néanmoins, si, d’un côté, on ignore, il faut, d’un autre, qu’on en ait quelque savoir ; sinon, on n’aimerait pas. Si on aime le Bien, si on ne sait aimer que ce qui est bon, il faut bien savoir qu’il existe du bon ; mais, dans le même temps, on ignore ce qui est bon ; de telle sorte qu’aimer, pour l’esprit, c’est être sans repos, puisque le caractère aimable de ce qui est aimé est précisément inaccessible.
Par ce petit apologue de l’amour – amour qui doit être à la fois ignorance et pressentiment d’un savoir –, Nicolas de Cues introduit au privilège de l’ignorance. La voie privilégiée du rapport à Dieu n’est pas la voie du savoir, mais bien celle de l’ignorance, et même d’une ignorance méthodique. La référence de Cues est celle de la théologie mystique dite négative, celle du Pseudo-Denys, qui situe Dieu au-dessus de tout ce qui est intelligible, et conduit donc le sujet à passer au-dessus de lui-même. C’est lorsque le sujet entre dans l’ombre de « la Ténèbre », délaissant le savoir ou ce qu’il croit savoir, quand il a, non pas laissé toute espérance mais, au contraire, au nom de cette espérance, laissé tout savoir, qu’il a chance, s’il a été assez appliqué, d’avoir accès à un rapport authentique à Dieu.
Cette notion d’un Dieu qui ne peut être compris, qui ne peut être embrassé par le savoir, par aucun concept, est une théorie de l’infini. C’est la notion qu’une énumération épuisante des signifiants du savoir est nécessaire. C’est d’ailleurs ainsi que se présentent les traités de théologie mystique : ils énumèrent les noms de Dieu, les noms possibles de Dieu, pour conclure, s’agissant de chacun de ces noms, qu’il n’y est pas encore. Cette présentation énumérative n’est pas sans faire songer à la façon dont Lacan écrit le savoir supposé des signifiants dans l’inconscient. C’est comme si, dans cette théologie mystique, on se proposait de subjectiver assez de savoir, assez de signifiants – d’en réaliser l’exhaustion – pour vérifier que Dieu est incommensurable à ce savoir. On énumère et on doit indéfiniment barrer les signifiants qui se proposent pour nommer Dieu.
La question posée est de savoir dans quelle mesure cette suite est finie. Lacan écrit, certes, le savoir supposé présent des signifiants dans l’inconscient comme une suite indéfinie, mais qui semble rester finie. Quand on se donne pour but de saisir l’objet dont il s’agit par exhaustion du savoir, pour atteindre enfin ce zéro de savoir qui serait la présence même de cet objet, il faut, pour commencer, le temps. Du temps, il en faut d’ailleurs pour lire les traités de théologie mystique ! Bien qu’ils soient basés sur un principe assez simple, sur un algorithme assez élémentaire, ces volumes mettent inlassablement en scène, sur des pages et des pages, cette rature continue, indéfinie. Le facteur temps est ici tout à fait présent.
La vérité dépathétisée
En évoquant cette formule des signifiants supposés présents dans l’inconscient, je suis déjà passé de l’autre côté, sur l’autre versant, celui où l’inconscient est savoir.
La définition de l’inconscient comme savoir pousse à écrire le savoir en dessous de la barre et à inscrire, au-dessus, un terme dont on peut dire qu’il est le refoulé, le retour du refoulé, le retour du savoir refoulé. C’est dans cette disposition que Lacan a pu dire de l’enseignement qu’il valait comme refoulement du savoir.
Cela oblige à distinguer deux espèces de savoir : le savoir Plus je sais et le savoir Plus je ne sais pas, celui dont on peut seulement dire qu’il y a savoir et qui le dit. Cette distinction entre deux types de savoir – le savoir auquel le Je sais peut s’ajouter et le savoir auquel le Je sais ne peut pas s’ajouter – rend nécessaire, comme médiation, comme lien, la fonction du sujet supposé savoir. C’est seulement à partir du moment où on distingue ces deux types de savoir – le savoir que je sais et le savoir qu’il y a sans que je puisse dire que je le sais –, c’est dans leur écart que le sujet supposé savoir s’inscrit. Le sujet supposé savoir est au fond une autre façon d’écrire le savoir en position de vérité.
La promotion du savoir pour définir l’inconscient est une promotion tout à fait singulière. Elle est beaucoup moins évidente que l’équivalence de l’inconscient et de la vérité. L’équivalence de l’inconscient et de la vérité a ses lettres de noblesse ou ses lettres de créance dans toute l’histoire de la pensée. L’équivalence de l’inconscient et du savoir est par contre quelque chose qui est profondément moderne, contemporain. Nous en avons un maniement plus facile depuis que nous avons à notre disposition les petits ordinateurs qui nous donnent une certaine présentification d’un savoir sous une forme matérielle, déjà présent, en posant certes des problèmes d’accès et d’usage dès qu’il y a écriture, mais qui nous est maintenant en quelque sorte imposé, qui nous submerge. On pourrait défendre que le déplacement de la vérité au savoir dans la définition de l’inconscient épouse ce mouvement historique dont nous sommes les sujets.
Le calcul de la vérité
La promotion du savoir s’accompagne d’une dévalorisation de la vérité. On en trouve les traces très sensibles dans l’enseignement de Lacan. Comme il m’est déjà arrivé de l’évoquer il y a pas mal de temps, cette dévalorisation de la vérité semble soustraire à la rhétorique de Lacan ce terme de vérité qui, il faut le dire, en nourrissait beaucoup les effets. Elle propose au contraire, pour ordonner la vérité, de ne pas prendre pour référence la progression dialectique du non-savoir, de ne pas prendre pour référence le Socrate interrogateur ou la pythie au-delà d’elle-même – toutes ces figures admirables, classées, dont les effets pathétiques ne sont plus à démontrer –, mais de prendre pour référence la logique mathématique. La définition de l’inconscient comme savoir dépathétise la vérité, la fait virer du côté du mathème et même, précisément, du côté des mathématiques ou, au moins, de cet effort mathématique pour saisir et pour vider la vérité de sa charge émotionnelle. Lacan n’a d’ailleurs jamais fait l’éloge de la passion de la vérité. Il a fait l’éloge de la passion de l’ignorance. C’était, à cet égard, beaucoup plus prudent. Quand il s’agit de passion, on est dans un registre pathétique – registre qui est réduit dans la discipline de la logique.
Dans la phrase qui nous occupe – où il s’agit du non-su –, la référence à « toute logique digne de ce nom » est une référence à la logique mathématique ou, avant l’émergence de la logique mathématique, à des logiques qui peuvent la laisser pressentir et qui, sans se mathématiser – il faudra attendre le XIXe siècle –, dépathétisent déjà la vérité. La logique stoïcienne, à laquelle Lacan se réfère aussi, est tout à fait en mesure de dépathétiser la vérité. Par exemple, quand elle raisonne sur des phrases comme S’il fait jour alors il fait jour. Vous avez, là, un maniement de la vérité, une réflexion sur la vérité, qui n’a rien à voir avec la passion de la vérité, mais strictement à voir avec un ordonnancement signifiant. Quand Lacan parle de « toute logique digne de ce nom »[9], il fait référence à la logique mathématique ou à ce qui, dans l’histoire, la précède et se trouve aussi digne de ce nom, c’est-à-dire à ce qui vide la vérité de sa passion. Ça réduit la vérité à n’être qu’une valeur, à être déduite, à être ce qui se déduit d’une combinaison de propositions.
Lorsqu’on prend la proposition C et la proposition Q, on a, entre ces deux propositions, un rapport que j’écris simplement par le losange de Lacan qui permet de dire toutes les relations possibles entre ces deux propositions.
Si on a une valeur de vérité pour l’une, une valeur de vérité pour l’autre, et si on détermine la relation dont il s’agit – par exemple la relation d’implication –, on obtient trois places : la place de la première proposition, la place de la relation qui les lie, la place de la seconde proposition. Puis on a la quatrième place qui permet d’écrire la valeur de vérité, qu’en l’occurrence on écrira comme étant celle du vrai.
Selon les lettres de valeur de vérité que l’on va mettre aux places 1, 3 et 4, peuvent se définir les différentes relations de ces propositions. Il s’agit d’un usage de la vérité qui la réduit à n’être rien d’autre qu’une lettre, V, par opposition à une autre lettre, F – F pour Faux. Dans cet ordre, la vérité n’est plus rien d’autre que l’index d’une combinaison signifiante. On appelle ça les tables de vérité. À l’occasion, par exemple pour les principales relations logiques, il faut les apprendre par cœur.Ces tables de vérité n’ont rien à voir avec les Tables de la Loi. Cet usage, que l’on peut dire très ravalé, de la vérité n’a rien à voir avec une vérité prophétique. C’est seulement la mise en place d’un certain nombre de conventions qui lient des lettres. C’est un calcul de la vérité, un savoir qui est un calcul de la vérité. Ne s’y trouve pas du tout un concept de la vérité comme extérieure au savoir – ni extérieure au savoir, ni critique du savoir – mais, au contraire, une résorption de la notion de vérité dans l’ordre du calcul. Il s’agit d’une vérité enchaînée, vidée de signification et, par là-même, de passion. Il n’y est plus question de la vérité qui dit Je parle, mais de la vérité qui dit Je la boucle. Elle ne dit même pas ça ; elle ne dit plus rien ! C’est une vérité qui, purement et simplement, s’écrit, qui tient à des chaînes de lettres.
Vous n’avez là que deux propositions qui sont liées, mais il pourrait y en avoir dix ou quinze avec différents foncteurs entre chaque proposition, dont il faut apprendre à savoir comment elles se rapportent les unes aux autres par rapport aux parenthèses qui peuvent s’y trouver, pour pouvoir, à la fin, écrire un grand V ou un grand F final. Faire cet exercice dégage précisément l’idée de ce que c’est que de n’en rater pas une ! Ce dont il s’agit, c’est finalement de remplir la petite case qui est au bout. Toutes ces propositions, les différentes parenthèses qu’il y a entre elles, sont données et puis, au bout, il y a une case vide où il faut être capable d’écrire V ou F.
L’inclusion de la vérité dans le savoir
C’est un état ravalé de la vérité, un état où la vérité est susceptible d’un calcul intégralement inclus dans le savoir. Un savoir, c’est au fond une table de vérité. C’est un savoir parce que c’est une certaine articulation de signifiants. Quand Lacan amène ça, il le fait contre le Lacan des années cinquante, en le qualifiant, de plus, comme la condition même de l’établissement du psychanalyste dans l’acte psychanalytique. Je le cite, dans son texte « Radiophonie » : « quelqu’un ne s’y assoit [dans l’acte psychanalytique] que de la façon [...] qu’il y impose au vrai »[10].
S’asseoir fait assez image. C’est vraiment se mettre dans la position analytique, qui est foncièrement une position assise. On pourrait dire que c’est la même chose pour la position d’écriture – encore que Nietzsche disait qu’il fallait écrire en dansant –, mais on n’a pas encore imaginé de dire qu’il fallait psychanalyser en dansant ; donc, on s’assoit.
Le mot façon est lui-même assez indicatif du caractère conventionnel et artificiel que prend la vérité dans l’expérience analytique. Il rappelle que le cadre analytique lui-même est une table de vérité. C’est un dispositif fait pour que s’inscrivent un certain nombre de signifiants, moyennant quoi il y aura l’inscription de la valeur de vérité au terme, au point où s’interrompt la chaîne. Autrement dit, l’analyse impose une façon au vrai. Ça traduit l’implication de l’acte analytique dans la production et l’émergence des effets de vérité.
Lacan fait varier ce mot, façon, dont je dis qu’il renvoie à l’artifice de l’expérience analytique, en l’écrivant : l’effaçon[11]. Ce Witz, connu, a une valeur très précise qu’il faut resituer. Il signifie qu’il n’y a pas de vérité donnée, que la condition de l’émergence de la vérité dans l’expérience analytique passe d’abord par l’effacement de ce qui serait une vérité en soi, de la même façon que le F ou le V de la logique mathématique ne repose sur aucune vérité de nature. Au niveau du S’il fait jour il fait jour, il n’y a absolument pas à ouvrir les yeux pour voir s’il fait jour ou s’il fait nuit. Il n’y a pas à y ouvrir les yeux sur autre chose que sur le morceau de papier où s’inscrit la proposition. Au contraire, il faut commencer par fermer les yeux, par effacer. À cet égard, un seul savoir donne l’effaçon du vrai, un seul savoir est la condition de l’acte analytique : le savoir de la logique. Il n’y a pas là à ouvrir les yeux sur un monde de culture. Lacan le dit: « Un seul savoir donne ladite effaçon : la logique pour qui le vrai et le faux ne sont que lettres à opérer d’une valeur. »[12] C’est quelque chose de radical, une variation à 180 degrés par rapport à la conception pathétique de la vérité.
Faire de la logique mathématique la référence de la vérité, faire d’un savoir bien particulier la référence à la vérité, c’est sans doute ce à quoi se réfère Lacan dans le passage sur le non-su de sa « Proposition... » Cette « Proposition... », il faut bien s’apercevoir qu’elle n’est pas sous le régime de la première distinction vérité/savoir. Elle n’est pas sous le régime où la vérité est au-dessus de la barre et le savoir en dessous. La « Proposition... » de la passe chez Lacan est sous le régime de la bonne façon de faire avec la vérité, à savoir la façon logique : effacer la passion de cette vérité pour n’en garder que sa valeur de lettre, de lettre parmi les autres. Autrement dit, contrairement à ce qu’on peut croire quand on y regarde un peu trop vite, la « Proposition... » de la passe est bien fondée sur une domination du savoir sur la vérité. On pourrait même dire que ce que pourrait être la référence de Lacan quand il fait du non-su le cadre même de ce savoir, ce serait la table de vérité elle-même. À condition de n’en pas rater une, on finit par savoir la valeur de vérité de ce qui a été ainsi enchaîné. De telle sorte que le non-su pourrait être la vérité de la combinaison, la valeur de vérité de la combinaison, et la table de vérité, à proprement parler, le cadre du savoir.
Vérité, savoir et réel
Cette articulation du savoir et de la vérité ne répartit pas savoir et vérité l’un par rapport à l’autre, mais les fait tenir ensemble. Cette inclusion de la valeur de vérité dans le savoir conduit plutôt à distinguer la vérité et le réel. Confondre vérité et réel conduit au savoir absolu. C’est bien à partir du moment où Lacan a défini l’inconscient par le savoir – qui implique un mode d’inclusion de la vérité dans le savoir – qu’il a fallu distinguer et cerner le réel par rapport au savoir et à la vérité. Et ce n’est pas parce que ces chemins ont été foulés de nombreuses fois que ça va de soi.
Les Écrits se terminent, au contraire, par une équivalence de la vérité et du réel. C’est bien pourquoi ça garde finalement sa consistance, puisque ça se répartit après sur des termes différents. L’équivalence de la vérité et du réel mobilise, d’une façon plus confuse sans doute, ce qui trouve à se déplier après.
Tout le texte de « La science et la vérité », par lequel Lacan termine ses Écrits, est animé par une équivalence du réel et de la vérité. Dans son Séminaire, Lacan a dit qu’il aurait pu l’appeler « Le savoir et la vérité ». C’est peut-être là que l’équivalence de la vérité et du réel est poussée à son comble. La vérité y est définie, non comme un effet du signifiant, mais, au contraire, comme une cause, comme un point voilé dans la science. Lacan définit la vérité comme cause et comme ce qui reste voilé dans la science. Ne serait-ce que par cette mise en place, c’est à l’opposé de donner comme exemple au psychanalyste la réduction scientifique de la vérité.
Il y a un autre indice de cette équivalence faite entre vérité et réel. Devisant sur la vérité freudienne, Lacan fait valoir, en 1966, l’horrible de cette vérité. Mesurons l’écart avec la formule qui viendra sept ans plus tard, celle de l’horreur de savoir[13]. Ce qui indexe ces formules, c’est ce mot d’horreur. Les Écrits se terminent sur l’horreur de la vérité. On ne peut pas pousser le pathétique de la vérité plus loin. Le terme d’horreur désigne le culmen du pathétique, le moment où le pathétique fait défaillir le sujet lui-même. Extrême d’une passion du sujet où il pâtit tellement de ce dont il s’agit, qu’il y a une insurrection de tout son corps et de tout son être pour le refuser.
Le volume des Écrits se termine donc sur le pathétique de la vérité. La chose principale qui vient après les Écrits, c’est la « Proposition... » sur la passe. Cette « Proposition... » se situe déjà sur un autre versant de la vérité. Elle est sur un abord où Lacan suppose, au contraire, qu’on ne se prenne pas à cet horrible de la vérité, mais qu’on s’occupe d’une logique de la vérité – une logique de la vérité et non pas son horreur.
Le non-savoir de Bataille
Il y a quelque chose que l’on ne peut pas éluder dans ce débat sur le non-savoir chez Lacan et ses rapports avec l’horrible de la vérité. On le trouve dans les soubassements des références au non-savoir que Lacan fait dans « Variantes de la cure-type », son premier écrit après le Séminaire I. Cette référence concerne ce qui fut assez célèbre dans le Paris des années cinquante : les conférences sur le non-savoir[14] faites par Georges Bataille au Collège de philosophie de Jean Wahl – lieu éminent, fréquenté par Lacan lui-même. Il y a de très nombreuses conférences de Lacan – peu ont été conservées – faites au Collège de philosophie de J. Wahl, lequel fut son interlocuteur pendant un certain temps jusqu’à ce qu’il ait quelques mots ironiques dans Les Temps modernes à l’égard de Lacan – un Lacan qui serait tout embobiné de Hegel. Il y a, à ce propos, une note méchante dans les Écrits[15], disant que le monsieur qui l’accuse d’être hégélien ferait mieux de se tenir au courant de son Séminaire et qu’il s’apercevrait ainsi que c’est justement là où il passe au-delà des références hégéliennes qu’on vient lui reprocher de s’y maintenir. Cet épisode a mis un terme, je crois, aux conférences de Lacan au Collège de philosophie.
Jean Wahl, personne ne le connaît plus tellement. C’était un professeur de la Sorbonne, toujours curieux de tout, dont, pour ma part, je garde un seul souvenir pour m’être trouvé une fois – la seule – au cours de Paul Ricœur et avoir vu un petit monsieur en imperméable se glisser sur ma droite. J’avais reconnu Jean Wahl. Ce qui m’a étonné, c’est qu’il prenait des notes sur un ticket de métro. Il a pris, en notes, tout le cours de Paul Ricœur sur un ticket de métro ! C’était peut-être même un ticket de métro usagé qu’il avait conservé. Ça donne une certaine idée du rapport entre savoir et non-savoir. De tout ce que déployait comme érudition Paul Ricœur sur Husserl, Jean Wahl prélevait un agalma de lui seul connu.
C’est une digression pour marquer qu’il y a tout lieu de penser que Lacan a entendu ces conférences de Georges Bataille. Il fréquentait le Collège de philosophie et avait même des relations personnelles avec Bataille. Sans même avoir le témoignage direct de sa présence à ces conférences, on peut donc la supposer. Elles n’ont été publiées que dix ans plus tard, après la mort de Bataille, sous la forme où il les avait laissées : un certain nombre de notes. Quelqu’un qui y a assisté m’a dit que c’était très pathétique et étonnant, puisque Georges Bataille n’y parlait pas du non-savoir de façon extérieure, comme d’un objet à démontrer, mais que c’était pour lui une vraie expérience. Il était tout le temps sur le bord de se taire, dans des vacillements, des silences profonds. Je crois que la référence de Lacan au non-savoir vient de ces conférences de 1951-1953 ou, du moins, que c’est Bataille qui a réveillé en lui le souvenir de Cues.
Le point de départ de Bataille y est assez remarquable : la conférence d’un philosophe anglais de logique mathématique, Alfred Jules Ayer – n’ayant pas laissé un grand nom dans la logique elle-même mais bien dans la philosophie anglaise. C’est donc une conférence d’Ayer qui a motivé l’insurrection de Georges Bataille, au moment où, autour d’un pot où il se trouvait avec Merleau-Ponty, Ayer avait formulé la proposition qu’Il y avait le soleil avant que les hommes existent. Nos philosophes se lancent alors dans une controverse sur la véracité de cette proposition. On voit bien Ayer, assis sur son positivisme, formuler comme une évidence l’indépendance du réel par rapport à l’humanité.
Ça dérange Georges Bataille qui y trouve le point de départ de ses conférences sur le non-savoir. Bataille ressent une gêne dans cette proposition, puisque c’est à la fois parfaitement raisonnable, mais, qu’en même temps, c’est un parfait non-sens. Ce que Bataille trouve inacceptable pour l’homme, c’est la proposition selon laquelle il existerait quelque chose avant lui. Il qualifie donc la proposition d’Ayer d’inattaquable du point de vue logique, mais il reste – comme il dit – une gêne, et cette gêne l’intéresse. En formulant cette proposition, on croit savoir quelque chose sur le soleil. C’est une phrase qui formule au fond un Il y a. Il y avait le soleil avant que les hommes existent. On croit savoir, mais, en fait, nous dit Bataille, on ne sait rien. C’est à ça que Bataille se fie, d’une façon que l’on peut dire très courageuse, pour parler du non-savoir et de la gêne qu’il y a dans une proposition de cet ordre. Ce que Bataille vise, c’est la disparition du sujet lui-même. Dans ses conférences sur le non-savoir, il y en a une sur la mort – la mort comme non-savoir – où il peut dire que le non-savoir concernant la mort est de la même nature que le non-savoir en général.
Ce que Bataille donne comme définition du non-savoir est une définition tout à fait bataillienne, faite d’une sorte de flou qui vous enveloppe : « Pour préciser ce que j’entends par ce non-savoir : ce qui résulte de toute proposition lorsqu’on cherche à aller au fond de son contenu, et qu’on en est gêné. »[16] Elle comporte la notion qu’au fond de toute proposition, de tout énoncé, il y a finalement quelque chose de pas très ragoûtant. C’est la notion que sous la barre, sous la barre de tout énoncé, sous ce qu’il appelle proposition et qui est après tout un terme logique – Ayer ayant sans doute fait une conférence sur la logique des propositions et sur la vérité, puisqu’il y a un livre de lui qui porte là-dessus –, il y a quelque chose d’horrible, qu’on n’arrivera finalement jamais à savoir, parce qu’on n’y est pas. On n’y est pas, pas plus que devant le soleil d’Ayer.
On voit bien : d’un côté, l’homme de la science, celui qui tient mordicus à ce que le savoir soit dans le réel – qu’il y ait ou non quelqu’un pour le savoir – et, d’un autre côté, Bataille qui réinclut ici le pathétique. Parler de gêne n’est rien d’autre que d’inclure le pathétique et de laisser soupçonner que, sous ces propositions d’allure innocente, il y a quand même quelque chose qui rôde, quelque chose qui est de l’ordre de l’horrible.
C’est pourquoi, de façon tout à fait singulière, Bataille prend comme exemple le sacrifice. Il étudie les similitudes du non-savoir et du sacrifice. Ce ne sont que quelques pages, mais c’est très surprenant : « Dans le sacrifice, on détruit un objet, mais non complètement, il reste un résidu [...]. La satisfaction immédiate que donne une vache égorgée est soit celle du paysan, soit celle du biologue, mais c’est ce qui est exprimé dans le sacrifice. La vache égorgée n’a rien à [voir] avec toutes ces conceptions pratiques. »[17] On n’égorge donc pas la vache pour un usage bassement utilitaire. Bataille ajoute : « Dans tout cela [la pratique du biologue ou du paysan], il y avait une connaissance limitée, mais solide. Lorsqu’on s’est livré à la destruction rituelle de la vache, on a détruit toutes les notions auxquelles la vie simple nous avait habitués. »[18]
Qu’est-ce que Bataille essaye de faire valoir à travers cet apologue ? C’est un petit apologue ; ce n’est pas une théorie du sacrifice. Disons que c’est une théorie du sacrifice donnée par aperçus, qu’il faut reconstituer. Ce que Bataille essaye de faire valoir, c’est qu’il y a une destruction du savoir dans le sacrifice de l’objet. Il y a dans le sacrifice destruction du savoir, ainsi que recherche même de l’horreur : « Atmosphère de la mort, de la disparition du savoir, naissance de ce monde qu’on appelle sacré ; il y a là possibilité de dire du sacré qu’il est le sacré, mais à ce moment-là le langage doit au moins subir un temps d’arrêt. »[19] Bataille présente le moment du sacrifice comme, à la fois, la destruction du savoir et une recherche d’horreur. Quand l’horreur surgit sous les espèces du sacré, quand cette vache égorgée est là pantelante, le langage défaille. C’est à cette occasion que Bataille se demande s’il peut même continuer de parler : « Je suis en même temps devant vous comme un bavard donnant toutes les raisons que j’aurais de me taire : je peux aussi me dire que peut-être je n’ai pas le droit de me taire, position encore difficile à soutenir. »[20]
Il y a dans cette production méthodique de l’horreur par le sacrifice, le pressentiment – et même déjà la formulation – de la connexion du déchet et de l’agalma. Il nous fait voir un non-savoir qui n’est pas du tout comparable au non-savoir de l’absence des hommes devant le soleil, quand on suppose le soleil précéder de beaucoup l’existence des hommes. La phrase d’Ayer s’enchante d’un savoir qui est là sans l’homme, qui n’est pas pour l’homme, qui pose un réel où il n’y a personne pour voir et pour savoir. Par contre, ce que Bataille fait voir, c’est le même non-savoir, mais comme destruction. C’est comme si, à Ayer qui parle du soleil d’avant les hommes, Bataille opposait ce soleil qui pourrait très bien rester là une fois que le savoir scientifique nous aurait permis de détruire l’humanité ; non pas dans la paix d’avant, mais comme le résultat de la guerre d’après.
Ce qu’il en reste chez Lacan
Qu’en reste-t-il comme marque chez Lacan ?
Dans le cadre de ses conférences sur le non-savoir, Bataille fait un sort très important à la pratique de l’amok[21], qui est, comme il s’exprime, une « singulière crise de violence qui n’est pas rare dans les îles de la Malaisie » et qui « précipite dans la mort, puisqu’il voue celui qu’il possède au meurtre délirant »[22]. L’amok, c’est une crise de violence quasiment codifiée, où le sujet est à un moment pris de la passion brûlante, de l’exigence de saisir un poignard et d’aller tuer le premier qui passe : « L’amok est la soif et la rage obscure de tuer. Il s’agit armé d’un poignard à lame ondulée, d’un kriss malais, de se jeter sur le premier passant venu et de frapper à mort [jusqu’à ce] qu’un autre menacé finalement se défende et l’abatte. »[23] Bataille précise que le sujet sait que son geste n’a qu’une issue : « L’amok n’est au fond que le suicide le plus ouvert, qui s’ouvre au délire illimité, au délire infiniment ouvert de la mort. »[24]
Au cœur des conférences de Bataille sur le non-savoir, pour incarner d’une façon sensible la destruction qui pour lui est au cœur du non-savoir, avec le résidu qui reste, il y a la mort. Il y a un passage très singulier dans « Radiophonie », où Lacan explique pourquoi il se moque au fond du slogan du non-savoir: « Ce qu’il y a d’admirable, c’est la prétention de qui voudrait se faire aimer sans ce matelas [de savoir]. Il s’offre la poitrine nue. Qu’adorable doit être son “non-savoir”, comme on s’exprime assez volontiers dans ce cas ! »[25] Ensuite – et c’est là ce qui est singulier –
Lacan nous dit que le slogan du non-savoir est un leurre qu’on dirige contre lui pour l’avoir: « c’est un leurre qu’on a, je crois, imaginé pour en justifier un amok fait à mon égard »[26]. L’amok, si cher à Bataille dans ses conférences de 1951-1953, revient dans ce texte de Lacan en 1971, au moment où il qualifie exactement ce qu’on pourrait appeler une controverse théorique qui le vise et qu’il caractérise exactement comme un amok – une tentative folle de meurtre dans le but de se faire tuer.
[*] Miller J.-A., « L’orientation Lacanienne. Le banquet des analystes » [1989-1990], enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université de Paris VIII, leçon du 2 mai 1990. Texte transcrit et établi par Jacques Péraldi, édité par Yves Vanderveken pour La Cause freudienne. Non relu par l’auteur. Cette leçon suit chronologiquement celle parue dans La Cause freudienne n° 75, juin 2010, intitulée « Logiques du non-savoir en psychanalyse », p. 169-184 [NDLR].
[2] Miller J.-A., « Logiques du non-savoir en psychanalyse », La Cause freudienne, n° 75, juin 2010, p. 169-184.
[3] Lacan J., « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 249. Le texte est d’abord paru dans Scilicet, n°1, Paris, Seuil, 1968, p. 20-21. C’est à cette édition que Jacques- Alain Miller se réfère dans cette leçon, le volume intitulé Autres écrits n’étant alors pas encore paru.
[4] Cf. Kant E., « Préface » de la seconde édition [1787] de la Critique de la raison pure, Paris, PUF, 1975, p. 24. Dans cette traduction classique par André Tremesaygues & Bernard Pacaud, la phrase est ainsi traduite : « Je dus donc abolir le savoir afin d’obtenir une place pour la croyance. »
[5] Cf. Miller, J.-A., « Logiques du non-savoir en psychanalyse », La Cause freudienne, n° 75, op. cit.
[6] Cf. Lacan J., « Variantes de la cure-type », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 361.
[7] Ibid, p. 349.
[8] Cues N. de, Lettres aux moines de Tegernsee sur la docte ignorance ; Du jeu de la boule, Paris, L’œil-François-Xavier de Guibert, 1985.
[9] Lacan J., « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », Autres écrits, op. cit.
[10] Lacan J., « Radiophonie », Autres écrits, op. cit., p. 427.
[11] La citation précédente complète est : « Je tiens ici à marquer que quelqu’un ne s’y assoit que de la façon, de l’effaçon plutôt, qu’il y impose au vrai. », idem. [NDLR]
[12] Lacan J., id.
[13] Cf. Lacan J., « Note italienne », Autres écrits, op. cit., p. 309.
[14] Les « Conférences » de Bataille sont publiées dans les Œuvres complètes tome VIII, Paris, Gallimard, 1976 – ce sont en fait des transcriptions. Dans l’ordre, sans compter la première qui est une émission dont on ne sait plus très bien apparemment où elle fut enregistrée, « Le sacré au XXe siècle » [p. 187-189], celles qui ont eu lieu au « Collège philosophique » sont : « Les conséquences du non-savoir », 12 janvier 1951 [p. 190-196], suivie d’une « Discussion » [p. 197-198] ; « L’enseignement de la mort », les 8 et 9 mai 1952 [p. 199-209] ; « Le non-savoir et la révolte », 24 novembre 1952 [p. 210-213] ; enfin, « Non-savoir, rire et larmes », 9 février 1953 [p. 214-233].
[15] Cf. Lacan J., « Subversion du sujet et dialectique du désir », Écrits, op. cit., p. 804, note 1.
[16] Bataille G., « Les conséquences du non-savoir », Œuvres Complètes, tome viii, op. cit., p. 191.
[17] Ibid., p. 193-194.
[18] Ibid., p. 194.
[19] Ibid.
[20] Ibid.
[21] Bataille G., « L’enseignement de la mort », Œuvres complètes, tome VIII, op. cit., p. 199-209 et la note de la page 560 qui reprend l’édition de Tel Quel.
[22] Ibid., p. 560.
[23] Ibid.
[24] Ibid.
[25] Ibid.
[26] Lacan J., « Radiophonie », Autres écrits, op. cit., p. 441.