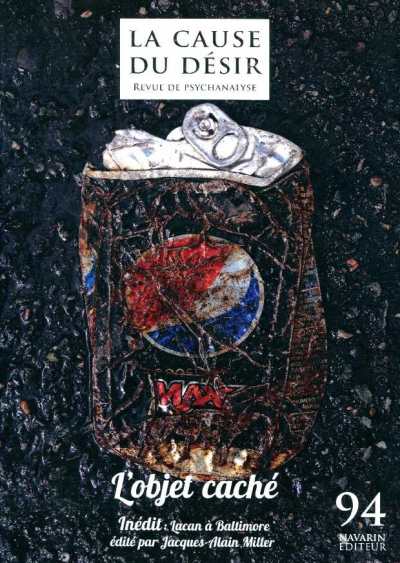L’image reine
Jacques-Alain Miller
"La Cause du désir n°94"
-
L’image reine
Jacques-Alain Miller
« L’image reine », c’est le terme qui m’est immédiatement venu lorsque les collègues brésiliens m’ont sollicité quant au titre de cette Rencontre[I]. Ce titre évoque l’ouverture plutôt que la fermeture. De plus, il convient bien pour une rencontre à Rio de Janeiro, ville qui est en soi un spectacle d’une grande beauté – où mieux étudier la souveraineté de l’image ?
Bien que « l’image reine » ne soit pas une catégorie appartenant à la langue de notre paroisse – pour reprendre cette formulation d’un de nos collègues – ce titre a tout de suite été retenu pour ces Journées, suscitant de nombreux travaux, dont certains déjà publiés dans le volume de la Rencontre.
Un homologue du signifiant-maître
J’ai introduit l’expression « image reine » comme homologue dans l’imaginaire, de l’expression « signifiant-maître » dans le symbolique. Le signifiant-maître, lui, appartient à notre paroisse, laquelle compte d’ailleurs beaucoup de paroissiens.
Le signifiant-maître n’est pas une catégorie freudienne. C’est une invention de Lacan, forgée de manière artificielle et qui désigne, à proprement parler, le signifiant par lequel le sujet cherche à être représenté dans le symbolique, inscrit dans la chaîne signifiante. Cependant, replacé dans l’œuvre de Freud, dans la terminologie psychanalytique, ce syntagme regroupe et met en série des concepts qui, sans cela, resteraient déconnectés – de l’Idéal du moi au Nom-du-Père.
Notre paroisse est habituée à ce terme de signifiant-maître, qui – il faut le dire – se comprend de lui-même. Ses effets de résonance s’étendent au-delà de notre champ. Et ce, bien que tout signifiant puisse venir à la place d’un autre. Car rigoureusement il n’y a pas de signifiant privilégié. C’est la définition même du signifiant – un élément x susceptible de métaphore et de métonymie. Puisqu’il y a égalité des signifiants, on ne devrait pas parler de signifiant-maître. Par définition, tout signifiant peut se substituer à un autre. L’expression même de « signifiant-maître » a donc un caractère paradoxal. On peut cependant soutenir ce syntagme en pure logique ou, disons, en quasi pure logique. N’entrons pas dans le détail, qui pourrait faire l’objet d’un séminaire. J’évoque seulement le « signifiant-maître » pour introduire cette tentative que constitue le terme « image reine ». Peut-il nous servir, pouvons-nous en faire bon usage dans le registre imaginaire ?
Les signifiants imaginaires en psychanalyse
Pour en revenir au registre imaginaire, une question se pose d’emblée (et je n’y répondrai pas, ou du moins pas complètement, dans cette conférence d’ouverture) – l’image reine est-elle un élément du registre imaginaire, tout comme le signifiant-maître est un élément du registre symbolique ? Cette affirmation est difficile à soutenir, sauf à signifiantiser l’image. L’image ne devient vraiment un élément du registre imaginaire qu’à la condition d’en faire un signifiant.
Ce point doit retenir notre attention. Les images se signifiantisent, elles peuvent se transformer en signifiants, être prises comme des signifiants, puisque les images, comme toutes choses, ne sont nommées que par la parole. Nous parlerons alors de signifiants imaginaires. Un signifiant imaginaire est-il encore une image ? À quelles conditions une image devient-elle un signifiant ?
Ces questions sont urgentes. L’étonnant est qu’elles n’aient pas été posées, qu’elles n’aient pas encore de réponse typique dans notre paroisse. Cela aurait pu m’inciter à proposer, comme titre pour ces Journées, « les signifiants imaginaires en psychanalyse ». J’ai pourtant préféré « image reine ».
Primat du dicible sur le visible
Les images, c’est un monde, elles abondent. Il y a les images du rêve qui n’ont pas la même structure que celles que nous percevons au réveil. Il y a les images du champ perceptif où le visuel prédomine. La prégnance de certaines images a été étudiée par la psychologie de la forme, la Gestalt Psychology : on a démontré qu’une formalisation opère de manière spontanée dans la perception visuelle de certaines images. Il y a des images que nous tentons de situer comme préalables à l’objectivité, la phénoménologie (celle de Merleau-Ponty en particulier) a essayé de décrire le monde avec de telles images. Il y a les images de l’art, produites et exposées pour libérer une satisfaction qui n’est pas aisément situable. Il y a les images qui proviennent de ce que la psychologie académique appelait la faculté d’imagination. Et que nous rencontrons dans la psychanalyse sous le nom de fantasme, spécialement en lien avec une satisfaction facilement repérable comme masturbatoire. En fin de compte, il y a pléthore d’images. Sans oublier les masques, les déguisements, les doubles, les simulacres et les fétiches...
C’est dans ce monde plein d’images et de théories de l’image que je pénètre avec le signifiant « image reine » en posant cette question – en psychanalyse, quelles images dominent l’imaginaire ? Quand il s’agit de psychanalyse, y a-t-il même encore des images ? La question mérite d’être posée dans la mesure où l’opération analytique, dans sa façon de procéder, paraît adéquate pour défaire ce que James Joyce appelle, dans Ulysse, l’« inéluctable modalité du visible »[2].
La modalité inéluctable en psychanalyse est plutôt celle du dicible. Dans la psychanalyse, le dicible prime sur le visible. Que faisons-nous au juste à nous occuper de l’image, à commenter des tableaux, au lieu de laisser tranquillement cette tâche aux historiens de l’art et même aux critiques, puisque c’est leur métier ? Encore que Rubens n’ait pas suscité beaucoup de critiques sur son art. Mais cela a-t-il à voir avec la psychanalyse ? Si oui, pourquoi ?
J’ai évoqué les images du rêve. Mais Freud ne s’arrête pas tant sur les images du rêve que sur son récit. Il s’agit de ce qui en est dit et non pas de l’image, de ce qui serait vu dans une modalité très spéciale du visible.
D’ailleurs, l’expérience analytique prescrit plutôt une suspension, un endormissement du champ perceptif au profit exclusif de la parole. Au point que recevoir le patient en face-à-face est toujours un peu inquiétant pour lui, sorte de concession faite à la structure et qui serait donnée au sujet, comme si le champ de l’Autre, abstrait en tant que tel, devait s’appuyer sur un support corporel. Avec l’espace laissé au voir, à la perception, dans le face-à-face, on peut toujours se demander – et les patients se le demandent – si l’on est, ou pas, dans le discours psychanalytique. Ce peut être le cas, mais cela génère malgré tout de l’inquiétude quand le visuel, le perceptif, insiste dans le champ analytique. En vérité, dans une psychanalyse, il n’y a rien à voir et il y a tout à dire. Quand bien même se déroulerait-elle en face-à-face, c’est toujours une invitation pour le sujet à s’abstraire de l’inéluctable modalité du visible et à renoncer à l’image au profit du signifiant.
Nos trois images reines
Dans ce naufrage de l’image, certaines subsistent pourtant. Et ce, pour la raison qu’elles se concentrent dans les dits des patients ou les déductions de l’analyste – la référence élective à l’image n’est en effet pas l’apanage du patient. Ces images qui survivent au naufrage du monde de l’image en psychanalyse, nous pouvons les appeler les « images reines » de la psychanalyse. J’en trouve trois, pas plus – le corps propre, le corps de l’Autre et le phallus.
Premièrement, le corps propre. C’est le corps qui m’appartient. À chacun son « mon corps ». Pour Lacan dans son stade du miroir, il s’agissait d’une forme visuelle dont il entendait montrer qu’elle était la matrice du moi. Il a donné au concept freudien de narcissisme sa référence à partir du corps propre. C’était faire du moi rien d’autre que l’idée de soi-même comme corps[3], définition qu’il donne dans son Séminaire sur Joyce, c’est-à-dire dans les derniers moments de son élaboration. L’image du corps propre appellerait bien d’autres développements que je vous épargne.
Deuxièmement, le corps de l’Autre. C’est celui sur lequel, selon Freud, nous lisons la castration. Chez Freud, la castration est pour ainsi dire une castration optique. Sa référence à l’anatomie – « l’anatomie c’est le destin »[4] – concerne en premier lieu non pas l’anatomie scientifique, mais le champ de la vision. En même temps, cette forme se prête à la formalisation signifiante, puisque c’est le support d’une présence et d’une absence.
C’est justement ce que Lacan souligne à propos de la troisième image reine, le phallus. Le phallus n’est pas l’organe masculin de la reproduction, mais sa forme érigée et transformée en signifiant, tout en conservant ses articulations imaginaires. D’ailleurs, c’est à propos du phallus que Lacan a risqué l’expression « signifiant imaginaire »[5] sur laquelle nous pourrions revenir. Les objets qui, dans la clinique, méritent d’être appelés « fétiches », dérivent du phallus.
Voilà en fin de compte ce que la psychanalyse extrait du monde des images : trois images reines. Ajoutons que chacune d’elles convoque un opérateur spécial qui agit dans le champ de la vision. Tout d’abord le miroir qui redouble et divise l’espace en trois dimensions. Ensuite le voile – appelé vêtement quand il recouvre le corps – qui opère la conversion magique, et métaphysique, du rien en quelque chose. Voiler une chose, rien de plus précieux quand c’est le rien qui est voilé. Car voiler le rien, c’est sans doute le faire exister. Le voile peut être ainsi désigné comme voile du rien pour laisser aux autres le soin de lui faire révéler définitivement quelque chose. C’est l’opération subtile du travesti. En troisième lieu, une série de mots, le support, le piédestal, le cadre, la fente, la fenêtre, bref, toute une série d’opérateurs visuels qui délimitent, isolent, ce qui peut être offert, exposé, par ce moyen, comme image Une. C’est dans cette série que nous rencontrons les opérateurs qui, de la meilleure manière, font des signifiants à partir des images. Ceci vaut aussi pour le miroir et le voile, étant donné que ces opérateurs isolent l’image en accentuant, en marquant son unité, sa valeur unitaire. Dès lors qu’il y a image Une, elle est signifiantisée.
Voilà les trois images reines. Je me suis contenté de regrouper trois images reines et trois opérateurs, une série d’opérateurs du visible qui ont un effet de signifiant. Dès lors, que vient apporter la catégorie de l’image reine, si, en dernière analyse, quand une image est réelle, elle est signifiante ? Pourquoi ne pas nous contenter de la catégorie du signifiant-maître ?
L’image, une modalité inévitable du fantasme
Il y a cependant au moins une différence entre signifiant-maître et image reine – les images reines ne représentent pas un sujet, elles sont coordonnées avec sa jouissance. Je soumets à la discussion le fait que ces images reines soient toutes trois impliquées dans le fantasme. Pour ne pas rester dans ce monde si pauvre en images, je réunis ces trois images reines en tant que présentes dans le fantasme de chacun.
Le fantasme est sans aucun doute de notre paroisse. Considéré comme une phrase, il a la fonction d’un axiome. Mais le fantasme relève aussi de l’imaginaire. L’image est une modalité inévitable du fantasme. Quand il n’y a qu’une phrase, sans qu’elle soit liée à une image ou à une représentation, il est difficile de qualifier cette instance de fantasme. En pratique, nous exigeons un élément imaginaire pour parler de fantasme et le reconnaître comme tel. Il n’y a pas d’objection à ce que je parle ici de « phrase-image » en me référant au fantasme. Une phrase-image, nous le savons, est habituellement une image figée. Évidemment, cette stase est magnifiée lorsque nous sommes captivés. Une image figée peut être une image-mouvement. Mais quand il s’agit d’une image fantasmatique, un mouvement répétitif fermé sur lui-même prédomine toujours. L’image fantasmatique est essentiellement une image immobile, un élément suspendu, fixe et erratique.
Disons que la souveraineté de l’image, si elle existe, procède d’une capture signifiante de la jouissance. Est-ce une souveraineté ultime ? Ces images sont sans nul doute sous un empire, l’empire du regard. Je parle d’empire parce que le regard n’est pas une image reine. De plus, dans sa définition, le regard proprement dit est le « sans image ». À travers lui, nous trouvons une représentation, un supplément. J’y reviendrai, le regard est « en plus », mais ce n’est pas une image reine.
Ces trois images reines relèvent toutes du corps, il y est question du corps. Elles marquent une fascination pour le corps, en particulier pour le corps propre de l’homme, du parlêtre. Cette prévalence unique du regard en comparaison avec le monde animal dénote une certaine dysharmonie de l’homme avec le monde. Cette prévalence du corps propre surgit précisément de la dysharmonie signifiante.
Le lieu où l’imaginaire s’amarre à la jouissance
Le corps analytique se distribue selon ces trois images reines, au point que nous pourrions dire : « Le corps, c’est ça, nous savons ce que c’est. » Or nous ne savons pas ce que c’est.
Par exemple, quid de l’image reine pour les Grecs de l’Antiquité qui ne connaissaient pas la psychanalyse ? « Le visage », nous répondraient-ils, ou du moins inscriraient-ils celui-ci parmi les images reines.
Prosopon, le terme grec pour « visage », désigne ce que nous présentons à la vue des autres, précisément par contraste avec le reste du corps, plus ou moins voilé par le vêtement. Il s’agit plus exactement de la face, de la partie située en dessous du metopon, de la tête. Définissant le prosopon comme la partie de l’homme comprise entre la tête et le cou, Aristote célèbre la fonction du visage comme ce qui est présenté à l’autre. Car l’homme, comme l’avait aussi observé Freud, est le seul animal qui se tient debout, regardant devant lui et projetant sa voix en avant. Le visage grec est celui qui émet en même temps le regard et la voix, c’est celui qui parle et qui voit – et ce, en même temps qu’il est vu, dans une parfaite réversibilité. De sorte que le prosopon grec est vraiment le blason du sujet, ce que chacun porte en lui et qu’il expose aux yeux de tous, manifestant ainsi sa propre individualité. Le visage est alors l’image comme signifiant du sujet.
Curieusement, le même mot est utilisé pour désigner le masque. Mais le masque grec, comme le montre un érudit dans une œuvre que je viens de terminer, ne masque rien – contrairement à ce qu’il est pour nous aujourd’hui – ; il représente et identifie.
Seule exception dans toute la littérature grecque, un unique personnage dont le visage est décrit comme un masque – Socrate, pour lequel, précisément, le visage n’est qu’apparence. Socrate est le seul Grec à penser que le visage n’est qu’une apparence de l’être. Voilà pourquoi Platon souligne que Socrate ne s’adresse pas au visage d’Alcibiade mais à son âme. Socrate est le paradigme, l’exemple parfait de sa propre théorie, car il était d’une laideur parfaite, une laideur achevée. Son visage est un masque au sens où on l’entend aujourd’hui, il dissimule la beauté cachée à l’intérieur. Vous le savez, son visage est comme un masque de Silène, masque fort peu attrayant et qui, sous cette apparence, recèle justement l’objet précieux, l’agalma.
Comme le suggère Lacan, ici commence peut-être quelque chose de la psychanalyse. L’analyste se veut « sans visage », en tant qu’il dissimule l’image invisible de l’agalma, l’objet auquel un voile est intimement associé, un voile qui dissimule justement le rien. Chez les Grecs, il n’y a que Socrate pour annoncer la psychanalyse, puisque celle-ci consomme la décadence de l’image reine qu’est le visage, le prosopon.
Laissons le visage grec à son Antiquité, ce n’est plus le nôtre, sauf quand, comme Socrate, nous sommes des boîtes à agalma. Mais retenons que les images reines sont le lieu où l’imaginaire s’amarre à la jouissance.
Le secret du plus-de-jouir
J’évoquerai à présent ce que j’avais à l’esprit quand j’ai proposé « l’image reine » (non sans penser à la splendeur visuelle de Rio). Nous connaissons cette référence, l’émoi de Freud sur l’Acropole d’Athènes et le titre qu’il lui a donné – « Un trouble de mémoire... » Voici le cœur de la question : quand Freud s’extasie devant le magnifique spectacle de l’Acropole d’Athènes, il n’a pas de trouble de mémoire. Le titre choisi par Freud est le résultat du phénomène qui se produit, à savoir ce qui vient à la conscience du sujet Freud et qui se formule de la manière suivante : Ainsi tout cela existe réellement comme nous l’avons appris à l’école ![6]
Freud constate que cet énoncé implique une schize, une division subjective devant l’image splendide. Il y a en lui, d’un côté, une personne qui sait que cela existe réellement et, de l’autre, une « autre personne » [selon l’expression de Freud] qui paraît douter. Je n’aurai pas ici le plaisir de suivre la longue analyse des méandres de sa « confusion » – autre qualificatif employé par lui. J’irai directement à la solution qui, pour lui, résout ce problème qu’il analyse.
Freud écrit que l’énoncé qui lui est venu à l’esprit implique qu’il a douté que l’Acropole existe effectivement. C’est la défense contre un autre énoncé. Il a douté de l’existence de l’Acropole et a évoqué un doute ancien parce qu’il se défend d’un autre énoncé. C’est la clef grâce à laquelle, nous dit-il, « toute cette situation apparemment confuse et difficilement descriptible se résout d’un coup ». Cet autre énoncé, que Freud ne considère pas comme un trouble de mémoire, est – ce que je vois là n’est pas réel. L’image de l’Acropole provoque chez Freud cet énoncé – Was Ich da sehe [ce que je vois là] ist nicht wirklich [n’est pas réel]. Il n’est pas question ici de Realität mais de Wirklichkeit.
Ainsi, une seconde division du sujet est dissimulée sous la première évoquée par Freud ; nous pouvons la nommer avec un terme utilisé pour la perversion, Verleugnung, soit un véritable démenti qui agit sur un bout de réalité. Quelle est la cause de cette division ? Face à la réalité perçue, ce sentiment d’étrangeté ne parvient pas à s’exprimer ; Freud préfère parler de « trouble de mémoire » et éviter le sentiment d’étrangeté. Mais quelle est la cause de ce sentiment contre lequel il se défend ? Le texte n’est pas ambigu, il s’agit d’une jouissance, d’un plaisir intense, « trop beau pour être vrai ». À la perception de l’image, Freud a lié une jubilation excessive, et pour cela interdite, provoquant la première division du sujet et le sentiment d’étrangeté contre lequel il se défend avec le « trouble de mémoire ».
Sans doute y a-t-il, comme il le dit lui-même, une culpabilité « attachée à la satisfaction d’avoir si bien fait son chemin », mais celle-ci reste fixée à un plus-de-jouir visuel. Derrière ce mécanisme complexe surgit la figure du père. Freud en vient à évoquer le surmoi sévère dont la censure frappe le plus-de-jouir visuel et empêche la jouissance (le terme Genuß, jouissance, figure dans son texte). Puis il fait référence à Napoléon se tournant vers son frère lors de son sacre – « Que dirait Monsieur notre père s’il pouvait être ici maintenant ? » – autrement dit, Et s’il pouvait nous voir ?... C’est le regard du père qui, chez Freud, perturbe la perception du spectacle imaginaire de l’Acropole.
Les frères Freud vont sur l’Acropole. La vision les comble. C’est alors que surgit le regard du père, qui fait retour sur leur jouissance. Faut-il ajouter que ces deux juifs de Moravie (pour qui, selon la tradition, le plus grand doit rester sans image) sont comme une tache dans le tableau où resplendit la beauté grecque ? L’Acropole devient ainsi l’équivalent de la célèbre boîte de sardines[7] qui regardait Lacan, cet exemple fameux du Séminaire XI. C’est aussi pour cela que Lacan pouvait dire – « Freud n’a pas besoin de me voir pour qu’il regarde. »[8]
Je ne crois pas déformer le texte de Freud en démontrant que le regard qu’il évoque (et qui relève peut-être du registre de la culpabilité), surgit avant tout du plus-de-jouir recelé par l’image perceptive. C’est ce plus-de-jouir qui provoque la censure. La beauté même de l’image, qui recèle le plus-de-jouir, cache le regard du père.
D’ailleurs, au-delà de l’horreur, de l’impuissance de Freud, qu’est-ce qui est voilé ? Dans le préambule, Freud se présente comme un homme appauvri dont la production s’est asséchée. Derrière le plus-de-jouir, derrière l’objet a, comme nous l’écrivons dans notre paroisse, il y a le – φ, la castration. Freud est à la fin de sa vie, il se présente revêtu de l’emblème de la castration et il la rencontre précisément dans ce qui a été élidé par le champ scopique. Il n’y a pas de meilleur exemple pour comprendre que l’objet a, le plus-de-jouir, visuel en l’occurrence, porte secrètement la castration. Freud confesse que cet épisode l’a ravagé dans sa vieillesse. Le trouble de mémoire qui ne se laisse pas oublier, c’est que Freud le déchiffre seulement lorsqu’il s’approche de – φ en tant que vieil homme, quasi impuissant, qui en appelle à l’indulgence de l’autre.
Une nouvelle théorie de l’image
Sous cet angle, cet exemple nous indique au mieux à quelles conditions se soutient le champ de la réalité perceptive – expression complexe, sans doute. Le champ de la réalité perceptive se soutient dans la mesure où nous disons ce que je vois est réel. Nous ne sommes pas dans la position où Freud s’est trouvé précipité – ce que je vois n’est pas réel. Habituellement, nous nous promenons dans le monde avec la conviction que ce que nous voyons est réel. Cet exemple nous montre que cet énoncé banal suppose le refoulement du sujet, du désir et de tout ce que Freud a été amené à analyser ici. Cela suppose ce que nous avons rappelé concernant l’extraction de l’objet a, venu s’inscrire pour lui dans le spectacle comme plus-de-jouir visuel et comme regard. Ainsi, l’homéostase se vérifie dans la perception, tandis que la levée du refoulement, concomitante du surgissement de l’objet a, s’accompagne de l’énoncé d’un sentiment d’étrangeté, ce que je vois n’est pas réel.
Se marque ici une antinomie entre le wirklich de la perception, le réel de la perception, et le wirklich de l’objet a. Nous ne pouvons pas avoir les deux ensemble. D’où le fait que l’un comme l’autre, chacun à son tour, peut être irréel. C’est au cœur des exemples que Lacan donne dans le Séminaire qui nous sert de référence, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. Avant d’aborder le tableau, l’anamorphose, etc., évoquant un exemple de sa vie personnelle ainsi que l’un des rêves de la Traumdeutung, Lacan se demande Qu’est-ce qui réveille ?[9] Toute son analyse est faite pour montrer que ce qui réveille n’est pas la perception du monde réel, même quand une porte claque. Ce qui réveille, c’est l’objet a dans le rêve, la rencontre dans le rêve avec une jouissance traumatique. La perception n’appelle pas, ou pas directement, le réveil de la conscience, à la différence des moments où le sujet rencontre l’objet a dans son rêve. Tout se passe dans l’espace entre perception et conscience, espace où, à travers ce que nous percevons, le perceptum, la réalité perçue, se répète la relation du sujet avec la jouissance. En ce sens, c’est le Trieb freudien, la pulsion, qui réveille.
On pourrait approfondir le parallèle qui s’impose entre le rêve du père, dans lequel son fils mort lui dit Père, ne vois-tu pas, je brûle, et le trouble du fils rapporté par Freud sur l’Acropole. Le rêve de L’interprétation des rêves où, dans sa douleur, le père vient regarder son fils au sein de sa propre absence, et l’épisode de l’Acropole tournent autour de la même chose.
Lacan propose – et c’est ce qui nous réunit autour de « l’image reine » – une nouvelle théorie de l’image dans la mesure où le champ de la perception est interrogé à partir du désir et de la jouissance. Avant Lacan, dans les marges de Freud, le champ de la perception n’avait été abordé qu’à partir du refoulement du sujet, en éludant le plus-de-jouir. Avant Lacan, le champ de la perception était toujours apparu comme le modèle même de l’homéostase, ce qui comportait un certain aveuglement quant à la jouissance.
Si les Grecs ont pu élaborer quelque chose comme la contemplation, c’est dans la mesure où le champ de la perception, spécialement le visuel, leur apparaissait comme prévalent, le plus-de-jouir y étant mis à distance, exclu, dominé, nivelé. La phénoménologie de notre siècle a inclus la présence du corps dans le spectacle du monde, mais elle n’a pas libéré de la proscription de la jouissance hors du champ de la perception. Elle s’est efforcée de décrire le monde perçu dans sa pureté, c’est-à-dire hors de la jouissance, à partir de la pure présence du perçu. Lacan a rétabli que le perceptum, mot latin pour dire « le perçu », est, en tant que tel, impur. Ainsi a-t-il rétabli la pulsion dans le champ scopique, s’efforçant de concevoir le champ scopique à partir de la pulsion.
Au-delà du miroir
Cela suppose, spécialement pour Lacan, un renversement complet, car cet effort implique – prêtons-y bien attention ! – de ne pas réduire l’imaginaire, le scopique, au spéculaire, soit de ne plus le penser à partir du miroir. Or, dès qu’il s’agit du champ de la perception, nous sommes focalisés sur le miroir.
Lacan a d’ailleurs été le premier à construire les fondements de la réduction de l’imaginaire au spéculaire, au miroir. Dans l’espace à trois dimensions, le miroir introduit avec certitude une division entre l’Un et l’Autre, entre l’être et l’apparence. Cela permet de penser les identifications du moi. Cependant, au motif de penser les identifications du moi, il a longtemps oublié l’au-delà du stade du miroir, que nous pourrons aborder lors de ces Journées.
Je dirai deux mots sur le parcours de Lacan que j’ai étudié avec minutie cette année[10]. Ce qui a conduit Lacan au miroir, c’est le concept freudien de narcissisme, d’où il a déduit que la libido était de nature narcissique. Tout un pan de l’enseignement de Lacan s’appuie là-dessus en inscrivant la jouissance dans l’ordre spéculaire. Il en résulte que la pulsion se retrouve placée sous la dépendance de l’image. L’image est alors reine au sens où elle semble dominer la jouissance.
J’ai détaillé dans mon cours la transcription symbolique de la libido que Lacan a tentée avec le terme de « désir », en le concevant comme une métonymie. Lorsqu’il lui est apparu que cette libido ne pouvait plus être réduite au désir, il a fait le Séminaire L’éthique de la psychanalyse, situant la Chose en face du grand Autre, tout comme l’objet a se place en face du sujet. Il a ensuite fait son Séminaire sur le transfert en le centrant sur un objet libidinal que nous ne voyons pas, un agalma invisible.
Puis, après avoir situé l’objet entre le signifiant de l’identification et l’affect d’angoisse, il a posé la pulsion scopique comme paradigme. Ce sont nos références du Séminaire XI ou de « L’objet de la psychanalyse ». Au terme de ce parcours, il a considéré la pulsion scopique comme un paradigme de l’objet a, dans la limite de l’expérience analytique. Pourquoi cherchons-nous, aujourd’hui encore, à situer l’objet a par rapport à la fonction scopique ?
Une formule signifiante pure
Quelque chose à propos de cet objet a reste, je crois, incompris. Nous croyons que c’est une chose. Nous pensons toujours l’objet a sur le modèle du sein ou de l’excrément ou même du phallus, c’est-à-dire comme un objet plein en relation avec le vide du sujet.
Pendant des années, j’ai essayé sans succès d’extirper de notre usage l’expression de « semblant d’objet » qui fait accroire que l’objet a est différent du semblant. Or, si Lacan se réfère électivement à la pulsion scopique pour traiter de l’objet a, c’est pour montrer que cet objet n’est ni le sein, ni l’excrément, ni le phallus, ni le regard, ni la voix. Que cet objet a comme tel est un semblant d’être qui n’existe pas, qui n’est pas wirklich. Et quand il est réel, tout le reste s’éteint.
Puisque nous avons beaucoup parlé de la pulsion scopique, prenons l’exemple de la pulsion orale. Lacan signale le paradigme, le modèle idéal donné par Freud relativement à la pulsion orale, soit une bouche qui se baiserait elle-même. C’est dire que l’objet propre de la pulsion orale n’est en rien quelque chose qui se mange. L’objet oral, comme n’importe quelle chose qui se mangerait, serait justement un leurre, un faux-semblant de la pulsion orale. Il laisserait la pulsion éternellement insatisfaite.
Quand Lacan invente l’objet a, ce n’est pas comme double de l’objet oral, mais comme trou, comme vide, semblant qui oblige la pulsion à le contourner. Il doit être pensé à partir de l’exemple topologique du tore dont le trou central n’a rien de réel, étant donné qu’il n’y a rien au-delà de sa surface topologique. C’est ce qui empêche, si vous tracez des cercles le long du tore, de les réduire à un point. Il s’agit simplement de cette impossibilité de réduire les cercles à un point unique. Voilà pourquoi Lacan recourt à la topologie, à une topologie idéale, pour situer l’objet a.

Les images proposées par Lacan, ses surfaces topologiques, sont les images reines de la psychanalyse. L’objet a n’est localisable que sur ces surfaces, car en trois dimensions, cela devient impossible. C’est une formule signifiante pure. Ce que nous appelons couramment « objet a » est simplement le support ou l’incarnation de la formule de l’objet a. Comme si la fonction logique et topologique que Lacan a baptisée objet a opérait une extraction sur le corps, soustraction nécessaire pour lui décerner sa valeur de plus-de-jouir. C’est un point sur lequel j’aimerais beaucoup insister dans un Séminaire pour en finir avec l’expression « semblant d’objet » qui va à contresens de la question.
Le regard est précisément l’incarnation de l’objet a. C’est une incarnation matérielle, puisque la relation à la lumière lui est nécessaire. Dans le tableau de Rubens qui illustre l’affiche de notre Rencontre[11], on a cherché à mettre en valeur l’élément brillant permettant de donner substance à la fonction logique de l’objet a. L’Acropole d’Athènes est sans aucun doute inondée de lumière. Pour le dire autrement, cette fonction logique trouve des incarnations dans le point lumineux, dans le point opaque ou dans la tache, mais toujours en relation avec la lumière. Sans doute, le regard peut être vu comme délimité et isolé, trouant la métrique de l’espace. Mais Lacan soutient que, si je vois le regard, je ne vois pas l’espace d’où je suis regardé. C’est pour cela que le point regard semble toujours surgir d’une autre dimension.
C’est dans l’anamorphose qu’une autre dimension de l’espace se déplie. On l’observe clairement dans Les Ménines, où il faut en passer par le plan projectif pour rencontrer l’objet invisible, – φ.
Dans l’objet a, il s’agit d’une élision de structure, laquelle ne peut être représentée que par un supplément. En tant que trou, l’objet a peut être équivalent au cadre, à la fenêtre, à l’opposé du miroir. L’objet a ne se laisse pas capter, spécialement dans le miroir. Lacan, qui a passé beaucoup de temps avec le miroir, le souligne. Il s’agit plutôt de la fenêtre que nous constituons nous-mêmes, en ouvrant les yeux. Voilà qui devrait nous arrêter, car cet objet a est celui de l’expérience de la passe.
Il ne s’agit pas d’un objet a substantiel, mais d’une pure formule. Ainsi, la chute de l’objet a, celle qui connote la passe, ne doit pas être conçue comme un renoncement à un avoir substantiel. Nul renoncement, nulle résignation. La passe comme chute de l’objet a concerne l’être et ce que vous êtes en tant que fenêtre sur le réel. La passe veut dire quelque chose comme voir la fenêtre et se connaître comme sujet de la pulsion, soit ce dont vous jouissez en en faisant le tour dans un sempiternel échec.
En sortant, vous verrez le soleil de Rio légèrement couvert. Vous pourrez dire ce que je vois est réel. Et alors vous laisserez l’image régner tranquillement sur vous.
* Cette conférence d’ouverture de la Ve Rencontre du Champ freudien au Brésil, L’image reine, qui s’est tenue les 29 et 30 avril 1995 à Rio de Janeiro, a été traduite et publiée (transcription et traduction : Maria Lúcia Homem ; révision et établissement du texte : Angelina Harari) sous le titre « A imagem rainha » dans Opção lacaniana, no 14, novembre 1995, p. 12-18. Traduction : Thierry Jacquemin. Édition : Pascale Fari, avec le concours d’Hervé Damase et de Véronique Voruz. Texte non relu par l’auteur, publié avec son aimable autorisation.
[2] Joyce J., Ulysse, Paris, Gallimard, coll. Folio, 1929 / 1957, p. 58.
[3] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le sinthome, Paris, Seuil, 2005, p. 150 : « l’idée de soi comme corps a un poids. C’est précisément ce que l’on appelle l’ego ».
[4] Freud S., « La disparition du complexe d’Œdipe », La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969, p. 121.
[5] Cf. Lacan J., « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 823.
[6] Freud S., « Un trouble de mémoire sur l’Acropole », lettre à Romain Rolland, janvier 1936, Résultats, idées, problèmes, t. II, Paris, PUF, 1985, p. 223.
[7] Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, Paris, Seuil, 1973, p. 89.
[8] Lacan J., Le Séminaire, livre XVI, D’un Autre à l’autre, Paris, Seuil, 2006, p. 92.
[9] Lacan J., Le Séminaire, livre XI, Les quatre concepts..., op. cit., p. 57.
[10] Cf. Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Silet » (1994-1995), enseignement prononcé dans le cadre du Département de psychanalyse de l’université Paris VIII, inédit.
[11] Il s’agit de La Toilette de Vénus.