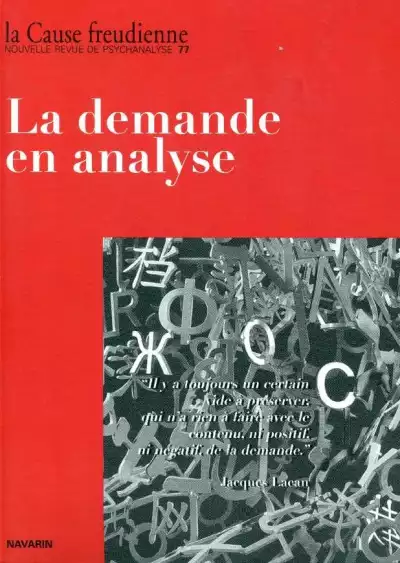L’économie de la jouissance
Jacques-Alain Miller
"Revue de la Cause freudienne n°77"
-
L’économie de la jouissance[*]
Jacques-Alain Miller
1. Le cogito lacanien
J’ai évoqué, la dernière fois, ce que j’ai appelé le cogito lacanien.
Il ne délivre pas un Je suis, mais – l’expression figure dans le texte de Lacan – un Se jouit, qui appellerait, si on voulait transformer cette expression en une phrase grammaticale, un il. C’est un jeu de lettres et de sons avec le Se jouit sur le Je suis.
(il) Se jouit
Jouir se dit gaudeo en latin – pour autant qu’il en provienne – qui porte plutôt le sens de se réjouir en latin classique. Derrière le terme de jouissance, il y a gaudia – la joie. J’ai consulté le dictionnaire étymologique qui m’a appris que le mot jouir provenait du latin tardif gaudire, alors qu’en latin classique c’est gaudere. Dans les transformations qui ont eu lieu au XIIe siècle, on a commencé par dire goïr, puis joïr. Il a fallu attendre le XIIIe siècle pour arriver à la forme jouir – dans le sens d’accueillir joyeusement quelqu’un ou quelque chose, faire fête. Ce qui domine, c’est donc la valeur de la signification de réjouissance.
Gaudeo Gaudia Gaudire Gaudere
Seulement, dès le milieu du XIIe siècle, ce mot a pris une valeur érotique – signalée comme telle par le dictionnaire. C’est après tout une chose mystérieuse, un miracle, une gloire de la langue française. C’est ce qui fait que les lacaniens d’autres langues s’en tiennent, avec leur accent propre, à dire jouissance. Les anglophones, en particulier, déposent les armes devant la jouissance française. Ils considèrent que c’est une spécialité locale de ces curieux indigènes que nous sommes. Le fait est là : le mot anglais to enjoy – qui a clairement la même source et appartient à la partie latine du vocabulaire anglais – n’a pas pris cette valeur qu’il a pour nous d’éprouver du plaisir, en particulier du plaisir sexuel. Il y a aussi un usage juridique du terme de jouissance – la jouissance d’un bien –, mais à part ça la valeur érotique marque bien ce mot. Il semble qu’il n’y ait qu’au Québec qu’on en soit resté à pouvoir dire Je jouis de quelqu’un pour signifier que l’on a de l’agrément à fréquenter telle personne en toute innocence.
L’usage lacanien du mot jouissance va-t-il marquer la langue ? Peut-être, puisque c’est un usage qui certes s’appuie sur le sexuel, mais qui étend la signification du mot jusqu’à englober le pulsionnel – avec ceci que la jouissance pulsionnelle est réductible, sous un certain angle, à la jouissance du corps propre et, qu’en ce sens, elle n’est pas sexuelle. La valeur sexuelle de la jouissance, nous en faisons dans notre usage un tremplin pour passer à une jouissance généralisée du corps.
Dans la pratique analytique, quand il s’agit de la manifestation de cette jouissance pulsionnelle, un passage se fait du Je suis au Se jouit ; passage où s’écrête le moi et s’évanouit le sujet. C’est la valeur acéphale du Se jouit qui réalise même l’ablation du il impersonnel.
Du « Wo Es war… » au « Se jouit »
Si on y songe, le passage du Je suis au Se jouit est l’inverse de celui dont Freud faisait un impératif : le trop fameux « Wo Es war, soll Ich werden », traduit par « Là où était le ça, doit advenir le moi », que Lacan, d’une façon plus poétique et d’ailleurs de manières diverses, avait traduit par « Là où c’était, Je dois advenir » – le Ich ayant ici la signification du sujet, du Je.
Cette injonction exprime une exigence de subjectivation. Là où c’était, là où était la pulsion acéphale et silencieuse – ce silence des pulsions dont Freud parle fameusement doit advenir le sujet, le sujet du signifiant. C’est ce que l’on a de façon familière conçu comme le fin mot de l’opération psychanalytique : la mise en mots – mettre en mots ce qui restait silencieux ou, encore plus familièrement, ce qui restait non dit.
Pour nous, la mise en mots – jusqu’à ce que nous rectifiions éventuellement cette conception – ne va pas sans mortification. Faisons entendre l’homophonie : la mo(t)rtification ! C’est une conception que Lacan a rendue classique – qui ne lui appartient pas en propre – selon laquelle le mot est le meurtre de la chose : le signifiant, spécialement celui qui vous désigne – votre nom –, vous survit. L’espèce s’emploie à la survivance du nom. Quand le pape était hier devant le monument de Yad Vashem, il articulait que les noms des disparus ne disparaîtront pas – ça ne mange pas de pain. Il voulait évidemment dire : ils ne disparaîtront pas, parce que les êtres qui les ont aimés se souviendront d’eux.
D’une part, le signifiant survit – pas vous. D’autre part, comme Lacan l’a développé de multiples façons, le signifiant tue. Il l’a même fait entendre dans le pronom personnel tu, prenant la valeur de tuant ou tué.
En ce sens, la subjectivation est une négativation.
Même sans prendre cet angle radical, il y a l’idée qu’à force d’en parler, on va user la chose, que cela va décharger une réserve libidinale emprisonnée dans le silence.
Moi, j’évoque précisément le contraire.
Avec Lacan, il s’agit d’un Wo Ich war, soll Es werden, « Là où le Je était, doit venir la jouissance » – je ne sais pas si ça peut s’entendre en allemand ; sans doute, puisque c’est décalqué sur le Wo Es war, soll Ich werden de Freud. Il s’agit de faire venir, de faire apparaître la jouissance. C’est ce qui pourrait être donné comme la formule de l’interprétation lacanienne : Là où était le Je, doit venir la jouissance.
Lacan pouvait écrire que la jouissance ne se dit jamais qu’entre les lignes, entre les signifiants – ce qui signifie qu’elle ne se dit jamais en propre, que ce qui peut s’en dire la tue. Quelque chose de la jouissance y disparaît.
Considérons ce qui, de la jouissance, reste vivant. Il n’y a pas de jouissance au présent sans la vie. On ne sait pas plus ce qu’est la vie que ce qu’est la jouissance. Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’il y a une appartenance entre ces deux signifiants – je n’ose pas dire concepts – : la vie, la jouissance. Si la jouissance ne va pas sans la vie, il faut alors qu’elle ne soit pas signifiantisée. On peut dire que la jouissance ne va pas sans la vie. Peut-on dire que la vie ne va pas sans la jouissance ? On peut se poser la question. Est-ce que les plantes jouissent ? En quel sens les animaux jouissent-ils ? Si c’est le cas, on n’en sait rien. Pour ce qui est des êtres parlants, on arrive tout de même à le savoir, à partir de ce qu’ils ne disent pas quand ils parlent. Il semble difficile de retirer la jouissance à la vie animale, au moins quand on les entend, ces animaux. Pour les poissons, c’est évidemment plus mystérieux, quoique l’on puisse les écouter avec des appareillages. Tout cela est déjà l’indication que lorsque nous parlons du signifiant, il ne faut pas seulement le prendre par le côté, évidemment majeur, où il a des effets de signification, mais aussi dans sa matérialité phonique. Pas seulement le sens, mais aussi le son. Pas seulement la parole, mais aussi le cri. Il y a, semble-t-il, quelque affinité entre la jouissance et le cri. Quand on remplace, dans l’ordre du signifiant, le cri par l’écrit, il semble que l’on s’éloigne de la dimension de la jouissance. On ne peut pas, avec l’écrit, imaginer en avoir le même témoignage.
Quand Lacan pouvait dire que la jouissance ne se dit qu’entre les lignes – ce qui supposait déjà qu’il ait distingué comme telle la jouissance, au moins par un mot –, il lui assignait, par rapport à l’ordre signifiant, la même place qu’au désir, puisqu’il faisait du désir le non-dit, l’impossible-à-dire de la demande, la marge que toute demande laisse en avant ou en arrière d’elle-même.
Désir et jouissance
Désir et jouissance – qui sont un effort pour ordonner l’expérience analytique sur deux vecteurs – sont les deux interprétations que Lacan a distinguées de la libido freudienne. Je l’avais dit, jadis, quand je m’en étais aperçu. Ce sont deux interprétations qui avaient au départ en commun d’être métonymiques par rapport à la chaîne signifiante, d’être dans une position de glissement, sans pouvoir être capturées, saisies. Pour simplifier, on pourrait dire qu’une de ces deux interprétations – l’interprétation de la libido comme désir – est une interprétation négative, et que l’autre – l’interprétation de la libido par la jouissance – est au contraire positive.
La première interprétation est négative dans la mesure où le désir est articulé à un manque – c’est le b.a.ba du lacanisme. Ce manque se résout lorsqu’il se dénude. Il apparaît alors, après coup, que le désir était une gonfle, une bulle, qu’il n’était, comme le disait Lacan, que la métonymie d’un manque. C’est la vérité menteuse du désir. D’ailleurs, quand Lacan avait l’idée que l’expérience de la passe pouvait trouver une conclusion logique, il en donnait deux formules, dont la première, sur le versant du désir, se concluait par le mathème de la castration – moins phi – comme étant la seule substance, négative, du désir.
(-φ)
La seconde interprétation, celle de la libido par la jouissance, c’est tout à fait autre chose. Si nous avons là, comme je l’ai indiqué il y a quelques semaines, du plus et du moins, ce moins n’est pas pour autant négatif. C’est un moins qui est un pas autant. Les variations de la jouissance sont des variations d’intensité qui restent dans le positif.
Il y a – pour le dire en court-circuit – une vérité menteuse du désir, une vérité qui fait s’interroger à son propos. Le désir est marqué par la question : Qu’est-ce que je désire vraiment ? Quand elle revient de l’Autre, cette question prend la forme que Lacan nous a donnée avec l’expression italienne : Che vuoi ? – expression qu’il avait trouvée dans un petit roman de Jacques Cazotte, Le Diable amoureux, au moment où le diable surgit sous les espèces d’une affreuse tête de chameau, laissant derrière lui son apparence précédente, celle d’une charmante petite blonde, amour du narrateur : Biondetta. C’est du sein de cette apparence ravissante que surgit l’horreur de ce Che vuoi ? – en italien dans le texte alors que tout le roman est en français. Ça pourrait nous faire penser à la nouvelle d’Edgar Poe, « L’ange du bizarre »[2], ange qui, singulièrement, parle avec un fort accent allemand. Dans Le Diable amoureux, c’est en italien. Le désir du narrateur était apparemment satisfait par cet objet charmant qui se révèle ensuite être un chameau. Cela manifeste que le narrateur n’en est pas au bout de son désir pour avoir fait halte dans cette oasis paisible.
Il y a donc une vérité menteuse du désir, alors que – en variant la formule auguste du maréchal Pétain – la jouissance, elle, ne ment pas. Vous avez peut-être en mémoire le slogan illustre qu’avait trouvé le speechwriter de Pétain, le nommé Emmanuel Berl : « La terre, elle, ne ment pas. » Eh bien, la jouissance ne ment pas. Elle n’est pas, en ce sens, marquée de négativité. Lacan, lui, avait trouvé comme symbole – corrélatif du moins phi du désir – le grand Phi comme impossible à négativer :

2. L’équivoque de l’objet a
L’objet a, si on essaye de le placer et d’en jauger l’usage dans la pratique psychanalytique, est un mathème à vrai dire équivoque, puisqu’il emprunte à la fois au désir et à la jouissance – à moins phi (-φ) et à grand Phi (Φ).

C’est pourquoi son usage a surclassé tous les autres mathèmes dans l’enseignement de Lacan. L’objet a est équivoque parce qu’il est essentiellement positif et qu’il comporte en même temps, en son cœur, la castration. Disons que l’objet a est un ambocepteur entre désir et jouissance. Rien ne le montre mieux que les deux définitions que Lacan lui a données au cours du temps. D’une part, l’objet a comme plus-de-jouir et, d’autre part, l’objet a comme cause du désir. Si Lacan a donné un tel développement à ce concept qu’il a forgé, c’est parce que c’est un terme qui accomplit comme une médiation entre le désir et la jouissance, une médiation entre les tromperies du désir et la constance positive de la jouissance.
Cette médiation ne durera que jusqu’à ce que cette solution des paradoxes de l’expérience par l’objet a, c’est-à-dire le salut par l’objet a, apparaisse à Lacan comme marquée de semblant, lui semble pâlir au regard du réel. Lacan lui a donné consistance par d’extraordinaires constructions logiques et topologiques, mais au regard du réel, l’objet a est quand même un artifice théorique. Il fonctionne comme une unité de jouissance que l’on mettrait en fonction dans une analyse, unité que l’on aurait à viser par l’interprétation et où l’analysant trouverait la clef de son être.
Assurément signifiant
Comment l’objet a s’est-il inventé ? À mon sens, à partir de l’idée géniale de transférer, de transporter ou d’exporter la structure de langage vers la jouissance, vers la substance de la jouissance qui apparaît si difficile à capter. À partir de la linguistique structurale de Saussure, on dispose d’un appareil, d’une grille, d’une articulation et on considère, ensuite, que la jouissance lui est ordonnée. Lacan a fait la preuve que l’on peut parler assez longtemps pour donner de la force à cette hypothèse, de la beauté, de la consistance et de la crédibilité. Ceci jusqu’à ce que se découvre un certain break-down, à savoir que ça ne tient pas le coup jusqu’au bout. Dans l’enseignement de Lacan en tout cas, le transfert de la jouissance vers la structure de langage ne tient pas le coup jusqu’au bout. Cela ne veut pas dire qu’on efface tout et qu’on recommence, mais il faut bien constater que cette entreprise est tout de même finalement inapte à capturer l’expérience de la substance jouissante.
Cette entreprise de transport-export est développée par Lacan sous la forme : la pulsion est une chaîne signifiante. Pourquoi pas ? Pourquoi ne pas dire, en effet, que la pulsion est une demande, une demande que l’on ne peut pas refuser – pour le dire à peu près comme Marlon Brando dans Le Parrain –, acéphale : c’est une exigence du corps. C’est seulement au niveau de la pulsion que la traduction anglaise du mot de demande par demand est valable, puisqu’en anglais demand veut dire exigence. Ce mot anglais ne convient donc pas du tout pour traduire la demande formulée par le sujet qui parle ; la bonne traduction est to ask, to ask for. Demand n’est valable, quand on traduit Lacan, qu’au niveau où il s’agit de la pulsion.
Lacan nous dit que la pulsion est une chaîne signifiante. Il faut de la bonne volonté pour accepter ce point de départ ! Si la bonne volonté manque, il reste à dire ce que dit Lacan, que c’est une chaîne signifiante dont les éléments sont les objets fantasmatiques : l’objet oral, l’objet anal, le phallus, objets qui sont, dit-il à la page 614 des Écrits – c’est comme cela que sa construction a commencé – « assurément signifiants ». Quand je déchiffrais jadis l’enseignement de Lacan et que j’étais tombé sur le texte « La direction de la cure… » – même si j’avais pris cet enseignement à un moment où Lacan s’était déjà exprimé sur l’objet a comme étant tout à fait différent d’un signifiant – je me souviens avoir mis un point d’interrogation sur cet assurément signifiant. Cet assurément signifiant était appelé par cette conception – conception restée fondamentale chez Lacan – consistant à transporter la structure linguistique vers la jouissance, à transformer la pulsion en chaîne signifiante, ce qui impliquait de dire que ces objets étaient des signifiants. Comment dire le contraire, puisqu’ils ont des noms ? Cette doctrine peut donc se plaider.
Ce qu’on appelle la théorie de Lacan se développe de cette manière : c’est une suite de plaidoiries. Il y a – je simplifie – une intuition, une hypothèse de départ, et Lacan rassemble ensuite les arguments qui les rendent crédibles. On le voit parfois lui-même, d’une semaine à l’autre, avoir échoué à se convaincre et reprendre par ailleurs. Ce sont des tentatives – celle du transport de la jouissance vers la structure de langage étant d’une grande ampleur. Cette tentative est, d’une certaine façon, plus naïve au début. L’idée du transfert de la structure du langage sur la jouissance va tenir le coup pendant plus d’une décennie chez Lacan, mais, au début, il l’attrape plus sommairement, plus naïvement. C’est là que l’on voit surgir cet assurément signifiant.
En retrouvant ce passage de « La direction de la cure… », j’ai aussi retrouvé le passage sur lequel j’ai été interrogé, lundi soir, par Victoria Woollard. Ce n’était pas facile de répondre, puisqu’elle m’interrogeait sur deux traductions anglaises différentes d’un passage de Lacan, sans me donner le texte français de référence – elle pensait sans doute que je savais tout Lacan par cœur. Je cite ce passage de Lacan qui se trouve à la page 617 des Écrits : Par l’intermédiaire de la demande, tout le passé s’entrouvre jusqu’au fin fonds de la première enfance. Demander, le sujet n’a jamais fait que ça, il n’a pu vivre que par ça, et nous prenons la suite. On m’interrogeait sur la traduction de ce et nous prenons la suite. Il y avait visiblement une difficulté à traduire cette fin de phrase. Ce et nous prenons la suite veut évidemment dire que, comme psychanalystes, nous prenons la suite en tant que, dans l’analyse aussi, le sujet continue de demander.
La distinction lacanienne de la demande et du désir – celle qui nous avait particulièrement frappée à l’époque par sa clarté et sa faculté de mettre en ordre les phénomènes de l’expérience psychanalytique – n’a pas simplement pour but de dégager la fonction du désir, mais aussi la fonction de la pulsion comme forme supérieure de la demande, c’est-à-dire une demande dont les éléments ne sont pas les signifiants de la langue mais les signifiants du corps. C’est une forme supérieure de demande, puisque le graphe de Lacan est construit sur ce schématisme. Il comporte deux lignes, celle du bas étant la demande, celle du haut, la pulsion – conçues comme parallèles, voire simultanées au niveau temporel, où les signifiants sont des signifiants organiques, ainsi que s’exprimait Lacan à l’époque. La chaîne supérieure est, dit-il, constituée de signifiants, c’est-à-dire qu’elle se développe en termes de pulsion.

Le second trésor de la langue
De la même façon que nous avons au niveau inférieur le signifiant grand A – où sont supposés co-présents la batterie phonématique de la langue, le dictionnaire et tout ce que l’on peut rassembler de façon indistincte sous le nom de trésor de la langue – nous avons, sur l’étage supérieur du graphe, un second trésor de la langue. Vous trouvez cela dans le texte « Subversion du sujet et dialectique du désir… », page 817 des Écrits, puisque Lacan a continué de perfectionner son approche au cours des années. Ce second trésor de la langue, où est rassemblée la langue du corps, je l’appellerai A2 pour la circonstance. Ce sont les archives de la demande pulsionnelle, les archives de ce que l’on appelle, encore aujourd’hui, les traces archaïques.
C’est à ce niveau que Lacan place le mathème (S ◊ D) – que j’ai longuement commenté jadis – désignant l’acéphalité de la demande pulsionnelle, où le sujet manifeste sa disparition par la barre qui le frappe, étant entendu que s’évanouit aussi la demande comme demande de parole, comme demande parlée.
La coupure et le phallus
Lacan nous dit gentiment que ce qui reste, c’est la coupure elle-même, la coupure que l’on retrouve – je simplifie – dès qu’il est question de jouissance.

Lacan fonde ainsi l’essentiel de l’introduction de la structure de langage dans la jouissance sur la coupure – la coupure qui isole les unités de langage, mais que l’on retrouve dans la délimitation des zones érogènes qui, dans l’organisme, sont spécialement des lieux de bord. Nous avons, si je puis dire, comme une broderie des objets pulsionnels. Cette coupure présente au niveau de la jouissance, nous considérons qu’elle est ce qui articule la jouissance à la structure de langage, ce qui la fait conforme à cette structure.
Il n’en reste pas moins que ce mot de coupure – que Lacan va aussi valider par la topologie : on coupe avec des ciseaux et on obtient des effets transformatifs sur la structure des objets mathématiques – reste tout à fait équivoque. La coupure proprement linguistique introduit en effet du négatif, du moins, alors que la coupure que l’on peut vouloir désigner au niveau libidinal n’annule pas la positivité d’ensemble. Le terme de coupure est donc aussi un ambocepteur. Il doit d’ailleurs sa popularité à ce caractère – popularité qu’il a conservée dans l’usage lacanien commun, dans les différentes communautés qui se réfèrent à l’œuvre de Lacan.
Nous avons un ambigu de désir et de jouissance, un ambigu linguistico-libidinal, avec quoi nous pensons pouvoir résoudre les paradoxes que l’expérience psychanalytique nous propose.
Ce qui justifie que j’écrive un second grand Autre, un pseudo second grand Autre sur l’étage supérieur du graphe, c’est que Lacan va rassembler corrélativement sur ce même graphe les paradoxes de S (Ⱥ) – paradoxes strictement signifiants. Il pousse si loin la signifiantisation de la pulsion, qu’il affecte au second point de recroisement tous les paradoxes signifiants de S (Ⱥ), retrouvant la négativité de Ⱥ et ne sauvant le positif que par le grand S figurant dans ce mathème – grand S non barré qui demeure, quoi que Lacan ait pu dire par la suite, le signifiant qui ne se négative pas à ce niveau. Il est donc bien, par là, équivalent au grand Phi (Φ) impossible à négativer.

Ce que Lacan entend préserver, c’est le signifiant de la jouissance. Ce signifiant, il le désigne avec un emblème phallique, en posant que c’est le phallus qui donne corps à la jouissance. Dire que c’est le phallus qui donne corps à la jouissance – c’est ainsi qu’il l’écrit – ne veut dire qu’une seule chose : ce n’est pas le corps qui donne corps à la jouissance. Cela veut dire que, dans le corps, la jouissance est négativée et que l’impossible à négativer de ladite jouissance se concentre dans le phallus.
Si on prélève cette formule, il faut bien dire que, comme telle, elle ne tient pas. Qu’il y ait un privilège du phallus, de sa forme, de son image, de son signifiant, pourquoi pas ? Nous en avons toutes les preuves à l’appui. Mais réserver au phallus de donner corps à la jouissance, c’est à se demander où l’on vit ! Le point de vue selon lequel c’est le corps qui donne corps à la jouissance est quand même beaucoup plus sensé. Combien plus sensée est la notion de substance jouissante, la notion qu’il y a un statut du corps qui est corps de jouissance ! Ce qui n’empêche d’ailleurs pas que cette jouissance puisse se condenser dans des lieux du corps.
Tout ceci, au fond, parce qu’il fallait tout de même – et tout est là – que Lacan, pendant la plus grande partie de son enseignement – nous le voyons après-coup – localise la jouissance. Impossible de faire avec la jouissance si on ne la localise pas ! On peut suivre, au fil de son enseignement, les lieux de la jouissance, on peut voir comment il a assigné divers lieux à celle-ci.
Il l’a d’abord assignée – à chaque fois les preuves sont surabondantes – au phallus : Regardez dans cette direction ! C’est le phallus qui donne corps à la jouissance, tout est fait pour ça ! Que ce soit dans l’anatomie du corps, dans l’imaginaire ou dans le symbolique, tout est fait pour que ce soit le phallus qui donne corps à la jouissance.
Il a ensuite localisé la jouissance dans les fantasmes. Comme on est là devant une extraordinaire multiplicité, Lacan a inventé le fantasme fondamental. Il faut qu’il y ait un fantasme fondamental qui localise la jouissance, un fantasme et un seul ! Nous avons la même logique qui lui faisait localiser la jouissance dans le phallus. Ce que les objets pulsionnels peuvent condenser de jouissance, ils le doivent au Un phallique, ils ne sont pensables qu’à partir de la fonction phallique. C’est cette même logique phallique qui fait ensuite surgir le concept du fantasme fondamental. Lacan n’a seulement employé qu’une ou deux fois par écrit cette expression. Et tout le monde, alors, de le chercher : Quel est mon fantasme fondamental ? Tout le monde fait bien de le chercher. La quête du fantasme fondamental est un support valable de la recherche analytique dans le cadre de la vérité menteuse. Mais, de là où nous sommes un peu en retrait, un peu à distance –, ce que nous voyons, c’est comment cette logique unaire, et même unienne, cette logique de l’Un, impose sa forme à la réflexion de Lacan.
3. Du fantasme à l’interprétation
Qu’en dire, de cette logique ? Elle est marquée par ce que Lacan dégagera plus tard comme étant un trait propre de la sexuation masculine. C’est seulement du jour où il a abordé la sexuation féminine – avec les moyens de sa logique, mais justement en la tordant, la compliquant – qu’il s’est décalé de cette logique du Un, de cette logique unienne.
La molécule fantasmatique
Le fantasme, qu’est-ce que c’est chez Lacan ? C’est une sorte de molécule, au sens où une molécule est un assemblage de particules ou d’atomes qui forment une petite masse de matière. Une molécule, c’est susceptible de se transformer au cours – c’est ainsi qu’on l’appelle – d’une réaction chimique. Quand Lacan écrit le fantasme avec son mathème S (Ⱥ), c’est comme une formule chimique, comme H2O pour l’eau, CH4 pour le méthane. C’est une molécule dont les deux éléments, $ et a, sont susceptibles de se séparer.

On apprend en chimie que les molécules se transforment assez facilement : on verse quelque chose de bien choisi, on chauffe et ça transforme les molécules. Je ne vais pas au-delà de la chimie amusante. Par contre, les atomes sont, eux, beaucoup plus stables. Pour transformer les atomes, il faut ce qu’on appelle une réaction nucléaire. L’atome sujet et l’atome a, pour arriver à les transformer, si c’est pensable, il faut se situer au niveau nucléaire. Le fantasme fondamental est, comme molécule, au-delà de cette forme, composé d’un atome de signifiance et d’un atome de jouissance. La question est alors d’obtenir, par une réaction chimique, la séparation de l’atome de signifiance et de l’atome jouissance. Cela ne s’accomplit, au niveau du fantasme fondamental, qu’au moment de la traversée dudit fantasme – traversée fait d’ailleurs penser à un terme alchimique. Toute interprétation opère sur une telle molécule, toute interprétation vise à séparer l’atome de signifiance et l’atome de jouissance dans la molécule fantasmatique.
Il n’est pas sûr que l’on ait raison de s’exprimer comme s’il y avait une substance de la jouissance qui précède l’atome de signifiance et soit indépendante de lui. On peut être tenté de le faire. Quand on s’exprime avec un certain relâchement sur ce sujet, on va dans cette direction – comme on le fait aujourd’hui dès lors que l’objet a est quand même un éclopé de la théorie lacanienne : il n’est plus à la pointe. On dit : la jouissance. Par ce fait même, on distingue ce que l’objet a a de restreint et d’unitaire au regard de cette jouissance, que Lacan lui-même, dans son Séminaire Encore, marquait d’un grand J entouré d’un espace désignant une certaine matière amorphe.

On a tendance à parler de la jouissance comme d’une matière amorphe, pour la bonne raison que, comme on prend la jouissance pour le réel, on considère qu’il n’y a aucun prédicat qui lui convienne. Autrement dit, de la jouissance, on fait de l’antéprédicatif, comme s’exprimait le bon Husserl, c’est-à-dire ce qui concerne tout ce que l’on peut éprouver et sentir avant que la grille des prédicats ne vienne se saisir de ce dont il s’agit.
Y a-t-il une substance de la jouissance qui précède le signifiant et en soit indépendante ? Le rappel de la molécule était fait, si l’on doit ordonner les choses temporellement, pour montrer que l’atome de jouissance suppose l’atome de signifiance. Ce que Lacan développe sur la marque est précisément de cet ordre : il faut la marque signifiante qui mortifie la jouissance et opère une déperdition pour qu’en supplément se présente le plus-de-jouir. C’est ce qui nous fait vraiment voir que, dans ce que Lacan appelle l’objet a, la jouissance se moule sur le signifiant.
L’interférence de la vérité menteuse
Si l’on prend ses distances avec cette référence-là, il n’en demeure pas moins que cette construction fait valoir, concernant l’apparition de la jouissance, qu’elle vient toujours en remplacement, quand bien même on n’en serait plus à la localiser dans une unité. Même si on admet que la jouissance est partout, que la jouissance est du corps, il n’en reste pas moins que tout se passe comme si elle avait été perdue et retrouvée comme Eurydice – retrouvée, mais comme une autre –, ce qui fait que ce n’est pas la bonne. La psychanalyse n’aurait pas de consistance si l’expérience analytique n’était pas parcourue par le fil selon lequel la jouissance qu’il y a est celle qu’il ne faudrait pas.
C’est à ce niveau-là que s’introduit une négativité. La négativité ne s’introduit pas au niveau du Se jouit. Elle s’introduit au niveau où ça se jouit, mais où il ne faudrait pas que ça se jouisse comme ça. Il y a là une interférence de la vérité menteuse dans la jouissance qui ne ment pas.
Qu’est-ce qui opère du signifiant ? C’est bien parce que l’on ne peut pas être assuré qu’il y ait de la jouissance là où il n’y a pas le signifiant, qu’il faut supposer que le signifiant n’a pas simplement des effets de signifié, mais aussi des effets de jouissance. Ce serait comparable aux cloches. Si la première fois qu’une cloche bat, il se produit une fêlure, vous continuerez ensuite, chaque fois que vous sonnerez le carillon, à entendre cette fêlure de la cloche. La jouissance, c’est cette fêlure-là, c’est la fêlure de la cloche.
Un mode du dire
Si l’interprétation se mesure à la jouissance, alors l’interprétation est sollicitée, non par ses effets de sens, mais par ses effets de jouissance. Elle ne concerne pas seulement par ses effets signifiés, mais aussi par ses effets corporisés. C’est ce qui faisait que Lacan avait pu rêver d’un effet de sens réel.
Si c’est à la jouissance que se mesure l’interprétation, on est bien forcé d’élaborer l’interprétation comme un mode de dire spécial, qui n’est pas de la dimension de la signification, pas de la dimension de la vérité, mais qui accentue, dans le signifiant, la matérialité, le son. C’est l’hypothèse à laquelle Lacan était arrivé – et c’est une hypothèse radicale.
On est, en effet, parti de très loin. Il n’est pas sûr que Freud faisait, au début, une différence entre interprétation et construction. C’est seulement à la fin de sa trajectoire qu’il a isolé la construction de savoir, en disant qu’elle est distincte de ce qu’il faut dire à l’analysant. Mais le concept d’interprétation vient quand même de là, de la communication d’un savoir. À partir du moment où l’on mesure l’interprétation à la constance de la jouissance, on la fait émigrer de l’interprétation de savoir vers le cri. C’est pourquoi Lacan a pu dire que l’interprétation efficace était peut-être de l’ordre de la jaculation, c’est-à-dire un usage du signifiant qui n’est pas à des fins de signification, à des fins de signifié, mais où c’est le son, la consistance même du son, qui pourrait faire résonner la cloche de la jouissance d’une façon qui convienne, pour que l’on puisse s’en satisfaire.
Nous sommes ici obligés de faire une disjonction entre jouissance et satisfaction. Il n’y aurait pas d’expérience analytique si la jouissance était satisfaisante. C’est précisément parce que le ver est dans le fruit même de la jouissance qu’une analyse est concevable, où une jaculation puisse rectifier – ainsi que Lacan le disait dans ses premiers temps en parlant de rectification subjective comme premier moment de l’analyse –, rectifier non pas le sujet, mais la jouissance. Il s’agirait d’une rectification de jouissance, afin qu’elle puisse être conçue comme satisfaisante.
J’ai touché – au moins visé – cette cible qu’est l’économie de la jouissance.
Lacan pouvait en dire – page 105 de son Séminaire Encore –, au moment où il prenait le tournant de son dernier enseignement, que ce n’était pas encore près du bout de nos doigts, et qu’il y aurait tout de même un petit intérêt à ce que ça arrive.
Bien que j’aie abondamment glosé les années précédentes sur ce dernier enseignement, je pourrais, pour en donner le nerf, adopter cette formule d’économie de la jouissance.
Ce n’est pas une invitation à être économe, mais à tenter de clarifier la distribution de cette jouissance : sa distribution dans le symptôme et dans le fantasme, sa distribution dans la parole et dans le corps.
Le mot d’économie est de pure provenance freudienne. Freud appelait économie le point de vue à prendre sur la libido – sa circulation, son organisation –, à distinguer de la distribution topographique de l’inconscient, du subconscient et du conscient. Le point de vue économique, quand Freud l’apporte engagé comme il l’est dans l’élaboration sur la psychanalyse, est déjà distinct des merveilles qui lui étaient apparues de l’interprétation comme déchiffrage.
Le déchiffrage, c’est ce dont Lacan était parti. Il y avait donné son fondement dans la « structure de langage » – j’y mets les guillemets – empruntée à la linguistique structurale – emprunt qui suivait les traces de Lévi-Strauss enseigné par Roman Jakobson. À cette structure de langage, il avait apporté un certain nombre de modifications, de façon à ce qu’elle soit d’usage dans la psychanalyse, qu’elle puisse y servir. Il y était question d’éléments signifiants, d’effets signifiés et du rapport entre le signifiant et le signifié. Lacan avait ajouté dans son pot la théorie de la communication, où il était question de locuteur et de destinataire, de message, de lecture et de ponctuation.
L’économie de la jouissance, c’est autre chose.
Lacan, après vingt ans de constructions, pouvait en dire que ce n’était pas encore à sa portée. Est-elle davantage à la nôtre maintenant – nous qui l’avons suivi dans son effort ultime, dans ce tournant qui consiste à essayer de donner à cette économie de la jouissance une articulation qui puisse faire foi par rapport à la structure de langage ?
4. La substance jouissante
Ce qui vient tout au moins à notre portée, c’est apparemment quelque chose que je m’amuserai aujourd’hui à appeler la philosophie de la jouissance, puisque s’agissant de la jouissance, nous avions chopé, les dernières fois, le terme de substance. J’y avais même ajouté pour le compte, le terme d’antéprédicatif qui m’était venu – anté au sens d’avant. L’antéprédicatif désigne ce qui est en deçà de la prédication – non pas de la prédication religieuse, mais de la prédication au sens de la logique du prédicat. Si je voulais faire bref, je dirais que l’antéprédicatif est ce dont on ne peut pas parler, ce que l’on ne peut qu’éprouver.
Le mot substance est rare dans notre usage, comme dans celui de Lacan d’où d’ailleurs il procède. Quand nous l’avions introduit, nous n’avions pas dit de la jouissance qu’elle était une substance. Nous avions seulement dit que le concept de jouissance, pour autant que nous pouvions arriver à le saisir – comme le comporte le mot de concept –, appelait le concept de substance, requérait une référence à la substance. Notre intérêt s’est centré sur l’expression de substance jouissante. Dans cette expression, c’est la jouissance elle-même qui est un prédicat. Nous avons fait intervenir une substance qui jouit, et comme nous ne désignons cette jouissance que par là, on pourrait dire, en employant le terme de Descartes, que cette jouissance serait l’attribut principal de ladite substance.
Descartes et Aristote
Descartes, c’est en effet là que s’enracine et se motive cette curieuse adjonction de la jouissance au jeu des substances. Descartes distinguait deux substances : la substance pensante et la substance étendue – les corps, en particulier ceux qui sont vivants et dont nous avons besoin dans notre substance jouissante, étant résorbés, comme ses modes, dans la substance étendue.
Si on prend comme point de départ le binarisme cartésien des substances, la psychanalyse implique d’y apporter d’autres modifications. La conception qu’on peut se faire avec Descartes de la substance pensante est évidemment modifiée par l’apparition, la découverte et la nécessité de loger ce que Freud a appelé l’inconscient fait de pensées. Le sujet auquel nous avons affaire dans l’expérience analytique ne procède pas du cogito, ne procède pas du sujet qui pense. L’existence du sujet dans la psychanalyse procède du sujet qui parle. Dans la psychanalyse, penser et parler font deux.
Dans une séance analytique, le sujet qui pense, il la boucle ! Je rencontrais ça hier encore avec un patient : Oui ?... Oui ?, ai-je dit – c’est là tout un discours, quand c’est dit avec le ton qu’il faut, qui se déchiffre comme un Alors, ça vient ? Ce sujet, sous les espèces du patient, était venu me voir sous la forme d’un J’ai trop d’idées. Voilà un moment où l’on vérifie la disjonction entre le sujet qui pense et le sujet qui parle. Il n’y a pas de mal à ce que le sujet pense de tout son saoul entre les séances, mais, dans la séance analytique, le dispositif comporte que le sujet sacrifie – on l’espère – l’abondance de sa pensée au fait de parler, au fait de parler à tire-larigot dans le temps qu’on lui laisse pour le faire. C’est de là qu’on espère que prenne forme, consistance, poids, un certain Je suis qui ne soit pas trop évanescent. Si l’on se place dans le fil des conséquences de ce qui est dit, on attend d’atteindre, comme le dit Lacan, un certain réel. S’il y a un sum dont se fait la somme dans l’expérience, c’est à partir de ce qui est parlé, et non à partir de ce qui est pensé. On comprend en conséquence que Lacan ait pu s’emparer des schémas de la communication et que nous ayons continué, à l’époque, à le suivre sur ce chemin.
Pour autant, le sujet qui parle n’est pas du tout une substance. La psychanalyse a plutôt comme hypothèse que c’est l’inconscient qui en l’occurrence fait substance – Freud lui-même a d’ailleurs été tenté de la naturaliser, ainsi que le disent les fervents des neurosciences. Ce que, dans la psychanalyse, nous appelons sujet, n’est pas une substance ; c’est seulement un supposé. Ça ressemble à la substance parce que, dans l’imaginaire, on le met dessous les phénomènes, dessous ce qui apparaît. Mais le sujet comme sujet du signifiant, une fois qu’on a réduit la parole à la chaîne signifiante, il est ce qui est supposé à l’articulation d’un couple de signifiants – rien de plus. C’est même la valeur que l’on peut donner à l’écriture familière de $ – sujet n’est pas substance.

Aristote distinguait sévèrement, dans ses catégories, le terme d’ousia qui, latinisé, a donné notre substance, et le terme d’upokeimenon, où Lacan voyait le répondant de ce qu’il appelait sujet – la confusion des deux étant spécialement dommageable. Toute la structure du langage telle que nous nous en servons s’est en effet élaborée dans l’élément du non-substantiel. Quand nous parlons d’articulation signifiante, nous voulons dire qu’un signifiant n’est pas une substance qui puisse être conçue par elle-même, mais est au contraire relatif à un autre signifiant, voire à l’ensemble des signifiants. Le point de vue structuraliste, comme tel, a donc partie liée avec le non-substantiel.
Je disais que je commençais par une philosophie de la jouissance, mais je n’en trace qu’une esquisse, puisque je tiens compte, et de vos connaissances, et de vos intérêts. Retenons au moins qu’il s’agit, avec la jouissance, d’une certaine modification de la substance pensante. Corrélativement, la substance jouissante est aussi une modification conceptuelle de la substance étendue en ce qu’elle y réintroduit le corps, l’unité du corps vivant.
Quand nous risquons l’expression de substance jouissante, il s’agit de la substance corporelle. Il s’agit du corps vivant considéré comme substance, dont l’attribut principal serait la jouissance en tant qu’affection de ce corps. La jouissance serait propriété et affection du corps vivant. Je ne crois pas excessif de dire que la substance jouissante fonctionne comme l’attribut essentiel, au sens où l’entendait Descartes, puisque Lacan dit que la seule chose qu’on peut en savoir, c’est que c’est ce qui se jouit.
Évidemment, Lacan ne se tient pas toujours à la rigueur de cette position de la jouissance comme auto-affection du corps vivant. Longtemps, à partir du Séminaire Encore et dans son dernier enseignement, il tentera une sorte d’intersubjectivité de la jouissance, en impliquant l’Autre dans l’économie de ladite jouissance : c’est le jouir du corps de l’Autre. Il tentera donc d’insinuer un processus dialectique dans la jouissance, mais cette élaboration se conclut tout de même sur le fait qu’il n’y a pas de jouissance de l’Autre, qu’elle est essentiellement imaginaire et pas du tout du même registre que la jouissance du corps propre.
Il se peut que la jouissance du corps propre rende votre corps étranger à vous-même, que ce corps qui est le vôtre vous devienne Autre. Il y a des modalités de cette étrangeté : Je ne sens plus mon corps ou bien J’imagine un autre corps qui jouit à la place du mien, Je ne peux jouir qu’à imaginer que c’est le corps d’un autre qui est à ma place dans la relation sexuelle. À cet égard, la figure de l’Autre s’insinue dans la jouissance, mais c’est pourtant d’un autre ordre que l’expérience qui arrive à certains quand ils se retrouvent comme flottant un petit peu par-là, au-dessus de leur corps.
C’est alors plutôt de l’ordre des phénomènes élémentaires que l’on trouve dans la psychose. Tout est une question, pas seulement de texte, mais aussi d’accent. La dimension d’avoir un corps, la certitude pleine et entière que c’est le sien, le oui franc et massif à son propre corps, n’est pas l’apanage de tous les sujets. La jouissance est sans doute une propriété du corps qui se prête à la saisie par l’Autre, mais ce que je désigne, c’est autre chose : à savoir que, par sa face la plus profonde, la jouissance est une auto-affection du corps vivant – ce qui n’exclut pas que la cause – ou le déclencheur – puisse être extérieure à cette substance corporelle.
Heidegger et Husserl
Dans cette philosophie de la jouissance, on ne peut éviter de s’interroger sur le statut antéprédicatif de ladite jouissance. D’autant moins que dans l’usage courant qui est fait de ce mot, pour ce que j’ai pu en entendre ou en lire, la jouissance se classe volontiers sous cette rubrique.
Que la jouissance soit antéprédicative veut dire, pour simplifier, que rien de ce que l’on peut en dire ne convient. La jouissance appartiendrait ainsi à ce que Husserl – fondateur de la phénoménologie, philosophe déchiffré avec passion et qui a occupé toute une part des meilleurs esprits du xxe siècle, maître de Heidegger, ce dernier étant son assistant universitaire – avait désigné comme le Lebenswelt : le monde de la vie. Pour développer ce dont il s’agit, il me faudrait plus de temps que je n’en ai, puisque le mot monde, lui-même, est tout à fait codé dans le langage husserlien. C’est de là qu’il est passé dans ce que Heidegger a désigné, dans Être et temps, comme l’être-dans-le-monde. Je ne peux ici qu’en donner un sentiment. Je dirai que le monde de la vie, ce serait l’idéal d’arriver à isoler, ou en tout cas à désigner, un niveau radical du vécu. Ce serait le flux héraclitéen, le flux du vécu élémentaire, ou plutôt le flux originaire en deçà de toute forme discursive. Le flux qui se maintiendrait toujours là sous le discours, sous tout ce qui est informé par lui, sous tout ce à quoi le discours donne forme, y compris forme au niveau de la perception. Par là, le monde de la vie échapperait à toute forme de prédication. Si c’est une affirmation, c’est une affirmation en deçà du oui et du non, en deçà du vrai et du faux. Disons que c’est un vrai qui n’a pas de contraire. En ce sens, il n’est sans doute pas excessif de formuler que ce Lebenswelt, on ne peut pas le dire mais seulement l’éprouver. D’où son statut d’expérience première de l’être.
C’est évidemment peu sur le Lebenswelt. Je ne jugerai pas que cela soit d’une parfaite orthodoxie husserlienne. À l’époque de mes études de philosophie, je faisais très attention avant de professer quelque chose sur Husserl. Il y avait des chiens de garde extrêmement méchants, qui avaient accès aux derniers manuscrits de Husserl qui s’étaient accumulés à l’université de Louvain, aux mains de prêtres très scrupuleux qui n’ouvraient les portes qu’à des érudits choisis. C’était Husserl lui-même qui était antéprédicatif : on ne pouvait rien en dire sans que l’on vous reprenne. Est-ce que ça m’en a éloigné ? Peut-être bien. Ici, c’est un Lebenswelt à usage des lacaniens que j’essaye de transmettre.
Tel que je le vois, le Lebenswelt a statut d’absolu. C’est un absolu de l’ordre de l’infra. Pour s’en approcher, on est obligé de prendre une voie apophatique – non pas apophantique mais apophatique ; une lettre de différence, c’est énorme – c’est-à-dire une voie négative, comme dans la théologie négative où l’on peut seulement dire ce que Dieu n’est pas et non ce qu’il est. Par certains de ses traits, par ce que le Lebenswelt comporte de voie apophatique, le réel de Lacan y est apparenté. En tout cas, la voie apophatique vers le réel est très marquée dans l’enseignement de Lacan : dès que l’on dit ce que c’est, on est à côté.
Ce qui reste, dans ce concept-limite du Lebenswelt, c’est qu’il faut la vie – la vie qui reste un x. Pas de jouissance sans la vie, sans une vie véhiculée par un corps, un organisme, voire une cellule. Les imaginations de la jouissance sans la vie ou après la vie ne manquent pas, notamment l’idée de la vie après la vie – peut être marquée par ce que l’on rencontre difficilement dans la première : la béatitude. Il y a aussi l’imagination de la jouissance des morts-vivants, qui se prêterait à une vaste enquête anthropologique, jouissance dont on considère unanimement dans l’humanité qu’elle ne vous veut pas du bien. Mais à la béatitude des âmes et à l’appétit des vampires près, il n’y a pas de jouissance sans la vie.
Si l’on renverse le propos, si l’on dit Pas de vie sans la jouissance, on doit alors dire qu’il y a sans doute un statut antéprédicatif de la jouissance, que partout où il y a de la vie, on peut et doit inférer de la jouissance. Il est arrivé à Lacan de faire tel ou tel apologue interrogeant la jouissance de la plante ou des lys des champs. À ce momentlà, c’est évidemment un statut de la jouissance qui inclut le plaisir, avec comme caractéristique certaine que personne n’en dit rien. Mais si l’on ne veut pas se mettre à délirer – ce serait amusant mais ce n’est pas mon objectif – nous devons revenir à nous demander comment et sous quelle forme on rencontre cette jouissance dans la psychanalyse. Nous devons nous demander comment cette jouissance y figure.
Avant, je voudrais bien distinguer le S du sujet, et le grand S – non barré – de la substance.

Spinoza
C’est Spinoza qui a donné une définition moderne, brève, bien sentie de la substance. Elle vaut la peine d’être rappelée. Elle figure au Livre I de l’Éthique comme Définition III : Par substance j’entends ce qui est en soi et conçu par soi : c’est-à-dire ce dont le concept n’exige pas le concept d’une autre chose, à partir de quoi il devrait être formé. Il se dégage de cette définition une superbe autosuffisance. C’est une définition de la substance faite pour permettre à Spinoza, après quelques coups ou quelques avancées de ses pièces sur son échiquier contre l’adversaire invisible avec lequel il joue sa partie, sa partie contre l’Autre qu’il s’agit de convaincre et de mettre échec et mat – c’est cela l’Éthique de Spinoza : un échec et mat perpétuel contre le lecteur –, de démontrer qu’il n’y a qu’une seule substance. Pas deux, comme chez Descartes, mais une seule, à quoi il donne le nom de Dieu. Il invente par là un Dieu qui ne ressemble à rien de ce que l’on a connu avant lui. Il y a des petites ressemblances qu’on est allé chercher dans la Kabbale, mais c’est quand même un Dieu que l’on reconnaît surtout par le signifiant que Spinoza lui a collé, dont on peut dire qu’il fait preuve tout au long de l’Éthique – ça va dans mon sens – de ce que je pourrais appeler un autisme supérieur.
Le sujet, lui – loin que son concept n’exige pas le concept d’une autre chose pour se former, loin d’être en soi et conçu par soi –, dépend du signifiant. Ce que nous appelons le sujet dépend de la parole, réduite à son armature signifiante. Nous considérons même que le sujet est susceptible de varier en fonction du signifiant. Le concept de l’interprétation, l’idée que l’interprétation de l’analyste puisse modifier le sujet, implique que le sujet n’est pas substance.
En revanche, la vie, la reproduction de la vie, ne dépend pas, dans son concept, du signifiant. Elle dépend – pour prendre ici la dichotomie célèbre de Weismann – de la transmission du germen à travers les générations de corps. Seulement, même si l’on ne sait sans doute pas plus ce qu’est la vie dans l’espèce humaine que dans une autre espèce, on a tout de même, en particulier grâce à la psychanalyse, une petite idée sur la reproduction de la vie. On a spécialement l’idée que ça ne va pas tout seul. Concernant la vie, on a l’idée que sa reproduction dans l’espèce humaine est curieusement conditionnée par le langage, par le signifiant. Elle n’est marquée d’aucune automaticité – comme en fait preuve le refus de la reproduction, qu’il soit conscient ou inconscient. Au point que Lacan pouvait dire que, dans l’espèce humaine, la lettre est l’analogue du germen, que pour que le germen se transmette à travers les générations, il faut qu’un certain type de signifiant – que Lacan appelait la lettre pour insister sur la matérialité de ce signifiant – soit transmis.
De la même façon, s’il y a un statut antéprédicatif de la jouissance – ce que l’on est bien en peine de nier – il n’apparaît pourtant pas qu’elle soit antésignifiante dans l’espèce humaine. C’est dans cette perspective que Lacan avait pu dire – une fois – que le signifiant était la cause de la jouissance, exactement de la façon dont il avait pu dire que le signifiant était la cause du sujet ; à distinguer tout de même : le signifiant étant la cause du sujet dans le discours, là où il serait la cause de la jouissance dans le corps.
Même s’il y a une jouissance équipollente à la vie, même si toute vie comporte jouissance, il se spécifie néanmoins, du fait de l’incidence du signifiant, une Autre jouissance dans l’espèce humaine.
En brutalisant un peu la chose, en dissipant certains effets poétiques sur lesquels Lacan peut jouer, je peux apporter une stratification et distinguer la jouissance antéprédicative de tout corps vivant et la jouissance bis, celle qui prend consistance et se fixe à partir de l’incidence du signifiant, à partir du fait qu’il y a de la parole. Il n’y a pas que le monde de la vie, il y a aussi le monde de la parole – Sprachwelt.
5. La jouissance dans l’expérience analytique
C’est à cette jouissance bis que nous avons affaire dans l’expérience analytique. Nous avons affaire à une jouissance traumatisée. Ce n’est pas une jouissance brute, c’est plutôt une jouissance brutalisée. Nous avons affaire à une jouissance déplacée. Ce dont on nous parle en tant qu’analystes, ce que l’on nous fait signifier, c’est une jouissance qui se présente comme celle qu’il ne faudrait pas, celle qui appelle – le mot est chez Lacan – un Non decet : elle ne convient pas. On peut même dire, puisque le mot est dans le même fil étymologique, qu’elle n’est pas décente.
C’est pourquoi l’aveu de cette jouissance rencontre toujours, dans la règle, des obstacles. On ne pourrait pas écrire le chapitre de l’aveu de la jouissance en psychanalyse – le mot d’aveu le comporte – sans lister tout ce qui y fait obstacle. Pour le fantasme, Freud le notait : il faut savoir attendre du patient l’aveu des scénarios imaginaires fantasmatiques qui lui sont nécessaires pour jouir – ce qui n’est, bien sûr, pas le fantasme fondamental, mais le fantasme comme instrument, comme moyen de jouir. J’ai, par exemple, recueilli les aveux d’un sujet (ces aveux dont il se torturait à les sortir), tentant de négocier avec, disons, sa conscience morale, avec un infernal bâillon, pour qu’il me lâche quelque chose qu’il avait voulu m’épargner – ce qui ne m’avait fait venir aux lèvres qu’un « Mais c’est très fleur bleue, tout ça ! », c’est ce que je lui avais dit, alors qu’il reculait devant l’horreur et la transgression que comportait son fantasme. C’est là que l’on mesure que cette jouissance, quelle qu’elle soit, n’est pas, d’être jouissance, décente.
Elle n’est pas décente, et pourtant il faut bien dire que l’on n’invente vraiment pas grand chose dans ce registre. Toutes les horreurs que vous faites ont déjà été faites. Il y en a certaines qui sont punissables devant les tribunaux, c’est un fait, mais vous remarquerez que ce sont celles qui se disent le plus facilement. Évidemment, quand un sujet n’a pas du tout de décence, c’est une autre affaire. Ça existe aussi, mais enfin, dans la règle, la décence est là.
Fixation
Dans l’expérience analytique, la jouissance se présente avant tout par le biais de la fixation. Sinon, ce ne sont que des petits plaisirs. La jouissance, c’est vraiment à la fixation qu’elle se reconnaît, c’est-à-dire qu’on y revient toujours. Il s’agit de savoir si ce on y revient toujours est arrêté ou non par la traversée du fantasme.
J’avais indiqué qu’il y avait un après à la traversée du fantasme fondamental. Il y a bien un espace analytique d’interrogation et d’élaboration qui s’ouvre après la traversée du fantasme fondamental. C’est peut-être bien là que se présente le on y revient toujours, peut-être par d’autres voies, éventuellement par des voies plus corporelles. Dans ce on y revient toujours de la jouissance, on y revient toujours en plein – pas à côté. C’est comme telle que la jouissance est à côté, à côté de celle qu’il faudrait, comme le disait Lacan. Comme telle elle est à côté, mais on y revient en plein. La jouissance ne ment pas, disais-je, alors que tout le reste ment, est du registre de la vérité menteuse. Alors que le désir qui s’enfle est fait, dans l’expérience analytique, pour s’amincir et se dégonfler, la jouissance, elle, ne ment pas. Elle ne ment pas dans la mesure où elle est en elle-même un malentendu par rapport à celle qu’il faudrait.
Pour bien garantir de ne pas confondre de but en blanc la jouissance avec le réel et de ne pas en faire un antéprédicatif dans l’expérience analytique, je prendrai une formule que je prélèverai dans le Séminaire XX, Encore. Autant j’essaye de vous aider à écarter les formulations de Lacan qui sont des essais ou tentatives qu’il rejette ensuite, autant cette formule, jusqu’à plus ample informé par moi – je veux dire jusqu’à ce que je m’informe moi-même davantage – je la garde comme repère : Le langage est appareil de la jouissance.
Découpage
Ce que nous dit Lacan, c’est que dans l’espèce humaine, la jouissance est appareillée par le langage. Ce n’est pas le cas chez l’animal. Si l’animal peut être parcouru par des effets de langage, ce ne sont jamais, évoque Lacan, que des effets parodiques. Je prélève une autre formule, qui n’est pas dans le Séminaire Encore – Séminaire d’ailleurs semi-improvisé ; Lacan n’avait que quelques formules écrites sur ses papiers. Cette seconde formule figure dans l’écrit « ... Ou pire » – qui concernait le Séminaire précédent, mais que Lacan avait rédigé à la fin de son Séminaire XX. Elle se trouve dans les Autres écrits, page 550 : Le savoir, dans son usage du moment, c’est le savoir en tant qu’articulation signifiante, affecte le corps de l’être parlant – j’abrège – ceci de morceler sa jouissance, de le découper jusqu’à en produire les chutes dont je fais l’objet petit a. Le signifiant affecte le corps du parlêtre en ceci qu’il morcelle la jouissance du corps ; ces morceaux, ce sont les objets petit a. Si on regarde de près cette formule, elle suppose qu’il y a un premier statut de la jouissance – celui que j’appelais jouissance de la vie, la jouissance antéprédicative –, mais que du fait que le corps dans l’espèce humaine est parlant, sa jouissance s’en trouve modifiée sous les espèces d’un morcellement, d’une condensation dans des zones érogènes freudiennes, chacune relative à un certain type d’objet – morcellement et condensation, donc.
Ce n’est pas une économie de la jouissance, mais nous sommes au plus près d’où Lacan s’en est approché avant son tout dernier enseignement. C’est le bord-limite où l’on peut encore appliquer et transporter la grille structurale linguistique dans l’économie de la jouissance.
La grille linguistique enseigne que le signifiant a des effets de signifié. Les sons que j’émets sont porteurs d’une signification – plus ou moins vague, un nuage, certes, mais une signification ; ce n’est pas considéré comme des jappements, des hurlements. Transporter cette grille dans l’économie de la jouissance consiste à dire que le signifiant a aussi des effets de jouissance. Il n’a pas que des effets signifiés, il a aussi des effets jouissants. Dans la mesure où l’effet jouissant est plus consistant que l’effet signifié – lequel est évanescent –, on dira qu’il s’agit d’un produit. Plutôt que de dire effet, on dira produit. Lorsque Lacan invente ses quatre discours, il place l’objet a au rang de produit et en tant que symétrique à l’effet de signifié. De la même façon que j’avais pu reprendre la molécule fantasmatique, j’écris la conjonction du signifié ou du sens avec l’objet a.

C’est ce que Lacan, quelques années plus tard, appellera le jouis-sens ou le sens-joui,– jouant sur le mot jouissance. Dire sens-joui, c’est surmonter le binarisme du sens et de la jouissance. Autant Lacan faisait fonctionner le fantasme comme une molécule susceptible d’être explosée en deux atomes, $ et a, autant le néologisme de jouis-sens ou de sens-joui prend figure d’atome et non de molécule. C’est ce que Lacan a sans doute essayé de dire en parlant de parole jouissante, spécialement pour qualifier la parole analysante. Ce que ça traduit, c’est un effort pour aller au-delà du binarisme finalement hérité de Descartes, celui où nous avons d’un côté le signifiant et de l’autre la jouissance.
Le deux, le Un et le trois
Pour Lacan, il y a clairement un pousse-à-l’unarisme, la recherche – même à travers des jeux de mots – de dire en même temps le signifiant et la jouissance, le sens et l’objet a. Dans ce fil, j’irai même jusqu’à penser que, si son tout dernier enseignement se présente comme triplice, comme faisant fonds sur la trinité du réel, du symbolique et de l’imaginaire – trinité qu’il avait exposée bien longtemps auparavant, mais qui n’avait jamais été thématisée comme telle et mise au premier plan de ses manipulations –, c’est en définitive pour appareiller le pousse-à-l’unarisme. Tout le vecteur de son enseignement conduit vers une conjonction étroite, vers une coalescence entre signifiant et jouissance, mais le passage à cet unarisme se trouve habillé d’une triplicité. Lacan, de ce pousse-à-l’unarisme, se rejette vers une triplicité.
L’enseignement de Lacan a été, premièrement, dominé par le deux : d’un côté, par l’articulation signifiante, et de l’autre, par la pulsion, avec la question de savoir comment résoudre méthodiquement ce qui est de l’ordre de la jouissance et de la pulsion à partir de l’articulation signifiante. Il se trouve qu’ensuite, par la pression de l’expérience analytique elle-même, Lacan est conduit, deuxièmement, vers l’effort de surmonter ce dualisme. Il surmonte, troisièmement, ce dualisme, non pas en élaborant comme tel le un, mais en élaborant un trois sous les espèces du fameux nœud borroméen.
Ce qui compte vraiment, ce qui habite le tout dernier enseignement de Lacan malgré sa triplicité – du moins à mon gré et tel que je le vois – c’est la recherche d’un langage unitaire et d’une expression identique pour les registres du signifiant et de la jouissance. C’est aussi pourquoi ce tout dernier enseignement dégage tout un espace de monstrations et de configurations qui sont précisément en deçà ou au-delà du discours. Lacan fait la place à ce qui ne se laisse pas résorber dans le discours et qui ne peut que se manipuler et se regarder.
Les structures nodales que Lacan a multipliées à plaisir dans son tout dernier enseignement répondent à cette idée singulière – déjà exprimée une fois dans le Séminaire Encore – selon laquelle la structure est du texte même de la jouissance. C’est une formule paradoxale qui adjoint à la jouissance le mot de texte, pour en qualifier la structure. Par ce mot, il faut entendre la texture nodale, qui est à la fois structure et jouissance. Les nœuds de Lacan sont des nœuds de sens-joui. C’est cette unité-là qui gît au cœur de la triplicité placée au premier plan dans ce tout dernier enseignement. Il y a trois dimensions, il y a trois ronds de ficelle ; le trois semble donc dominer cette réflexion, alors que son fondement invisible est ce un de coalescence du sens-joui.
Le signifiant lui-même s’en trouve altéré. Quand Lacan montre lalangue comme fondement du langage, quand il l’isole sous les constructions artificieuses du langage, il distingue de la même façon le signifiant de la lettre – ce qui veut dire que, dans les deux cas, il va dans le sens de ce que, faute d’un autre mot, j’appellerai la matérialité – en évidence dans le maniement des nœuds borroméens.
C’est là que l’interprétation qui s’affronte au-delà du fantasme, au-delà de la molécule explosée du fantasme, qui s’affronte à l’atome du sens-joui, se fait jaculation et vise la substance jouissante. Elle n’atteint cette cible qu’à renoncer aux facilités du déchiffrage sous l’égide du Père. On n’y accède qu’en secouant, comme je le fais ici, le discours de celui qui fait encore figure de second Père de la psychanalyse.
6. La jouissance : transgression ou substitution ?
Telle que je l’aborde dans la perspective du dernier enseignement de Lacan, la jouissance n’est pas une transgression – à la différence de ce qui est exposé dans L’Éthique de la psychanalyse qui en constitue le pivot.
La jouissance est au contraire un fonctionnement normal – et non pas bizarre ou exceptionnel.
Le modèle transgressif
Lacan est multiple. Il n’est pas-tout, oserais-je dire. Il y a certes un enseignement de Lacan, parmi d’autres enseignements de Lacan, qui expose le concept de jouissance à partir de celui du plaisir. Le concept du plaisir dont il prend son départ est aristotélicien – concept qui a conditionné la théorie du plaisir à travers les âges, celui qui fait dudit plaisir le nom d’un état de bien-être.
Ce bien-être, on le retrouve encore, de nos jours, intégré à la définition de la santé par l’oms – cette Organisation mondiale de la Santé qui veille à nous protéger, par exemple, de ces pandémies que l’état actuel de la civilisation facilite par le développement de l’industrie des transports. Cette industrie est si essentielle que lorsqu’un petit symptôme apparaît, lorsqu’un avion fait plouf au milieu de l’Atlantique, ça devient une information mondiale. Une unification progressive d’une humanité en voie de faire Un – Un-tout – se manifeste ainsi. Elle est d’autant plus attachée à son bien-être que celui de chacun apparaît comme la condition de celui de tous.
Si l’on prend comme référence l’état de bien-être et les ajustements des valeurs fonctionnelles qu’il comporte – que j’ai déjà, dans mon cours, représenté par une boucle symbolisant la régulation homéostatique du principe du plaisir que l’on a, de toujours, attaché à une moyenne : ni trop ni pas assez, juste ce qu’il faut –, la jouissance apparaît alors comme une transgression, connotée d’un en-plus, d’une valeur supplémentaire résultant d’un forçage où le plus vire facilement au trop. Le plus-de-plaisir communique alors avec le début de la souffrance – par exemple avec l’équivoque des cris, qui peuvent, chez l’être parlant, scander cette irruption.

Vous trouvez ce fonctionnement exposé par Lacan dans le chapitre V de son Séminaire XI, Les Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, où la régulation du plaisir est qualifiée d’homéostase, terme promu en 1920 par le physiologiste Cannon qui en a apporté le concept. C’est congruent avec ce que Freud a pu relever du relief des zones dites érogènes dans le corps humain, les lieux électifs de la libido d’où s’élance le vecteur de cette jouissance transgressant la règle du plaisir. Lorsque Lacan, au terme d’une analogie avec la théorie économique de Marx, qualifie l’objet a qui condense la jouissance de plus-de-jouir, lorsqu’il forge ce néologisme, il est cohérent avec ce que je taxerai ici de modèle.
Ce modèle de la jouissance – simple, solide, structurant et puissant pour ordonner les phénomènes – est en fait conçu sur le modèle du désir. Il s’agit d’un décalque du modèle du désir – ce qui s’entend d’autant mieux que désir et jouissance sont les deux termes qui, chez Lacan, répartissent le concept freudien de libido.
Quel est donc ce modèle du désir, dont je dis qu’il sert de référence au modèle de la jouissance ?
On le trouve en particulier exposé dans le Séminaire VII, L’Éthique de la psychanalyse, quand Lacan surprend son auditoire en citant, avant de donner le nom de son auteur, une lettre de saint Paul qui marque la dépendance du désirable à l’endroit de l’interdit :
Je désire ce qui est interdit
Je sais ce qu’il y a à désirer par le fait que la loi l’interdit
Avant qu’il y ait la loi, il n’y avait pas le désirable.
Le désir est ici l’effet, ou plutôt le contre-effet, de la loi. Il en découle la formule provocante que Lacan a pu émettre, selon laquelle La loi, c’est le désir – équivalence et réversibilité de la loi et du désir.
Dans ce modèle de la jouissance, la règle du plaisir a donc la même fonction que la loi du désir. La notion de la jouissance comme transgression transpose le rapport du désir à l’interdit.
Eh bien, la jouissance, ça ne fonctionne pas comme ça !
La jouissance n’est pas antéprédicative
La jouissance n’obéit pas à la logique du désir. En ce qui concerne la jouissance, la loi est inopérante. On peut répartir le désir interdit, annulé, inhibé, et le désir qui s’accomplit, qui se réalise – mais la jouissance, elle, est des deux côtés.
S’imaginerait-on que le désir pourrait tenir comme interdit, s’il n’y avait pas une jouissance du désir interdit ? C’est ce que démontre tout ce qu’on appelle les ascèses les disciplines qui vous enseignent à maîtriser le désir. N’éclate-t-il pas aux yeux qu’il y a une jouissance qui est incluse dans la maîtrise des désirs ? C’est même l’essentiel de ce qu’on appelle la philosophie antique. Un érudit, Pierre Hadot, a très justement dit que ces philosophies étaient faites d’exercices spirituels, de discours qui devaient conduire à un travail de soi sur soi afin d’obtenir une transformation subjective, un état de bonheur, un état d’harmonie. Il s’agissait, en somme, d’un dur travail pour obtenir la régulation du désir.
C’est, d’ailleurs, ce qui fait penser que c’est une amphibologie, une construction, que de parler de la philosophie. Au Moyen-âge, la philosophie n’était pas un exercice spirituel : elle était occupée à passer des compromis, à viser des accords avec la théologie. Aux temps modernes, la philosophie avait ensuite pour problème la science, afin d’arriver à l’accorder avec l’expérience existentielle. À partir de là, elle a finalement été capturée par l’université.
On retrouve des morceaux d’exercice spirituel aussi bien dans ce que Descartes a appelé Méditations que dans l’ouvrage majeur de Spinoza, l’Éthique. Il y s’agissait d’obtenir un contrôle de la vie psychique par le biais de l’attention portée à l’événement de pensée, de façon à acquérir par l’apprentissage de bonnes habitudes. L’exercice spirituel était, avant tout, un exercice de maîtrise, de maîtrise de soi, qui ne pouvait se soutenir que parce que cet exercice engendrait une jouissance de maître.
C’est une façon d’apercevoir en quel sens la jouissance n’a pas de contraire. Si elle est coordonnée à un symbole, il est impossible à négativer – en particulier par l’interdit. La jouissance ne se pense pas à partir de la loi, même si la loi positive. La loi des législations existantes s’occupe à réguler la distribution des jouissances : de quoi a-t-on le droit de jouir, de quelle façon, jusqu’à quel point, etc. Mais cela ne concerne pas la jouissance telle que nous la visons : la jouissance de l’inconscient, au niveau de l’inconscient.
De la doctrine de la jouissance, j’écarte donc la transgression et la loi. Est-ce à dire que je l’écarte du signifiant ? Est-ce que la loi, ou la règle, sont les seules figures où se représente le signifiant ? J’ai dit, qu’à mon sens, la jouissance n’était pas de l’ordre de l’antéprédicatif, utilisant un terme que j’ai emprunté au vocabulaire du philosophe Husserl. Disons, en termes lacaniens, que la jouissance, la jouissance non transgressive que je vise, n’est pas avant le signifiant.
La jouissance n’est pas antérieure au signifiant, bien qu’elle soit du corps. Chez celui que nous n’appelons plus le sujet mais le parlêtre – parce que nous le voulons concerné de façon essentielle par la jouissance –, le corps lui-même, son corps, n’est pas, lui non plus, d’avant le signifiant. Il n’est pas une réalité d’avant le signifiant. C’est en quoi le parlêtre n’est pas son corps. Son corps, il l’a – comme on a un bien, une propriété, un objet, que l’on traite bien ou mal, dédaigne, délaisse ou bichonne. Les soins, qu’on lui apporte ou qu’on ne lui apporte pas, dénotent la valeur inconsciente qu’on lui attribue.
Par une sorte de court-circuit, Wilhelm Reich, ce psychanalyste fou, mais malin et intelligent, considérait qu’il était essentiel dans la pratique de la psychanalyse d’observer ce que le patient fait de son corps. Ça l’a évidemment conduit à des extravagances qui l’ont fait sortir du domaine de la psychanalyse. Il avait pensé qu’il pouvait opérer directement sur la libido et sur le corps et avait construit des « accumulateurs » de libido. Là, quand même, ses collègues ont dit non, mais, à vrai dire, c’était un réaliste de l’objet a – cet objet que Lacan définissait comme un condensateur de jouissance.
W. Reich pensait que la jouissance, dans son statut essentiel, était déconnectée du signifiant, qu’on pouvait la traiter comme une matière, susceptible d’une physique, qu’elle pouvait être manipulée, captée et redistribuée par des appareils concrets, matériels.
Tout le monde sent bien que ce n’est pas là que la psychanalyse nous mène et que, si la jouissance est du corps, elle se supporte néanmoins du langage. Ceci dit, ça n’a rien à faire avec sa liaison supposée à la loi. Le langage, ce n’est pas la loi, c’est une articulation.
La question se rassemble et pointe dans la formule que j’en propose : comment se conjoignent le corps et le langage pour faire jouir ? Je peux donner une réponse qui n’en est pas une – puisqu’elle s’appuie sur un concept de Lacan qui a sa propre complexité, bien que vous en ayez un certain usage, ne serait-ce que par les cours que j’y ai consacrés : Pour faire jouissance, corps et langage se conjoignent dans le sinthome.
Le sinthome emporte le corps, mais le sinthome est articulation. On dit justement sinthome, parce qu’il n’y a pas d’abord direct de la jouissance, parce que cette jouissance brute, imaginaire, est toujours réfractée par le sinthome.
7. La jouissance réfractée par le sinthome
Ce n’est pas pour rien que, pour qualifier la pointe du rapport à la jouissance, Lacan a choisi ce mot de sinthome – modification, justifiée par l’étymologie, de celui de symptôme. Ce terme de symptôme est un mot du vocabulaire de Freud qui veut dire beaucoup de choses. Cependant, dans les différents sens qu’il peut prendre chez Freud, j’isole que le symptôme est une substitution.
Libido freudienne et logique masculine
J’ai relu la dix-huitième conférence de l’Introduction à la psychanalyse – conférence sur la fixation au trauma et à l’inconscient. Freud y expose que la formation de symptôme est le substitut de quelque chose d’autre qui n’a pas eu lieu. Dans l’écho du mot lacanien de sinthome, persiste cette valeur de la substitution.
Pour Freud – qui lit le symptôme comme il lit les rêves, les lapsus et les mots d’esprit –, le substitut dont il s’agit est d’abord un substitut linguistique : le texte du symptôme se substitue à un texte originaire qu’il s’agit de déchiffrer. Il y a eu des processus psychiques qui ont été inhibés, occultés, il y a eu un message interrompu qui n’est pas parvenu à la conscience, qui a été contraint de rester inconscient, et c’est – pour le symptôme comme pour le rêve – ce que l’on déchiffre dans une analyse. C’est à son collègue Breuer que Freud rend l’hommage d’avoir posé que les symptômes disparaissent quand on a rendu conscientes leurs conditions préalables inconscientes. C’est à partir de là qu’il expose à ses auditeurs que les symptômes passent, disparaissent, une fois que leur sens est su.
Ce n’est là qu’un des deux versants du symptôme. Selon le premier, le symptôme est un texte de substitution, mais, ainsi que Freud l’expose en clair, il a un autre versant, supplémentaire, à savoir que le symptôme sert la satisfaction sexuelle : Un symptôme est un substitut de la satisfaction sexuelle dont le patient est privé dans la vie. Il s’agit donc aussi de comprendre le symptôme comme une satisfaction qui vient se substituer à celle qui fait défaut dans la vie. Autrement dit, le symptôme dans la névrose est une satisfaction sexuelle substitutive – remarquez que les initiales de ces trois mots sont les mêmes que dans l’expression de sujet supposé savoir.

* La perversion comme référence
Tout cela est présent, tous ces échos sont inclus, dans le terme lacanien de sinthome. Cette substitution, Freud l’illustre d’abord par les perversions. Il va puiser dans leur catalogue. On y voit le patient – le malade, comme il dit –, loin de se satisfaire de jouir d’un corps du sexe opposé, jouir de certaines parties de ce corps ou de parties en contact avec ce corps, des vêtements par exemple. On le voit passer par des scénarios et des actions complexes, éloignés du coït normal. À travers ces objets, ces actions, ces sujets obtiennent une satisfaction qui vient à la place de la satisfaction sexuelle normale.
Le passage par la perversion, entendue comme distincte de la névrose, sert à Freud pour mettre en évidence le même processus de substitution à l’œuvre dans la névrose notamment dans l’hystérie. Le sujet hystérique peut attacher ses symptômes à tous les organes du corps, par exemple dans les paralysies et dans les hyperesthésies hystériques qui sont autant de satisfactions sexuelles substitutives. Si Freud prend la référence de la perversion, c’est donc pour démontrer que la jouissance substitutive est aussi bien présente dans la névrose et qu’elle est capable de perturber les fonctions du corps. Comme il l’a dit et comme on l’a traduit : Les organes se conduisent comme des organes génitaux de substitution.
Comment mieux marquer l’affinité de la jouissance substitutive et du signifiant qu’en disant, ainsi que Freud le fait, que les organes corporels acquièrent une signification sexuelle – eine sexuelle Bedeutung. C’est cette expression de Bedeutung que Lacan, en conservant le terme allemand, avait mise en évidence à propos du phallus, traitant conformément à la lettre de Freud de Die Bedeutung des Phallus, dans son texte des Écrits qui porte ce titre. Il tentera, plus tard, en plus, un clin d’œil à l’endroit du logicien Frege qui faisait, lui, la différence entre Sinn et Bedeutung. Je crois cependant que la Bedeutung de l’écrit de Lacan est en fait très directement freudienne et qu’elle ne s’insère que difficilement dans la conceptualité frégéenne.
* La référence originaire de la jouissance
Du point de vue de la jouissance, la différence entre perversion et hystérie n’est donc pas essentielle. Dans la perversion, la substitution joue en direct, elle se montre en plein et est consciente : le sujet sait ce qu’il recherche, connaît l’action qu’il lui faut, l’objet dont il a besoin pour jouir. Dans l’hystérie, par contre, c’est inconscient. Il faut, pour retrouver la fonction de signification sexuelle, en passer par le détour de l’interprétation du symptôme. Mais, à cette différence près du conscient et de l’inconscient, nous avons dans les deux cas affaire à la jouissance substitutive.
Cette conception de la substitution de jouissance, de la jouissance substitutive, anime toute la théorie freudienne de l’évolution de la libido. Quand Freud met en valeur les zones érogènes et les objets correspondants – l’objet oral, l’objet anal –, les zones érogènes avec le plaisir d’organe qu’elles comportent et qu’elles permettent, lorsqu’il détaille les pulsions partielles, c’est toujours dans le cadre de la jouissance substitutive. L’évolution de la libido témoigne qu’il faut en passer d’abord par la jouissance substitutive avant d’arriver à celle qui ne le serait plus.
Quelle est cette jouissance substitutive ? Il y a, chez Freud, un étalon de la substitution, une référence originaire de la jouissance. Manque de bol, si je puis dire, c’est une référence tardive dans ce qu’il appelle l’évolution de la libido. La référence par rapport à laquelle il mesure les substitutions, c’est la sexualité dans sa fonction reproductive, procréative – celle du coït ordinaire. La référence de Freud, c’est donc la sexualité en tant qu’elle obéit au programme biologique. C’est par rapport à cela qu’il ne voit que jouissance substitutive dans l’histoire de la libido. Si on lit Freud convenablement, on s’aperçoit que la jouissance est toujours substitutive, sauf lorsqu’elle se conforme au programme biologique. Considérer que le coït est toujours extraordinaire n’est somme toute pas faux !
Freud est conduit à supposer un tournant dans l’évolution de la libido – c’est ainsi qu’il s’exprime – où toutes les pulsions partielles viennent se subordonner au primat des organes génitaux, se soumettre à la fonction de la procréation. Les pulsions partielles arrêtent de gambader, de cueillir la succion, le regard, la voix – ces deux objets ajoutés par Lacan – et se concentrent sur la sexualité procréative. Autrement dit, pour Freud – comment le dire plus simplement ? – le rapport sexuel existe. C’est par rapport à l’existence du rapport sexuel que se mesurent les constantes substitutions de la jouissance.
Jouissance lacanienne et logique féminine
Depuis que Lacan a dit que le rapport sexuel n’existe pas, on se casse la tête pour savoir ce qu’il voulait dire par rapport sexuel. Je l’ai déjà expliqué trente-six fois, mais je ne crois pas pouvoir l’expliquer plus simplement qu’en disant que Lacan appelle rapport sexuel ce qui fait la référence de Freud dans toute sa théorie de la libido, dans toute sa théorie des pulsions, et par rapport à quoi il mesure les substitutions de la jouissance. La conséquence de la formule selon laquelle le rapport sexuel n’existe pas, c’est de nous dessiner une économie de la jouissance qui est, de part en part, substitutive – sans original. Que le rapport sexuel n’existe pas veut dire qu’il n’y a pas de ganze Sexualstrebung, de pulsion sexuelle totale, selon l’expression de Freud. Lacan la niait déjà dans son Séminaire xi. C’est ce que traduit le fait que le rapport sexuel n’existe pas. La jouissance dont est capable le parlêtre est toujours celle qu’il ne faudrait pas. De la jouissance, on peut toujours dire en latin : Non decet – elle ne convient pas. La seule qui conviendrait, ce serait celle du rapport sexuel, qui n’existe pas.
* Le régime du pas-tout
Lacan généralise donc l’économie substitutive de la jouissance, qui est la clef de toute sa théorie des pulsions. Si vous voulez bien me suivre, je dirai qu’il n’a pu formuler les choses ainsi qu’une fois qu’il s’est détaché de la référence freudienne pour structurer la sexualité féminine. La théorie freudienne des pulsions obéit à la logique de la sexuation masculine. C’est une logique qui est capable de totaliser les pulsions, de poser un pour tout x, en référence à un élément, un référent unique, hors classe, qui a primat et privilège – le phallus –, qui s’exprime en termes de pouvoir – Freud parle de subordination de toutes les pulsions partielles sous le primat des organes génitaux.

La théorie freudienne des pulsions est œdipienne de part en part, alors que la théorie lacanienne de la jouissance répond, elle, au régime du pas-tout.
Il n’y a pas – je vais écrire ici un zéro entre guillemets – le primat du phallus. Il n’y a pas le tout des pulsions – ce tout que je représente par un cercle en pointillés. Il y a plutôt une série pulsionnelle, celle de la jouissance substitutive – que je représente dans mon schéma, par rapport au rapport sexuel qu’il n’y a pas, par une série de segments. L’élément freudien qui rassemble le tout des pulsions et qui les soumet, c’est le rapport sexuel. Chez Lacan, le rapport sexuel n’existe pas – écrivons-le surmonté d’une barre de négation – il n’y a donc que la série de la jouissance substitutive.

La théorie de la jouissance doit donc être, elle aussi, désœdipianisée. Elle comporte que ce qui nous est donné de jouissance ne convient pas au rapport sexuel. C’est en quoi la jouissance fait sinthome. Le sinthome de Lacan, c’est simplement le symptôme, mais généralisé, le symptôme en tant qu’il n’y a pas de pulsion sexuelle totale. Ça fait symptôme, mais c’est un symptôme qui est irrémédiable.
De ce fait, une métonymie court tout le long de cette série de la jouissance substitutive. Les merveilleuses transformations de la libido que Freud avait pu détailler trouvent ici leur place ; simplement, elles ne s’achèvent pas, elles ne se bouclent pas dans une totalité qui serait unitaire.
* La jouissance est partout
À cet égard, si on lui ôte sa référence originaire, la jouissance est partout dans le signifiant. Il y a une jouissance de la parole, qui fait partie de la métonymie des jouissances substitutives. Il y a une jouissance du savoir, de l’interdit, etc. Il n’est rien de ce qui entre dans la sphère de l’intérêt du parlêtre où l’on ne puisse repérer une jouissance. Paraphrasant Leibniz, on pourrait dire : Rien n’est sans jouissance.
D’où ce qu’a de ridicule l’idée que la psychanalyse consisterait à abandonner de la jouissance, l’idée de faire venir de la négativation sur la jouissance. Tout ce que l’on peut dire, c’est que l’on peut déplacer la jouissance, qu’elle peut se répartir autrement. Elle peut se métonymiser autrement, mais elle ne peut pas se négativer – au moins dans l’emploi que j’en propose ici.
Il y a une jouissance de l’interdit, il y a une jouissance du savoir, il y a une jouissance du corps et il y a aussi une jouissance de la pensée. La névrose obsessionnelle, par exemple, nous manifeste l’existence et l’insistance de la jouissance propre de la pensée. La jouissance peut être traquée dans toutes les manifestations de l’intérêt. On peut même dire que rien ne subsiste pour le parlêtre qui n’ait son coefficient de jouissance. C’est en quoi la formation des symptômes est coextensive à l’émergence de la jouissance.
J’ai d’ailleurs tort, au point où j’en suis, de parler d’émergence, puisque la jouissance dont il s’agit est plutôt de l’ordre de la nappe, d’une nappe parcourue de vagues, d’ondes, comme la cloche que j’évoquais. Ces vagues et ces ondes mesurent, pour chacun, la distance où il est du rapport sexuel qui n’existe pas.
Reste l’amour. L’amour que Lacan n’arrache pas à sa racine imaginaire quand il dit que ledit amour donne l’illusion du rapport sexuel. C’est ce qui distingue en propre la jouissance et l’amour. Il y a une jouissance à parler d’amour, à faire l’épreuve de l’amour, à écrire des lettres d’amour – ou des mails, évidemment. Cette jouissance-là est celle qui est à la fois la plus loin et la plus proche, topologiquement, du rapport sexuel qui n’existe pas.
De l’abjection
Il y a un mot qui était cher à Lacan. Je le sais mieux que quiconque. Jadis – c’était en 1966 – ayant sous les yeux et compulsant les épreuves de ses Écrits, je lui disais qu’il faudrait faire un index des concepts de son enseignement. Il me répondit : Faites-le ! Je lui répondis oui – c’était plus facile de lui répondre oui que de lui répondre non. Je n’avais cependant pas l’idée de ce dans quoi ça m’engageait. Cet index, j’ai dû le faire deux fois, en raison de l’autre bonne idée que j’avais eue de lui avoir dit de placer le « Séminaire sur La lettre volée » en tête de ses Écrits. Je le lui avais dit, parce que si l’on suivait l’ordre chronologique du premier jeu d’épreuves, les premiers textes dataient et étaient extérieurs à son enseignement proprement dit. Ce à quoi je n’avais pas pensé, ni personne, c’est que placer le « Séminaire sur La lettre volée » en tête du volume des Écrits allait décaler toutes les pages. L’index que j’avais fait sur le premier jeu d’épreuves ne valait plus rien au moment où arriva le deuxième jeu avec le « Séminaire sur La lettre volée » en tête.
La réplique de Lacan à laquelle je fais allusion date du premier jeu d’épreuves, quand la décision fut prise de faire un index des concepts des Écrits. Il me le laissa faire à mon gré et ne me fit qu’une seule recommandation : Ça doit commencer par le mot d’abjection. Sauf erreur, c’est ainsi que l’index commence. En tout cas, le mot d’abjection y figure, ce mot dont Lacan voulait qu’il fût l’alpha, sinon l’oméga de son enseignement.
* Une portée polémique
Ce mot d’abjection avait d’abord une portée polémique. Lacan était en effet soutenu par l’idée qu’il avait affaire à l’abjection de ses collègues psychanalystes. C’est dans cette visée que ce mot est employé trois fois – si mon souvenir est bon – dans le volume des Écrits. Ce mot d’abjection a aussi une portée théorique, dans la mesure où le psychanalyste, qu’il soit pour ou contre Lacan, est par lui assigné à la position d’objet a. Cet objet, comme il lui est arrivé de le dire plus tard, est aussi bien un abjet.
D’une façon générale, la jouissance a ses racines dans l’abjection.
Quels sont les antonymes de ce mot ? La dignité. L’honneur. L’honneur ne se soutient que du signifiant, qu’il porte à l’idéal. C’est bien ce qui avait obligé Freud à rallonger sa théorie des pulsions par le circuit de la sublimation – le circuit que suit la jouissance, en son fond abjecte, pour atteindre aux réalisations les plus touchantes du beau, du bon et du bien.
Quand nous disons de l’objet a que c’est un rejet, un déchet, nous le qualifions, en fait, d’abject. C’est un objet d’aversion, de dégoût, de répulsion, mais qui fait en même temps plus-de-jouir. Dans l’expérience analytique, ce qui concerne le plus intime de la jouissance prend toujours la forme de l’aveu – l’aveu de ce qui mérite d’attirer, comme l’indique le dictionnaire, le mépris et l’opprobre. L’abjection, c’est l’extrême degré de l’abaissement. Le sujet du signifiant, celui de la parole, n’y touche, ne consent à s’avouer son rapport avec lui, qu’en témoignant que la répulsion accompagne, est inséparable de l’attirance invincible qu’il éprouve dans ce rapport.
Savoir la dilection de Lacan pour le mot d’abjection m’a conduit jadis à lire, et depuis lors à relire – peut-être à révérer – un petit livre dont je crois n’avoir jamais parlé ici, d’un auteur qui ne fait pas partie de mes écrivains favoris pour beaucoup de raisons. Ce quelqu’un, qui a eu le culot d’intituler son ouvrage De l’abjection, est un auteur français qui passait, au beau temps de la nrf, pour écrire un français admirable. Il était d’ailleurs très admiré dans d’autres pays, par des écrivains allemands par exemple – Ernst Jünger lui rendait hommage –, ce qui l’avait conduit, il faut bien le dire, à admirer un peu trop l’Allemagne en un temps où cette puissance, désormais amie, occupait le territoire français. Il ne fait pas de doute que, concernant l’abjection, il en connaissait quelque chose.
* Jouhandeau et Paulhan
Cet ouvrage est dédié à un autre luminaire de la NRF avec lequel Lacan avait aussi eu quelques débats : Jean Paulhan, l’auteur du Guerrier appliqué. Marcel Jouhandeau a donc dédié son ouvrage à Paulhan, et ce, sur le bord même de la disparition de son écrit. Voici la dédicace : « Mon cher Jean, reçois ce texte comme un document concernant n’importe qui et que je n’ai consenti à te donner que parce que j’étais tenté de le détruire »[3].
Dans la partie qui semble bien concerner non pas n’importe qui, mais lui-même, Jouhandeau fait état de ce qu’il appelle le penchant monstrueux qu’il avait découvert en lui à l’âge de douze ans, et qui l’avait décidé à se tuer. Il survécut, pour hésiter entre se marier ou se donner à Dieu exclusivement – il était très croyant. En définitive, il se maria, écrivit d’ailleurs des horreurs sur son épouse et s’adonna avec une certaine constance, voire une certaine frénésie, à son penchant monstrueux, qui aujourd’hui paraît bien innocent – ce livre est de 1939 : l’homosexualité.
Je recommande la lecture de cet ouvrage. Comme c’est la dernière fois que nous nous voyons pour cette année universitaire, je vais vous faire la lecture d’un de ses passages, qui est une variation sur le thème Découvrir sa vérité que, ces jours-ci, j’entendais comme étant digne de nous figurer le programme d’une analyse :
« Découvrir sa vérité, ce n’est ni la deviner, ni l’effleurer, ni en humer le parfum, ni en apercevoir le reflet, en admettant qu’elle soit insaisissable elle-même, ni non plus la comprendre au point de pouvoir l’expliquer : c’est malgré soi, sans savoir pourquoi ni comment cela s’est fait, en être possédé de la tête aux pieds, de l’ongle des orteils et des doigts à la pointe des cheveux, de tous ses sens jusqu’aux tréfonds de l’âme, ne respirer qu’elle, ne voir qu’elle, n’entendre et ne toucher qu’elle à travers toutes choses, n’obéir qu’à elle, ne s’adresser qu’à elle, ne désirer et ne craindre qu’elle, n’être qu’un avec elle et qu’elle ne fasse qu’un avec vous et le reste du monde dont elle est devenue le signe pour vous seul. Et peu importe que cette vérité soit d’un ordre élevé ou d’un ordre bas et qu’elle soit “la Vérité” absolument, pourvu qu’elle soit la vôtre ou la mienne uniquement et qu’entièrement elle m’habite. Et peu importe que je me l’explique, pourvu qu’elle m’explique moi-même et le reste. Même si elle n’a de valeur que pour moi, qu’elle n’est accessible qu’à moi, pourvu qu’elle me donne le mot de l’énigme, qu’elle détermine le tour de chacun de mes gestes, qu’elle rythme mon pas, qu’elle illumine de l’intérieur mes pensées et qu’elle galvanise mes paroles, anime mon visage, dispose de mes larmes, règle mon sourire, commande à l’ombre ineffable de mes tristesses de me couvrir ou de me quitter : c’est elle seule qui me livre à une volupté que je suis seul à connaître, elle seule qui délivre en moi “mon plaisir” ; grâce à elle je ne suis plus perdu, à ma recherche, à la recherche de mon secret, je le recouvre ; et même si j’étais le plus malheureux des hommes et dussé-je le payer de ma damnation, je ne me préfèrerais personne, dans l’impossibilité où je suis de renoncer, dirai-je, à la vérité, je veux dire, à tel souvenir, à telle émotion ou à tel espoir que je lui dois qui me confirment dans mon obstination à demeurer dans l’être et dans mon être, à ne vouloir à aucun prix autre chose que mon identité, ma singularité »[4].
* La vérité, c’est la jouissance
La vérité dont il s’agit dans le contexte du petit livre d’où est extrait ce fragment – c’est un livre fait de fragments –, qu’on entrevoit aussi dans la déclinaison de cette vérité, c’est la jouissance. Relevons que, pour celui qui écrit, il s’agit d’une volupté infâme. On pourrait donner ce qui est décrit là pour l’état d’un sujet après la traversée du fantasme, sauf que Jouhandeau s’est, semble-t-il, largement passé de faire une analyse et qu’il n’y a pas à chercher sa vérité dans le fantasme. Ce qu’il écrit se passe au niveau du sinthome, au niveau de ce qui est sa vie tout entière, dont il rêve que la jouissance lui donne son unité. Ce que nous appelons le sinthome peut passer pour être l’unité d’une vie – non concentrée dans cet élément équivoque que nous appelons le fantasme.
J’ai voulu, pour terminer l’année, faire résonner ce passage que je considère comme éclairant. Si Lacan fait appel à Paulhan et à son Guerrier appliqué pour nous donner une idée de la passe comme traversée du fantasme, je ne vois pas pourquoi je ne ferais pas appel à Jouhandeau pour nous donner quelque sentiment de la passe au niveau du sinthome. Jouhandeau nous dit aussi comment il s’est arrangé de son penchant monstrueux. Cet arrangement culmine dans l’affirmation de sa singularité, éternelle peut-on dire, puisqu’il joue sa partie au regard de l’Être divin.
Je laisse Jouhandeau, pour essayer de prendre une vision perspective sur ce que j’ai cherché à explorer cette année, qui m’apparaît quand je porte le regard sur ce qui fait le fil, le support et le tourment de mon propos : l’enseignement de Lacan et la façon dont je m’en arrange aujourd’hui.
8. Des tours du dire et du jouir
Lacan avait lui pour support et pour fil l’œuvre de Freud. Il qualifiait son projet dans la psychanalyse, le projet de son enseignement, de Retour à Freud. Mais ce n’est pas là le fin mot. J’irai même jusqu’à en dévaloriser l’expression en y voyant un slogan ou le schibboleth d’une propagande dans la conjoncture où Lacan s’était trouvé avoir à prendre la parole. Cette conjoncture était marquée par le développement, dans la psychanalyse, d’une conception aujourd’hui récusée par tous qui s’intitulait elle-même l’Egopsychology. C’était la façon dont les élèves de Freud, émigrés spécialement aux États-Unis, avaient réussi à traduire les concepts freudiens, en privilégiant ce qu’on appelle la seconde topique – celle qui distingue le moi, le ça et le surmoi. Ils oubliaient par là la première topique – celle où s’enracine le concept d’inconscient – et reconfiguraient les concepts freudiens autour de l’idée d’adaptation, en faisant, par exemple, du moi une fonction psychologique d’adaptation à la réalité. Cela demandait de se tenir très largement à distance des textes freudiens, remplacés dès lors par les contributions de l’école de l’Egopsychology ou par des manuels orientés dans le sens que j’ai dit.
Une reprise à l’envers du projet de Freud
Lacan s’était donc trouvé dans cette position de faire lire Freud en un temps où l’on pouvait le tenir comme dépassé. De ce fait, le retour à Freud a pu être entendu comme un retour aux sources. Lacan dit pourtant explicitement dans ses Écrits, page 366, que retour à Freud ne veut d’aucune manière dire retour aux sources, même si ce fut là un sous-produit de son action. Lui-même présenta ses dix premiers Séminaires comme des commentaires freudiens prenant chaque année comme thème un écrit de Freud. Ses élèves de l’époque se lancèrent en effet dans l’érudition freudienne, d’où sortit tel Vocabulaire de la psychanalyse. Ce sont d’ailleurs ses élèves les plus engagés dans ce retour aux sources qui firent ensuite objection à la poursuite de l’enseignement de Lacan après ses dix premiers Séminaires.
Lacan a lui-même indiqué en quel sens il faut entendre le « retour à Freud » : une reprise à l’envers du projet de Freud.
Il rend raison de cet envers, de cette inversion, par la structure topologique qu’il assigne au sujet – pour simplifier, la structure de la bande de Moebius, qui n’est parcourue dans son ensemble qu’à la condition de faire un double tour qui inverse l’orientation. Transposé à l’œuvre de Freud, Lacan imagine, propose, que ce parcours double délivre une véritable élucidation. Je le cite : Tout doit être redit sur une autre face pour que se ferme ce qu’elle enserre. Il n’y a pas à rêver que l’on obtienne ainsi une totalité ni, précise Lacan, un savoir absolu. Il fait de ce double tour la condition pour que, dit-il, le savoir renverse des effets de vérité. Je me demande même si cette phrase a été imprimée comme il convient et s’il ne faudrait pas plutôt lire reverse au lieu de renverse. On peut néanmoins comprendre qu’il faille un double tour pour que le savoir ne soit pas figé dans des énoncés qui semblent ne varietur et pour qu’une vérité puisse émerger d’un renversement.
Un double tour
Quelle est la substitution par laquelle passe ce double tour ? La seule indication que je déchiffre, c’est que Freud reste prisonnier d’une référence à la sphère, par rapport à laquelle se distribuent l’intérieur et l’extérieur, tandis que le tour lacanien substitue à la sphère des surfaces topologiques qui répondent à une tout autre distribution – surfaces topologiques que sont cette bande de Moebius, la bouteille de Klein et spécialement le plan projectif qui est une transformation de la sphère.
Je ne rentre pas dans le détail du double tour de Freud à Lacan, je m’inspire seulement de cette notion d’une reprise à l’envers, pour situer la dimension qui nous est ouverte par ce que j’ai appelé le dernier et le tout dernier enseignement de Lacan. Ce ne sont pas seulement des étiquettes chronologiques. Il y a – je l’ai assez souligné ces dernières années – un tournant, une rupture, qui consonnent avec ce qui, dans la pratique psychanalytique, se transforme tous les jours.
Je m’inspire de ce que Lacan a pu situer de son rapport à Freud, pour proposer que son dernier enseignement, ainsi que le tout dernier qui en est la pointe, représentent la reprise par Lacan de son projet à l’envers. Lacan n’a laissé à personne le soin de lui faire le coup qu’il a fait à Freud. De la même façon qu’il peut dire qu’il reprend à l’envers le projet de Freud en l’indexant sur la substitution des surfaces topologiques à la sphère, lui-même substitue, dans son dernier enseignement, les nœuds borroméens aux surfaces topologiques. Si l’on suit son indication qui indexe la reprise à l’envers de ces références spatiales, il crève les yeux que Lacan a lui-même accompli une substitution du même genre.
Ce que je vous dis n’est que l’index d’un renversement. Quel est ce renversement ? Qu’est-ce que je peux dire de plus clair et de plus ramassé sur celui-ci ? Le passage à l’envers de l’enseignement de Lacan ne concerne pas seulement cet enseignement, mais aussi la pratique analytique telle qu’elle se poursuit – c’est mon hypothèse – dans l’espace qu’il a ouvert, sans doute pour se tenir au plus près de ce que les transformations de la pratique elle-même esquissaient en son temps. J’essaye donc d’être simple et je vais vous dire ce que j’en ai tiré.
Le premier tour de l’enseignement de Lacan met en place, exploite la subordination de la jouissance au primat de la structure du langage. Le passage à l’envers que nous a indiqué Lacan – et qu’il n’a pas accompli avec la même perfection que pour son premier tour – a ensuite consisté dans la subordination de la structure du langage à la jouissance.
C’est corrélatif d’un déplacement de ce qu’il est convenu d’appeler l’écoute analytique. Mais ça va bien au-delà de l’écoute ! Cela implique l’interprétation et les finalités de l’expérience. Le primat de la jouissance, ce n’est pas une abstraction. Concernant la pratique analytique, c’est placer les phénomènes qui y apparaissent la parole de l’analysant et ce dont elle témoigne – sous l’égide de la question : Qu’est-ce que ça satisfait ? Cette question est sensiblement distincte de la question : Qu’est-ce que ça signifie ? J’y vois un renversement, une inversion, un passage à l’envers qui va de la signification à la satisfaction.
Se déprendre de la prégnance de la question Qu’est-ce que ça veut dire ? ouvre à une autre dimension du dire qui invite, en particulier, et même expressément, à chercher là où ça jouit. Nous disons avec Lacan – un Lacan qui décalque et transforme Descartes que le corps est substance jouissante. Mais ce n’est pas là le fin mot. Il n’y a pas que le corps qui jouisse. Il y a jouissance de la parole, jouissance de la pensée, comme tous ceux qui sont attachés à décrire le phénomène de la névrose obsessionnelle sont amenés, sous des formes diverses, à le constater. Le langage lui-même est un appareil de jouissance et pas seulement un appareil à produire de la signification. Le signifiant n’est pas seulement cause du signifié, cause du sujet, il est aussi cause de la jouissance.
Cela conduit à un état du signifiant antérieur à la structure du langage, que l’on peut dire prélinguistique, si la linguistique commence là où l’on prend en compte les effets de signification. C’est dans cette veine que Lacan en viendra à inventer lalangue, tissée de signifiants mais antérieure au langage. La structure de langage apparaît alors elle-même comme dérivée par rapport à lalangue.
L’indice de l’inertie
S’il y a bien ce passage à l’envers, on doit pouvoir en trouver des indices certains. J’en ai trouvé un, qui tourne autour du terme d’inertie.
J’avais déjà jadis signalé la valeur et la portée de ce mot d’inertie au début de l’enseignement de Lacan. J’avais souligné l’expression d’inertie des facteurs imaginaires, dans la première page des Écrits après l’ « Ouverture », la première page du « Séminaire sur La lettre volée » – lettre volée qui témoigne du déplacement structurant du signifiant. Isoler l’imaginaire et lui assigner une fonction d’inertie dans l’expérience analytique, c’est tout à fait essentiel et structurant dans le premier tour de l’enseignement de Lacan.
* Les facteurs imaginaires
Pour le premier Lacan, l’inertie supposée des facteurs imaginaires s’oppose à la dynamique des facteurs symboliques. Toute son attention a été de mettre en valeur les mécanismes qui supportent ces facteurs symboliques, reformulés à partir de l’œuvre de Freud : la Verwerfung (la forclusion), la Verdrängung (le refoulement) et la Verneinung (la dénégation). Ce sont trois termes qui figurent dans cette première page du « Séminaire sur La lettre volée », auxquels on peut ajouter la Verleugnung (le déni – si l’on veut bien admettre cette traduction). Par rapport à l’Egopsychology, qui centrait l’attention sur les facteurs imaginaires, Lacan s’est distingué en mettant en valeur la dimension du symbolique supportée par la structure de langage, comme étant le lieu d’une dynamique par où les changements se font.
En quoi, d’ailleurs, les facteurs imaginaires sont-ils inertes ? C’est parce qu’au point de départ de Lacan, l’imaginaire est le lieu de la jouissance : le sujet jouit de l’imaginaire. Cet imaginaire est pour Lacan primordialement scopique ; il tient à la vision. Pour le premier Lacan, le corps est, non pas la substance jouissante, mais avant tout la forme du corps. Cette inertie est précisément liée, dans son enseignement, à la découverte qu’il avait pu faire vingt ans auparavant – ce qu’il avait appelé le stade du miroir, où il y a émergence d’une jubilation du petit d’homme devant son reflet. Il s’agissait de rendre compte de ce qui fait jouir de l’image. Pendant tout un temps, Lacan a donc organisé ce qu’il captait de l’expérience analytique à partir de ce couple imaginaire : le sujet et son image.
Lorsque le premier tour de son enseignement commence, Lacan resitue cette relation imaginaire a – a’ et il y loge toute la dimension qu’explore l’Egopsychology : le moi est un effet imaginaire, le narcissisme est la jouissance de cet ego imaginaire, et tout ce qui est fantasme est placé sur la ligne de cette relation. Le stade du miroir subordonne en quelque sorte tout ce que Lacan appelle la fantasmatisation mise au jour par l’expérience analytique. Quand son enseignement commence, tout cela représente ce qui est inerte dans l’expérience. C’est sur ce fond que la dynamique du couple symbolique, celle qui va du grand Autre au sujet,
 , apparaît, s’interpose, écrante et freine la relation imaginaire. Tout le premier enseignement de Lacan consiste à opposer le couple imaginaire inerte et l’intersubjectivité symbolique, elle, dynamique.
, apparaît, s’interpose, écrante et freine la relation imaginaire. Tout le premier enseignement de Lacan consiste à opposer le couple imaginaire inerte et l’intersubjectivité symbolique, elle, dynamique.
* Rectifications
C’est une prescription de ce qu’il faut négliger dans l’expérience psychanalytique pour s’intéresser aux signifiants, comme éléments dynamiques qui tissent une relation du sujet avec l’Autre, une relation d’identification symbolique positive distincte de l’identification imaginaire. Si on néglige le symbolique dans l’expérience, si on néglige donc l’interprétation, on s’emploie seulement à rectifier l’imaginaire. Rectifier l’imaginaire est une expression propre à Lacan qui appelle chez lui le concept de rectification symbolique, de « La direction de la cure ». Rectification est un terme délicat, puisqu’il fait appel à une norme, mais Lacan, répudiant la rectification imaginaire, ne peut que la déplacer sur le registre du symbolique. Il a même pu parler d’orthodramatisation : il faut rectifier – dans le sens de l’ortho – la dramatisation de son expérience par le sujet. La pratique consistant à rectifier l’imaginaire est d’ailleurs la pratique qui s’inspire de la relation d’objet. Lacan indique, page 54 des Écrits, que cette pratique confinée à l’imaginaire, ne peut chez tout homme de bonne foi que susciter le sentiment de l’abjection.
Il y a une inspiration décisive du premier tour de l’enseignement de Lacan que l’on trouve déjà dans son écrit « Intervention sur le transfert », portant sur le cas Dora, où le transfert est lui-même situé sur le couple imaginaire. Le transfert est pensé comme une formation imaginaire, émergeant dans un moment de stagnation de la dialectique psychanalytique qui, elle, se déroule sur l’axe symbolique.
Les premiers Séminaires de Lacan sont faits pour traduire systématiquement les grands concepts freudiens présentés par l’Egopsychology comme formations imaginaires, afin de les déplacer sur l’axe symbolique. Le transfert deviendra donc aussi un effet symbolique, et ainsi de suite. Le premier enseignement de Lacan se poursuit comme une symbolisation des grands concepts de Freud.
Il faut prendre le mot d’inertie comme indice.
Dans le tout premier tour de l’enseignement de Lacan, l’inertie est le propre de la jouissance, tandis que le symbolique est en revanche dynamique. Son dernier Séminaire, Encore – quand j’avais entrepris d’en écrire la série ; la finirai-je bientôt ? – est bien celui qui marque le moment du passage à l’envers. On y retrouve ce mot d’inertie, à la page 100, venant qualifier – et si simple que ce soit, ce serait impossible dans le premier tour – non plus l’imaginaire, mais le langage lui-même. Ledit langage comporte une inertie considérable, y dit-il. Cette inertie du fonctionnement du langage, il l’oppose alors à la vélocité des signes mathématiques, des mathèmes qui, eux, se transmettent aisément, intégralement, sans que l’on sache ce qu’ils veulent dire. Il faut comprendre que c’est précisément parce que ces signes mathématiques c’est du moins comme cela que je comprends la chose – sont allégés du signifié, qu’ils n’ont pas l’inertie que présente le fonctionnement du langage en tant qu’il est, lui, chargé de signifiés.
* Renversement
Si l’on aperçoit ça, on réalise que la valeur du langage change du tout au tout dans ce passage et que Lacan a été aspiré dans un sens où l’on voit la dynamique symbolique s’épuiser pour être remplacée par la routine. C’est ce qu’éclaire la page 42 de ce Séminaire XX : Si le signifié, dit-il, garde toujours le même sens, c’est dû à la routine. Le sens est donné par le sentiment que chacun a de faire partie de son monde, sa famille et tout ce qui tourne autour.
On s’aperçoit que la notion même de discours, ces discours que Lacan avait créés comme fondateurs du lien social, reposait déjà sur l’idée de la routine, sur l’idée que la structure signifiante est en fait comme telle inertielle, que l’inertie est du côté de la structure du langage. L’association symbolique égale dynamique s’y estompe. Le symbolique apparaît au contraire comme une routine, un discours, un disque, une répétition. C’est même parce qu’il lie le langage et l’inertie, que Lacan peut dire que ce qui paraît le mieux pouvoir supporter l’idée du langage, c’est l’idée des bouts de ficelle qui font des ronds. Quand il introduit des bouts de ficelle qui font des ronds et qui peuvent s’articuler entre eux, il les introduit comme une représentation de l’inertie du langage.
Je prends donc comme indice cette inversion de l’inertie.
À force de faire passer au symbolique les concepts freudiens, Lacan est arrivé, dans son Séminaire VI, « Le Désir et son interprétation », à une telle résorption de l’imaginaire dans le symbolique, qu’il a dû ensuite, dans un sursaut, créer un autre pôle qu’il est allé pêcher chez Freud – il l’a appelé das Ding dans son Séminaire L’Éthique de la psychanalyse. C’était déjà comme un passage à l’envers, mais il n’a traité ce das Ding dans son enseignement – qui, disons-le pour la commodité, est tout de même un nom de la jouissance – que comme objet a, c’est-à-dire en lui imposant la structure de langage. L’objet a, c’est précisément la marque de la subordination de la jouissance à la structure de langage – jusqu’à faire de cet objet a une constante.
Lacan a réduit l’écran imaginaire et inertiel de son premier enseignement à la structure du fantasme, S (Ⱥ). Il a mis le fantasme à la même place, d’une façon évidemment beaucoup plus élaborée, que le modèle du stade du miroir. La meilleure preuve en est que si l’on met le fantasme à la place du vecteur imaginaire sur le schéma L – ce que je ne crois pas avoir fait jusqu’à présent alors que ça crève les yeux ! – on comprend d’autant mieux l’expression traversée du fantasme.

L’appareil de jouissance, c’est le langage
Ce que Lacan a appelé le fantasme, c’est le rapport fondamental à la jouissance modelé par la structure de langage – prenant soin de marquer que si ledit fantasme a des racines imaginaires, le symbolique y est néanmoins impliqué sous la forme de scénarios, tout autant qu’il constitue une fenêtre sur le réel, qu’il fait fonction de réel.
L’idée de la passe repose sur la notion que le fantasme est l’appareil de la jouissance, que c’est avec lui, à travers cet appareil, que la réalité est abordée pour le sujet. Dans le passage à l’envers, l’appareil de jouissance n’est plus contenu dans les limites du fantasme. C’est le langage lui-même qui apparaît comme étant cet appareil – un pas de plus, et c’est lalangue, le signifiant dépouillé de la structure de langage. Dans le passage à l’envers, le sinthome vient à la place du fantasme. Ce qui signifie que le rapport fondamental à la jouissance n’est plus enfermé dans l’inertie et la condensation du fantasme, qui devrait être traversé par une dynamique. C’est dans le sinthome, non pas comme condensation, mais comme fonctionnement, que sont entraînés, impliqués et noués le symbolique, l’imaginaire et le réel.
Si l’on se reporte, pour finir, aux conférences de l’Introduction à la psychanalyse de Freud, on s’aperçoit que ce dernier introduisait ses auditeurs à la psychanalyse en mettant d’abord en valeur, dans les deux premières parties, l’interprétation des actes manqués et des rêves, donnant ensuite, en troisième partie, sa théorie de la libido sous le nom général de Doctrine générale des névroses. C’est la perversion qui constituait son repère ou son indicateur. La perversion figure en tête de la Doctrine générale des névroses, comme mise en évidence d’une condensation de jouissance : une abjection à laquelle le sujet ne peut pas s’empêcher de se livrer – ce qu’on appelle aujourd’hui une addiction.
* Le modèle de la perversion
C’est la perversion qui donne le modèle de l’objet a. Cette perversion a également servi de modèle chez Lacan, pour dire que dans les névroses c’est la même chose que dans les perversions, à ceci près que l’on ne s’en aperçoit pas parce que c’est camouflé, brouillé par les labyrinthes du désir, en tant que le désir est défense contre la jouissance. Il faut dès lors, dans les névroses, en passer par l’interprétation.
À suivre le modèle de la perversion, on n’en passe pas par le fantasme. La perversion met au contraire en évidence la place d’un dispositif, d’un fonctionnement. C’est ce que retrouve le concept de sinthome. Cela ne se condense pas dans un lieu privilégié, qu’on appelle le fantasme. Ça prend, dans sa parenthèse, la vie entière. De la même façon, la jouissance n’est pas seulement emprisonnée dans cette petite capture de l’objet a, mais elle s’étend partout où il y a du signifiant. Le fait majeur, c’est l’obtention de jouissance.
La jouissance, le sens et la passe
Sur ce point, Lacan se distingue de Freud. Freud pense la libido comme une énergie, susceptible d’une énergétique. Lacan pose que la jouissance ne fait pas et ne saurait s’inscrire comme une énergie. Une énergie rentre dans des calculs. Elle suppose la structure des mathématiques. La jouissance, par contre, si elle est consubstantielle au signifiant, elle se déchiffre. D’où la notion qui s’impose – même si Lacan ne l’a pas formulée ainsi – de l’interprétation de jouissance.
L’interprétation de jouissance, ce n’est qu’une élucubration de savoir sur la jouissance, sur ce pour quoi elle ne convient pas. Nous savons pourquoi elle ne convient pas ! Elle ne convient pas parce que la norme freudienne n’existe pas, parce que la norme sexuelle, celle du rapport sexuel, n’existe pas. Ce qui s’interprète, ce sont les formes contingentes que cette absence du rapport sexuel a prises, en particulier dans la famille et dans le couple parental.
Interprétation de jouissance, parce que si le discours analytique vise le sens, le sens n’est que routine d’un discours, routine du milieu où vous vivez. Par rapport au non rapport sexuel, par rapport à la jouissance, ce sens est du semblant.
Qu’est-ce qui vient alors à la place de la traversée du fantasme qu’il n’y a pas ? La semblantisation du sens d’abord, la réduction de cette vérité – qui n’est pas à découvrir – à la vérité menteuse. La passe, si elle ne se joue pas par rapport au fantasme mais bien par rapport au sinthome, n’est pas la révélation d’une vérité. La passe, c’est la révélation que la vérité est menteuse, que le sens est du semblant. Ce qui s’élucide, c’est comment la jouissance est interpellée, pour vous, par le semblant, par le signifié ou par la belle forme inoubliable que rencontre Jouhandeau à douze ans.
Cette passe du sinthome, c’est aussi vouloir l’éternel retour de sa singularité dans la jouissance. Comme Le Guerrier appliqué, il s’agirait d’un parlêtre qui ne serait plus tourmenté par la vérité. Cette fin-là est elle-même contingente. Il se pourrait que la fin de l’analyse ait la structure de la rencontre.
[*] Miller J.-A., « L’orientation lacanienne. Choses de finesse en psychanalyse » [2008-2009], enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de l’université de Paris VIII, cours des 13 et 20 mai, 3 et 10 juin 2009. Texte transcrit et établi par Jacques Péraldi, édité par Nathalie Groges-Lambrichs et Yves Vanderveken pour La Cause freudienne. Non relu par l’auteur.
[2] Cf. Poe E. A., « L’ange du bizarre », Histoires grotesques et sérieuses, traduction de Charles Baudelaire, Paris, Classiques, 1973.
[3] Cf. Jouhandeau M., De l’abjection, Paris, Gallimard, 2006.
[4] Ibid., p. 26-27.