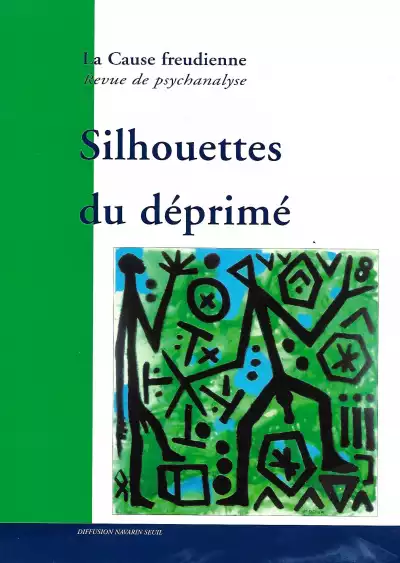L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique
Jacques-Alain Miller
"Revue de la Cause freudienne n°35"
-
L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique[1]
Jacques-Alain Miller
Introduction
L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique.
C’est sous ce titre que nous commençons un séminaire qui se poursuivra tout au long de cette année. Nous le commençons à deux, mais, conformément à la notion qui est celle du séminaire, nous espérons le poursuivre de temps à autre avec d’autres, à plusieurs, avec le renfort que pourront éventuellement nous apporter ceux qui voudront bien nous rejoindre dans cette élaboration.
Il y a une relation entre, d’une part, le titre sous lequel nous situons notre point de départ, les thèmes de l’inexistence de l’Autre et de l’éthique concoctée en comité, et, d’autre part, le mode sous lequel nous entendons travailler et présenter ce travail devant vous, à savoir celui du séminaire.
Si nous avons choisi de réunir, de fusionner les thèmes que nous avions déterminés et annoncés chacun de notre côté, si nous avons choisi de nous retrouver ensemble à la tribune, si nous avons choisi d’enseigner sur le mode du séminaire, c’est d’abord pour la raison suivante.
C’est aux fins de mettre en évidence, d’exhiber, j’irai même jusqu’à dire de mettre en scène, ce dont il s’agit, c’est-à-dire précisément que l’Autre n’existe pas, de mettre en évidence que nous renonçons cette année au monologue enseignant, qui, quoi qu’on en ait, fait croire à l’Autre, à l’Autre singulier, majuscule, unique, à l’Autre de référence. Nous préférons, étant donné ce dont il s’agit, vous présenter l’Autre de l’enseignement sous une forme double, dédoublée.
Ce tandem est ainsi l’amorce d’un pluriel.
Si déjà on franchit la prison de l’un, de l’un Autre, pour passer au deux, alors tous les espoirs sont permis, et peut-être tous les désespoirs le sont aussi. Si nous nous présentons ici à deux, c’est pour affaiblir l’Autre, conformément à notre thèse de départ. C’est pour l’ébranler, le miner, le ruiner, le révéler dans sa ruine. Et c’est aussi du même coup constituer le comité, pour esquisser le comité, pour jouer au comité, pour manifester ainsi que l’inexistence de l’Autre ouvre précisément l’époque des comités, celle où il y a débat, controverse, polylogue, conflit, ébauche de consensus, dissension, communauté, avouable ou inavouable, partialité, scepticisme, et cela, sur le vrai, sur le bon, sur le beau, sur ce que parler veut dire, sur les mots et les choses, sur le réel. Et ce, sans la sécurité de l’Idée majuscule, sans celle de la tradition, ni même sans la sécurité du sens commun.
Est-ce cela qui a été proclamé par le dit fameux « Dieu est mort » ?
Certainement pas. Car la mort de Dieu, comme celle du père, mise en scène par Freud dans son Totem et tabou, ne met fin au pouvoir d’aucun, ni de Dieu ni du père, mais au contraire l’éternise et sert de voile à la castration.
La mort de Dieu est contemporaine de ce qui s’est établi dans la psychanalyse comme règne du Nom-du-Père. Et au moins peut-on définir ici le Nom-du-Père, en première approximation, comme le signifiant que l’Autre existe.
Le règne du Nom-du-Père correspond dans la psychanalyse à l’époque de Freud. Si Lacan l’a dégagé, mis au jour, formalisé, ce n’est pas pour y adhérer, ce n’est pas pour le continuer, le Nom-du-Père, c’est pour y mettre fin. C’est ce qui, dans l’enseignement de Lacan, s’est annoncé sous les espèces du mathème S(A), signifiant de l’Autre barré, et qui a éclaté lorsqu’il en donné la lecture qui pluralise le Nom-du-Père – les Noms-du-Père.
Non seulement cette lecture de ce mathème pluralise le Nom-du-Père, mais encore elle l’effrite, elle le dévaste de l’intérieur, et ce, par l’équivoque, en attaquant le lien du signifiant à ce que l’on croit être son signifié. C’est l’équivoque célèbre entre les Noms-du-Père, les non-dupes errent, à quoi Lacan a été logiquement amené, à partir de son Séminaire Encore – que j’ai commenté en partie l’année dernière à mon cours –, et cette équivoque consacre celle de l’inexistence de l’Autre.
L’inexistence de l’Autre ouvre véritablement ce que nous appellerons l’époque lacanienne de la psychanalyse. Et cette époque, c’est la nôtre. Pour le dire autrement, c’est la psychanalyse de l’époque de l’errance, la psychanalyse de l’époque des non-dupes.
De quoi sont-ils non dupes, ces Noms-du ?
Certes, ils ne sont plus, plus ou moins, plus dupes du Nom-du-Père. Au-delà, ils ne sont plus, plus ou moins, plus dupes de l’existence de l’Autre. Ils savent, explicitement, implicitement, en le méconnaissant, inconsciemment, mais ils savent que l’Autre n’est qu’un semblant.
De là, l’époque, la nôtre, l’actuelle, voit s’inscrire, à son horizon – plutôt l’horizon que le mur – la sentence que tout n’est que semblant. L’époque, en effet, est prise dans le mouvement, toujours
s’accélérant d’une dématérialisation vertigineuse qui va jusqu’à nimber d’angoisse la question du réel. Cette époque est celle où l’être, ou plutôt le sens du réel, est devenu une question.
Nous aurons sans doute à examiner cette année des travaux contemporains, actuels, de philosophie, où s’étalent aussi bien la mise en question que la défense du réel, et qui témoignent, comme nous pouvons les lire, sous des modalités naïves ou sophistiquées, de la douleur des non-dupes quant au statut et quant à l’existence du réel.
S’il y a crise aujourd’hui – il n’est pas sûr que le mot soit approprié –, ce n’est pas comme à l’époque de Descartes, une crise du savoir. D’où. Descartes a pu forer l’issue de cette crise du savoir par la promotion du savoir scientifique.
Une crise, la crise de l’époque cartésienne, est une crise dont le ressort sans doute principal a été l’équivoque introduite dans la lecture du signifiant biblique, équivoque due à l’irruption de la Réforme. Donc, on a assisté à une crise de l’interprétation, du message divin, qui a mis l’Europe à feu et à sang. Cette crise elle-même succédant au retour aux textes de la sagesse antique gréco-romaine à la Renaissance.
C’est là la mutation scientifique que Dieu n’est plus à être seulement l’objet de l’acte de foi, mais bien celui d’une démonstration, adossant la solitude assiégée, précaire, du cogito à un réel qui ne trompe pas. Ce réel, à cette époque, était en mesure de mettre le sujet à l’abri des semblants, des simulacres, disons des hallucinations.
En revanche, aujourd’hui, s’il y a crise, c’est une crise du réel.
Est-ce une crise ?
À ce mot, on peut préférer le mot de Freud – malaise. On pourrait dire – Il y a du malaise quant au réel. Mais le mot de malaise est peut-être en passe d’être dépassé.
En effet, l’immersion du sujet contemporain dans les semblants fait désormais, pour tous, du réel une question. Une question dont ce n’est pas trop de dire qu’elle se dessine sur fond d’angoisse.
Il y a là, sans doute, comme une inversion paradoxale.
C’est le discours de la science qui a, depuis l’âge classique, fixé le sens du réel, pour notre civilisation. Et c’est – rappelons-le – à partir de l’assurance prise de cette fixion scientifique du réel, que Freud a pu découvrir l’inconscient, et inventer le dispositif séculaire, dont nous faisons encore usage – ça marche encore –, la pratique que nous nous vouons à perpétuer sous le nom de psychanalyse.
Cette pratique a été rendue possible par la fixion scientifique du réel, qui, au temps de Freud, il faut le dire, tenait encore, et même faisait l’objet d’une valorisation spéciale sous les espèces de l’idéologie scientiste – à quoi Freud a participé largement. Or – là, je m’avance – le monde des semblants, issu de nul autre discours que du discours de la science, a désormais pris le tour – ce n’est pas aujourd’hui, mais c’est en cours – de détruire la fixion du réel, au point que la question Qu’est-ce que le réel ? n’a plus que des réponses contradictoires, inconsistantes, en tous les cas, incertaines.
Eh bien, ce lieu entre semblant et réel, ce lieu de tension, ce lieu d’émotion, ce lieu de réflexion aussi, c’est désormais là qu’il nous appartient de déplacer la psychanalyse pour la mettre à sa juste place.
Éric Laurent a, dans le passé, souligné la portée de la phrase, ou du Witz, de Lacan – On peut se passer du Nom-du-Père à condition de s’en servir.
Comment l’entendrons-nous aujourd’hui ? Peut-être ainsi – On peut se passer du Nom-du-Père en tant que réel à condition de s’en servir comme semblant. On peut dire que la psychanalyse même, c’est ça – pour autant que c’est à titre ou en place de semblant que le psychanalyste entre dans l’opération qui s’accomplit sous sa direction, et qu’il s’offre comme la cause du désir de l’analysant, pour lui permettre de produire les signifiants qui ont présidé à ses identifications. C’est en tout cas un commentaire du schéma donné par Lacan comme étant celui du discours analytique. Mais aussi bien, l’usage des semblants est vain, inopérant, voire foncièrement nocif, si impasse est faite sur le réel dont il s’agit.
Il y a du réel dans l’expérience analytique.
L’inexistence de l’Autre n’est pas antinomique au réel. Au contraire, elle lui est corrélative.
Mais ce réel – celui dont j’ai dit Il y a du réel dans l’expérience analytique – n’est pas le réel du discours de la science, n’est pas ce réel gangrené par les semblants mêmes qui en sont issus, et qu’on est réduit, pour le situer, à aborder, comme on le fait depuis toujours, par les nombres. C’est au contraire le réel propre à l’inconscient, du moins celui dont, selon l’expression de Lacan, l’inconscient témoigne.
À mesure que l’empire des semblants s’étend, il importe d’autant plus de maintenir dans la psychanalyse l’orientation vers le réel. C’est tout le sens, la portée, de l’ultime tentative de Lacan, consistant à présenter le réel propre à la psychanalyse, en le rendant présent, visible, touchable, manipulable, sous les espèces des nœuds borroméens et autres.
Que cette tentative ait été concluante ou non, elle témoigne que l’orientation lacanienne c’est
l’orientation vers le réel. Car le nœud, susceptible de se manifester sous les formes visibles les plus différentes, cet objet par excellence flexible, pluriel, bien là, et aussi qui se dérobe, échappant – comme dit Mallarmé –, cet objet ondoyant, divers, aux apparences, aux facettes innombrables –, cet objet n’est pas un semblant. Il est, aussi bien que le nombre, de l’ordre du réel. Et c’est pourquoi Lacan aurait voulu en faire le témoignage, la manifestation, du réel propre à la psychanalyse.
Le réel propre à la psychanalyse, c’est quelque chose comme ça. Pouvoir dire – Le réel dans la psychanalyse, c’est ça. Et ce n’est pas un semblant. Même si ça bouge, même si ça a des aspects multiples et insaisissables.
J’ai dit que ce nœud était, aussi bien que le nombre, de l’ordre du réel. Et il a, par rapport au nombre, le privilège de n’être pas chiffré et de n’avoir pas de sens. La leçon à en tirer, c’est qu’il importe, dans la psychanalyse, de maintenir, si je puis dire, cap sur le réel.
Cela n’importe pas que dans la psychanalyse. Cela importe aussi bien au malaise dans la civilisation. La civilisation, que nous laissons au singulier, bien qu’il y ait les civilisations, et qu’on annonce déjà, pour le siècle prochain, que l’histoire sera faite du choc, de la rivalité, de la guerre des civilisations. C’est la thèse toute récente, et fort discutée, d’un professeur américain, qui pourrait nous retenir un moment cette année. Mais il y a bien sûr aussi la civilisation au singulier, l’hégémon – d’hégémonie – scientifique et capitaliste, dont l’emprise, que l’on pourrait dire totalitaire, est aujourd’hui devenue patente, et que l’on désigne ici, dans notre contrée, comme la globalisation. Cette globalisation entraîne, traverse, fissure, et peut-être même déjà fusionne les civilisations.
Dans ce malaise, ou ce vertige global, la psychanalyse a sa place. Elle en subit les effets quotidiens dans sa pratique. Mais aussi, elle a sa partie à tenir qui n’intéresse pas que sa discipline, qui importe à ceux et à celles qui habitent avec nous le malaise.
Lacan pouvait écrire, il y a une éternité, en 1953, dans son rapport de Rome – La psychanalyse a joué un rôle dans la direction de la subjectivité moderne, et elle ne saurait le soutenir sans l’ordonner au mouvement qui, dans la science, l’élucide. Le contexte d’aujourd’hui est tout différent. Mais la question reste de savoir quel rôle peut en effet soutenir la psychanalyse dans ce que Lacan appelait la direction de la subjectivité moderne.
Pour notre comité, c’est de cela qu’il sera question cette année, de la direction de la subjectivité
moderne, voire post-moderne – on ne va pas pouvoir éviter le mot –, disons de la subjectivité contemporaine, du rôle que la psychanalyse peut y soutenir, des « impasses croissantes de la civilisation », dont Lacan voyait dans le malaise freudien le pressentiment, et dont il annonçait que la psychanalyse pourrait y faire défaut, rendre ses armes.
J’en ai dit assez, précédemment, pour indiquer la voie où nous entendons engager notre effort. La subjectivité contemporaine – je ne sais pas si nous garderons cette expression, qui est commode pour lancer le mouvement – est entraînée, captivée, roulée – c’est le cas de le dire – dans un mouvement peu résistible, qui la submerge industriellement de semblants, dont la production toujours accélérée constitue désormais un monde qui ne laisse plus à l’idée de nature qu’une fonction de nostalgie, qu’un avenir de conservatoire, d’espèce protégée, de zoo, de musée.
Et le symbolique ?
Eh bien, le symbolique contemporain, là où il est vif, là où il est productif, là où il est intense, là où il concerne le sujet et ses affects, est comme asservi à l’imaginaire, ou comme en continuité avec lui. Loin que ce symbolique soit en mesure de percer, de traverser l’imaginaire, comme le comportait le schéma L de Lacan, que j’ai longuement commenté voire fait varier dans mon cours. Ce schéma est en fait basé sur un x, et où la flèche du symbolique traverse – même si elle peut être freinée, parfois arrêtée, ralentie – l’axe de l’imaginaire.
Voilà le squelette du schéma qui était pour Lacan fondamental au début de son enseignement. Une opposition franche, nette, du symbolique et de l’imaginaire, et la notion d’une traversée dialectique du symbolique par rapport à l’imaginaire.

Voilà le squelette du schéma qui était pour Lacan fondamental au début de son enseignement. Une opposition franche, nette, du symbolique et de l'imaginaire, et la notion d'une traversée dialectique du symbolique par rapport à l'imaginaire.
Le symbolique contemporain n’accomplit plus désormais cette traversée dialectique, à quoi jadis Lacan ordonnait l’expérience analytique. Et on pourrait croire, au contraire, que le symbolique se
voue à l’image, quand on voit comme, dans nos ordinateurs, il se dissimule comme hardware derrière l’écran où il miroite comme semblant.
Dans ce paysage d’apocalypse – apocalypse confortable, pour un certain nombre en tout cas –, le rôle que la psychanalyse a à soutenir ne souffre pas d’ambiguïté. C’est le rappel du réel qu’il lui revient d’accomplir. C’est ce que Lacan a indiqué, pour finir.
Que la vérité ait structure de fiction n’est que trop vrai, mais c’est au point que désormais la structure de fiction a submergé la vérité, qu’elle l’inclut, qu’elle l’avale. La vérité y prospère, sans doute, elle s’y multiplie, elle s’y pluralise, mais elle y est comme morte. C’est là que s’impose, devant cette désuétude fictionnelle de la vérité, le recours au réel comme à ce qui n’a pas structure de fiction.
Le privilège de la psychanalyse – encore faudrait-il qu’elle le connût, qu’elle l’ait appris de Lacan, c’est le rapport univoque qu’elle soutient au réel.
Ce n’est que des autres discours, énonçait Lacan en 1967, ceux qui ne sont pas le discours analytique, que le réel vient à flotter.
L’usage contemporain du terme de dépression, terme évidemment fourre-tout, fait ici symptôme du rapport au réel quand il s’avère dans la clinique comme l’impossible à supporter. À le leurrer de semblants, on ne peut en effet que le faire flotter.
La clinique psychanalytique est le site propre du réel dont il s’agit. C’est là, dans la pratique, que s’établit le rapport au réel. Et c’est là que, depuis des années, nous nous attachons, à la Section clinique, au Département de Psychanalyse, dans les diverses sections cliniques qui existent en France et ailleurs, à mettre le réel en évidence dans son relief, dans son orographie.
Cette année, il s’agira seulement pour nous de mettre ce réel explicitement en relation avec la civilisation, une civilisation qui n’est plus sans doute à l’âge du malaise, pour être entrée décidément dans l’époque de l’impasse. L’impasse est en particulier patente au niveau de l’éthique. La solution victorienne, qui prévalait encore au temps de Freud, celle d’une éthique capitaliste des vertus, a été emportée, et si elle revient aujourd’hui, c’est toujours sous des formes dérisoires et inconsistantes.
La nouvelle éthique se cherche, mais ne se trouve pas. Elle se cherche par la voie qu’Éric Laurent a soulignée des comités. C’est une pratique de bavardage, comme telle assourdissante, mais qui, à la différence du bavardage analytique, n’a pas chance de délivrer un rapport au réel qui ne flotte pas.
La faillite de l’humanitaire se déclare tous les jours, comme prévu par Lacan. Comment l’humanitaire résisterait-il au calcul universel de la plus-value et du plus-de-jouir ?
Nous n’allons pas faire du journal la prière du matin du psychanalyste, mais nous allons lire les journaux, cette année.
Comment opérer tous les jours dans la pratique, sans inscrire le symptôme dans le contexte actuel du lien social qui le détermine dans sa forme ? – pour autant qu’il le détermine dans sa forme.
Nous avons l’intention, Éric Laurent et moi, d’affirmer cette année la dimension sociale du symptôme.
Affirmer le social dans le symptôme, le social du symptôme, n’est pas contradictoire avec la thèse de l’inexistence de l’Autre. Au contraire, l’inexistence de l’Autre implique et explique la promotion du lien social dans le vide qu’elle ouvre.
En nous intéressant à ce que nous allons isoler comme des phénomènes de civilisation, nous n’entendons pas nous divertir d’une clinique qui est celle du réel, mais bien au contraire prendre la perspective qu’il faut, et qui comporte un recul, pour cerner ce réel en son lieu.
Prenons l’identification.
J’ai évoqué, comme étant bien connue de la plupart, la production par l’analysant des signifiants de l’identification, comme ce qui est attendu de l’opération analytique – selon la lecture la plus simple du schéma du discours analytique par Lacan. Or l’identification fait précisément comme telle lien social. Elle est en elle-même lien social. Et c’est pourquoi Freud a pu glisser sans peine de l’analyse subjective à la Massenpsychologie, et retour, pour construire sa théorie de l’identification.
Qui peut penser, par exemple, que l’identification au signifiant être une femme reste intouchée par la spectaculaire mutation qui, de la proclamation révolutionnaire des droits de l’homme, a conduit à l’émancipation juridique et politique des femmes, jusqu’à la révolte proprement éthique du féminisme, dont l’incidence se fait sentir à tous les niveaux du nouvel american way of Life – bien différent de ce qu’il était du temps du rapport de Rome –, depuis le contrat du travail, jusqu’au mode de relation sexuelle ?
Qu’est-ce qui reste invariable de l’homosexualité et qu’est-ce qui en change, quand l’Autre social y fait désormais accueil d’une façon tout autre, et qu’une norme nouvelle est en cours d’élaboration, conférant une légitimité inédite et de masse au lien homosexuel ? Et cela n’est pas confiné à San Francisco.
Je peux ajouter que j’ai vu l’an dernier des comités d’éthique, des comités spontanés – ce qu’on appelait avant Éric Laurent des conversations de bistrot –, des comités spontanés d’éthique se former en Italie, quand ô surprise, la couronne de Miss Italie fut donnée à une Africaine.
La superbe dont témoignait le Comment peut-on être persan ? s’éteint aujourd’hui pour laisser place à Comment peut-on être français ?
Comment peut-on être encore français ? Interrogation qui taraude un peuple, jusqu’à la dépression collective, dit-on, dont les idéaux universalistes, établis sur des certitudes identificatoires millénaires, sont démentis par l’actuelle globalisation.
Non seulement ce séminaire ne pourra s’abstraire de ce contexte, mais il ne saurait le faire. C’est pourquoi nous trouverons sans doute nos références électives, cette année, dans les phénomènes de la civilisation américaine.
Pour le dire rapidement, les symptômes dans la civilisation sont d’abord à déchiffrer aux États-Unis d’Amérique. Et il n’est pas vain de le faire depuis la France, qui est à beaucoup d’égards l’Autre des Etats-Unis.
Universalisme, versus globalisation. Ce sera au moins notre chapitre US, à lire United Symptoms. À la fin du chapitre V du Malaise dans la civilisation, Freud précise qu’il résiste à la tentation d’entamer une critique de l’état présent de la civilisation en Amérique. Eh bien, nous avons l’intention de ne pas résister à cette critique.
Elle porte d’ailleurs sur un point très précis. Freud en donne un tout petit aperçu. Alors qu’en Europe, on pratique plus volontiers l’identification verticale au leader, qui met en action la sublimation d’une façon puissante – et il a quelque mérite à le dire au moment où il le dit, puisque ça conduit ses contemporains dans un certain nombre de difficultés dans la civilisation en même temps –, les États-Unis, dit-il, la sacrifie au bénéfice de ce qu’on peut appeler l’identification horizontale des membres de la société entre eux. Non pas identification au plus-un, mais identification horizontale des membres de la société entre eux.
Ce n’est sans doute pas excessif d’y voir le pressentiment de l’Autre qui n’existe pas, et de son remplacement par la circulation des comités d’éthique.
J’ai évoqué l’identification, pour marquer la dimension sociale des concepts les plus fondamentaux de la psychanalyse.
Pourquoi ne pas parler de la pulsion ?
Quand il faut à Freud inventer à la pulsion un partenaire, quelle est l’instance qui, pour lui, est partenaire de la pulsion ? C’est celle qu’il a dénommée du surmoi. Et il peut la référer au seul Ich, au seul moi, au seul Je. Elle déborde le sujet, cette instance. L’instance qui lui sert à penser la pulsion ne peut être par Freud même située qu’au niveau de ce qu’il appelle la civilisation. C’est à ce niveau-là, au moins dans cet ouvrage, qu’il pense les avatars de la pulsion, les renoncements comme les sublimations. C’est Freud qui, lorsqu’il s’agit de parler de la pulsion, implique la civilisation.
Allons jusque-là – Qu’est-ce qu’une civilisation ?
Disons que c’est un système de distribution de la jouissance à partir de semblants. Dans la perspective analytique, c’est-à-dire dans celle du surmoi – et nous ne pouvons pas faire mieux que le concept de surmoi –, une civilisation est un mode de jouissance, et même un mode commun de jouissance, une répartition systématisée des moyens et des manières de jouir.
Il faudra bien en dire davantage sur qu’est-ce qu’une civilisation ?, quitte à revenir même à l’historique du mot, à l’opposer à la culture, etc., mais cela fera office pour l’instant.
Comment la clinique psychanalytique pourrait être indifférente au régime de civilisation où nous, ici, entrons maintenant sur la voie où les United Symptoms nous ont précédés ? Comment la clinique serait-elle indifférente à cette voie, si cette voie est bien celle que l’on pourrait appeler du terme freudien d’Hiflosigkeit – Hiflosigkeit capitaliste, la détresse organisée, envers les fondements de l’impératif de rentabilité ? C’est donc à un peu de nostalgie, tout de même illusoire. La civilisation antique comportait que l’on soignât l’esclave – j’abrège –, la nôtre qu’on angoisse méthodiquement le salarié.
Il faut ici prévenir une inquiétude qui peut naître de ce que nous voulions introduire dans la clinique un relativisme social. À cette inquiétude, j’opposerai le rappel fait par Lacan, dès ses Complexes familiaux, en 1938, que l'Œdipe ne se fonde pas hors de la relativité sociologique et que la fonction du père est liée à la prévalence d’une détermination sociale, celle de la famille paternaliste. À l’époque, il faisait une référence expresse à l’enquête ethnologique de Malinovski en Mélanésie, où, comme on sait, c’est l’oncle maternel qui représente l’autorité familiale. Donc, au lieu que le père cumule sur sa personne à la fois les fonctions répressives et la sublimation, cela se trouve réparti en deux – l’oncle maternel assurant l’autorité et la répression, et le père, gentiment, les activités sublimatoires. Selon Malinovski, il s’ensuivait, de ce dispositif social distinct, un équilibre différent du psychisme, disait Lacan, attesté par l’absence de névrose. D’où la notion que le complexe d’Œdipe est relatif à une structure sociale, et que, loin d’être le paradis, la séparation de répression et sublimation avait comme conséquence une stéréotypie des créations subjectives dans cette société.
Que Lacan ait élaboré le mythe freudien ensuite, jusqu’à le formaliser sur le modèle linguistique de la métaphore ne veut pas dire qu’il ait jamais négligé sa relativité.
Il en a même annoncé le déclin, en 1938 – Les formes de névrose dominantes à la fin du siècle dernier semblent – j’abrège –, depuis le temps de Freud, avoir évolué dans le sens d’un complexe caractériel, où l’on peut reconnaître la grande névrose contemporaine. Il en désignait à l’époque la détermination principale dans la carence du père dont la personnalité est absente, humiliée, divisée ou postiche.
Le Nom-du-Père a pu passer pour une restauration du père par Lacan, alors que c’était tout autre chose. C’était un concept du retour à Freud, qui n’était fait, par sa formalisation même, que pour en démontrer le semblant et ouvrir à sa pluralisation.
Pouvons-nous parler aujourd’hui d’une grande névrose contemporaine ? Si on pouvait le faire, on pourrait dire que sa détermination principale, c’est l’inexistence de l’Autre – en tant qu’elle rive le sujet à la chasse au plus-de-jouir.
Le surmoi freudien a produit des trucs comme l’interdit, le devoir, voire la culpabilité. Autant de termes qui font exister l’Autre. Ce sont les semblants de l’Autre. Ils supposent l’Autre.
Le surmoi lacanien, celui que Lacan a dégagé dans Encore, produit, lui, un impératif tout différent – Jouis. Ce surmoi-là est le surmoi de notre civilisation.
Je termine, pour passer la parole à l’autre.
Éric Laurent
Bien sûr, le surmoi lacanien rend compte des données rassemblées par Freud. Il est la vérité du surmoi freudien. Mais le fait qu’il soit maintenant énoncé en clair a traduit le passage, est isochrone, au nouveau régime de la civilisation contemporaine.
Ce n’est sans doute pas un hasard si le terme de comité d’éthique a proliféré sur le secteur des pratiques sociales liées à la vie, et que l’on touche par ce terme, qui a connu sa chance dans le vocabulaire contemporain, aux difficultés à appliquer une morale comme guide de vie.
L’Autre de la civilisation se trouve confronté à une série d’impasses, pour diagnostiquer, appliquer, réduire, les effets des commandements universels ou des idéaux qui veulent embrasser de vastes domaines. Nous sommes confrontés à une perte de confiance dans les signifiants-maîtres, à une nostalgie des grands desseins.
Sur les pas de l’Autre de l’impératif, surgissent des problèmes locaux, toujours plus nombreux, qui se rebellent et font objection à son application. L’urgence de notre modernité ne nous fait pas oublier, bien sûr, que la dialectique de l’impératif et de la casuistique fut un tourment constant.
L’impératif peut contourner l’obstacle de diverses manières, par exemple en ritualisant, en inventant un rituel local, ad hoc, qui permet de contourner la difficulté, ou bien, au contraire, en s’en sortant par le haut, en inventant un commandement plus généralisé, qui affirme en toute invraisemblance qu’il ne connaît aucune difficulté d’application et qu’il n’y a que plus d’honneur à trouver comment s’applique le commandement là où il ne peut l’être.
La casuistique rituelle de la loi peut s’identifier à la loi même : par exemple, la façon dont, dans la common law anglaise, on est passé au régime moderne de la loi ; ou bien au contraire, sur le modèle chrétien du commandement simple, on peut vouloir un espace allégé, sans beaucoup de lois, où l’impératif sortirait grandi. C’était le souhait de Saint-Just.
Nous avons eu droit à tout depuis que le monothéisme universel nous a coupé de la solution des dieux locaux. À chaque problème, il y avait, non pas un impératif, mais un dieu. Ennui sexuel ? – temple pour la Vénus du matin – temple pour la Vénus de l’après-midi – temple pour la Vénus du lieu. Des difficultés à un endroit permettaient d’être surmontées à l’autre. On obtenait certes un univers peuplé de dieux, mais qui n’était pas infesté d’impératifs. C’était un univers peuplé de jouissances locales, contradictoires, dont les insignes et attributs ou prescriptions donnaient des listes inconsistantes, énigmatiques, laissant la volonté des dieux en quête d’un interprète – quelles que soient les listes que l’on puisse multiplier. Ce qui fait que, dans la multiplicité des cités grecques, on se donnait tout de même rendez-vous à au moins trois endroits, pour aller chercher l’oracle, la solution qui n’énonçait ni le vrai, ni le faux, mais qui indiquait où se nichait le problème de la jouissance coupable. C’est ainsi que va procéder Œdipe. Il ira à Delphes chercher l’oracle pour s’y retrouver. Et là, quelle que soit la diversité des discours tenus sur les dieux et leurs domaines, qui varient selon les cités et les époques, un air de famille s’y retrouve suffisamment pour qu’à Olympie, Delphes et Délos, un certain nombre se chargent de maintenir le cap du discours sur le divin.
Le mode de procéder des cités grecques est très distinct, évidemment, dans leur rapport avec le divin, de celui que mettent en place les états centralisés qui, avant le monothéisme universel, disposent de l’écriture pour classer les dieux. Les rois, régulièrement, réorganisent les panthéons et refont les listes des dieux en s’appuyant sur le savoir des prêtres. C’est le pouvoir central qui décide de redessiner la carte des sanctuaires et de restructurer la société des dieux.
Marcel Détienne, dans ses travaux, peut citer l’exemple du monde hittite où, lors de la prise de pouvoir d’un roi, trois groupes – divinité de l’orage, divinités de la fécondité et puissance de la guerre – sont réorganisés et réorganisent une longue liste de noms divins. Les administrateurs du nouveau panthéon sont nommés par la loi. À eux de loger les nouvelles idoles dans des temples en matériaux durs, et aussi de répartir interdits et puissance. De ce même monde, Détienne souligne que nous disposons au Louvre d’une liste datant du deuxième millénaire où 473 divinités sont cataloguées, distribuées en grandes familles, autour de quinze couples. Grâce à l’écriture, l’exégèse théologique des dieux recherche le pouvoir à travers la pluralité de leurs noms. Mais, avec le monothéisme, les impératifs sont regroupés dans de louables efforts de simplification qui terminent dans l’indépassable décalogue, qu’il faut encore savoir adapter au cas. Et Dieu sait si l’adaptation au cas du décalogue a donné ce savoir de l’interprétation auquel Lacan, avec le Midrash, donne toute sa place. C’est le monothéisme universel qui abrite ce que Freud nomme le plus récent des commandements – Aime ton prochain comme toi-même, qui nous impose par son universel même une rupture radicale avec la philia grecque.
Les Grecs, eux, limitaient l’amour de l’Autre à celui qui d’abord pouvait être digne d’en occuper la place, et la question permettait d’exclure pas mal de monde. La philia n’en assurait pas moins la cohésion de la cité des hommes libres.
Les comités d’éthique s’inscrivent dans une civilisation où coexistent des religions, des sagesses, des pouvoirs d’état, le culte de la raison, la science, sans que les uns puissent l’emporter sur les autres, sans qu’ils aient à le faire d’ailleurs. Dans un monde où, d’une part, les guerres de religion sévissent de plus belle et où, d’autre part, on peut se réunir en rituels éclectiques les plus variés, où pour la première fois l’Orient trouve en Occident à fidéliser un public de masse à la référence bouddhique.
Tout cela doit être consulté pour faire face aux mesures sur la vie, sur le style de vie qu’est arrivé à prendre le maître moderne qui, par son action même, a fait de la vie, sous la forme de la santé, un objet politique. Longtemps la vie, sous la forme de la santé, relevait exclusivement de la sphère privée. Seule relevait de la sphère publique la santé du roi, non pas le remboursement de ses maladies, mais sa santé en tant qu’elle était la garantie de celle du royaume par des sympathies étranges et généralisées. Le maître moderne a soulevé là un caillou qui lui est retombé sur les pieds et qui fait mal. Les métaphores abordant l’état de la société sous le mode d’une santé et sous le modèle médical ont fini par se réaliser et elle est devenue le problème comme tel de la société civile en temps de paix.
Le comité d’éthique est une façon, au-delà de ce domaine, de supporter le poids de l’Autre, par la pratique de bavardage qu’évoquait Jacques-Alain Miller d’abord, la façon dont nous arriverons à supporter le rapport à l’Autre et la charge qu’il implique.
Comment supporter l’Autre ? C’est la question que se pose Freud dans son Malaise et dans les textes contemporains, et il prend soin de distinguer la façon dont les deux sexes arrivent à supporter l’Autre. Pour les hommes, c’est par la sublimation, qui peut être présentée comme sublimation pulsionnelle ou comme homosexualité sublimée – réinterprétation de la philia grecque. Pour les femmes, il en va tout autrement. Elles supportent l’Autre parce qu’elles s’en séparent. C’est ce que Freud, dans Les nouvelles conférences de 1933, appelle les intérêts sociaux plus faibles des femmes. Et il les rapporte au caractère asocial qui est sans doute propre à toutes les relations sexuelles – les amoureux se suffisent à eux-mêmes et même la famille répugne à se laisser inclure dans des groupements plus larges. Là, Freud est très hégélien. Les femmes supportent l’Autre par leur retrait. L’Autre peut causer, elles s’assurent de l’auto-érotisme du secret de leur jouissance. Ce serait là la clé du retrait où elles se tiennent et qui les ont aidées à supporter, dans une position qui n’est pas celle de l’esclave, le maître masculin.
Notre moment historique ne peut plus se contenter d’une telle position, celle même qu’énonce Freud en 1933. D’abord parce qu’il y a eu un immense effort de civilisation de la position féminine dans la civilisation libérale, voulant la résorber par le contrat de travail, pas très égalitaire, il faut bien le dire, mais offrant comme jamais dans l’histoire, ce mode de socialisation aux femmes, qui, partout ailleurs, lorsqu’elles travaillaient, ne pouvaient le faire que dans des zones d’une prescription absolue. Les femmes au travail interrogent ce que Freud appelait leur soi-disant incapacité à la sublimation. Il faut d’ailleurs relire dans cette perspective les difficultés qu’a eues Freud à reconnaître la portée sublimatoire comme telle du travail, et il a reculé à concevoir comment l’activité créatrice, sublime, allait elle aussi se fondre dans l’ordre du travail pour l’artiste moderne. Cette opposition de l’homme sublimable et de la femme non sublimable est encore héritée de la fin du siècle. Baudelaire dans Mon cœur mis à nu peut dire – La femme est le contraire du dandy, donc elle doit faire horreur. (... ;) La femme est naturelle, c’est-à-dire abominable. Cette abomination, pour Baudelaire, désigne le retrait de la position féminine de l’Autre. C’est elle que Freud, plus précisément, qualifie d’énigme. Que les femmes aient un surmoi faible est une proposition qu’il faut examiner à partir de la clinique, puisqu’il est manifeste qu’elles peuvent être parfaitement coupables ou déprimées, et même plus que les hommes, mais il faut la situer bien sûr dans la difficulté, dont se sont toujours plaints les hommes, à éduquer les femmes ou même à influer sur leurs désirs. Ce qui déplace la question est donc l’insertion massive des femmes dans le monde de l’Autre par le travail.
Ce fait crucial ne figure pas dans Fonction et champ, en 1953, mais par contre, explicitement, dans Propos directifs pour un Congrès sur la sexualité féminine, en 1958. Lacan ne reprend pas la question de la limite des capacités sublimatoires des femmes, mais en revanche considère la limite de la résorption de la question féminine dans l’ordre du contrat. Ce qui fait que, pour nous, la question féminine est déplacée et que nous sommes parfaitement prêts à saisir les capacités sublimatoires de la position féminine, c’est que, pour les deux sexes, il y a le rapport à l’Autre et une jouissance asexuée, et par là, auto-érotique. La difficulté de la sublimation, la psychanalyse l’a démocratisée à l’homme, elle est généralisée dans notre condition subjective. C’est ce que Jacques-Alain Miller démontrait dans la façon dont Lacan lit Freud et le prolonge. Ce sont maintenant et les hommes et les femmes qui sont déterminés par leur isolement dans leur jouissance. Leur retrait est là montée au zénith social de l’objet a. Le comité d’éthique est symptôme de cette montée.
Cette année, je suivrai les traces, dans une série de symptômes, de la subjectivité moderne dans son rapport à l’Autre. Si Lacan, dès 1953, dès l’orée de son enseignement, propose une lecture du Malaise dans la civilisation qui ne soit pas sociologique, mais bien clinique et éthique, c’est sans doute qu’il n’a pas été sans s’intéresser à ce que Georges Bataille, dans un article célèbre de 1946, nommait le sens moral de la sociologie. Il y situe remarquablement la coupure éthique entre la culture du vingtième siècle et celle du dix-neuvième finissant de l’avant-première guerre mondiale. Il disait ceci – La génération qui atteignit la maturité entre les deux guerres aborda le problème de la société dans des conditions qui valent d’être remarquées. Elle tenait de ses aînés l’héritage d’une culture humaniste où toute valeur était rapportée à l’individu. Et Bataille notait – je ne me rappelle pas, durant des années, que l’on ait devant moi défendu contre ceux de l’individu les droits de la société. Ainsi, on ne pouvait avoir d’autre ambition que d’en précipiter l’effondrement. Des difficultés toutefois étaient rencontrées dans la pratique. Si on devait lutter pour ruiner l’édifice social, il fallait sacrifier le désir de l’individu aux nécessités de la révolution, qui se révèle ainsi ce qu’elle est, un mouvement de nature collective qui ne peut exiger moins que le maître précédent, qui doit même exiger plus que l’ancien. Des intellectuels de cette génération étaient amenés dans ces conditions à faire de la réalité collective et du sens qu’elle a une expérience inattendue, même assez lourde. Et il fait valoir, dans ce paradoxe de l’intellectuel qui, voulant affirmer ces droits de l’individu, se retrouvait devoir supporter un maître encore plus gourmand. Il fallait le corréler, dit-il, à l’épuisement des possibilités d’une culture individualiste, le mouvement de la poésie excédant par son ambition les limites de l’individu cultivé, du bourgeois distingué, riche ou pauvre, qui se retrouvait contraint à l’isolement et à la distinction. Le surréalisme fut une détermination décisive faisant du texte poétique l’expression d’éléments communs semblables à ceux que révèlent les vers. Et il montre par là comment est né, dans une crise morale, l’intérêt de la génération avant-guerre pour les créations collectives, pour l’Autre collectif ainsi introduit aux mythes et aux activités religieuses, manifestations d’emblée du lien social. Bataille notait là que c’est à partir, paradoxalement, de ce moment, longtemps après la mort de Durkheim, que toute une génération d’intellectuels, spécialement de jeunes écrivains sortis du surréalisme – Caillois, Leiris – commencèrent à suivre les enseignements de Marcel Mauss, fascinés par son œuvre.
Ce texte de Bataille est remarquable par l’importance qu’il situe pour l’horizon intellectuel français, de la discipline de l’ethnologie, et la place qu’a su occuper le continuateur et rénovateur de Durkheim, Claude Lévi-Strauss. Je ne développerai pas ce point aujourd’hui, mais je fais toute sa place à ce texte de 46 de Bataille pour nous instruire sur les façons dont se situent les figures de la subjectivité dans la relève du poids éthique que l’Autre de la civilisation fait porter sur des sujets pris dans une réponse commune à donner.
On peut voir comment cette génération, juste avant-guerre, releva la question et comment, dans l’après-guerre, se mit en place une autre figure, très distincte de cette subjectivité moderne, sous la forme de la belle âme, dans laquelle le portrait du sartrien à bien des égards se dessine.
Les comités d’éthique généralisés sont les figures où la subjectivité de notre temps tente de restaurer le sens moral de l’Autre, alors que nous sommes contemporains de la fuite du sens, de ce paradoxe de mélange des jouissances et de leur ségrégation, de leur isolement, sans que l’instance décidée à s’en faire responsable apparaisse clairement.
De la série des figures contemporaines, j’en présenterai simplement une aujourd’hui, celle des néokantiens, puisque ce sont eux qui sont les plus volontiers donneurs de leçons, qui ont critiqué le structuralisme pour avoir produit, en annonçant la mort de l’homme, une génération sans épine dorsale, déboussolée moralement, égarée dès qu’elle a perdu l’horizon fragile de l’idéologie politique. Un certain nombre de volées de bois vert ont été volontiers énoncées, en Europe – France, Allemagne, Espagne – sur le structuralisme, et aux Etats-Unis où l’étoffe morale des baby- boomers, comme le président Clinton dont les écarts sont considérés comme belle démonstration – Voilà ce dont vous êtes capable. Il y a pour les néokantiens, urgence à restaurer l’impératif et ses normes, pour qu’après l’Autre de la politique, l’Autre de la morale retrouve toute sa place. Et il faut mettre les bouchées doubles pour l’instauration d’une génération morale. Doubles sont les bouchées puisqu’il faut, d’une part, restaurer ce bon vieux sujet kantien et, d’autre part, retrouver le point de vue où peut se proférer qu’il faut que j’agisse de façon telle que mon action soit valable en tout cas. En effet, disait Lacan dans Kant avec Sade, pour que la maxime fasse la loi, il faut et il suffit, à l’épreuve de la raison purement pratique, qu’elle puisse être retenue comme universelle en droit de logique. Restaurer le tout n’est pas facile, puisqu’il se dérobe d’une part et que le relativisme culturel, l’affaiblissement des nations en général, du modèle européen de développement économique en particulier, et du consensus de la nation pour terminer, ne rend pas la chose commode. C’est dur, car le sujet libéral, parfaitement démocratique, ne suppose pas de tout préalable. Celui-ci, le tout, la communauté, ne surgit qu’à l’issue du débat démocratique et non pas avant, a priori. Or l’impératif catégorique, lui, ne lie un sujet que par le tout. Et Lacan a bien vu la difficulté qui, dans son Kant avec Sade, précise que l’universel de la maxime de Kant, il est possible de l’appliquer en démocratie, car le fait qu’elle soit valable en universel ne veut pas dire qu’elle s’impose à tous. Mais partout, dans la restauration du néokantien, et dans la façon plus ou moins subtile dont il opère, il y a une butée sur le relativisme culturel, autre nom du mélange des jouissances, et c’est là le problème du réel dans cet impératif. Nous devrons examiner les différentes façons dont on tente de constituer des communautés suffisamment stables pour faire face à la jouissance du sujet.
DISCUSSION
Jacques-Alain Miller – Je ne m’attendais pas à ton développement sur le polythéisme, la solution polythéiste formidable : à chaque problème son dieu. -Un univers peuplé de dieux et de jouissances locales, et non d’impératifs. Cela met l’Autre n’existe pas que je présentais comme notre moment habituel, vif, urticaire, et propulseur aussi, il y a très longtemps. Le monothéisme fait exister l’Autre puissamment, puisque, s’il y a le Nom-du-Père, comme dit Lacan quelque part, c’est « selon la tradition ». Si aujourd’hui quelque chose de l’Autre défaille, c’est l’occasion de se souvenir en effet des cultes de la Grande Mère et de la multiplicité des dieux. Les militants du monothéisme ont dit bien du mal du « poly », je pense à saint Augustin et à ses listes de La cité de Dieu, où il énumère les dieux multiples pour chaque occasion de la vie, en veux-tu, en voilà, comme on offre aujourd’hui des produits de l’industrie. Reste que les trois rendez-vous que tu rappelais ont toujours été liés à une organisation hiérarchique.
Éric Laurent – Le polythéisme pour moi n’est pas une modalité de l’Autre qui n’existe pas. Cette modalité pulvérulente, centralisée, qui nécessite ses interprètes pour toujours relancer, suppose tout de même que le grand Pan existe. Cela suppose qu’au moment où la nouvelle du « grand Pan est mort » se répand, ça n’existe plus. Nous pouvons cependant reprendre dans la perspective de l’Autre n’existe pas les questions classiques – Les dieux d’Épicure existaient-ils ? Qu’était donc ce dialogue où l’on convoque le dieu et où l’on arrive à établir un dialogue avec lui – Y croyaient-ils, n’y croyaient-ils pas ? Il faut une croyance fondamentale. Cette question même était limitée à ces clubs, ces bases d'opération qu’étaient les sociétés philosophiques, qui supposaient une opération sur soi qui faisait consister au moins ça.
J.A.M – Autre point. Ton introduction fait apparaître que la grande différence entre la soi-disant « subjectivité moderne » qu’évoque Lacan en 1953 et le sujet contemporain, c’est la question féminine. Lacan peut parfaitement aborder en 53 l’actualité de la subjectivité moderne, la présenter, situer la psychanalyse dans le contexte, et ne pas dire un mot de la position spéciale de la femme. De la subjectivité moderne au sujet contemporain, la question féminine éclate. Nous avons souvent parlé – en tout cas moi – du féminisme sur un versant parfois dépréciatif. Ces efforts pour élaborer des identifications nouvelles se sont en effet effondrées dans le paradoxe, ou ont démontré une certaine inconsistance. Cette fois-ci, je l’ai rapidement évoqué sur le versant du respect. C’est vraiment ce qui fait la différence de l’époque contemporaine. Il faudrait savoir si, à titre d’hypothèse, on ne peut pas ordonner un certain nombre des symptômes de la civilisation contemporaine à ce fait central, et à sa façon d’irradier.
Tu appelles néokantiens les philosophes restaurateurs de l’universel ?
É.L. – Les restaurateurs, si l’on veut, du devoir impératif et de l’universel comme seule issue à la crise morale.
J.A.M. – Restaurer, trouver les bons impératifs, ou les bonnes formules de l’impératif. Habermas, est-ce un néokantien ? De fait, c’est une recherche éperdue de restaurer l’universel par la conversation. L’Autre n’existant pas, qu’est-ce qu’il nous reste ? Il nous reste à converser – ce que nous faisons ici –, il nous reste à débattre et à nous mettre d’accord. Et il n’est pas aveugle au fait que, pour se mettre d’accord dans un débat, il faut d’abord se mettre d’accord sur les règles du débat. Et débattre des règles du débat, c’est un débat. D’où régression à l’infini. Comment en sortir quand on voudrait proscrire tout signifiant-maître – ce qui est très important pour Habermas, héritier de la grande tradition démocratique allemande. Dès qu’il a l’impression que, quelque part, on met en œuvre le signifiant-maître, il dit – Attention, cela peut conduire à des choses terribles ! Il se trouve à la fois héritier de la tradition universaliste allemande et, en même temps, c’est le plus américain des Allemands, c’est-à-dire le plus horizontal des Allemands. Les Américains commencent à converser avec Habermas. Ils le prennent au sérieux, et on discute avec lui sur la possibilité du consensus, question essentielle, qui fait l’impasse de la civilisation américaine : les identifications sont toutes en concurrence. Donc, l’Allemand arrive en disant – Tout le monde va discuter avec tout le monde. Et les Américains disent – Eh bien, chez nous, tout le monde ne veut pas discuter avec tout le monde. Qu’est-ce qu’on fait ? On les force ? D’où, un dialogue.
Je ne sais pas si on peut le qualifier de néokantien.
É.L. – Non, pas dans cette optique-là. Je ne voyais pas cette génération de penseurs qui maintiennent leur effort depuis les années soixante, mais plutôt ceux qui ont pris le contre-pied de tout ce qu’annonçait le structuralisme, de la suite Foucault, Derrida, et ceux qui se sont dédiés à ça, dans cette perspective-là.
Ce qui est frappant, c’est qu’à l’égard de Habermas, pendant des années, les Américains, Putnam, Rorty, etc., étaient prudents parce qu’il n’avait pas de philosophie des sciences très claire. On ne savait pas très bien où est-ce qu’il mettait le réel scientifique. Mais maintenant, en effet, ils se sont retrouvés sur le débat, à mettre à sa place la question du réel scientifique, qui n’est plus un tourment. Le grand tourment, c’est, dans la civilisation, pouvoir se rejoindre dans l’état actuel de l’Autre, très déchiré, alors qu’aux États-Unis, ils sont d’accord sur le point où en est le réel scientifique. Il y a un grand consensus sur le point, mais, dans les identifications, là, grand reflux...
J.A.M. – Notre problème local, en France, n’apparaît pas encore tout à fait pris dans cette tourmente. La grande question, c’est – est-ce que l’assimilation française continue de fonctionner ? Est-ce que l’École et l’Université fabriquent du Français standard ? Et, lorsqu’apparaissent, quelque part, des petites filles avec un voile sur le visage, tout le monde tombe dans les pommes. La question de l’identification sociale est encore presque intouchée en France, si l’on voit le déchaînement de la question aux États-Unis.
É.L. – Même en Angleterre, c’est très frappant, le mode de traitement est entièrement différent.
J.A.M. – Il est différent parce que, là, il est strictement communautaire. Les Anglais formant tribu, si je puis dire, ils acceptent très bien de voisiner avec d’autres tribus. Mais ce n’est pas la référence française.
Il faudrait que l’on parle d’une dame qui s’appelle Gertrude Himmelfarb. Elle a une belle carrière. D’abord communiste, très trotskiste, très de gauche, elle est aujourd’hui un phare du néoconservatisme américain. Elle a consacré une grande étude à la solution victorienne, et pense que c’était la bonne éthique pour le capitalisme. Les gens devaient être propres, beaucoup travailler, pas boire, faire des économies, aller à l’église, etc., et, par inadvertance, on a perdu cette éthique. Elle propose donc de la restaurer sans peut-être tout à fait mesurer que le marché capitaliste lui-même est par excellence ce qui a fait table rase de cette éthique. C’est la femme de Irving Kristol, la mère du nommé William Kristol. J’ai d’ailleurs lu une interview où tous les deux disent en substance – En fait, il y a un seul homme dans la famille, c’est maman, c’est Gertrude.
[1] Cette première séance du séminaire d’Éric Laurent et Jacques-Alain Miller intitulé L’Autre qui n’existe pas et ses comités d’éthique a été prononcée le 20 novembre 1996, dans le cadre de la Section clinique du Département de Psychanalyse de Paris VIII. Texte édité par Catherine Bonningue et Béatrice Chahtoussi. Publié avec l’aimable autorisation d’É. Laurent et J.A. Miller.