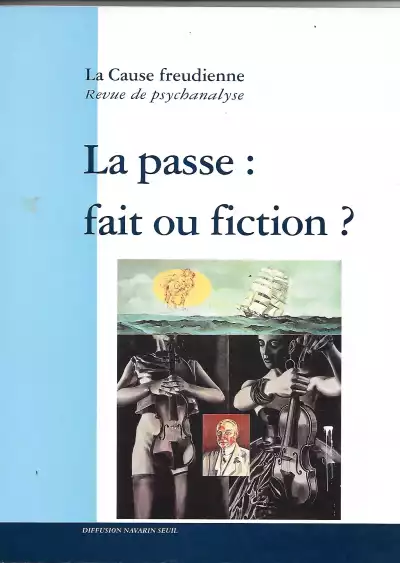Quel est le donc qui ici nous intéresse ? Il semble nécessaire que je le précise. Quel est le donc qui est ici notre affaire, celui qui est, pour nous, en question cette année ? C’est le donc de la conclusion de la cure analytique.
-
«Donc, je suis ça»[1]
Jacques-Alain Miller
Quel est le donc qui ici nous intéresse ? Il semble nécessaire que je le précise. Quel est le donc qui est ici notre affaire, celui qui est, pour nous, en question cette année ? C’est le donc de la conclusion de la cure analytique.
Ce mot de conclusion n’est pas jusqu’à présent d’usage courant dans cette fonction. Si nous le prenons au sérieux pour désigner la fin authentique de l’analyse, son terme vrai, à distinguer de l’interruption, de la sortie prématurée, disons de la sortie non nécessaire, qu’elle soit contingente ou simplement possible, alors il faut lui donner pour pivot un donc, pour autant qu’une conclusion comporte, implicite ou explicite, un donc. Et nous voulons, cette année, faire exister ce mot dans la psychanalyse pour essayer de donner un contenu précis, au terme vrai de l’analyse.
De quel ordre est ce donc de l’hypothétique conclusion de la cure ? Quel est son statut ? Vient-il couronner une déduction ? Ou est-ce une induction à quoi il met le point final ? Voilà une alternative qui se propose. Ça suppose de s’interroger aussi bien sur le point de savoir en quel sens ou dans quelle mesure la cure analytique est assimilable à un processus logique, et lequel. Rien ne dit que le concept de la déduction ou celui de l’induction suffisent à capturer cet éventuel processus logique, s’il y en a un.
Ce n’est pas rien, même si la voie est frayée – effrayée, oui – par Lacan que de passer du thérapeutique au logique. Rien ne dit que le logique l’emporte sur le thérapeutique. Il y a une tension entre le thérapeutique et le logique.
Dans l’expression la conclusion de la cure, les deux dimensions sont juxtaposées. Mais, on ne peut pas dire que, dans cette seule expression, l’articulation du thérapeutique et du logique soit pensée. Le mot de conclusion appartient à la dimension logique. Une cure désigne un processus thérapeutique. Nous essayons, clopin-clopant, de nous arranger avec ça. Et, pour autant que l’accent, au moins cette année, est mis sur le terme de conclusion, le terme de cure est entamé, a vocation à être dissous.
I
À partir même de Freud, et du bémol qu’il a mis sur la notion de guérison, sur le désir de guérir, on est conduit à mettre en doute ce terme de cure. Sans doute peut-il décrire certains aspects de ce dont il s’agit, mais il paraît bien insuffisant pour dénommer le processus, et c’est pourquoi nous avons volontiers recours au mot d’expérience. Le mot lui-même est à commenter. Ce n’est pas, bien entendu, l’expérience au sens de l’expérimentation. C’est l’expérience – avançons-nous doucement – entendue comme subjective.
Qu’est-ce à dire ? L’expérience subjective peut signifier que le sujet se prête, se dispose à éprouver une, voire plusieurs transformations, ou au moins, soyons encore plus prudents, certains états inédits pour lui. Et c’est en ce sens qu’il n’est pas illégitime de parler d’expérience mystique. Ou encore que la prise de drogue, les effets qui s’ensuivent, le récit qui en est fait, peuvent être qualifiés d’expérience, d’expérience vécue de l’hallucinogène, comme dit Lacan. Platon, aussi bien, décrit volontiers les procédés – dans le Phèdre – par lesquels on arrive à un certain nombre d’états d’enthousiasme. Il y a aussi une gradation savante de ces expériences d’états de conscience dans diverses initiations asiatiques.
Il est peu vraisemblable que ce soit dans ce sens-là que nous ayons à entendre le terme d’expérience. Comme le note Lacan, page 795 des Écrits, Freud s’est soigneusement écarté de cette dimension. S’agissant de l’hystérie, il a préféré – ce verbe est dans Lacan – se fier au discours de l’hystérique plutôt qu’aux états hypnoïdes. D’ailleurs, de se fier à son discours a comme effet de tempérer, voire de faire disparaître, la propension éventuelle du sujet à se mettre dans des états hypnoïdes.
Il faut sans doute accentuer dans le terme d’expérience son sens hégélien – et Lacan souligne la mise à l’écart freudienne des modifications des états de conscience dans un développement à propos de Hegel.
Le concept hégélien de l’expérience est tout de suite mis en valeur au début de sa Phénoménologie de l’esprit, cette Phénoménologie qui a inspiré Lacan, dont il a fait usage, et qu’il n’écarte ou qu’il ne relativise qu’à la fin du volume de ses Écrits, alors qu’elle est très présente pour lui lorsqu’il s’agit de penser le cours de l’analyse. Il n’y a pas chez Lacan, à proprement parler, de mathème du cours de l’analyse.
Il y a telle formule de son début, telle formule de sa fin, telle formule de la structure du discours analytique. Il n’y a pas – on pourrait penser que cela fait manque – de formule du cours même de l’analyse. Peut-être en a-t-il longtemps trouvé le substitut, précisément, dans le concept hégélien de l’expérience.
Ce mot est en évidence au tout début de la Phénoménologie de l’esprit. Le titre Science de l’expérience de la conscience a été, par Hegel, placé en tête de la Phénoménologie de l’esprit, juste après la préface et juste avant l’introduction. Wissenschaft der Erfahrung des Bewutseins. Erfahrung, pas Erlebnis.
Il y a un texte majeur de Heidegger sur Hegel qui s’intitule Hegel et son concept de l’expérience[2]. Expérience veut dire, si je comprime un peu les choses, qu’on ne doit pas commencer à exposer la science philosophique par la critique de la connaissance. Il ne faut pas faire ce que Kant, qui n’est pas nommé dans l’introduction, a fait, commencer par examiner, critiquer notre pouvoir de connaître – mais pas non plus commencer tout de go par ce qui serait le savoir vrai, ce serait, échappant au criticisme, tomber dans le dogmatisme. Au sens de Hegel, et il l’établit dès son introduction, la science, la connaissance effective de ce qui est en vérité, le savoir vrai, est liée à une expérience. Le savoir vrai est intrinsèquement lié à une expérience. Ce savoir vrai, comment est-ce qu’il entrerait en scène – c’est une expression de Hegel entrer en scène – sans coup férir, pour formuler la connaissance absolue, pour dire ceci est vrai, ceci est faux ? Si le savoir vrai entrait en scène de cette façon-là, en rejetant les savoirs, les croyances qui ne sont pas véritables, en s’assurant soi-même d’être un savoir d’un tout autre ordre, et renvoyant tout le reste au néant, il ne serait qu’un savoir partiel – ce serait un savoir qui garderait toujours comme son Autre le savoir non vrai, et à qui on aurait encore à demander de rendre compte de ce savoir non vrai. C’est une objection qui se présente facilement quand on lit nos philosophes modernes de la logique, ceux qui dépistent nos fausses croyances. Il leur faut tout de même consacrer de temps en temps une considération à la question de savoir pourquoi on parle comme ça pour ne rien dire, c’est-à-dire pour dire des choses qui ne sont pas aussi pertinentes que la neige est blanche parce que la neige est blanche. Et la plupart du temps, ils ne comprennent pas absolument pourquoi on ne passe pas son temps à dire des choses vraies de ce genre.
Le point de vue de Hegel sur le savoir, c’est donc que le savoir vrai ne vient pas tout d’un coup, qu’il vient, pas à pas – précisément, au cours d’une expérience où le savoir non vrai se modifie. Et c’est pourquoi il définit lui-même sa Phénoménologie de l’esprit comme un processus – en français, c’est curieux, comme la présentation du savoir apparaissant die Darstellung des erscheinenden Wissens. Erscheinung, c’est l’apparence. C’est-à-dire il démontre, ordonne au cours d’un temps, la manière dont le savoir, dans le mouvement même d’apparaître, pénètre la non-vérité. Ce qu’il appelle la science, et qu’il expose, présente le savoir apparaissant dans le mouvement de son apparition, et elle apparaît elle-même dans cette présentation, se défaisant les apparences non vraies.
Le mot même de phénoménologie indique qu’on suit précisément ces apparitions du savoir, qu’il y a un itinéraire qui va de la conscience naturelle, de la conscience quotidienne, celle qui séjourne dans le monde, au milieu de l’étant, jusqu’à la conclusion qui est la connaissance scientifique, philosophique, à quoi Hegel a donné le nom de savoir absolu. Le chemin de l’expérience, c’est de suivre ce qui est donné, de s’en tenir aux phénomènes pour suivre à la trace la conscience naturelle qui se met en mouvement.
Question. Pourquoi cette conscience ne reste-t-elle pas bien tranquille à s’affairer dans le monde ? Elle se trouve poussée à s’avancer. Il y a déjà, au départ, quelque chose qui la chagrine, qui la travaille, et elle se trouve arrachée à elle-même par une inquiétude, emportée au-delà d’elle-même. Le mot d’angoisse vient sous la plume de Hegel dans cette introduction. La conscience en tant que réfléchie, que conscience de soi, a le sentiment d’une violence qui l’arrache. Alors, dit-il – L’angoisse peut bien reculer devant la vérité mais elle ne peut s’apaiser. En vain, elle veut se fixer dans une inertie sans pensée, mais la pensée trouble l’absence de pensée et son inquiétude dérange la paresse. Ce mot d’angoisse, tout à fait au début de la Phénoménologie de l’esprit, est souligné par Heidegger, et aussi bien ce règne de l’inquiétude qui propulse la conscience dans son itinéraire.
Cet itinéraire prend un certain nombre de formes qui sont, pour Hegel, des formes de la conscience, chacune de ces formes situant un rapport précis du sujet et de la vérité. Dans chacune de ces formes, le plus souvent historiquement repérables, on peut dire qu’à chaque fois le sujet formule un certain ceci est vrai. Et puis, dialectiquement – ce qui veut dire par sa propre expérience de cette vérité –, il en découvre la non-vérité, il se défait de sa vérité antérieure, seulement transitoire, pour passer à un nouveau régime de la vérité. On voit donc à peu près – c’est habilement couturé –, sans solution de continuité les formes de la conscience se succéder les unes aux autres. Donc, continuellement des passages, on fait halte dans une certaine forme, et puis Aufhebung opère, et la conscience verse dans une nouvelle forme.
La traduction aujourd’hui abandonnée de Aufhebung par dépassement avait pour nous bien des échos. D’une certaine façon, la conscience ne cesse pas de passer, ne cesse pas de faire la passe d’une forme à une autre, jusqu’à la passe finale, le savoir absolu qui est la conjoncture ultime. Et j’ai dit que, tout du long des Écrits, Lacan s’adosse à cette expérience dialectique des formes de la conscience pour penser le cours de l’analyse.
Il est notable que, telle que l’imagine Hegel, cette expérience de la conscience qui se déploie dans l’histoire converge – ce n’est pas une histoire ouverte – sur une conjoncture déterminée, « la conjoncture du savoir absolu ». Et quand on en est là, c’est la fin de l’histoire. Culotté.
Culotté, et de temps en temps, il y a des surgeons de l’affaire, et on se lève pour dire – Mais non, mais non, vous voyez bien, regardez autour de vous, ça continue quand même.
Eh bien, Lacan a introduit la notion que la psychanalyse était une expérience dialectique. Ça veut dire que le sujet se déploie, se déplace, comme le dit Hegel, dans l’élément de la vérité. C’est à ça d’abord qu’il a affaire, une vérité qui est une vérité transitoire, une vérité qui se pluralise, une vérité qui peut tomber en décadence, dont le sujet peut s’extraire quand il rencontre certaines de ses conséquences, une vérité continuellement intenable. Et le sujet, enfin ce qui circule là-dedans, se trouve incessamment délogé. C’est de ces abandons de vérité et de cette trajectoire elle-même que se construit, que s’étend le règne du savoir, que Lacan résumait en disant chez Hegel la vérité en résorption constante dans le savoir. On pourrait dire aussi bien un arrangement symbolique continuellement confronté avec un réel qui en déconcerte l’ordonnance.
Il y a, en préface à l’enseignement de Lacan, la mise en œuvre la plus précise de cette conception appliquée à l’analyse. C’est la conceptualisation du cas Dora, que vous trouvez dans les Écrits, et où vous voyez une mise en ordre du cas où alternent des développements de la vérité, dit Lacan, qui sont de véritables figures de la conscience et des renversements dialectiques montrant l’instabilité de la position du sujet.
Il n’est pas niable – je l’ai jadis plusieurs fois souligné – que la fin de l’analyse a commencé à être pensée par Lacan à partir du savoir absolu. Vous trouvez cela page 321 des Écrits, à la fin du Rapport de Rome – la question de la terminaison de l’analyse est celle du moment où la satisfaction du sujet trouve à se réaliser dans la satisfaction de chacun, c’est-à-dire de tous ceux qu’elle s’associe dans une œuvre humaine.
Cette réduction de la question de la terminaison de l’analyse à une résorption du particulier dans l’universel, on peut dire qu’elle est de part en part d’inspiration hégélienne, curieusement corrigée par Heidegger, puisque le savoir absolu est censé équivaloir à l’assomption pour le sujet de son être-pour-la-mort. Heidegger plus tard a eu lui-même l’occasion de préciser qu’il préférait la traduction être-vers-la-mort. On en a le témoignage dans le même passage, quand Lacan formule que l’œuvre du psychanalyste opère comme médiatrice entre L'homme du souci – c’est un terme de Heidegger, en français – et le sujet du savoir absolu, nommé comme tel dans cette esquisse d’une théorie de la fin de l’analyse.
Ce sont autant de signes, de témoignages, que le cours de l’analyse, dont la formule, le mathème, semble faire défaut, le recours premier qu’il a trouvé, c’est le schématisme de l’expérience dialectique des formes de la conscience. Tout de suite après le rapport de Rome, dans l’écrit Variantes de la cure-type, une sorte de préférence est donnée à l’accent heideggerien pour qualifier la fin de l’analyse. Lacan abandonne ses références à la subjectivité de l’époque, que le sujet analysant aurait à rejoindre à son horizon – tout en conservant la notion que le processus analytique est animé par une dialectique qui reste convergente, ce qui est proprement hégélien, mais qui converge sur l’expérience de la mort, et ça, c’est heideggerien. On croirait volontiers que pour penser la conclusion de la cure, Lacan avait fait au départ de Hegel et de Heidegger ses compagnons, dans un très curieux syncrétisme. Même lorsqu’il abandonne la notion de savoir absolu pour qualifier la fin de l’analyse, c’est néanmoins comme un itinéraire qu’il présente l’expérience – dans Variantes de la cure-type par exemple, c’est l’itinéraire du narcissisme – de telle sorte que l’expérience analytique consisterait dans une analyse du moi au cours de laquelle tomberaient successivement les prestiges du narcissisme comme autant de figures de la conscience, et qui sont là prises comme autant de masques de la mort, dont la figure le terme hégélien y est – se dévoilerait à la fin comme soutenant l’image narcissique. Donc, un itinéraire où le moi se délesterait progressivement de ses oripeaux, de ses identifications, pour, à la fin des fins, trouver ce qui, sous l’image, la maintient, à savoir, ce que Lacan qualifie de façon étonnante, à cette place de maître absolu, la mort.
Le maître absolu, la mort – non le savoir absolu – est une référence hégélienne. Évidemment, comme il y a le terme absolu, cela vous a de petits échos de savoir absolu. En fait, la mort dont il s’agit ici est bien plutôt la mort au sens de Heidegger qu’au sens de Hegel. Enfin, c’est un micmac, qui a toute sa consistance par le style et par la notion nouvelle que Lacan amène alors, mais qui, rétrospectivement, et surtout en comparaison de conceptions, si on peut dire, autochtones à la psychanalyse, que Lacan a développées par après, ne peuvent pas ne pas apparaître comme un rapiéçage de Hegel et Heidegger. De telle sorte que le terme idéal de l’analyse, ce serait pour le sujet de revenir aux origines du moi, et ce serait alors, en un sens dont rien n’est précisé – et c’est plutôt à Sein und Zeit qu’on est renvoyé – le moment où la mort serait subjectivée.
On a très peu de choses pour donner un contenu de pensée à cette expression, sinon un renvoi à la dernière grande philosophie. Sans doute, la subjectivation de la mort est une expérience limite dans la mesure où la réalité de la mort n’est pas imaginable, donc une limite de l’imaginaire. Lacan aurait déjà pu amener là le tableau de Holbein avec sa tête de mort en anamorphose sur le sol de la pièce où se multiplient toutes les moires et tous les prestiges de l’image – mais dans Les quatre concepts, dix ans plus tard, c’est moins sur la mort qu’il met l’accent que sur l’anamorphose elle-même comme index phallique. Au terme, non la mort, mais un dévoilement de la vraie fonction du phallus.
II
Il faut attendre la fin des Écrits pour que Lacan répudie, si je puis dire, Hegel, mais il ne le répudie pas sans souligner qu’il en a fait usage.
Il en a fait usage, dit-il, contre les évidences de l’identification, et en effet, ce mouvement successif des figures de la conscience tombant les unes après les autres, c’est une bonne leçon pour guérir du narcissisme. En quelque sorte, c’est Hegel pour guérir du narcissisme, ou en tout cas de cette position du sujet qui colle à son Je dis la vérité - Tu dis la vérité, mais combien de temps ? Combien de temps, ta vérité, peux-tu l’habiter ? Ce que Lacan a opposé à Je dis la vérité, c’est Moi, la vérité, je parle, qui est tout différent, puisqu’elle parle justement dans le non-vrai, dans ce qu’on prend pour le plus essentiellement non vrai. L’idée d’un usage fait de Hegel, vous la trouvez dans Position de l’inconscient, page 837, et c’est encore développé dans le texte juste antérieur, Subversion du sujet, qui trouve son origine dans un colloque sur la dialectique, organisé par le philosophe Jean Wahl, auteur d’un livre classique, Les malheurs de la conscience chez Hegel.
À cette occasion, Lacan explique pourquoi Hegel fait défaut quand il s’agit de conceptualiser l’expérience analytique. Le savoir absolu, c’est là où le réel est si bien conjoint au symbolique qu’il n’y a plus rien à attendre du réel, on y trouve donc un sujet qui s’achève dans son identité à lui-même, et c’est l’hypothèse fondamentale de tout le processus. L’hypothèse du processus, c’est un sujet identique à lui-même, même s’il est inquiété, même s’il est angoissé, et c’est pourquoi on peut en déduire le savoir absolu. En revanche, le sujet dont il s’agit dans l’expérience analytique – et c’est là qu’il coupe le cordon avec la conceptualisation dialectique de l’expérience analytique – n’est pas un sujet identique à lui-même, n’est pas un sujet qui, dès l’origine et jusqu’au bout sait ce qu’il veut, comme le sujet fondamental de la dialectique hégélienne. Et donc, quand il introduit le sujet de l’inconscient, Lacan explicitement le met en balance avec le sujet du savoir absolu, et pour l’en différencier.
La figure qu’il amène alors, c’est une figure qui n’est pas du bataillon des figures hégéliennes. C’est la figure – le mot hégélien y est – de ce père mort qui vient en songe, et le rêveur l’accompagne de cet énoncé que vous connaissez, Il ne savait pas qu’il était mort. Lacan en fait le paradigme même du sujet freudien, à savoir un sujet qui ne subsiste qu’à ne pas savoir la vérité. Et c’est pourquoi on peut dire – Pourvu qu’il sache que je meure, oui, c’est ainsi que Je vient là où c’était.
C’est la valeur que Lacan donne au Là où c’était, je doit advenir – cet avènement est une disparition. L’histoire du père qui ne savait pas qu’il était mort est là pour illustrer la position du sujet de l’inconscient en tant qu’il ne veut pas savoir, c’est-à-dire en tant que sujet du refoulement – pour lui, venir à savoir, c’est disparaître. Là, il faut mettre des guillemets au terme d’avènement. Cet « avènement » c’est une disparition. C’est ce que Lacan, plus tard, quand il parlera de la passe, conception qui n’a tout de même rien de hégélien ou de heideggerien, qualifiera de destitution subjective – autrement dit, terme à terme, à la place du sujet identique à lui-même, qui conditionne l’expérience dialectique, le sujet barré, S, – à la place du savoir absolu, S(A) – à la place de la satisfaction capable d’entrer dans la conjonction universelle des satisfactions, la jouissance.
Nous avons là les trois termes, le triangle où se joue la conclusion de la cure, le sujet, le savoir et la satisfaction. Et pourtant, ce qui reste hégélien chez Lacan dans sa notion du cours de l’analyse et de sa conclusion, c’est la notion d’une expérience subjective. Certes, elle n’est plus animée par l’Aufhebung logicisante, comme dit Lacan, de Hegel. Mais l’expérience subjective reste bien animée pour Lacan par une instance logicisante. Elle s’achève, comme chez Hegel, sur une conjoncture déduite. La notion de la passe est hégélienne au moins en ceci – elle ne l’est pas dans son fonctionnement ni dans sa structure – que c’est une conjoncture déduite des conditions mêmes de l’expérience.
Il faut bien dire que Lacan est ici plus hégélien que freudien, parce que Freud ne nous présente nullement l’analyse comme une expérience qui aurait un principe d’arrêt. C’est même ce sans fin qui justifie pour lui l’invitation faite à l’analyste de retourner périodiquement sur le divan. À vrai dire, Freud pensait que la position même de l’analyste était contradictoire avec les exigences de l’analyse, et spécialement avec ses exigences éthiques, et c’est pour cela qu’il voulait qu’il redevienne analysant, si je puis dire, pour être moral.
La notion de Lacan, c’est au contraire que c’est sans retour, la fin vraie de l’analyse, à condition que l’analyste, le devenu-analyste, entre dans l’enseignement de la psychanalyse, qu’il retrouve un rapport de déchiffrement avec le sujet supposé savoir dans l’enseignement de la psychanalyse, ce qui distingue cet enseignement de toute pédagogie. Allons encore un peu plus loin dans ce sens, pour expliquer, rendre sensible, le cadre où l’enquête sur le donc se poursuit. Ce qui est encore hégélien chez Lacan, c’est cette articulation qui fait, en quelque sorte, que l’hypothèse fondamentale du processus se retrouve sur une autre forme à la fin, que, s’il y a là une fin de cette expérience, c’est dans la mesure où elle est prescrite par le début même du processus, que la conclusion était déductible de la structure même de l’expérience.
C’est ce qu’on observe quand Lacan amène ce qui nous sert de repère, son concept de la passe. Il fait précisément une articulation en court-circuit du début et de la fin de l’analyse. Et quand il a à présenter la structure de la fin de l’analyse dans des termes qui sont scrutés depuis des années, eh bien, il déduit la structure de la fin de la structure du début. Au commencement est le transfert. Eh bien, la fin de l’analyse demande qu’on écrive le terme de la relation de transfert. Dès lors, c’est moins de la fin du moi qu’il est question que d’une forme de mort du sujet, qui n’est pas dramatisée par cette expression qui a sa place dans la théorie de la psychose, mais qui est donnée de façon plus tempérée sous le terme de destitution, qui est donnée aussi pour équivaloir à la chute du sujet supposé savoir.
Ce sujet supposé savoir, c’est une sorte d’ombre portée du sujet, c’est le sujet supposé savoir ce qu’il dit, dans la mesure où, corrélativement, le sujet analysant est dans la position de ne pas savoir ce qu’il dit. C’est au regard du sujet supposé savoir ce qu’il dit que le sujet analysant peut être dans la position contraire. En ce sens la chute du sujet supposé savoir se traduit par le fait que dorénavant le sujet sait ce qu’il dit. Enfin, c’est le terme idéal. C’est le terme idéal, et ce serait la définition de l’analyste. Il est tenu pour savoir ce qu’il dit, et c’est pourquoi il ne peut pas se tenir pour irresponsable des effets de sa parole. Et c’est aussi bien le sujet supposé savoir ce qu’il veut. Là, il n’est pas là au départ. Et c’est pourquoi la chute du sujet supposé savoir, ce serait l’émergence du sujet qui sait ce qu’il veut. Et à vrai dire, savoir ce qu’on veut, c’est ce qu’on appelle la pulsion, la volonté qui veut la jouissance coûte que coûte. Et c’est pourquoi Lacan peut dire que la fin de l’analyse suppose la résolution du désir. Dans la psychanalyse, le désir est essentiellement problématique, et la définition de Lacan la plus sûre du désir est qu’il s’agit d’une défense d’outrepasser une limite dans la jouissance. Tandis que le désir dans la psychanalyse est essentiellement problématique, la pulsion, elle, est résolutoire. Et c’est pourquoi la résolution du désir, c’est en quelque sorte équivalent à la réconciliation avec la jouissance.
La réconciliation avec la jouissance pulsionnelle, avec la pulsion, qui n’en fait qu’à sa tête, et d’autant plus à sa tête qu’elle n’en a pas, c’est ce que Lacan a résumé sous le terme de destitution du sujet. On pourrait parler de destitution pulsionnelle du sujet. Et c’est pourquoi on ne trouve pas chez Lacan, me semble-t-il, la notion de subjectiver la pulsion, comme on subjectivait la mort au départ. Même si la mort n’est nul objet imaginable, il est pensable à partir du philosophe d’assumer et de subjectiver la mort, tandis que le terme même de sujet pâlit quand il s’agit de pulsion – bien que l’on trouve une fois sous la plume de Lacan – c’est un hapax, enfin, on ne le trouve pas bien souvent – le terme de sujet de la pulsion. Tandis que s’agissant du désir, on peut dire qu’il reste une intersubjectivité inhérente au désir, comme on le voit dans toute forme d’identification – désirer comme l’autre, désirer ce que désire l’autre, même si Lacan, pour articuler le désir à la pulsion, a fait de l’objet petit a sa cause. La pulsion fait l’impasse sur le grand Autre, au moins comme sujet. C’est pourquoi quand Lacan invente un mythe de la pulsion, il en fait un organe qui précède le subjectif et le conditionne.
S’agissant de la conclusion de la cure, la question qui déborde en effet le couple infernal de Hegel et Heidegger, c’est de savoir comment le rapport du sujet au savoir, instauré par l’analyse, agit sur le rapport du sujet à sa satisfaction. En quoi le fait d’instaurer un rapport inédit du sujet avec le savoir, en l’invitant à l’association libre, à dire n’importe quoi, à en dire plus qu’il ne sait, à ne pas s’occuper de contrôler ses dires, agit-il sur le rapport du sujet à sa satisfaction ? Et en quoi cela modifie-t-il le rapport du sujet à cette satisfaction que nous appelons la jouissance ? Et comment est-ce que, de là, il peut surgir le donc je suis de la conclusion, le donc je suis analysé, le donc je suis analyste, et disons le donc je suis ça ? Lorsqu’on ne réfléchit pas à la subjectivation de la mort, mais à la pulsion, la formule la plus serrée, c’est donc je suis ça.
C’est pourquoi il ne faut pas prendre à l’envers le Là où c’était, Je doit advenir. Vous avez ce ça tout poussiéreux, et puis, le Je advient, ça se nettoie, ça s’illumine, le Je est advenu. Pas du tout. L’idée que ça va dans ce sens-là, c’est ce que comporte la notion de subjectivation – on va subjectiver, on va faire passer tout ça dans le Je, on va rebriquer tout ça. Ça, c’est l’idée hégéliano-heideggerienne d’où Lacan a pris son départ pour penser la fin d’analyse alors que Freud ne lui donnait pas le principe d’arrêt. C’est le versant subjectivation – penser la fin de l’analyse comme une subjectivation, le tout-sujet, le presque-tout-sujet. Il me semble à moi que la notion à quoi Lacan est arrivé, et sur laquelle nous continuons de travailler, c’est au contraire que le sujet s’éteint. Le sujet s’éteint dans un devenir ça. C’est pourquoi, à la place où il y avait, dans la théorie, la subjectivation, il y a désormais la destitution subjective. C’est là qu’est en jeu l’énoncé particulier de l’existence d’un analyste, là quand il existe quelqu’un dont Je n’est plus à venir – n’est plus à venir pour autant, non pas qu’il illumine le tout, mais au contraire, pour autant qu’il en est venu à s’éteindre.
III
Il peut paraître que cela nous sort des mythes de la logique. Pourtant, dans le moment même où, d’une façon suffisamment voilée pour que l’opposition durcie que je présente entre subjectivation et destitution ne soit pas immédiatement apparente, Lacan fait entrevoir le devenir ça du Je et non pas le devenir Je du ça, il confirme que la structure logique ne perd jamais ses droits, que c’est la logique qui commande, qu’elle est bien présente dans les affaires de jouissance, que l’objet petit a est une consistance qui se soutient de logique pure. Il y a un usage de la logique mathématique, comme pour lui il y avait auparavant un usage de la Phénoménologie de l’esprit, en tant, dit-il, qu’elle atteste un Autre tel que sa structure ne va pas à se recouvrir elle-même. Donc, logique témoin, témoin du non-recouvrement de l’Autre, de S(A). La logique, c’est la Phénoménologie à l’envers.
C’est pour cette raison que j’ai commencé par les paradoxes de l’induction, par Hempel, par Goodman. J’aurais pu commencer par d’autres paradoxes, mais ceux-là sont moins exploités, et plus proches de l’induction à l’œuvre dans la pensée analytique. Ce sont les paradoxes qui commencent quand on se demande ce qu’on peut conclure des faits, de l’observation des faits – et on s’aperçoit que cela fait surgir un trou d’essayer de conclure des faits.
J’ai amené Courteline et son Boubouroche[3] – quel nom ! quel nom ! – bien fait pour illustrer le proverbe Il ne faut jamais en croire ses yeux. Ça surclasse le principe de saint Thomas, qui ne croit que ce qu’il touche. Au fond, on peut toujours dire – Ça ne prouve rien. Ça ne prouve rien est une réplique qui a la force du Mon cul ! de Zazie. Ça ne prouve rien, et, en particulier, aucun fait ne prouve rien.
Vous avez peut-être lu, donc, ce Boubouroche, et vu ce personnage, bonne pâte, qu’on nous présente d’abord au jeu où il se fait taper par les copains, et charitablement averti par le voisin qu’à peine il tourne les talons, sa maîtresse sort d’on ne sait z'où un monsieur. Tous les jours où il y va elle fait ça. Alors, il s’y rend, il veut lui parler, timidement demande à fouiller, ne demande pas, bon, et puis c’est résolu par une panne d’électricité. Et alors, on s’aperçoit qu’il y a André – qu’on nous a montré un peu avant – dans le bahut, avec une bougie, un grand bahut à l’intérieur duquel, tranquillement,... il lit la Phénoménologie de l’esprit, peut-être ! Et il s’en va très dignement. Alors Boubouroche veut la tuer. Et puis, il défaille, alors elle parle, et alors il est perdu. Parce qu’elle fait signifier le fait. -Tu m’as trompé, dit-il. On pourrait dire, Ça crève les yeux. Elle répond – Jamais. -Enfin et cet homme. Elle – Je ne peux te répondre, c’est un secret de famille. Je ne puis le révéler. -Ça par exemple ! Et elle le démontre – Si je n’étais pas une honnête femme, je ne sacrifierais pas ma vie au respect de la parole donnée. Et elle ajoute – vraiment, c’est réduit au minimum, c’est une esquisse qui montre comment le fait se volatilise – Inutile de discuter plus longtemps, nous ne nous entendrons jamais. On sent bien qu’en effet, il faut un accord de base, il faut un accord sur les principes pour être en désaccord déjà. Elle dit – Ce sont là de ces sentiments féminins que les hommes ne peuvent pas comprendre.
Qu’est-ce qui règle la question de la vérité dans cet apologue ? C’est qu’il pleure, le monsieur, c’est qu’il dit – Je ne peux pas te quitter, c’est plus fort que moi. Et au fond, là, tout est dit, elle n’a plus qu’à se montrer et à dire – Ai-je l’air ou non d’une femme qui dit la vérité ? Ah ! le nigaud. Et donc, il va casser la gueule au voisin.
Ce petit apologue que j’ai repris là, conservons-le en mémoire. Considérons qu’il met en valeur le principe d’Adèle, c’est d’elle – On croit qui on aime. Ça introduit l’amour dans la théorie de la vérité. Une théorie de la vérité, comme on en cherche en philosophie de la logique, rate toujours faute d’une érotique. Pas de théorie de la vérité sans doctrine de l’amour.
Ça volatilise le fait, au moins ça indique que nul fait ne signifie en lui-même, mais seulement par le dit, et ledit secret de famille est là, au fond, tout-puissant. Peut-être une autre fois vous amènerai-je une histoire où on trouve aussi les pires suspicions portant sur une femme – toujours diffamée, comme notait Lacan – et où il y a aussi vraiment un secret de famille. Il y a aussi un loup caché quelque part, mais c’est un vrai secret de famille.
Alors, jusqu’où le doute ? Il n’y a pas de doute qu’on peut mettre en doute par le signifiant tout ce qui est. Le donc je suis cartésien est éminemment obtenu après une mise en doute généralisée, hyperbolique, un doute qui va jusqu’à frapper les vérités mathématiques. Le donc de Descartes est fils du doute. Le doute est aussi bien évoqué par Hegel dans son introduction – La conscience naturelle s’engage dans son difficile chemin vers le savoir absolu comme chemin du doute et même du désespoir. Ce désespoir qu’il appelle scepticisme n’est pas le scepticisme roboratif de Descartes, à qui fait allusion Hegel quand il parle de la résolution de ne pas se rendre à l’autorité des pensées d’autrui, mais d’examiner tout par soi-même. Non, le scepticisme qu’évoque Hegel, c’est le scepticisme radical qui finit avec le vide, qui attend le nouveau qui vient et qui le jette illico dans le même vieil abîme. On trouve dans le cours de la Phénoménologie de l’esprit, à un moment, la figure du sceptique. Et quand on tombe sur l’abîme sceptique, il est très difficile d’en sortir. Il y a une petite couture, mais il faut faire un petit saut pour arriver à en sortir.
Eh bien, il y a une reviviscence récente du scepticisme dont je ne veux pas faire l’économie, qui a surgi au sein même d’une réflexion sur la logique. C’est le paradoxe de Kripke, qu’il a forgé de Wittgenstein[4].
Ça les a excités, pas possible ! Pendant toutes les années 80, ils se sont tous objecté, réobjecté sur ce scepticisme inventé par Kripke. Donc, il y a une littérature dont, à la fin de la décennie, on a fait la revue d’ensemble. Il faut peut-être que je vous dise ça, pour que vous preniez ce paradoxe au sérieux. Vous n’y consacrerez pas le soin et l’attention de cette population, qui a d’autres intérêts que les nôtres, mais enfin, sachez que pour eux ça a été un enchantement – Ça nous a ramenés aux tout premiers temps où on étudiait Wittgenstein, ça a lavé notre Wittgenstein de tous les commentaires ennuyeux, on s’est vraiment mis à penser à partir de là.
Son paradoxe a été inspiré à Kripke par une lecture du paragraphe 201 des Investigations philosophiques de Wittgenstein. Je pense que vous n’auriez pas eu l’idée de Kripke – moi non plus – d’y lire ça. En se référant à ce qu’il a dit un peu avant, Wittgenstein écrit – C’était là notre paradoxe. Aucune suite d’action – on peut dire aucune suite de comportements, de manières de faire, de manières d’agir – ne peut être déterminée par une règle, parce que chaque suite d’action peut être conçue comme s’accordant à une règle. Voilà la formulation dont Kripke a fait des merveilles. La suite, d’ailleurs, du paragraphe chez Wittgenstein, c’est – Si toute suite d’action peut toujours se conformer à la règle, elle peut également la contredire. De la sorte, il ne peut y avoir ici ni conformité, ni contradiction. C’est ça, dans cet ouvrage considérable et qui a mobilisé de grands esprits, que pique Kripke pour dire – Voilà le problème central de Wittgenstein, et en plus, page 20 de son opuscule – Ce n’est pas sans parenté avec ce qu’a développé monsieur Goodman, que vous connaissez maintenant que je vous en ai parlé.
Sur cette base, il amène un personnage, une figure de sceptique, qui n’est pas le sceptique hégélien, ni le sceptique cartésien, qui n’est sceptique que pour un moment, mais un sceptique bizarre. Supposons, dit-il – c’est la façon dont il met en scène le paradoxe un peu obscur – que vous n’ayez jamais additionné 68 et 57 De toutes façons, dit-il, il y a toujours une opération d’addition que vous n’aurez pas faite. Vous n’avez jamais fait qu’un nombre fini d’opérations d’additions. Donc, on peut toujours finalement vous présenter une addition avec des chiffres que vous n’avez pas additionnés. Pour chacun d’entre vous, ce n’est pas difficile à trouver, surtout avec des grands chiffres.
Vous faites donc l’opération : 68 + 57 = 125. Arrive alors le sceptique bizarre de Kripke. Vous, vous êtes déjà une petite foule, évidemment il est très minoritaire, et ça compte beaucoup, à la fin, pour sortir de l’affaire la majorité et la minorité. Donc, vous faites l’opération, et un sceptique bizarre arrive qui met en question votre certitude. L’objection est la suivante. C’est tout de même amusant, tomber dans une zone où on fait des objections à 2 + 2 = 4, ou quelque chose d’approchant. Le sceptique bizarre dit – Vous me dites 58 + 67 = 125. Peut-être, dans la façon dont vous avez utilisé le terme plus dans le passé, la réponse qu’il aurait fallu donner aurait dû être 5.
Le sceptique de Kripke ajoute – Vous allez répondre j’applique la même règle que j’ai toujours appliquée pour faire les additions. Mais quelle était cette règle ? Dans le passé, vous ne vous êtes jamais donné qu’un nombre fini d’exemples de cette règle. Supposons, par exemple, que vous n’ayez jamais additionné que des nombres plus petits que 57, et peut-être que vous appeliez plus une fonction qui en fait était quus – la fonction quus prévoyant que x quus y est égal en effet à x + y à condition que x ou y soient inférieurs à 57, mais que, autrement, c’est égal à 5. Qu’est-ce qui prouve que ce n’est pas la fonction auparavant signifiée par plus ? Là, en disant plus vous appliquez quus et vous croyez seulement appliquer plus.
C’est pour cette raison que c’est, en effet, comme une autre version du paradoxe de Goodman, au moins en ceci qu’on introduit une fonction temporelle. De la même façon que les émeraudes étaient vertes jusqu’à un certain temps, et après étaient bleues, ici aussi il y a ce qu’on a calculé jusqu’à un certain moment, en dessous de 57. Et donc, le sceptique dit – Tu ne sais pas ce que tu faisais, tu t’es trompé sur la signification de ce que tu faisais.
Ce qu’on met en question ici, n’est-ce pas une opacité subjective ? C’est l’écart entre l’usage présent et l’usage passé, comme s’il n’y avait pas de raison de dire 125 plutôt que 5. Comme dit gentiment Kripke – C’est un saut injustifiable dans le noir, de dire 125. Il nous rend là vraiment saisissable le trou que nous évoquions dans le procès de l’induction.
Bien sûr, la réponse fuse – Qu’est-ce que je fais, en fait, quand j’additionne ? On ne peut pas dire que j’aie fait un certain nombre d’additions avant, et que j’extrapole la règle par après. Je ne fais pas une induction de la règle de l’addition à partir des exemples d’additions. Je ne fais pas d’induction quand j’additionne. Au fond, ce que j’ai appris, c’est la règle de l’addition. C’est-à-dire j’ai appris un certain nombre d’instructions, un ensemble d’instructions que j’applique et qui disent comment on additionne. Donc, je compte d’une certaine façon, conformément à l’algorithme de l’addition, à la procédure réglée de l’addition.
Ne pensez pas que ça démonte le sceptique. Il dit – Oui, vous avez appris à compter sur un nombre fini d’exemples. Qu’est-ce qui prouve que ce que vous appelez compter, ce n’était pas quompter ? – et que, en effet, tant que vous quomptiez jusqu’à 57, en dessous de 57 ça allait, mais après c’est 5. Alors, vous expliquez que la validité précisément de la procédure de l’algorithme de l’addition ne dépend pas de la composition de l’addition, sinon ça ne serait pas une addition. Ah ! il dit – Donc, c’est indépendant. C’est indépendant, mais est-ce quindépendant ?
Autrement dit, plus vous multipliez les objections, plus on peut étendre à la signification de tous les mots l’objection qui est faite au sens de plus, jusqu’à une subversion sémantique totale.
Ça, on le trouve chez Wittgenstein lui-même. Vous faites des tests, pour savoir si vous pensez bien, rapidement, si vous êtes astucieux. Alors, on vous met la suite 2, 4, 6, 8, qu’est-ce qui vient après ? Vous pensez que c’est 10. En fait, un nombre tout à fait indéfini de règles sont compatibles avec ce segment-là, et vous pouvez très bien avoir 2, 4, 6, 8, 11, 23, etc., si la règle qu’on applique est suffisamment complexe. Autrement dit, à partir d’un nombre fini d’exemples, on peut toujours supposer un nombre indéfini de règles. Une règle beaucoup plus complexe que l’addition + 2 peut délivrer aussi bien 2, 4, 6, 8 comme segment initial.
Kripke marque bien que le raisonnement peut s’étendre à tout le langage. Vous dites table, vous pensez savoir ce que c’est une table, mais est-ce que ça s’applique aussi, dit-il, à une table sous la tour Eiffel ? La tour Eiffel fait son apparition ! Ce n’est pas loin de la question si troublante que posait Wittgenstein – Comment est-ce que je sais que cette couleur est rouge ? Et c’est aussi ce qu’il y a dans le paradoxe de Goodman – Peut-être en disant vert je voulais dire bleu.
Ce qui est aigu dans cette considération, c’est qu’elle marque une certaine défaillance du sens dans la fonction à laquelle précisément des philosophes de la logique le réduisent, à savoir celle de donner la référence. C’est là qu’il y a une sorte de breakdown. C’est comme s’il se découvrait que le sens ne parvient pas à donner, à prescrire la référence, et comme si le petit attelage carnapien intension-extension – l’intension, c’est le nom qu’on donne au sens quand il n’a pas d’autre fonction que de permettre de grouper ce qui répond à la signification du concept – fléchissait. À quoi tient le paradoxe ?
Il est certain qu’on ne peut pas, en toute certitude, recomposer la règle que quelqu’un d’autre suit. Quelqu’un fait un certain nombre d’opérations qui semblent être l’addition, et puis hop ! on arrive à 57, et on découvre que ce n’était pas l’addition, que c’était quus qui était en fonction. Autrement dit, de l’extérieur, à observer ce que fait l’autre, on ne peut jamais être sûr de la règle qu’il suit. C’est un paradoxe, si l’on veut, mais ce n’est que le paradoxe de l’induction. Le paradoxe de Kripke consiste à ne faire qu’un du sujet qui additionne et de celui qui l’observe, à les confondre en un, et à faire dire à celui-ci par le compère bizarre – Tu ne sais pas ce que tu fais. Kripke ajoute donc une opacité subjective au paradoxe simple, humien, de l’induction.
Il y a aussi le scandale de la règle qui est celui d’enfermer, d’enserrer dans son filet le futur, comme si on savait déjà ce qui aura lieu. Comment des esprits finis peuvent-ils formuler des règles supposées s’appliquer une infinité de temps ? Et c’est pourquoi Kripke dit – Toute nouvelle application d’une règle, c’est un vrai saut dans le noir. Dans l’abîme de ce scepticisme, le seul recours que trouve Kripke est un appel à la communauté – faire comme les autres – suivez le chef si on additionne autrement, on s’exclut. Autrement dit, additionner c’est faire ce que la communauté dans laquelle on vit ferait dans les mêmes circonstances. L’addition est à cet égard une forme de vie.
On peut discuter sur le point de savoir si c’est bien ce que Wittgenstein a voulu dire. Il n’y a pas de raison qu’on le sache en toute certitude. Il ne semble pas que Wittgenstein lui-même ait eu beaucoup de sympathie pour le scepticisme. Il considérait que le scepticisme était un véritable non-sens, lorsqu’on essaie de mettre en doute un point où aucune question ne peut être posée. Peut-être bien considérerait-il que c’est ce que fait Kripke.
Son idée, à Wittgenstein, c’est que la signification ne fait pas de miracle, qu’elle ne permet pas de traverser une infinité de cas en un seul instant, pas plus que le sens n’est un fait mental, que j’aurais observé dans ma tête. C’est bien ce qu’il dit en 202 – obéir à la règle constitue une pratique. Une règle, en effet, prescrit des applications. Et comment savoir que je fais bien ? Il me faudrait une règle pour l’application de la règle, pour interpréter la règle, car toute règle peut être interprétée de façon différente. D’où la régression à l’infini. Voir quelque chose, et dire c’est rouge – on ne peut pas formuler une règle pour passer de l’un à l’autre, entre le voir et le dire. Et c’est pourquoi l’idée de Wittgenstein, c’est que comprendre n’est pas autre chose que de maîtriser une technique. Et c’est pourquoi le langage n’est pas pour lui une réflexion de la pensée, un miroir de la pensée, mais une forme de comportement. C’est pourquoi, comme Lacan, il aimait bien citer Goethe – Au commencement était l’action.
Cette difficulté sur la règle a toute raison de nous retenir, nous dont une règle détermine toute l’expérience, et une règle dont il faut bien dire que l’application est ouverte au doute. Est-ce que je fais bien ce que je dois faire ? peut légitimement se demander l’analysant. Évidemment, il y a l’analyste qui est là, et ce n’est pas un sceptique bizarre – il est là pour confirmer que – Oui, tu te conformes à la règle. Et c’est bien ici que, ce qui confirme le discours d’être inconscient, comme dit Lacan, c’est l’interprétation.
Ce que nous pouvons retenir de Kripke, c’est la scission qu’il introduit dans le sujet. Le sujet croyait appliquer plus, alors qu’il se pourrait bien qu’il applique en fait autre chose. Là surgît une opacité subjective. Celle-ci surgit du seul fait que le sens recroise le matériel signifiant. Deux algorithmes – je vais vite – rendent tout discours interprétable dans l’analyse. C’est l’algorithme saussurien, qui clive le signifiant et le signifié. Et c’est le deuxième algorithme, qui renvoie l’oral à l’écrit. C’est pourquoi on ne fait pas d’analyse par écrit. Et précisément, la différence de l’oral et de l’écrit, principe de l’interprétation, est constitutive du sujet supposé savoir.
Comprendre, est-ce maîtriser une technique ? Il faut une règle pour comprendre. Ce que cherche Wittgenstein, comme Kripke, c’est la règle-pour-comprendre, et c’est ce qui échappe toujours précisément.
Or, ce que l’on aperçoit par l’analyse, c’est que la règle-pour-comprendre est à chacun particulière. C’est ce qu’on appelle le fantasme. A meaning is use, nous substituons meaning is fantasy, la signification, c’est le fantasme. On comprend par le fantasme. On ne comprend à proprement parler que le fantasme. Et l’inconsistance sémantique au regard de la référence, qu’avec un grand art Kripke[5] fait valoir, indique bien pour nous le statut de consistance logique que nous donnons à petit a, et principe d’intellection.
Le fantasme fixe le sens, ce sens inconsistant, ce sens toujours douteux. C’est pourquoi la conclusion de la cure touche au fantasme. Elle touche précisément à ce par quoi chacun comprend. Et c’est pourquoi, notre « savoir absolu », c’est l’objet petit a, a comme absolu, à ce qu’il tombe.
12 janvier 1994
[1] Quatrième leçon du cours intitulé Donc (1993-1994), enseignement donné dans le cadre du Département de Psychanalyse de Paris VIII. Texte rédigé par Catherine Bonningue. Publié avec l’aimable autorisation de J.-A. Miller.
[2] Heidegger, « Hegel et son concept de l’expérience », Chemins qui ne mènent nulle part, Paris, Gallimard, 1962
[3] Courteline G., Boubouroche, 1893
[4]. Kripke Saul A., « The Wittgenstein paradox », Wittgenstein on Rules and Private Language, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1982, pp. 754
[5] Note de J.-A. Miller : Je n’ai pu que faire allusion dans ce cours au pamphlet anti-Kripke du tandem Baker et Hacker, Scepticism, Rules, and Language (Blackwell, 1984). J’ai consulté avec intérêt dans Mind, tome 98, «The Rule – Following Considérations », de Paul A. Boghossian, qui fait la revue de toute la littérature sur le sujet jusqu’en 1989. En langue française, je signale l’étude de mon camarade Jacques Bouveresse, La force de la règle : Wittgenstein et l’invention de la nécessité, Éd. de Minuit, 1987.