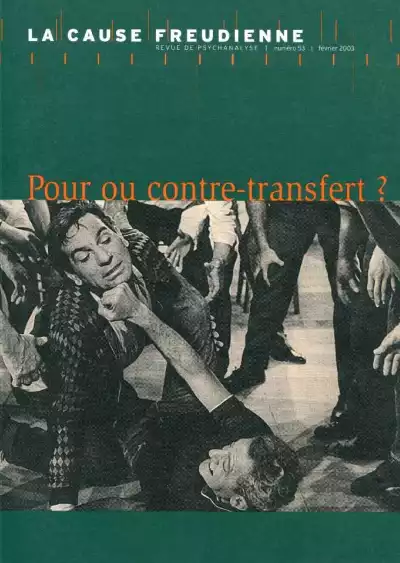-
Contre-transfert et intersubjectivité
Jacques-Alain Miller
I – Contre-transfert et empathie
1. Structuration du contre-transfert
Un obstacle
Nous allons poursuivre la mise en place du contre-transfert, sa structuration [1]. Nous n’en avons pas fini avec le contre-transfert, et ce, pour trois raisons. Premièrement, ce terme nous donne la clé de la logique de l’histoire de la psychanalyse. Le contre-transfert n’est pas cette clé, mais nous permet de la prendre en main, c’est-à-dire de construire la logique de l’histoire de la psychanalyse.
Deuxièmement, le terme de contre-transfert nous donne aussi une perspective sur l’enseignement de Lacan, une perspective qui est puissante au point que cet enseignement puisse nous apparaître comme un refus du contre-transfert, incessamment modulé sous des formes diverses.
Troisièmement, de ce fait, la référence au contre-transfert nous offre les moyens de répondre aujourd’hui, à nouveaux frais, à la question « Qu’est-ce qu’être lacanien ? » [2].
On s’imagine volontiers, au moins en France, qu’être lacanien ce serait autre chose qu’être freudien. Cela m’a été, peut-être comme à vous-mêmes, réactualisé par les formules, galvaudées dans les médias, qui opposent les lacaniens aux freudiens. Admettons-le. Reconnaissons que c’est ainsi que nous sommes perçus, que nous sommes commentés.
Cette opposition des lacaniens et des freudiens prend pour critère la durée de la séance. Ce qui distinguerait le psychanalyste lacanien du psychanalyste freudien, ce serait que l’un pratique la séance de durée variable et dans l’ensemble courte, tandis que l’autre pratique la durée fixe et « longue », entre guillemets – la durée précise en étant variable de la demi-heure, des trois quarts d’heure, des cinquante-cinq minutes. Néanmoins, si l’on substitue au critère de la durée celui du contre-transfert, il en va tout autrement [3].
La position freudienne orthodoxe, celle qui a été établie par Freud lui-même en 1910, quand il a amené le terme de contre-transfert – un ternie rare dans ses écrits –, conçoit le contre-transfert comme un obstacle à la poursuite de la cure, un obstacle qui doit être réduit, et en particulier par l’analyse de l’analyste. C’est donc le fait d’une position hérétique, non-freudienne, que de concevoir le contre-transfert comme un instrument, un moyen de la cure. C’est ce critère qui justifie pour nous la psychanalyse lacanienne à se prétendre freudienne orthodoxe. C’est là le critère qui fonde l’orthodoxie freudienne de l’enseignement de Lacan et de la pratique qui s’ensuit.
Neutralité analytique
C’est un fait historique que l’introduction du contre-transfert de l’analyste comme instrument de la cure – cela au début des années 50 – a été contestée, au sein même de l’Association internationale, au nom de l’orthodoxie freudienne. Permettez-moi ici de me référer à l’article d’Annie Reich qui date de 1960, « Quelques remarques supplémentaires sur le contre-transfert » [4]. Annie Reich qui n’était pas lacanienne, et au terme d’une décennie qui avait vu se multiplier les contributions analytiques sur le contre-transfert, contestait le parallélisme établi entre transfert et contre-transfert. Ce parallélisme aurait été fondé sur le fait que l’un et l’autre de ces termes, d’abord conçus comme interférences et obstacles dans la cure, avaient vocation à être transformés en moyens et instruments.
Déjà en 1960, elle voyait se dessiner un engouement pour les relations interpersonnelles, la relation analytique devant être englobée dans le registre plus vaste de ces relations interpersonnelles. Elle voyait déjà – c’est déjà bien fait pour nous manifester qu’il y a là une logique à l’œuvre – ces relations interpersonnelles menacer la psychanalyse d’une dilution, et aussi bien d’une confusion entre psychanalyse et psychothérapie. D’où nous sommes, nous ne pouvons que valider son pressentiment ou sa prophétie.
Annie Reich ne nie pas le phénomène du contre-transfert, mais elle conteste ce qu’elle appelle sa surestimation. De quoi s’agit-il dans cette surestimation ? Elle admet qu’il y a des manifestations contre-transférentielles de l’analyste dans la cure. Elle admet aussi bien qu’il puisse y avoir lieu pour l’analyste de reconnaître devant le patient ses manifestations contre-transférentielles – ce qui est déjà l’amorce de ce que nous trouvons aujourd’hui promu dans le cadre de la psychanalyse intersubjective comme le dévoilement de l’analyste, the disclosure, que j’ai référé à ce nouveau déviant qui s’appelle Owen Renik [5].
L’analyste peut admettre devant l’analysant des oublis et des erreurs, c’est-à-dire se décompléter, avouer que l’Autre n’est pas infaillible. C’est la valeur qu’elle donne à cette reconnaissance des manifestations contre-transférentielles. Mais elle s’oppose en même temps à ce que l’on accable le patient des affaires privées de l’analyste.
C’est donc dire que, déjà à cette date, l’on pouvait repérer cette tendance qui consistait pour l’analyste à faire part à l’analysant de ce qui pouvait l’émouvoir de l’expérience analytique en cours. Elle considère qu’il s’agit là de l’intrusion d’un matériel étranger à la cure et qui l’encombre et l’opacifie. Elle dit cela remarquablement en 1960 quand elle voit se dessiner cette pratique, cet usage de l’expérience ouverte par Freud.
Elle s’oppose de ce fait à ce que tout ce que l’analyste peut faire dans la cure – terme qui résonne pour nous de l’opposition que Lacan a construite avec l’acte de l’analyste – soit mis sous la rubrique du contre-transfert, c’est-à-dire à ce que le contre-transfert soit conçu comme équivalent à ce que l’on a appelé alors la réponse totale de l’analyste au patient. Cette conception a été mise en avant par Heinrich Racker comme par Margaret Little, qui a même essayé de créer un mathème de la réponse totale sous les espèces d’un R majuscule. La ligne de clivage, c’est qu’Annie Reich maintient, contre vents et marées qui se lèvent au cours de la décennie des années 50, la notion de la neutralité analytique. C’est sur ce critère-là qu’elle trace la ligne de partage entre les freudiens et les autres.
Surestimation du contre-transfert
Les freudiens ne nient pas l’existence du contre-transfert, ne nient pas qu’il y ait, chez l’analyste, réponse émotionnelle au patient, des affects, ce que Lacan appellera le « tu me plais ou tu me déplais ». Mais c’est pour inviter l’analyste à la vigilance à l’endroit de ses sentiments, de ses réponses émotionnelles, considérant précisément que l’élément sentimental fait obstacle au bon fonctionnement de l’analyste, et qu’il s’agit donc, ce contre-transfert, de le surmonter. Tandis que les autres, ceux qui dévient, selon Annie Reich, de la position freudienne, établissent une corrélation entre le contre-transfert de l’analyste et la structure du patient, ses pulsions et ses défenses.
La distinction est là entre un contre-transfert qui tient à l’inconscient de l’analyste en tant qu’il n’est pas, selon le terme freudien, purifié, et le contre-transfert rapporté au patient comme cause. Il s’agit de savoir quelle est la cause du contre-transfert. Le contre-transfert tient-il à ce qui persiste chez l’analyste d’un inconscient non-analysé ? Ou le contre-transfert est-il à rapporter à l’inconscient du patient comme cause ? Chez ceux qui dévient de la position freudienne, on peut obtenir, en analysant une réaction contre-transférentielle du patient, une révélation de son histoire infantile et de sa structure. Ce qui lui apparaît déjà comme non-freudien, c’est l’idée que l’émotion de l’analyste est une réponse au patient et qu’elle est identique aux expériences les plus originaires du patient qui deviendraient lisibles chez l’analyste. Cette orientation transforme en effet du tout au tout l’usage de l’expérience freudienne, parce que l’analyse du contre-transfert est dès lors susceptible de remplacer la remémoration, la reconstruction, du passé du patient. Le contre-transfert est supposé donner un accès direct – direct parce que l’analyste l’éprouve – à l’histoire inconsciente du patient.
Cela a des conséquences majeures sur la conduite de la cure. Cela dévalorise l’interprétation qui se trouve ainsi reléguée, comme elle le dit, à une place seconde. Elle nous décrit une pratique ayant pris forme dans les années 50 et qui valorise à la place la participation émotionnelle de l’analyste à la cure. Elle en voit le fondement, le point d’appel, dans la pratique étendue au psychotique, alors que lorsque Lacan évoque le contre-transfert dans l’introduction de son texte « Fonction et champ de la parole et du langage », à cette date de 53, il lie la question du contre-transfert à la fin de l’analyse. On voit qu’il n’en est déjà plus ainsi en 1960 et que c’est plutôt l’expérience avec les psychotiques qui pousse, favorise, cette surestimation du contre-transfert, la participation émotionnelle de l’analyste remplaçant l’interprétation. Pour une classique comme Annie Reich, cela se traduit ainsi : on privilégie le ça par rapport à l’inconscient, on prétend établir un contact direct avec le ça en court-circuitant l’inconscient ou on réduit l’inconscient au ça.
2. Une pratique contre-transférentielle
Empathie
Dans la même ligne, Annie Reich, dans un article suivant, en 1966, signale que la personne qui fait le plus de tapage autour du contre-transfert est kleinienne, c’est Margaret Little. Elle amène une nouvelle définition de l’expérience analytique conçue comme « une réflexion mutuelle du patient et de l’analyste, dans une sorte de miroir où l’inconscient de chacun se présente à l’autre ». C’est ainsi réduire ce qu’on s’imagine qui se passe chez le patient à l’émotion qu’éprouverait le psychanalyste. Une réduction et une déduction. On pourrait, à partir de ce qu’éprouve l’analyste, déduire ce qu’il en est de ce qui se passe pour le patient.
Annie Reich, elle, nie cette déduction. C’est un point évidemment essentiel qui est compatible, harmonique, avec ce que Lacan développera d’une logique du fantasme comme étant la logique de la cure, et où ce qu’il y a de déduction est interne à la chaîne signifiante du patient, et non pas une déduction qui irait de l’émotion de l’analyste à ce qui se passe pour le patient. Mais elle établit en même temps une différence qui sera d’avenir entre le contre-transfert et l’empathie, cette empathie dont Daniel Widlöcher fait aujourd’hui le moteur de l’expérience analytique.
Elle voit entre contre-transfert et empathie deux usages distincts de l’inconscient de l’analyste. Dans son effort pour être orthodoxe, pour être freudienne, si elle valide l’empathie en l’opposant au contre-transfert – elle n’a évidemment pas les moyens de se situer ailleurs que dans la même problématique, en définitive –, c’est dans la mesure où ce qui l’occupe est de rendre compte de ce qu’elle appelle la compréhension psychanalytique, soit du terme anglais d’insight, le fait que tout d’un coup on sait, comme elle s’exprime.
Il y a beaucoup de témoignages, dans l’expérience lacanienne de la psychanalyse, où l’on met en valeur ce « tout d’un coup on sait ». Eh bien, pour Annie Reich, cet insight, qui est le moteur de l’interprétation analytique, se fonde sur ce qu’elle croit être, ce qu’elle appelle « une saisie intérieure qui provient de l’inconscient de l’analyste ». Il y a là un enjeu sérieux pour nous, qui est de savoir dans quelle mesure il est fondé de rapporter cette illumination, cette révélation de vérité, à une saisie intérieure de l’inconscient de l’analyste, dans quelle mesure c’est réductible à un processus logique, tel que Lacan l’entend. L’empathie, cette saisie intérieure, rend compte pour elle de ce que nous appelons le point de capiton. Mais, dans sa conception qui oppose empathie et contre-transfert, l’inconscient en jeu dans la compréhension psychanalytique, celle qui permet l’insight, ce savoir soudain, est un inconscient freudien, défini comme analytiquement purifié, qui permet à l’analyste d’orienter son inconscient comme un organe récepteur. C’est un inconscient qui ne serait plus encombré du fantasme, un inconscient dont les résistances auraient été éliminées.
Identification au patient
Sur cette base, qui est distincte de celle du contre-transfert, l’identification au patient est permise. Ce n’est pas l’interaction mutuelle de deux inconscients chargés, mais au contraire ici la purification analytique de l’inconscient chez l’analyste qui est la condition d’une identification au patient. C’est justement parce que l’analyste a élucidé son inconscient – je glose – qu’il est en mesure de s’identifier au patient sur le mode de l’empathie. Ce qu’on appelle ici l’inconscient purifié, c’est un certain vidage de l’inconscient de l’analyste qui lui permet de s’identifier au patient.
Cela permet à Annie Reich de dresser une liste de psychanalystes qui auraient, eux aussi, partagé cette conception de l’empathie qu’elle défend, qu’elle essaye de dresser comme une digue en face de la pratique contre-transférentielle de la psychanalyse. C’est d’abord Robert Fliess, que Lacan cite dans son Séminaire, qui invite l’analyste à procéder à une identification transitoire au patient, de courte durée, pour savoir ce qu’il en est avant de revenir à une position extérieure d’évaluation. Elle valide aussi bien Kohut. Elle admet sa version de l’empathie comme forme de communication primitive qui serait issue d’une fusion du petit enfant avec sa mère. Elle admet tous ces modes, qui s’inscrivent pour nous très généralement dans la rubrique du registre imaginaire, mais en essayant de faire la différence avec le contre-transfert.
Elle fait appel aussi bien à la caution de Ferenczi, qui prônait chez l’analyste une souplesse du moi qui le met en mesure de s’adapter au patient, sans être arrêté par son inertie moïque, par ses résistances, au point d’admettre d’ailleurs chez Jakob Arlow l’idée d’un mimétisme transitoire de l’analyste par rapport au patient. Elle se recommande aussi bien de Roy Schafer qui défend que l’analyste interprète correctement à condition d’avoir lui-même éprouvé ce que le patient a éprouvé – tout cela dans un registre distinct du contre-transfert. Et elle inscrit dans la même rubrique Theodor Reik qui prônait en effet pour l’analyste un « devenir le patient », afin de pouvoir percevoir en lui-même ce qu’il aurait éprouvé à la place du patient.
Chacun de ces auteurs mériterait d’être traité pour lui-même, mais ce que nous en conservons pour l’instant, puisque nous rentrons dans le labyrinthe du contre-transfert, c’est l’idée d’Annie Reich que tout ça n’est pas le contre-transfert mais de l’empathie, dans la mesure où l’empathie est vectorialisée par l’insight, par la notion de compréhension. Pour elle, le contre-transfert n’est pas vectorialisé par la compréhension mais pousse à l’acting out de l’analyste qu’elle définit comme un ratage de la compréhension.
Le critère ici en jeu est «compréhension, non». Ce qu’elle appelle empathie, même lorsque c’est pour nous du registre imaginaire, c’est le moyen de la compréhension, ce qui accouche de l’insight, tandis que le contre-transfert accouche d’un acting out de l’analyste.
Acting out
Cette construction n’est pas sans mérite et en tout cas pas sans exactitude si l’on se réfère par exemple à une praticienne du contre-transfert comme la nommée Lucia Tower [6], qui conduit en effet le contre-transfert jusqu’à l’acting out. Ce n’est pas une interprétation de ma part, elle-même donne un cas où il est question de la réaction contre-transférentielle de l’analyste avec acting out.
Voilà une patiente qui lui vient d’une autre analyse où elle aurait connu une « réaction quasi psychotique » – menons-le entre guillemets – et qui commence avec elle, Lucia Tower, à la vitupérer rageusement et à l’agonir d’injures séance après séance. L’analyste témoigne en avoir été un peu agacée, mais dit en même temps « la plupart du temps, je l’aimais bien ». Elle laisse se poursuivre l’expérience sur ce mode. La patiente l’injurie, tempête. Elle ne moufte pas. Cela va se payer d’un acting out. L’analyste s’en va déjeuner, agréablement, prend son temps, revient, et s’aperçoit que ses agapes ont eu lieu au moment où elle aurait dû être dans son cabinet pour recevoir cette patiente. Elle avait oublié le rendez-vous. Lucia Tower témoigne alors avoir été habitée de sentiments de rage, de culpabilité et d’angoisse après cette séance qu’elle avait oubliée. La patiente revient, lui demande où elle avait été. L’analyste répond : « J’avais oublié » – c’est le disclosure, elle admet son manquement –, « je suis désolée ». L’analysante proteste dans la séance et puis finit par dire : « Vous savez, docteur Tower, je ne peux pas vraiment dire que je vous blâme. » Et, merveille de l’acting out contre-transférentiel de Lucia Tower, comme elle s’exprime, « la défense disparut entièrement ». La patiente cesse de l’injurier et entre dans l’analyse à proprement parler. C’est, pour Lucia Tower, la preuve de l’utilité du contre-transfert dans l’expérience analytique. Le contre-transfert vous fait faire de ces sortes d’acting out qui libèrent finalement la possibilité de l’expérience.
Elle conclut tout de même qu’il est probable qu’elle avait eu trop de patience et que si elle s’était sentie plus libre d’être agressive avec la patiente et de lui dire « ça va bien comme ça » devant ses injures, peut-être aurait-elle gagné du temps. Elle y voit tout de même la justification de ce qui se produit dans l’analyse, et sans doute, toujours pour elle, « une névrose de contre-transfert, cette fois-ci heureusement de courte durée ».
C’est ce terme de névrose de contre-transfert qui ne passe pas auprès d’Annie Reich, dont on peut supposer qu’elle pense que c’est une question technique et qu’il faut savoir qu’il n’y a pas lieu que l’analyste, dans l’acte analytique, autorise le patient à dire n’importe quoi, en l’occurrence des injures à l’analyste. On ne manque pas de témoignages d’analyses lacaniennes, y compris d’interventions de Lacan, de mettre obstacle à ce que l’analyste autorise l’analysant à l’injure, à cette insulte.
Voilà au moins un aperçu de la façon dont on pouvait déjà voir se dessiner, en 1960, ce qui a fleuri depuis et se présente aujourd’hui comme une pratique empathique, contre-transférentielle, de l’analyse, et ce qui s’en dégage à la pointe, une pratique purement intersubjective, qui laisse de côté aussi bien le terme d’empathie que celui de contre-transfert, puisque c’est une pratique intersubjective qui fait l’économie de l’inconscient.
Impasses
Il est clair que, dans la perspective de Lacan, ce débat entre contre-transfert et empathie est tout entier à situer dans les impasses du registre imaginaire. Ce qui fait défaut, d’un point de vue comme de l’autre, c’est tout simplement de ne pas considérer que l’analyse est une expérience de langage, parce que clairement, dans un cas comme dans l’autre, l’analyse est définie comme une expérience émotionnelle.
C’est comme un réactif, de donner toute sa valeur à cette définition de l’analyse comme expérience de langage, ce qui est pour nous presque banal et a une pointe tout à fait précise quand on l’oppose à cette problématique émotionnelle dans ses deux versions. De ce point de vue, quand il y a contre-transfert, c’est-à-dire qu’est mobilisé l’inconscient de l’analyste, la solution c’est l’analyse de l’analyste, son autoanalyse ou sa reprise d’analyse.
Quant à ce qui concerne l’empathie, l’insight, le « tout d’un coup on sait », Lacan le rapporte à un processus logique. Ce qui oriente l’enseignement de Lacan à travers ces différentes versions, innovations, c’est la position de l’analyste définie à partir du « je ne pense pas », une position de l’analyste définie comme extérieure à l’inconscient. Comme il s’exprime, de quelqu’un qui a affaire aux pensées, comment définir sa position sinon par le fait du « je ne pense pas ». C’est comme une nécessité logique qui excepte l’analyste dans sa position de cet ensemble des pensées auxquelles il a affaire.
D’autre part, il faut bien constater que nous sommes ramenés dans ce débat à ce que Lacan a posé justement au début des années 50, la différence entre une intersubjectivité imaginaire et une intersubjectivité symbolique. Cette intersubjectivité imaginaire qu’il a pu appeler le discours intermédiaire où il peut s’agir de rapport de sujet à sujet, mais où le sujet prend en compte l’être de l’autre comme donnée, et se trouve ouvert par là à tous les labyrinthes de la ruse où lui-même est joué. En revanche, l’analyste a d’emblée été défini par Lacan comme celui qui fait taire en lui-même le discours intermédiaire, celui qui se déporte du côté de l’intersubjectivité symbolique, et capable d’amener une interprétation qui fait tomber la trame imaginaire de l’intersubjectivité.
Cette formule générale et initiale de l’enseignement de Lacan ne doit pas nous faire éviter de suivre dans leurs labyrinthes – et d’en recomposer, si nous le pouvons, la combinatoire – toutes les versions qui ont pu en être élaborées. J’ai dit le contre-transfert, j’ai dit l’empathie. Nous avons maintenant l’intersubjectivité rénikienne, qui est la dernière fleur, la fleur la plus actuelle de cette histoire.
II – Esquisse d’une chronologie
1. Une conversion du regard
Rire
Nous rions ici assez souvent, bien souvent, peut-être trop souvent, depuis que nous lisons les autres psychanalystes, en particulier leurs comptes rendus de cas, le récit qu’ils nous apportent de leurs interventions, la narration de leurs états d’âme, de leurs expériences émotionnelles ou pensatives, si je puis dire, et leurs élaborations théoriques à ce propos.
Ce rire est un fait et il exprime sans doute le préjugé que nous nourrissons, de la supériorité de notre technique et de notre clinique. Ce rire fait réfléchir et signale que nous pensons comme persuadés d’avoir le plan de la maison là où nous voyons les confrères se faire des bosses.
Je ne dis pas que ce rire est illégitime. Néanmoins, ici et maintenant, ce rire est un obstacle épistémologique dans la mesure où nous avons entrepris de nous enseigner à nous-mêmes ce qu’il en est du moment actuel dans la psychanalyse, c’est-à-dire où nous tentons, si je puis employer l’expression, une réunification conceptuelle.
Ce cours dit de L’orientation lacanienne s’est en particulier voué depuis longtemps à étudier la logique de l’enseignement de Lacan, à la recomposer, à la scander, à mettre en évidence sa cohérence et aussi bien sa dynamique de transformation. Il faut reconnaître que ce n’est que de loin en loin que nous avons jeté un œil sur ce qui avait lieu ailleurs, et dans l’esprit plutôt de vérifier que nous n’en avions rien à attendre.
Nous tentons ces jours-ci une conversion du regard. Ce qui se fait ailleurs, et ce qui se fait par une population plus nombreuse que la nôtre, plus étendue dans le monde, c’est aussi de la psychanalyse. Cela, nous l’avons toujours admis en parole, mais ce dont il s’agit maintenant, c’est de nous apercevoir à quel titre nous y sommes impliqués.
Rions, mais sachons que de te fabula narratur, c’est de ton histoire qu’il s’agit aussi. Ce qui s’est déroulé depuis un demi-siècle hors de l’enseignement de Lacan structure, organise, impulse des forces qui aujourd’hui nous traversent. Il y a en effet désormais un monde psy, et dont la psychanalyse fait partie, que ça lui chante ou pas. La psychanalyse a été l’accoucheuse de ce monde, mais il l’a débordée et il l’inclut désormais.
Nous l’avons traduit jusqu’ici dans les termes d’une alternative : ou la psychanalyse ou la psychothérapie. C’est un emplâtre sur une jambe de bois. C’est vraiment une réduction du problème, qui est bien plus pressant, bien plus ample, bien plus blessant pour la psychanalyse. Si d’ailleurs nous avons dû, en particulier l’an dernier, réaffirmer cette alternative à nouveaux frais [7] c’est bien parce qu’elle s’avérait poreuse dans les faits.
Un article séminal
Pour comprendre ce qui a lieu, il faut prendre une voie plus longue que celle du mathème. Il faut recomposer l’autre logique, celle de la psychanalyse non-lacanienne – nous supposons qu’elle en a une –, ce que nous commençons à peine. Cela a fait irruption ici dans les conséquences de quelques interventions aventurées, publiques, dont je dois encore porter – j’espère pour peu de temps – le poids d’images et de sottises qui vont avec. À défaut de pouvoir apporter toute chaude cette logique de l’autre psychanalyse, je m’en tiendrai à proposer l’esquisse d’une chronologie, quelques repères, que nous avons d’ailleurs déjà évoqués pour certains.
La première date, 1949, est celle d’un article que l’on dit – plutôt en anglais qu’en français – séminal, celui qui a ouvert le champ, la voie, et qui constitue une référence toujours présente après un demi-siècle. C’est la date de l’article de Paula Heimann intitulé « À propos du contre-transfert », parce qu’en effet tout a commencé par le contre-transfert et nous étions encore il y a peu à penser que tout en était au contre-transfert.
Premièrement, ce texte a, dans l’autre psychanalyse, autorisé le contre-transfert. Lequel contre-transfert était dans l’orthodoxie analytique qui s’est cristallisée après la Seconde Guerre mondiale, celle de Hartmann, Loewenstein et Kris à laquelle Lacan s’est attaqué – je dis 1945 parce que c’est là qu’apparaît Psychoanalytic Studies of tire Child où ces trois se rassemblent sous la houlette d’Anna Freud –, une source de perturbation de l’analyse, conformément aux indications de Freud. La kleinienne accomplit ce geste inaugural de donner sa légitimité au contre-transfert, en considérant que non seulement il est inévitable, mais qu’en plus il est suprêmement utile à la direction de la cure. C’est un outil de travail, un instrument de recherche – ce sont ses termes –, et il convient que l’analyste interroge ses sentiments. Il doit avoir des sentiments. Il en a. Il ne doit pas les méconnaître, les démentir, mais au contraire les accueillir et les interroger. Voilà l’acte inaugural, dont le sens est encore à dégager. Quel est le sens de cet acte de Paula Heimann ?
Deuxièmement, en légitimant le contre-transfert, elle en donne une définition déjà élargie : « La totalité des sentiments que l’analyste éprouve envers son patient ». Autrement dit, elle ne fait pas du contre-transfert une entité seulement relative au transfert du patient, mais elle pose une équivalence entre ce contre-transfert et la réponse émotionnelle de l’analyste, dont elle considère que c’est la clef essentielle qui ouvre l’inconscient du patient.
Troisièmement, elle introduit ce faisant, discrètement, une définition nouvelle de la situation analytique et de la position de l’analyste. Il vaut la peine de citer les deux phrases – il n’y en a pas plus – qui constituent l’introduction de cette perspective nouvelle à cette date, au moins pour ce champ orthodoxe. « La situation analytique a été étudiée et décrite sous plusieurs angles et l’on s’accorde sur son caractère singulier. Mais j’ai le sentiment que l’on n’a pas assez souligné qu’il s’agissait en fait d’une relation entre deux personnes. »
La relation
C’est le thème de la relation, ayant été jusqu’alors méconnu dans la psychanalyse, qui commence là à se faire entendre. Corrélativement, elle critique et propose d’abandonner l’élaboration orthodoxe de la position de l’analyste, cette position qui, à partir des indications de Freud sur sa neutralité, avait selon elle conduit en effet à un portrait-type, un portrait-robot de l’analyste détaché, neutralisant ses sentiments, un analyste zéro, si l’on veut, un analyste voué à l’impersonnalité. Par rapport à cet analyste, le contre-transfert ne pouvait être en effet situé que comme une perturbation.
On sent bien qu’à travers des phrases discrètes elle s’en prend à ce que Lacan a à l’occasion ridiculisé dans la position orthodoxe, cet effort d’impersonnalité, d’interchangeabilité de l’analyste que l’on pouvait encore moquer dans les années 50. Ne jamais rien bouger au cabinet de consultation, qu’il soit le plus neutre possible, que l’analyste soit habillé toujours pareil, qu’il soit habillé comme les autres analystes – choses qui font toujours rire. On sent bien qu’elle-même a affaire à ça, ce qu’elle conteste en invitant l’analyste à ne pas reculer devant ce que l’on pourrait appeler un engagement émotionnel dans la cure. Bien sûr, cet engagement émotionnel était déjà favorisé par le kleinisme et introduisait une atmosphère de la cure sensiblement différente chez ceux que l’on appelait – légitimement à l’époque – les freudiens et les élèves de Mélanie Klein.
Quatrièmement, je ferai un petit commentaire que me permet le fait de m’être reporté à des documents apportés par Philippe La Sagna [8] dont j’ai fait mon profit. Paula Heimann pensait apparemment qu’elle pouvait modifier la définition de la position de l’analyste sans mettre en question le statut de l’inconscient. Elle découple position de l’analyste et statut de l’inconscient, puisque, tout en modifiant dans le sens émotionnel la position de l’analyste, elle continue – on ne s’en aperçoit même pas tellement cela va de soi – de se référer à l’inconscient, et elle voit dans la relation le moyen d’accéder à cet inconscient du patient, en mettant en jeu celui de l’analyste. Or, dans la position orthodoxe – défendons-la un petit peu –, il y avait justement une corrélation très étroite entre position de l’analyste et statut de l’inconscient.
Pourquoi cette tentative pathétique pour parvenir à cette impersonnalité, cette réduction à zéro de l’individualité de l’analyste, si ce n’est pour protéger le statut de l’inconscient. C’était dans l’idée que l’inconscient est déjà là, inscrit comme une réalité objective, et que l’analyse, la cure, doit lui donner l’occasion de se révéler, de se manifester de la façon la plus pure qu’il soit possible. Ce réalisme de l’inconscient impliquait que l’analyste défalque sa singularité – on dit en anglais to factor out –, qu’il arrive à se mettre hors du champ d’expérience, afin de ne pas polluer, parasiter ce champ d’expérience qui doit permettre à un inconscient déjà là de se manifester. C’est à ce titre que l’orthodoxie hartmannienne pouvait prétendre donner à la psychanalyse un statut de science.
Qu’est-ce qui commence là tellement discrètement ? C’est comme le Boléro de Ravel. Cela commence tout petit pour ensuite s’enfler jusqu’à l’extraordinaire orchestration d’aujourd’hui.
Elle introduit la relation : « Dans la psychanalyse, la situation analytique est avant tout une relation de deux personnes. » La relation conduira inévitablement à mettre en question le statut de l’inconscient, et même à nier l’inconscient. Ce qui a commencé avec Paula Heimann en 49 conduit aujourd’hui un secteur, au moins, encore attaché à l’Association internationale, à considérer que l’inconscient est une hypothèse dont ils n’ont pas besoin.
2. Largage du contre-transfert
La réponse totale de l’analyste
Deuxième date – ce sont des repères –, 1956, Margaret Little. Cet article s’intitule « R », « La réponse totale de l’analyste aux besoins de son patient ». On ne voit pas comment traduire needs autrement que par besoins. Cela consonne avec l’usage que Winnicott faisait de ce terme. C’est le seul mathème qui ait été apporté pendant ces cinquante ans de ce côté-là. Cela traduit justement cet élément créateur.
Toujours dans cette esquisse, je dirai qu’elle largue le contre-transfert. Elle adopte la définition élargie de Paula Heimann, mais elle ne l’appelle plus contre-transfert, parce que, dit-elle, l’on ne s’y retrouve pas dans ce cas-là. On voit ce qui la dérange dans l’emploi du terme contre-transfert. Ce terme continue de faire référence à l’inconscient, au transfert, et c’est encore trop. On pourrait s’imaginer que l’on vise seulement l’attitude inconsciente de l’analyste envers son patient. Ce n’est pas à ça qu’elle a affaire, elle, dans son expérience.
Si l’on dit contre-transfert, on pourrait s’imaginer qu’il s’agit des éléments inconscients non-analysés de l’analyste, ou encore de la rencontre du transfert du patient par l’analyste. Margaret Little a au contraire une idée beaucoup plus grandiose de ce dont il s’agit. Ce qu’elle prend en charge dans la direction de la cure, et dont elle fait, pour le dire dans notre langage, un objet de la direction de la cure, c’est la réponse totale de l’analyste, consciente aussi bien qu’inconsciente. Son signifiant R inclut tout ce qu’un analyste « dit, fait, pense, imagine ou ressent ».
Déjà là, et d’une façon encore plus avouée, plus manifeste que Paula Heimann, elle fait le pas suivant. La perspective R sur l’expérience analytique efface, du point de vue métapsychologique, la différence entre conscient et inconscient, et efface, du point de vue technique, la différence interprétation et comportement. Cette globalisation est aussi bien à l’œuvre dans l’usage du terme need. Il ne s’agit pas des besoins en tant qu’ils seraient différents des pulsions. Cela implique tout ce qu’il faut apporter au patient, y compris les dispositions que l’on a à prendre avec l’entourage, le médecin, l’hôpital, les contacts à prendre autour pour que l’expérience soit possible. Le moteur de cette logique, c’est l’ouverture de la cure analytique à des patients qui ne sont plus ceux de Freud, comme chacun le souligne. C’est l’arrivée des borderlines, des psychotiques, des enfants. C’est la poussée que la psychanalyse elle-même a induite qui est la base matérielle de cette logique conceptuelle.
Margaret Little elle-même traite le terme de besoin non pas comme un concept mais comme un terme passe-partout. C’est fait pour effacer toutes les délimitations soigneuses qui avaient pu être faites dans l’œuvre de Freud ou dans la tradition analytique.
La dynamique de l’interaction
C’est là que je donnerai une valeur spéciale à l’article d’Annie Reich, 1960, « Quelques remarques supplémentaires sur le contre-transfert ». Cet article est manifestement un effort pour bloquer la dynamique en cours dans la psychanalyse. Elle signale une dilution de la psychanalyse, une confusion entre psychanalyse et psychothérapie, et elle essaye de construire une digue qui arrête la progression du terrible R – initiale de response – de Margaret Little. Elle s’oppose à la mise en équivalence du contre-transfert et de la réponse totale. Elle voudrait admettre un contre-transfert empathique. Empathie oui, réponse totale non. Elle essaie d’établir une digue. Elle refuse cet effacement de toutes les délimitations métapsychologiques fines qui sont essentielles à soutenir le point de vue de Margaret Little. Elle se trouve défendre la position orthodoxe de l’analyste et indique à cette occasion ce qui est déjà en train de se véhiculer en 56 contre cette position orthodoxe, dans le même temps où, en France, Lacan la prend aussi pour cible.
La nouvelle position analytique critique l’ancienne en disant que la neutralité analytique est une tâche impossible, irréalisable. Ce serait même une hypothèse malhonnête que de faire croire que l’analyste puisse s’être détaché, que c’est habiller l’analyste du mythe de la perfection, que cela n’a pas d’autre fondement que la prétention de l’analyste à se poser comme un être supérieur ou même à jouer à être un dieu. Toutes critiques qui sont vraiment recyclées aujourd’hui dans l’École californienne.
On le voit à travers Annie Reich, cette critique était déjà active dans la décennie des années 50. Elle signale très bien qu’à prendre les choses ainsi, la cure devient simplement une interaction de l’analyste et de l’analysant, une interaction qui joue sur les identifications et les projections et qui modifie les conditions – disons-le dans nos termes – de l’acte analytique.
Elle perçoit, au bout de dix ans, la dynamique de l’interaction qui remplace l’interprétation et la remémoration du passé, la reconstruction. Elle perçoit déjà que la dynamique de la perspective interactive met finalement en question le statut de l’inconscient. Ce qui occupe l’analyste, ce n’est pas la référence à l’inconscient, mais les épisodes, les événements, de son interaction avec le patient.
3. La fin d’une époque
1949 – Paula Heimann
1956 – Margaret Little
1960 – Annie Reich
1965 – Otto Kernberg
Un conciliateur
Je comprends maintenant quelle est la valeur d’un texte – assez difficile à lire, il a l’air d’une soupe – d’Otto Kernberg, qui écrit en 1965 un article qui s’appelle «Contre-transfert» [9]. Entre Margaret Little et Annie Reich, avec toutes les précautions d’usage, Kernberg valide le point de vue de Margaret Little. Au lieu de contribuer à la digue d’Annie Reich, il la détruit plutôt.
Kernberg est un conciliateur, qui essaye d’en donner à chacun. Le point d’application essentiel semble être que celui qui essaye de donner forme, sinon à la nouvelle orthodoxie, au moins au mainstream, adopte ce qu’il appelle la conception totalistique – traduction du mot anglais –, la conception grand R. Il distingue la conception classique du contre-transfert, celle de Freud, et tous ceux qui se rattachent à cette position, c’est-à-dire qui prennent le contre-transfert ou avec des pincettes ou avec des réserves, admettant qu’il y a des sentiments, peut-être peut-on s’en servir, mais ils ne sont pas à l’aise avec le contre-transfert, et puis la conception de la réponse totale, totalistique. Dans cet article, il adopte cette conception, il admet la réponse totale dans le mainstream psychanalytique, tout en faisant la part des choses et en essayant d’intégrer des éléments de la conception classique afin d’obtenir un consensus. C’est alors que s’accomplit vraiment une sorte d’abaissement des barrières. C’est la fin d’une époque. La dynamique relationnelle commence à s’imposer. Il y a à cette date une résignation.
L’école intersubjective
Et puis, il y a aujourd’hui. Il y a certainement des étapes intermédiaires qu’il faut reconstituer, mais prenons ce qui s’est cristallisé à partir des années 80 et qui est sans doute aujourd’hui la ligne de faille principale de la psychanalyse non-lacanienne.
Ce qui s’est cristallisé à partir des années 80, c’est l’école intersubjective, celle qui tire les conséquences de la dynamique de la relation, qui la pousse jusqu’à ses dernières conséquences, c’est-à-dire jusqu’au point où l’interaction l’emporte sur l’inconscient. On atteint là à un point extrême qui peut vraiment prendre en charge une critique radicale de l’ancienne orthodoxie, une orthodoxie qui inclut Freud.
Les psychanalystes intersubjectivistes d’aujourd’hui n’épargnent pas Freud, mais voient au contraire en lui celui qui a camouflé dans la cure analytique l’omniprésence de la subjectivité de l’analyste, et qui a donné à la psychanalyse un tour scientiste et positiviste. Ce qu’ils appellent ici le positivisme, c’est d’admettre une réalité psychique sous-jacente, déjà là, préalable à l’interaction, d’admettre l’inconscient comme déjà là, et en plus de lui chercher des fondements d’ordre biologique. On les voit donc impatients aussi bien du registre inconscient de la psychanalyse que du registre des pulsions.
Une critique radicale et cette fois-ci logique de la position de l’analyste qui se présentait comme scientifique, comme visant une vérité objective qui aurait été déjà déposée, présente dans le patient, et idéalisant une vérité objective, ce qui fonderait finalement l’analyste dans une position dogmatique et autoritaire.
Quelle que soit l’étendue actuelle de cette école intersubjectiviste, elle dégage les éléments qui étaient déjà présents dans l’intervention inaugurale de Paula Heimann en 1949. Ils vont jusqu’au bout, ils s’aperçoivent que l’accent mis sur la relation conduit à nier le réalisme de l’inconscient. Il y a donc aujourd’hui une psychanalyse postmoderne qui ne croit plus au réel et qui largue la conceptualité freudienne classique.
Cette École intersubjective se reconnaît des précurseurs chez Mélanie Klein et chez les théoriciens de la relation d’objet qui ont ouvert la sphère psychique fermée des hartmanniens. Elle se reconnaît comme précurseurs les personnalistes, les interpersonnalistes, cette École qui avait été mise sur les marges de l’IPA, aux États-Unis – Sullivan, Karen Horney, Fromm, les culturalistes aussi. Elle se reconnaît comme précurseur – bien qu’il ne soit pas exactement dans l’orthodoxie intersubjectiviste – un certain Lacan. Elle fait référence à « Fonction et champ de la parole et du langage », daté de 1984 – sans doute le moment où l’auteur a connu la traduction. Elle se reconnaît aussi à titre de précurseur tout le courant modéré qui a procédé du grand R de Margaret Little, y compris Winnicott, et en considérant que le fait d’avoir élargi les formulations sur le contre-transfert – growning – laissait présager le challenge actuel que l’École intersubjective lance à la psychanalyse classique. Ce secteur des psychanalystes est dans une attitude de défi à l’endroit de la psychanalyse classique, et déjà dans ce terme de challenge repris dans l’International Journal. C’est la première fois qu’on lit quelque chose d’aussi net, d’aussi affirmé. Disons, des dizaines d’années plus tard, une réédition californienne du défi lacanien à l’orthodoxie hartmanienne. C’est sans doute, par beaucoup de traits, une version US de Lacan. Elle dégage, chez Lacan, un théoricien de l’intersubjectivité. Je suppose qu’ils doivent le critiquer, parce qu’ils gardent encore trop l’idée de la supériorité de l’analyste sur le patient, qu’il soit à la place du grand Autre.
Ogden a écrit en 1992 un article en deux parties dans l’International Journal, « Le sujet de la psychanalyse constitué dialectiquement et décentré » [10]. Il avait précédemment, en 88, écrit un article qui s’appelait « Sur la structure dialectique de l’expérience analytique » [11]. Il y a actuellement à l’œuvre une version américaine de Lacan qui s’appuie certainement sur l’idée d’une négation du déjà-là qui emporte l’inconscient, allant donc plus loin que Lacan dans ce sens, et qui considère que la seule réalité en jeu dans la cure est la réalité intersubjective créée par l’interaction analyste/analysant. Tout le reste devient alors de l’ordre de la construction, de l’hypothèse ou de la construction socialement déterminée.
Il y a un combat en cours, puisque la majorité de l’Association psychanalytique américaine est encore attachée aux préjugés classiques et que l’on s’efforce de la familiariser avec une sensibilité intersubjective. La psychothérapie n’est-elle pas en train d’envahir la psychanalyse ? On s’aperçoit que c’est au sein même d’une réflexion sur l’analyse que prend forme cette cure interactive qui fait l’économie de l’inconscient, du ça, des pulsions, et est purement et simplement dans une architecture du dialogue thérapeutique. Il y a là un champ qui est encore à investiguer, niais qui nous permet déjà de mieux comprendre ce qu’a été la logique de Lacan.
Réalisme de la structure et dissymétrie
Il y a eu deux sorties de l’orthodoxie dans les années 50, celle par le contre-transfert et celle de Lacan. Si l’on date le point de départ de Lacan de 1953, « Fonction et champ de la parole et du langage », il est évidemment précurseur de lui-même, puisque son premier article sur la psychanalyse comporte une description phénoménologique de l’expérience précisément comme une relation. Vous avez ça déjà dans « Au-delà du principe de réalité ». Lacan souligne « le paradoxe que présente la notion de l’inconscient, si on la rapporte à une réalité individuelle »[12]. D’emblée, une réflexion conceptuelle sur ce qu’il en est de l’inconscient le conduisait à installer ce schéma bipolaire du sujet et de l’Autre. D’ailleurs, dans le graphe de Lacan, par exemple, où vous trouvez les termes classiques de pulsion, fantasme, le moi, vous ne trouvez pas l’inconscient à proprement parler, parce que l’inconscient est dans la relation des termes qui sont ici mis en place.
On voit bien que l’impossibilité de rapporter l’inconscient freudien à un individu conduit, sur la ligne du contre-transfert, à loger l’inconscient dans la relation à deux. C’est ce que fait Paula Heimann, sans savoir ce qu’elle fait, sans savoir qu’elle met en marche une mécanique qui conduira à nier l’inconscient. Lacan, de son côté, loge, lui, l’inconscient dans une dimension trans-individuelle, mais évidemment beaucoup plus complexe qu’une relation à deux puisqu’elle comporte parole, langage et discours.
Premièrement, il ramène l’expérience analytique à son fondement dans la parole et valide un terme comme celui d’intersubjectivité, qu’il introduit même dans la psychanalyse.
Deuxièmement, il resitue la fonction de la parole dans le champ du langage et de sa structure. Par là même, il réintroduit dans cette expérience – dont on ne nous chante que la souplesse, la fluidité, les interactions multiples, the interplay, le jeu mutuel de l’analyste et de l’analysant – une structure qui a ses lois, ses contraintes, où il y a de l’impossible et par conséquent du réel. Troisièmement, puisqu’il lui faut le discours pour définir l’inconscient, il y a ici une instance qui a une réalité autonome. Lacan sort de ce fait de l’orthodoxie régnante. Il ne liquide pas la conceptualité freudienne, mais recycle au contraire, à travers parole, langage et discours, le scientisme freudien, c’est-à-dire qu’il préserve un réalisme, le réalisme de la structure. Il recycle aussi la métapsychologie freudienne à partir de la communication, c’est-à-dire qu’il assigne à l’intersubjectivité une structure, et une structure foncièrement dissymétrique.
C’est toute la valeur qu’a ce fait que, chez Lacan, derrière la relation, il n’y a rien qui soit de l’ordre de l’interplay, mais la lutte à mort hégélienne, c’est-à-dire une structure foncièrement dissymétrique. On n’a rien chez Lacan qui soit de l’ordre de la soupe interactive que l’on nous présente, puisque la fonction de l’Autre préserve toujours une instance d’étrangeté dans l’expérience.
L’introduction par Lacan du sujet supposé savoir, c’est-à-dire que personne ne sait rien avant que les signifiants soient sortis – s’ils en ont eu vent du côté de la Californie, cela doit autoriser à leurs yeux leur irréalisme, leur constructionnisme – n’enlève rien à l’insistance du réel qui est au contraire l’orientation essentielle de son dernier enseignement.
III – Une aile marchante
1. Désir de synthèse
Un néo-lacanisme californien
Je fais ici mon éducation et ne recule pas à vous en faire les témoins. Celui qui vous parle ne sait pas. Il apprend. Pas à pas, il pénètre dans des zones du champ freudien qui étaient pour lui, avouons-le, terra incognita, et pourtant non pas complètement méconnue, puisqu’il avait repéré, de cette terre, la frontière extérieure.
Il savait – je me distingue déjà de ce « il », puisque, moi, j’ai avancé entre-temps – qu’il s’agissait d’une pratique de la psychanalyse ayant ignoré la reprise lacanienne du projet freudien, le retour à Freud, la refondation intervenue au début des années 50 sur le fondement de la parole et la structure de langage, une pratique prenant ses repères de la seule dimension imaginaire de l’expérience. Nous savions ce bord, le bord extérieur de cette vaste zone psychanalytique.
Jusqu’à présent, c’est ainsi. Rien de ce que nous découvrons n’invalide la formule de ce repérage, mais nous nous sommes proposés à l’aventure d’entrer plus avant dans le détail.
La psychanalyse non-lacanienne a été, tout au long de ce demi-siècle, animée d’une dynamique dont nous supposons qu’elle a sa logique et que celle-ci peut être reconstituée. C’est au moins dans cette direction que nous travaillons, travail ingrat à travers une littérature qui ne nous est pas affine.
J’ai commencé à m’avancer dans l’étude des travaux de ces analystes californiens qui lancent à l’orthodoxie de leurs collègues américains un challenge [13]. Il s’agit essentiellement, même s’il y a d’autres noms autour, de ce couple d’Ogden et Miller, qui n’ont pas l’air de travailler ensemble, qui ne se réfèrent pas l’un à l’autre, tous deux de San Francisco. J’ai procédé, avec ce que j’avais – je me suis arrêté à 1999 –, à une petite construction tout à fait élémentaire.
Ils constituent l’aile marchante du côté de l’Association internationale, ceux-là même qui font aujourd’hui problème à cette Association et qui sont des lecteurs de Lacan. On pourrait recadrer leur théorie comme constituant une espèce de néo-lacanisme californien, un lacanisme imaginarisé, mais qui a certaines adhérences, et en tout cas qui manifeste de temps en temps, explicitement, un intérêt pour l’orientation lacanienne. Sans doute n’en lisent-ils pas tout, ils ont même une certaine inhibition à le faire, et quand ils mentionnent Lacan, c’est plutôt en lui donnant une place à part par rapport à leurs propres collègues. D’une certaine façon, ils interprètent Lacan à partir des références qui sont les leurs et qui les conduisent à se placer sous l’insigne de l’intersubjectivité, c’est-à-dire à opérer à partir de la subjectivité de l’analyste.
Un moi-pivot
C’est ici que l’on peut tracer une ligne de démarcation entre l’École anglaise et ce qui s’est développé aux États-Unis d’Amérique. L’École anglaise, c’est-à-dire le ou les courants qui ont pris forme à partir de Mélanie Klein et de la théorie des relations d’objet, ont fait leur place au contre-transfert dans son acception élargie, jusqu’à inclure l’ensemble des réactions de l’analyste dans l’expérience analytique – intellectuelle, émotionnelle, manifeste, cachée, consciente, inconsciente.
Margaret Little est la première à avoir donné son mathème élémentaire au contre-transfert élargi avec la lettre R majuscule, qui traduit l’introduction d’un objet nouveau dans l’expérience analytique, nouveau par rapport au concept freudien de l’expérience. Cet objet nouveau, c’est l’analyste comme sujet, ce qu’il pense, ce qu’il fait, ce qui l’émotionne, ce qu’il associe. Si on l’admet comme une dimension de l’expérience, on dit qu’elle n’a pas été traitée par Freud, et donc on joue sa partie avec cet objet supplémentaire, dont, dans la ligne freudienne, Lacan s’était débarrassé d’emblée en parlant de la fin du moi chez l’analyste. Nous comprenons mieux ce que voulait dire cette expression de Lacan lorsque nous voyons maintenant ce moi au contraire si présent, si actif, si sensible dans l’expérience analytique de nos collègues. Eux, ils n’en ont pas du tout fini avec le moi. C’est au contraire sa présence, sa sensibilité qui est manifestée, dont ils font non seulement leurs délices mais leur pivot, le point d’appui de leur pratique.
Kernberg, en 1965, a fait sa place au contre-transfert. Si l’on regarde de près, on voit qu’il l’admet comme une sorte de complément de l’egopsychology, et spécialement dans les cas de patients d’organisation borderline, puisque c’est lui qui a créé le concept d’organisation-limite. C’est spécialement à propos des patients présentant selon lui les traits de cette organisation-limite, borderline, qu’il fait sa place au contre-transfert, alors que, chez nos tout derniers Californiens, ce qui est dans cette zone est tout-terrain. Les exemples qu’ils donnent viennent d’ailleurs tous d’analyses de patients que l’on qualifierait de névrosés.
En 65, Kernberg fait du contre-transfert élargi qu’il admet un complément de l’egopsychology avant tout destiné à manœuvrer les organisations-limites. Il en fait un instrument diagnostique qui peut contribuer à évaluer le degré de régression d’un patient, comme il s’exprime, et à clarifier le type de transfert qui est en jeu dans la cure.
Le fade-out
On peut souligner, justement par différence avec ce qui advient aujourd’hui dans cette École californienne, l’expression, qu’il emploie trois fois, de « complications contre-transférentielles ». En effet, avoir affaire au contre-transfert, pour l’analyste devoir s’interroger sur ses réactions, est un facteur de complications. Ce dont il traite, de façon d’ailleurs un peu lointaine, à distance, ce sont des patients qui empêchent l’analyste de s’en tenir à la neutralité analytique prescrite par l’orthodoxie, ceux qui délogent l’analyste de sa position standard. Il admet, à ce moment-là, que l’on est forcé de noter l’apparition de complications contre-transférentielles : « Je n’en peux plus, je n’en veux plus, au revoir. Comment se débarrasser de ce patient ? ».
J’essaye d’animer un peu un article qui demande à être relu pour qu’on s’aperçoive de quoi il s’agit. C’est le fade-out : « Je n’arrive à mon cabinet de consultation qu’en traînant les pieds quand il s’agit de ce patient. L’heure m’a l’air de durer beaucoup plus longtemps que la durée standard. Ou alors je n’y pense plus du tout entre les séances, ou au contraire je ne peux pas faire autrement que d’y penser tout le temps, et le patient s’occupe de me persécuter dans l’intervalle. » Tout ce qui déloge l’analyste de la position standard, qui introduit des complications contre-transférentielles par rapport au névrosé obsessionnel que l’on supposera fidèle au poste, à l’heure, et ne dérangeant pas cette ordonnance, cette organisation non-limite de l’analyste.
Kernberg légitime que l’analyste s’interroge alors sur ce qui lui arrive à lui, sur ce que le patient réveille dans sa réalité psychique, et se demande, s’interroge sur les mécanismes qui sont ainsi chez lui réactivés, et qu’il appelle, d’une façon générale, « mécanismes précoces d’identification et de défense ». Il invite donc l’analyste à repérer chez lui comment se manifeste cette réactivation. On trouve des termes comme la « discontinuité affective » ou « le phénomène de dévouement total », qui est aussi non-standard, ou encore, chez l’analyste, son attitude qu’il appelle joliment micro-paranoïde à l’endroit du patient.
C’est un effort de synthèse comme ce qui fait le fil, l’orientation, le désir de Kernberg dans ce qu’il a amené à la psychanalyse. C’est un désir de synthèse pour intégrer ou rendre compatibles avec l’egopsychology le kleinisme, les relations d’objet, le contre-transfert élargi. Cela doit en effet représenter pour les États-Unis, à partir du milieu des années 60 jusqu’à 1980, une forme de synthèse encore active aujourd’hui, mais qui s’est formée au cours de ces années.
2. Un rapt
Inter-
Cette tentative de synthèse par Kernberg de l’École anglaise et de l’orthodoxie américaine commence à prendre eau au début des années 80. Un analyste du milieu de Miller explique qu’à cette date des analystes américains, classiques, formés à l’IPA, ont commencé à conceptualiser la relation analytique comme interplay de deux psychologies – le jeu mutuel ou l’interaction de deux psychologies. S’ils se repèrent sur le terme d’intersubjectivité – on a déjà dit interpersonnel dans la psychanalyse américaine –, c’est parce qu’ils ont lu Lacan. S’ils utilisent le terme d’intersubjectivité, c’est qu’ils ne considèrent plus le grand R de Margaret Little comme un facteur exceptionnel, dangereux, un facteur de complications qui n’entre en jeu que lorsque le patient est non-standard, mais comme un élément comme tel constituant de la relation analytique.
On voit les contributions de ces analystes se répartir sur deux versants. Ce n’est pas tout d’admettre le contre-transfert même élargi ou de considérer ses propres réactions, le facteur vraiment discriminant pour ces théoriciens est de savoir si c’est pour eux un encombrement ou au contraire un élément constituant de la relation analytique.
J’ai eu le plaisir de parcourir l’article d’Ogden de 1992 qui s’intitule « Le sujet de la psychanalyse constitué dialectiquement et décentré » [14], et qui vous apprend que Monsieur Ogden introduit le terme de sujet dans la psychanalyse. Oui. Parce qu’il n’est pas satisfait du terme d’ego et de celui de self. Il préfère donc, pour cette raison, désigner l’individu en tant que sujet. C’est un homme qui a beaucoup lu et qui a pour références Hegel 1807 et Kojève 1934-1935 – où va-t-il chercher tout cela ? –, donc La phénoménologie de l’esprit et le cours de Kojève sur La phénoménologie. Il y a heureusement, à la fin de l’article, un post-scriptum consacré à Lacan, bien que « l’on n’ait pas le temps d’en parler vraiment comme il faudrait dans cet article ». Bref, on lit tout l’article au nom d’Ogden.
Ce qu’il appelle sujet – le rapt des mots est accompli –, c’est l’instance qui fait l’expérience de ce qu’il appelle en anglais I-ness, c’est-à-dire l’expérience de la jeïté, l’expérience du je. Ce n’est pas l’ego, le self, qu’il veut traduire par là, mais l’instance qui génère le sentiment de subjectivité. Il en fait une expérience dialectique toujours changeante en se référant aux bons auteurs, et à Hegel dont il ne dit d’ailleurs rien d’autre que le nom et la date. Il a visiblement lu et médité Lacan et en absorbe les termes dans sa pratique et dans ce qu’il essaye d’exposer à ses collègues. Cela lui sert à critiquer Freud. Il fait retour sur le sujet freudien pour repérer, à partir de l’idée que tout dans l’expérience analytique est centré sur le je et sur la dialectique de l’expérience, dans Freud, un certain nombre de points sensibles qu’il ordonne pour appuyer son idée du sujet freudien.
L’idée de dialectique est présente dans toute cette école, L’aspect unique de cette dialectique qui le retient, c’est le moment de la réciprocité. C’est pourquoi ils font varier tous les termes qui commencent par inter – interplay, interaction, intersubjectivité. Cela veut dire qu’on n’est pas tout seul, cela se passe aussi de la même façon dans l’autre et réciproquement. Voilà le concept de la dialectique avec lequel ils opèrent et qui est évidemment très à distance de la dialectique dissymétrisante de Hegel, qui est, elle, au contraire au premier plan pour Lacan depuis les années 30 jusqu’à son enseignement des années 80.
Une dialectique-réciprocité
Ne serait-ce que sur cette base, il repère que Freud avait beaucoup de mal à s’accommoder de la diachronie de la causalité. L’étiologie n’arrive pas à s’ordonner chronologiquement chez Freud, qui n’opérait pas vraiment avec un modèle linéaire de la causalité comme les positivistes. Seule la dialectique permet de rendre compte du projet de la psychanalyse. Il faut des allers et retours, des incidences réciproques qui ne s’accommodent pas d’un schéma seulement linéaire.
Premièrement, il relit Freud en termes dialectiques. C’est d’ailleurs plutôt proféré que vraiment démontré. Il voit chez Freud une dialectique du conscient et de l’inconscient, telle que l’existence de chacun dépend de l’existence de l’autre. Voilà à quoi se résume pour lui la dialectique.
Deuxièmement, il imagine aussi bien que la seconde topique freudienne du moi, du surmoi et du ça est un système dialectique tel que chaque terme a besoin des autres pour subsister. Il préfère dialectique à structure.
Troisièmement, il s’appuie sur la lecture par Jean Hyppolite du texte de Freud sur la dénégation – où est-il allé trouver ça ? – pour mettre en valeur des termes comme la présence dans l’absence et l’absence de la présence, et aussi la fonction de l’Aufhebung qu’il pêche dans ce texte. Cela lui paraît justifier l’introduction du concept de sujet en tant qu’une instance non-localisable, à la différence du moi, et qui circule au contraire entre conscient et inconscient. Il faut attendre la fin de son premier article pour lire un post-scriptum sur Lacan où il explique qu’il ne peut pas se livrer à une discussion approfondie de Lacan. Ce qui est formidable, c’est que cela paraît dans l’International Journal of Psychoanalysis. Tout le monde considère parfaitement normal de publier un texte constitué de cette façon-là.
Il voit tout de même une différence entre Freud, Klein et Winnicott d’un côté, et Lacan de l’autre, et il ne parlera plus de Lacan après ça. D’ailleurs, une fois que Lacan a été délesté d’un certain nombre de termes et de références, qu’est-ce qui reste à en faire ? Freud, Klein et Winnicott, selon lui, fondent le dialogue psychanalytique sur un discours interprétatif mutuel où l’on se comprend, alors que Lacan traite la compréhension comme une illusion. Cela fait la différence de Lacan, qui est due à sa doctrine du signifiant et du signifié qui barre la compréhension et le conduit toujours à déconstruire – c’est l’expression qu’il emploie – le texte manifeste. On comprend que la construction de Lacan débouche sur un « ne pas comprendre », alors que, pour lui, Freud est une herméneutique, Ricoeur à l’appui.
Voilà le Ricoeur de 1967 qui refait surface en 92 pour habiller et justifier ce mouvement vers Lacan, dont cela témoigne néanmoins puisque les références à l’œuvre de Lacan sont rares dans l’International Journal. Avec la même grille de lecture, avec cette dialectique réduite à la réciprocité, il n’a aucun mal à verser au compte de la dialectique l’identification projective kleinienne, et il s’appuie sur Bion pour montrer qu’il s’agit là d’un événement interpersonnel, intersubjectif. Il traite donc du sujet kleinien à partir de Bion et montre que l’identification projective n’est pas un mécanisme linéaire mais un mécanisme dialectique qui révèle l’interpénétration des subjectivités.
Interpénétration des subjectivités
Après cet article, Ogden ne fera plus de grande théorie générale. Il donnera des indications sur sa pratique, fort intéressantes, mais là où il prend son mouvement propre, c’est lorsqu’il formule – une fois dans cet article sur le sujet de la psychanalyse – que la dialectique intersubjective finit par révéler l’interpénétration des subjectivités. Si nous essayons d’ordonner le paysage inédit qui nous est là présenté, Ogden construit l’expérience analytique sur l’interpénétration des subjectivités. Il considère même que l’analysant lui-même est créé dans le processus analytique, dans le processus intersubjectif. Être analysant, c’est quelque chose qui advient dans la dialectique intersubjective entre le self et l’autre. Il approche, avec ses moyens, de ceci que « le sujet n’est pas ». Il ne dit pas que c’est un manque-à-être, mais il n’est pas, il devient à travers un processus intersubjectif. Ce qu’Ogden retient de ce qu’il a parcouru de Lacan et de l’état de la psychanalyse au moment où il s’y intéresse, c’est la primauté de l’espace intersubjectif. Il est, dans la psychanalyse non-lacanienne, le théoricien de l’espace intersubjectif comme primaire. Il repense tous les termes qui se présentent, aussi bien dans son expérience que dans la théorie, à partir de cet espace intersubjectif.
Autrement dit, la réciprocité débouche chez lui, pas chez tous, sur une forme de fusion. Parti en 92 de l’interpénétration des subjectivités, il pourra donner sa version à lui du tiers, de la tiercéïté, mais du tiers lacanien. Lui aussi parle du tiers analytique, mais il entend par là l’espace intersubjectif où les deux subjectivités de l’analysant et de l’analyste s’interpénètrent. C’est ça qui est le tiers, en quelque sorte le tiers primaire, originaire par rapport aux deux subjectivités qui s’y inscrivent.
3. Le tiers imaginarisé
Une perte de temps
C’est alors qu’en 94 il amène ce terme du tiers analytique, d’où d’ailleurs il a prélevé un morceau pour la Revue française de psychanalyse [15]. Ce qu’il appelle le tiers analytique, c’est l’espace commun des deux subjectivités réciproques, en tension dynamique, c’est-à-dire entre lesquelles il y a des échanges. C’est, d’une façon très explicite, la relation a – a’ prise dans la même parenthèse et conçue comme le lieu de l’Autre, terme de Lacan. Ce n’est pas ce qu’il dit, mais cela se laisse lire, sans forçage, de cette façon.
(a− a')
Le grand Autre d’Ogden, c’est la liaison interactive de a – a’. Ce n’est donc pas excessif de dire qu’on a là une conception imaginarisée du tiers, de l’instance tierce.
Qu’est-ce que cela donne dans la pratique ? L’impression que l’on perd beaucoup de temps dans l’expérience analytique.
Voilà Madame B., une dame active de quarante-deux ans, avocate, qui a des enfants. Cela fait trois ans qu’il l’a en analyse et il dit : « Sa demande n’est vraiment pas claire, cela me laisse un malaise, et, chaque fois qu’elle se présente à l’analyse, je me demande ce qu’elle vient faire ici. »
Il a ainsi laissé la demande absolument dans le flou. On doit supposer en effet que, dans cette notion de grand Autre imaginaire, il ne faut surtout pas y mettre trop du sien, qu’une notion de passivité doit être incluse là. Il ne faut pas amorcer le processus, il faut en quelque sorte que ça vienne des deux ensembles.
Ce qui se dégage au bout d’un an et demi d’analyse, c’est que la patiente est très occupée par la jalousie de sa mère, qui aurait été et qui serait toujours jalouse des signes de faveur que la patiente peut recevoir de son père, et qu’il lui est aussi très difficile dans son métier d’accepter que des femmes plus âgées lui apprennent quelque chose.
Au bout de deux années d’analyse, vraiment elle n’en peut plus. Silence, longs silences. La durée est invariable, et quand le patient se lance dans le silence, cela dure. Elle n’arrive pas à élaborer, elle se sent épuisée, désespérée. C’est alors que commence à s’amorcer la dialectique intersubjective, parce que, l’analyste, ça le déprime.
Il décrit là la propre dépression qu’il a engendrée avec sa pratique.
Il se décrit lui-même à un moment où il a la grippe. On se dit que c’est la faute de la patiente. C’est en tout cas quand il reçoit cette patiente qu’il est plus conscient de son état physique qu’avec d’autres, qui le distraient – je le suppose. Il lui vient de se sentir un très vieil homme. Il faut imaginer ça. L’analyste se déprimant progressivement, la patiente désespérée et l’analyste dans le trente-sixième dessous. Il a un sentiment d’anxiété diffuse, il est en retard aux séances – c’est très joliment dit de one minute or so. En plus, il commence à avoir des symptômes – nausées, malaises, vertiges.
Je ne dis pas tout cela pour faire rire. Pas du tout. Je le dis pour essayer de recevoir de ce texte la notion de la pratique qu’il expose.
Il lâche une interprétation. On ne sait pas s’il le fait périodiquement, mais il lâche une interprétation.
Il faut voir que tous ces comptes rendus, chez Renik, mais surtout chez Ogden, se resserrent toujours à un moment pathétique. Il y a une présentation d’ensemble qui est généralement assez floue. On sent bien que dans le a – a’, il n’y a pas d’instant de voir mais un long temps pour comprendre, un peu immobile. Cela engendre toujours un malaise chez le patient qui se transmet à l’analyste. Il y a en quelque sorte à ce moment-là une séance où cela se dénoue, où quelque chose se passe. Une scansion le déborde et s’élabore à partir de cette temporalité intersubjective.
Il lui dit donc : « Vous vous inquiétez de votre valeur comme mère » – elle avait témoigné de sa difficulté à élever ses enfants – « aussi bien que comme patiente ».
Ce n’est pas ça qui fait de l’effet. Qu’est-ce qui fait de l’effet ? L’analyste a soif. Il veut boire un verre d’eau qu’il a posé tout près de son fauteuil par terre. Il se penche pour attraper son verre d’eau. Et à ce moment-là, première fois depuis trois ans, la patiente se retourne. Elle le regarde, with a look of panic. Voyez dans quelle atmosphère cela se déroule. - « Mais pourtant parfois avant je bougeais un petit peu et ça ne lui faisait pas ça. » Elle : « I am sorry. Je ne sais pas ce qui vous arrivait. »
Voilà à quoi conduit le a – a’ fusionné. Elle fait ce pas de lui dire ça et l’analyste arrive enfin à nommer « la terreur qu’il portait en lui depuis quelque temps ». Il avait des symptômes, des vertiges. C’est parce qu’il était terrifié en son fond, et il s’aperçoit que cette terreur c’était l’idée que tous ses symptômes étaient causés par Madame B. et qu’elle était en train de le tuer – she was killing me.
Tuer l’analyste
Dans cet échange dialectique réciproque, she caused, elle causait mes symptômes. Là, la fonction de la cause est tantôt du côté de l’analyste et tantôt du côté de l’analysante. C’est une fonction alternative qui n’est pas fixée une fois pour toutes comme sur les schémas de Lacan.
Au moment où il éprouve tout ça, qu’il peut nommer sa terreur, il en profite pour lui faire une interprétation de première : « Vous pensiez à l’instant que j’étais en train de mourir. » Puisque lui s’est aperçu qu’il pensait qu’elle était en train de le tuer – she was killing me –, alors il peut lui faire l’interprétation : « Vous avez pensé que j’étais en train de mourir. » Elle lui dit : « C’est tout à fait vrai, en vous entendant bouger j’ai cru que vous aviez une attaque. » Là, c’est l’illumination. Tout cet interplay pour arriver enfin à une interprétation qui dit quelque chose à la patiente.
Maintenant, il peut en faire la théorie. – « À ce moment-là, je suis devenu pour elle un objet analytique. » Il dit qu’à ce moment-là il a été petit a. C’est un phénomène intersubjectif où ce qui éprouve et ce qui pense, c’est le tiers.
« Nous avions en commun la pensée que si cette personne arrivait à se libérer de ses symptômes et à naître, cela me rendrait malade et pourrait même me tuer. »
Après deux ans d’analyse terminés, dans la troisième année, la patiente peut venir à prendre en considération que sa mère n’aurait pas voulu avoir des enfants. Elle arrive à donner sa valeur au fait d’avoir été un enfant non-désiré. Cela s’est poursuivi pendant toute son enfance, il ne fallait pas déranger le père dans son bureau qui se livrait à des travaux universitaires.
C’est la première fois, au milieu de la troisième année, et parce qu’elle s’est retournée quand il prenait son verre d’eau sur le plancher, que s’ouvre un nouvel espace. Il produit la première interprétation qui fait de l’effet. D’ailleurs, les deux s’en aperçoivent. L’analyste formule : « Pour la première fois, j’ai senti qu’il y avait deux personnes dans la pièce qui se parlaient l’une à l’autre. » C’est une première fois pour lui et c’est une première fois pour elle, et à ce moment-là l’analyse connaît un nouveau développement.
Cela permet en particulier à l’analyste de changer son style, de s’ouvrir un peu plus à celui de la patiente. Il s’aperçoit qu’il restait identifié à son propre analyste, que c’était par identification à son propre analyste qu’il se sentait un très vieil homme, et que, pour analyser, il lui fallait tuer en lui ce vieil homme. Comment, nous, lisons-nous cela ? Il faut vraiment savoir gré à l’auteur de livrer ce détail de sa pratique, alors que les analystes français sont de façon générale, plus discrets. On ne peut s’empêcher de le traduire dans ces termes que, pendant deux ans et demi, il n’a donné aucune interprétation, aucune scansion, de la position de la patiente en tant qu’enfant non-désiré, et elle s’est en effet mise, dans son silence, à présenter ça. Il a fallu qu’elle le vive, qu’elle régresse, qu’il l’éprouve, pour qu’enfin une parole de vérité surgisse. Plutôt que de tirer comme conséquence de cette affaire qu’il était possible de sortir ça beaucoup plus tôt, à la place de l’interprétation juste, dont il n’a même pas le concept, il a éprouvé que lui devait mourir, que lui était de trop.
Nous pouvons tout à fait accepter la véracité de ces phénomènes qui sont là rapportés, de cette corrélation. Pourquoi mettre en doute le témoignage ? Mais ils appartiennent à cette dimension qui n’est pas dialectique, mais de réciprocité imaginaire. La grande surprise pour Ogden, c’est la vérité sortant de la réciprocité imaginaire. Ils s’aperçoivent qu’à partir du moment où c’est toujours interprété, c’est la voie imaginaire vers l’interprétation juste.
On n’a pas à mettre en doute que, dans la dimension imaginaire, on a ces phénomènes de coïncidence saisissante, et qui sont extrêmement coûteux du point de vue émotionnel aussi bien pour la patiente que pour l’analyste. Si vraiment Time is money, comme ils le pensent, nous autres pensons avoir les moyens d’arriver à ce point-là plus vite et d’une façon plus économique.
4. Un théoricien du couple
Flexibilité et radicalisme
Renik, c’est autre chose. Cela s’oppose très bien à ça. C’est le théoricien du self-disclosure, la révélation qu’accomplit l’analyste auprès du patient. Il dit des choses de lui. On pense évidemment à Ferenczi, dans l’histoire de la psychanalyse, et à l’analyse mutuelle. C’est ici une protestation contre l’orthodoxie du « Je ne suis personne ». C’est une pratique qui s’inscrit en faux contre la rigidité de l’analyste orthodoxe, dont nous n’avons plus vraiment tout à fait l’idée ici. Il ne faut pas se précipiter à penser qu’il s’agit d’une pratique de confession continuelle. Cela ne nous est en tout cas pas présenté ainsi. Cela prétend même avoir l’ambition de retrouver quelque chose de la pratique de Freud. C’est une pratique anti-formaliste de la psychanalyse, qui souligne que les principes de la technique ne sont pas des règles absolues mais des directions générales que l’on doit adapter au cas par cas. Il y a tout un discours sur la flexibilité de l’analyste qui a en effet l’air d’être adressé à des communautés analytiques – ils le mettent au pluriel, ils ne disent pas la communauté mais des communautés analytiques – qui sont au contraire élevées, éduquées dans le style impersonnel, rigide, de la position standard de l’analyste.
C’est un effort vers la flexibilité, ce que Lacan appelait discrètement jadis « la vacillation calculée de la neutralité », qu’il est obligé de défendre d’une façon très active et polémique dans un environnement qui n’est pas le nôtre. On sent qu’il a à faire accepter ce qui est déjà pour nous un combat dépassé. Il ne faut pas immédiatement penser qu’il s’agit pour l’analyste, dans ce self-disclosure, de raconter sa vie. Il s’agit à l’occasion de répondre à des questions de l’analysant sur ses opinions.
D’un côté, flexibilité, mais de l’autre, un radicalisme. Pour lui, ce n’est pas s’autoriser un petit self-disclosure quand on ne peut pas faire autrement, mais c’est une partie constitutive de l’expérience analytique. Il faut se laisser connaître par le patient. Avec des recommandations assez strictes, abandonner le piédestal analytique, se mettre sur le même plan que le patient – levelling the clinical analytic play in the field. Il n’y a plus l’analyste en haut et l’analysant en bas, mais les deux participants au même niveau.
J’en étais resté à l’article de 99, « Jouer cartes sur la table » [16], où il conteste que ce ne soit qu’un effet contemporain. Il vise la collaboration des deux. Il pense que l’analyste doit se refuser à être un objet mystérieux et que cette attitude libérale ne provoquera pas un désir insatiable du côté du patient d’en savoir toujours plus sur l’analyste.
Tel que c’est exposé, il y a toute une dimension où, non seulement ce n’est pas absurde, mais cela traduit d’une façon raisonnable une position qui consiste à ne pas faire le mystérieux. Il dit : « Si l’analyste ne répond pas à une question qui le concerne, le risque est que le patient conclue que l’analyste n’est pas vraiment intéressé par ses réflexions. »
Par exemple, il est amené à annuler une séance au dernier moment parce qu’il a mal à la gorge. Il téléphone à la patiente : « Je ne peux pas vous recevoir. » Il ajoute : « J’ai mal à la gorge, ce doit être un virus, ce n’est pas grave, cela devrait être fini demain .» Pour l’orthodoxie américaine, c’est vraiment du disclosure absolument encombrant.
C’est à considérer au cas par cas. Nous ne considérons pas que c’est une aberration de Renik, devant annuler très peu de temps avant, d’entourer cet énoncé de ces propos. Il en fait peut-être beaucoup. On croirait qu’il parle à sa maman. Il discute lui-même la chose : « La plupart des analystes diront qu’il ne fallait pas dire ça, mais laisser les fantasmes venir. » Il ajoute : « Ils sont venus de toute façon. » En effet, la patiente vient le lendemain : « Oh ! quand vous m’avez dit ça, j’étais tellement furieuse que j’ai pensé "qu’il meure ! " ». Il commente : « Les associations hostiles sont venues de toute façon. Je n’aurais rien dit, elle aurait pensé "il va mourir". »
Self-disclosure
J’ai trouvé ça assez sympathique. On entend déjà les impeccables de l’IPA : « Jamais ! Comment avez-vous pu dire "j’ai un virus" ? » On se demande ce qu’ils font quand ils ont un rhume. Comme dit Renik, ce disclosure est là de toute façon.- « Camarades analystes, tout ce que vous faites vous révèle. L’expérience analytique est impensable sans le self-disclosure. »
C’est la dimension raisonnable de Renik. Il accepte, il ne demande que ça, de mettre la barre sur l’Autre, comme nous disons dans notre jargon. Quand il s’agit de l’Autre du savoir, de l’Autre de la puissance, il accepte très bien A barré. C’est d’ailleurs un trait commun de cette École. Il cherche à contourner le discours du maître et à le faire disparaître dans l’expérience analytique. Ce qui, même si l’on rit ici et là, traduit un mouvement qui est plutôt sympathique. Ce dont Renik pense venir à bout avec son attitude, c’est aussi bien de l’Autre du désir. Son idée de jouer cartes sur table, c’est la même métaphore, mais utilisée à l’envers, que celle de la partie de bridge que Lacan utilisait dans « Variantes de la cure-type » et dans les premiers temps de son enseignement, où justement l’analyse se joue alors que l’analyste garde dissimulée sa propre main pour que le patient apprenne à lire la sienne en déchiffrant celle qu’il prête à l’Autre. C’est la fonction du désir de l’Autre, déjà présente au début de l’enseignement de Lacan, qui suppose justement que l’analyse ne se joue pas du tout cartes sur table, que l’on ne peut pas mettre les cartes sur la table. On voit bien la barre sur l’Autre du savoir, sur l’Autre de la puissance. Mais sur l’Autre du désir ? Alors qu’il constate lui-même que le désir se fraye la voie, quoi qu’il en ait. Il s’aperçoit que la barre sur l’Autre est une condition pour l’engagement du sujet dans l’expérience, mais A barré est pour lui équivalent au sujet barré.
La seule façon qu’il connaît de mettre cette barre sur l’Autre, c’est de faire de l’analyste un sujet de l’inconscient. Cela va assez loin : « Dans l’expérience analytique, le patient joue le rôle de consultant pour l’analyste. » Il lui indique ses erreurs, ce qui ne va pas, il est donc équivalent à un consultant. Il y a certes l’auto-analyse, le contrôle, mais personne ne peut aussi bien contrôler l’analyste que son patient. Le patient « est dans la position d’offrir une consultation dans l’instant même et sur la base d’une information qu’il est seul à avoir ». Il parle de « the patient’s rote as the consultant to the analyst and uniquety informed in the moment ».
Il est moins prodigue en exemples détaillés que ne l’est Ogden, mais il donne un aperçu de ce que cela doit être lorsqu’il dit qu’il admet que son style tend à l’activisme et à l’exhibitionnisme et qu’il a tendance à s’expliquer excessivement auprès de ses patients. Il admet, puisque tel patient le lui a enseigné, que cela peut aussi bien produire une idéalisation.
Si j’avais à les mettre en place, je dirais l’un théoricien du tiers, Ogden, et l’autre théoricien du couple, Renik.
Abrasement de la clinique
Ce qui fait vraiment de Renik un théoricien du couple et pas du tiers, c’est qu’il souligne : « C’est là comme un mérite des analystes français d’être sensibles au thème de la subjectivité et surtout à ses conséquences pour la pratique. » Il cite Lacan, en 99, en disant qu’il n’a peut-être pas réussi à surmonter le problème, mais il l’approuve d’avoir souligné que l’analyste est facilement impliqué dans la situation analytique en tant que sujet supposé savoir. Ce qu’il comprend, c’est que l’analyste doit se refuser à s’identifier au sujet supposé savoir. En conséquence, « les analystes français qui ont été influencés par Lacan font spécialement attention à respecter le caractère privé du point de vue épistémologique de la réalité psychique du patient, the epistemological privacy ». On ne sait pas ce qu’il y a dans la tête de l’autre.
C’est très différent d’Ogden qui éprouve, lui, dans un moment de coïncidence formidable. Alors que chez Renik, il y avait l’idée que chacun est de son côté et que dès lors l’interprétation n’est pas un énoncé de vérité qu’assène l’analyste au patient. Il pratique l’interprétation à l’ancienne – voilà ce qui se passe, c’est ceci et c’est cela. Il approuve les lacaniens de se servir de l’interprétation comme des stimuli pour favoriser la recherche du patient. Il souligne à quel point il serait utile que les analystes américains s’en aperçoivent, qu’on l’a perdu de vue aux USA, et qu’il serait surtout important de ne pas se prendre pour le sujet supposé savoir. Autrement dit, un théoricien du tiers, de la fusion du couple imaginaire, alors qu’on a là une théorie du couple dont les éléments restent séparés, et la self-disclosure c’est justement parce que ce n’est pas la même chose.
Si l’on voulait écrire Renik de la même façon, on mettrait aussi aa mais avec une double barre de séparation entre les deux.
a//a'
Pour l’un comme pour l’autre, à part ça, ce qui a lieu dans la séance les interroge. Leur horizon, c’est la séance et ce qui a lieu dedans. Ogden a une très belle formule, qui me paraît valoir pour les deux : « La question qu’il faut poser, dit-il en 99, n’est pas "qu’est-ce que ça veut dire ? " » – comme on se pose la question traditionnellement à propos du symptôme, du rêve, de l’acting out –, « la question analytique c’est What’s going on here ?, qu’est-ce qui est en train de se passer ici ?». Ici, et non pas ce qui se passe chez le patient. On ne se pose plus la question de ce que veut dire une formation de l’inconscient ou de ce qui est en train de se passer chez le patient. On voit bien que l’effet en est un abrasement de la clinique et de son objectivité. En se posant la question What’s going on here ?, ce qu’il rencontre comme objet primaire, c’est ce qui se passe chez eux. Sur le mode de la fusion chez Ogden, sur le mode de la séparation épistémologique chez Renik, mais le premier objet auquel ils ont affaire dans l’expérience analytique, c’est ce qui se passe en eux, c’est le contact direct avec leur corps, leur mind, leurs pensées, leurs comportements.
En effet, dans leurs articles, et sans doute dans leur pratique, ce qui occupe toute la place, ce ne sont pas des fragments d’autoanalyse, mais des fragments d’introspection. Il y a une enflure de l’introspection, qu’ils présentent à l’occasion comme autoanalyse et qui se poursuit durant la cure. Pour l’un comme pour l’autre, les cures qu’ils peuvent conduire les éclairent sur leur inconscient. C’est une pratique qui les intéresse, qui les passionne, parce qu’ils ont construit la chose de telle sorte qu’ils font leur analyse pendant l’analyse du patient, et avec l’analyse du patient.
Si la garantie psychanalytique voulait dire quelque chose dans un groupe analytique, cela devrait plutôt être la garantie que « votre analyste ne fera pas son analyse en même temps que la vôtre ».
IV – Retour à Lacan
1. Le rasoir de Renik
Je me propose de faire retour à Lacan à partir de ce que nous voyons s’être développé dans la psychanalyse, si l’on remonte à l’origine, sur le fondement du contre-transfert. Ce que nous voyons
fleurir depuis quelques années aux États-Unis sous les espèces de ce courant qui est interpersonnel, interactif et intersubjectif. Dans le même numéro du Psychoanalitic Quaterly où nous trouvons l’article de Miller, Kernberg, validant ainsi par sa présence cette entreprise comme psychanalytique, construit un grand panorama : « Il y a le courant principal, le mainstream », qu’il bricole et synthétise, « et puis il y a le courant intersubjectif ». Il reconnaît pour la première fois à ce courant intersubjectif la dignité d’être l’alternative au courant majoritaire américain. C’est à la fois un courant radical – c’est vraiment le rasoir qui passe sur les élaborations psychanalytiques d’un siècle – et en même temps un courant distinct du courant majoritaire.
L’existence de ce courant radical, dynamique, est la conséquence logique du tournant du début des années 50, lorsque le contre-transfert a été considéré comme la boussole nécessaire à orienter la direction de la cure. C’est alors qu’un pas a été fait, celui de tenir le psychanalyste à l’instar du psychanalysant comme un autre sujet. C’est pourquoi ceux qui font du psychanalyste, du thérapeute, un objet malléable, me semblent appartenir à une autre direction, et que Lacan, lui, a recyclée.
L’intersubjectivité, que nous voyons aujourd’hui se développer, était en germe dans le contre-transfert. En effet, que veut dire sujet dans cet usage ? Cela veut dire sujet à l’inconscient, sujet muni d’un inconscient, et c’est en tant que sujet de son inconscient que le psychanalyste a été impliqué dans l’expérience à partir des années 50, à partir de Paula Heimann. C’est à ce titre que le contre-transfert a été conçu comme la voie d’accès privilégiée à l’inconscient du patient. Les résultats que nous voyons aujourd’hui, c’est celui du contre-transfert conçu comme la voie royale d’accès à l’inconscient. Non pas le rêve, mais le contre-transfert comme voie royale.
Le contre-transfert est apparu dans un temps logique de l’histoire de la psychanalyse. C’est vraiment une scansion logique que l’on peut vérifier justement parce que, dans le même temps, Lacan commence son enseignement et trouve une autre voie d’accès. Le contre-transfert est apparu comme le témoin de la communication qui s’effectue dans l’expérience analytique. Une fois Freud disparu, qui était lui, par son énonciation, cette boussole déboussolante, il y eut une scansion logique au moment où les analystes ont tenté d’élaborer un instrument pour la direction de la cure, que les préoccupations de Freud ne leur exposaient pas d’une façon maniable. Ses textes sur la technique psychanalytique étaient déjà anciens et, d’une certaine façon – c’est rétrospectif –, lorsqu’il a amené la seconde topique, il n’a pas amené en même temps tous les éléments de la technique qui allaient avec.
Les analystes, à part Lacan, ont trouvé dans le contre-transfert le témoin, la preuve, la vérification de ce qui se communique dans l’expérience analytique. Dans cette perspective – c’est tout un, entre 1951 et 2001 –, la communication s’effectue globalement par une voie directe, immédiate et vécue, c’est-à-dire de l’ordre de l’affectif. C’est surtout marqué chez Ogden. Renik, avec ses textes si simples, est plus complexe. Quand Ralph [17] vient exposer son problème, il souligne qu’il se sent incapable d’agir et Renik lui dit : « C’est comme si vous aviez besoin de me demander à moi, ou à une autorité, la permission, et personne ne pourra le faire à votre place. » C’est une leçon de rasoir de Renik qu’il donne à son patient : « Faites cela vous-même, ne faites pas confiance à quelque autorité que ce soit. »
C’est d’ailleurs le côté plein d’allant d’Owen Renik lui-même, qui bazarde les constructions analytiques. On a là une butée interprétative. Mais, essentiellement, la communication telle qu’elle a été conçue à partir des années 50 est une communication de l’ordre de l’affectif. Le psychanalyste éprouve, s’imprègne de l’atmosphère de l’expérience, et il est avant tout qualifié par une passivité, une réceptivité essentielle, qui l’amène à une coïncidence avec l’inconscient du patient. On en a eu l’exemple avec l’article d’Ogden. C’est à l’acmé de cette coïncidence qu’est susceptible de se produire l’interprétation juste, la parole inédite d’où s’obtient une révélation de vérité.
2. Le mur du discours
Si nous faisons retour à Lacan sur cette base, en ayant un peu animé cette communication directe, vécue et affective, il est clair que, pour lui et ceux qui s’en inspirent, il s’interpose toujours quelque chose entre l’analyste et le patient venant gêner la communication affective. Ce qui s’interpose, et qui leur apparaîtrait sans doute comme un mur, c’est le discours, la fonction de ce qui se dit. Voilà l’élément qui se trouve finalement soustrait, effacé, dans la psychanalyse du contre-transfert, parce que l’expérience y est avant tout le moyen de l’affect qui se communique.
Il faut s’apercevoir qu’en même temps que Paula Heimann lance, avec un tout petit article, en 1951, le contre-transfert comme la nouvelle boussole de l’expérience analytique – ce qui va rouler pendant un demi-siècle jusqu’à nous amener ces derniers produits –, nous avons à la même date un texte de Lacan, exactement contemporain, qui porte sur le cas Dora, « Intervention sur le transfert ». À le relire à partir de ce que nous avons appris, nous nous apercevons qu’il met spécialement en valeur le contre-transfert.
Lacan, en même temps que Paula Heimann fait son texte, met l’accent sur le contre-transfert de Freud dans le cas Dora. Il écrit par exemple : « Freud, en raison de son contre-transfert, revient trop constamment sur l’amour que M. K. inspirerait à Dora. » Pour comprendre vraiment cette phrase, il faut penser que, simultanément, il y a l’article de Paula Heimann – il y a même eu Racker un petit peu avant –, et je supposerai que cela participe de cette agitation d’après la guerre sur le contre-transfert, dans les milieux kleiniens, avec lesquels Lacan était en rapport.
Si on lit ainsi « Intervention sur le transfert », c’est vraiment ce qui nous donne l’angle que va prendre l’histoire de la psychanalyse pendant cinquante ans. On voit là le partage des eaux s’accomplir. Ce n’est pas seulement une intervention sur le transfert, mais une intervention sur le transfert et sur le contre-transfert. Sont en effet déjà en jeu à ce moment chez Lacan, simultanément, le thème du contre-transfert et celui de l’intersubjectivité, puisque Lacan définit, dans ce texte, l’expérience analytique comme se déroulant tout entière dans le rapport de sujet à sujet. C’est un thème qui est tout à fait présent dans ses écrits d’après la guerre, définir l’expérience analytique à partir du rapport de sujet à sujet, c’est-à-dire de l’intersubjectivité. D’où l’intérêt de le relire avec ce que nous savons maintenant, et voir d’emblée comment Lacan dispose et articule contre-transfert et intersubjectivité à ce point de départ.
Le trait essentiel est le suivant. C’est saisissant. Il ne loge pas du tout le contre-transfert dans l’intersubjectivité. Il ne dit pas : « Puisque l’expérience analytique est une expérience qui va d’un sujet à un autre sujet, puisqu’on repère le transfert chez le patient, il y a donc le contre-transfert chez l’analyste. » Absolument pas. Il ne rabat pas du tout le contre-transfert sur l’intersubjectivité, mais structure au contraire le cas Dora de façon à disjoindre intersubjectivité et contre-transfert. Voilà presque la formule du texte. D’un côté, il réécrit le cas à partir d’une série de renversements dialectiques, chacun induit par une interprétation et suivi d’un nouvel insight pour la patiente – ce qu’il appelle un développement de la vérité. D’un côté, il y a une série de renversements dialectiques et, de l’autre côté, il y a ce qui est de l’ordre du transfert et du contre-transfert qui, loin d’obéir à cette dialectique, est au contraire situé comme ce qui fait obstacle au processus dialectique, qui empêche Freud exactement d’apporter à sa patiente Dora l’interprétation qui lui aurait permis de reconnaître dans Mme K., et non pas dans M. K., l’objet réel de son amour.
Il situe le contre-transfert, classiquement, de façon négative – c’est vraiment s’inscrire directement en faux contre l’article de Paula Heimann –, comme la somme des préjugés, des embarras, voire de l’insuffisante information de l’analyste à tel moment du procès dialectique, de telle sorte que, s’il en admet le terme, il ne fait pas du tout du contre-transfert un terme relatif au transfert du patient, tel qu’il le définit. Il situe le contre-transfert – c’est ainsi qu’il loge ce terme qui s’impose dans le débat psychanalytique contemporain de ce texte – comme préalablement constitué chez l’analyste. Le contre-transfert, c’est le nom de l’insuffisance de l’analyste à apporter l’interprétation qui conviendrait, celle qui permettrait à la dialectique de se poursuivre. C’est au point même qu’il glisse dans une phrase énigmatique, mais dont on voit bien que le sens est de bloquer le mouvement Paula Heimann, que c’est le transfert de la patiente Dora qui lui apparaît comme une entité toute relative au contre-transfert de Freud.
Il bloque tout à fait la voie du contre-transfert comme boussole de l’expérience, puisqu’il dit que le contre-transfert de Freud est préalablement constitué – c’est la somme de ce qu’il ne sait pas, de ses passions, de ses préjugés –, c’est déjà là. C’est au contraire le transfert de Dora qu’il voit comme relatif au contre-transfert de Freud. C’est dire de la façon la plus claire que le sillon qu’il est en train de tracer ne passe pas par le contre-transfert.
3. Contre le transfert
Il formule une thèse qui prend d’emblée le contre-pied de ce qui se développera par la suite dans la psychanalyse. La thèse comme quoi le transfert est relatif au contre-transfert, ce n’est absolument pas ce que Lacan va développer par la suite, mais cela se comprend, au moment où il le formule, dans l’intertextualité avec Paula Heimann. Il établit entre contre-transfert et transfert une relation réciproque mais orientée et qui est antidialectique. Elle relève d’une intersubjectivité, mais faussée, dégradée, corrélative d’un moment de stagnation de la dialectique, d’un point mort.
C’est au point que c’est non seulement le contre-transfert qui est ici mis en question par Lacan, qui est soupçonné ou stigmatisé, mais le transfert lui-même.
Son « Intervention sur le transfert », c’est une intervention contre le transfert. Ce n’est pas le contre-transfert, c’est contre le transfert. Il stigmatise en effet le transfert au titre de répétition, dans une formule que j’avais jadis soulignée comme étant une esquisse du mode-de-jouir. Il qualifie le transfert de « l’apparition des modes permanents selon lesquels le sujet constitue ses objets ». C’est un élément de répétition. Quand il y a transfert, le sujet répète et reproduit la constitution de son partenaire-symptôme.
Là où Lacan en est à ce point de départ où tout se joue, cette constante qui apparaît et qui s’isole comme telle du mouvement dialectique de la cure, de la recherche de la vérité, est nécessairement dévalorisée. Si je voulais employer la même formule, je dirais que nous avons à ce point l’apparition chez Lacan du mode permanent selon lequel il conçoit l’expérience analytique, comme le lieu d’un conflit entre inertie et dynamique. Il situe le transfert même du patient comme un élément qui relève de l’inertie répétitive. Je dis que c’est le mode permanent selon lequel il conçoit l’expérience analytique, parce qu’au fil des années il ne cessera pas de répartir ces termes ou dans le registre de l’inertie ou dans le registre du progrès de la cure.
Pour valoriser encore ce texte et inviter à le relire, je noterai que, parce qu’il fait du transfert essentiellement ce blocage de la dialectique, il formule exactement : « Le transfert n’est rien de réel dans le sujet » [18]. C’est tout de même frappant de voir que, bien plus tard, dans la Proposition de la passe, en 1967, c’est le même terme qui reviendra s’agissant du sujet supposé savoir : « Le sujet supposé savoir n’est pas réel » [19].
Un autre terme se retrouve et montre le mode permanent selon lequel il approche l’expérience analytique. Déjà en 1951, le soupçon porté sur le transfert appelle le terme de leurre : « Interpréter le transfert, c’est remplir par un leurre le vide de ce point mort ». Le même terme de leurre se retrouve à propos de l’acte analytique dans son « Compte rendu du Séminaire de L’acte psychanalytique », où il dit que l’analyste est amené « à supposer le leurre même qui pour lui n’est plus tenable » [20].
Je ne donne cette ponctuation que pour marquer que nous avons là une continuité qui pose que, pour Lacan, l’analyste dans la cure joue d’un leurre utile. Il rêve de compléter le cas Dora et « même si le leurre est trompeur, il relance le procès ». Il invente l’interprétation que Freud aurait pu formuler à Dora à partir de l’erreur de son contre-transfert. Il n’avait qu’à lui dire : « Vous m’imputez les mêmes sentiments, les mêmes intentions que M. K... » Et il invente : « Cela aurait été faux mais Dora s’y serait opposée et cela l’aurait engagée dans la bonne direction, qui l’aurait conduite à l’objet de son véritable intérêt. » De la même façon, lorsque Lacan sortira de sa poche le sujet supposé savoir qui va rouler dans la psychanalyse jusqu’à arriver dans l’intersubjectivité même, eh bien c’est encore au titre d’un leurre utile dans la cure. Lacan fait du sujet supposé savoir un leurre qui est de structure dans la cure, celui qui fait croire que l’inconscient est déjà là.
Au moment même où le contre-transfert commençait sa carrière dans la psychanalyse, Lacan pouvait déjà définir la psychanalyse comme « une pratique qui se fonde sur l’intersubjectivité ». C’est une intersubjectivité fort différente de celle qui fait la référence du courant intersubjectif américain, puisqu’elle est dédoublée. C’est pourquoi, chaque fois que nous lisons ces textes américains, nous avons le sentiment que deux niveaux sont là constamment rabattus. Nous, nous dédoublons ces niveaux dans notre approche de la cure – une intersubjectivité réciproque et une intersubjectivité dialectique, une intersubjectivité imaginaire et une intersubjectivité symbolique. Lacan pouvait d’ailleurs déjà repérer chez Balint, dans les années 50, la référence qu’il prenait à une intersubjectivité réduite à une dualité d’individus. Ce qui se modèle sur le couple du stade du miroir. Rien de ce que nous lisons jusqu’après présent ne sort de cette dimension, c’est-à-dire qu’ils saisissent cette expérience analytique comme se déroulant dans le cas d’une relation de deux individus.
Cela nous fait voir, par contraste, l’appareil beaucoup plus complexe que nous apportons pour structurer l’expérience analytique, avec un certain effet d’étrangeté, parce qu’il y a aussi un certain effet de naturel dans la présentation de cette communication directe. C’est un appareil qu’il faudra défendre si l’on ne veut pas qu’il tombe sous le hachoir du rasoir de Renik. Il faudra montrer comment cet appareil est constitué et en quoi il est fondé d’arriver à l’expérience analytique avec l’ensemble de ce que nous traînons avec nous.
*Ce texte reprend les leçons des 6, 13, 20 & 27 mars 2002 de L’orientation lacanienne III, 4 (2001-02), enseignement prononcé dans le cadre du Département de Psychanalyse de Paris VIII. On se reportera aussi avec intérêt à la leçon suivante du 3 avril 2002, «Un médium malléable», Tabula n°8, Bulletin de l’ACF-Voie domitienne, novembre 2002, pp. 13-33. Texte et notes établis par Catherine Bonningue. Publié avec l’aimable autorisation de J.-A. Miller.
[1] J.-A. Miller a commencé à aborder le thème du contre-transfert en janvier et février 2002 dans une partie de son cours intitulée «Réflexions sur le moment présent». La première leçon en est accessible sur le site de l’ECF.
[2] Miller J.-A., «Qu’est-ce qu’être lacanien ?», Quarto n°74, Bruxelles, ECF, 2001, pp. 6-14.
[3] Miller J.-A., «Réflexions sur le moment présent», op. cit.
[4] Heimann P., Little M., Reich A., Tower L., Le contre-transfert, Paris, Navarin, Analytica, 1987.
[5] Miller J.-A., «Réflexions sur le moment présent», op. cit.
[6] Tower L., « Contre-transfert » {1955) in Heimann R., Little M., Reich A., Tower L., Le contre-transfert, op. cit.
[7] Miller J.-A., «Psychanalyse pure, psychanalyse appliquée & psychothérapie», La Cause freudienne n°48, Puis, diffusion Seuil, 2001, pp. 7- 35.
[8] J.-A. Miller fait référence à l’exposé de Ph. La Sagna à son cours du 6 mars 2002.
[9] Kernberg O., « Notes on Countertransference » (1965), J. Amer. Psychoanal. Assoc.,13.
[10] Ogden Th.,, «The Dialectically Constituted/Decentred Subject of Psychoanalysis. I. The Freudian Subject. II. The Contentions of Klein and Winnicott.» (1992), Int. Psycho-Anal., 73, pp. 517-525 & 613-625.
[11] Ogden Th., « On the Dialectical Structure of Experience: Some Clinical and Theoretical Implications », Contemp. Psychoanalytic., 24, pp. 17-45.
[12] Lacan J., «Au-delà du principe de réalité», Écrits, Paris, Seuil 1966, p. 258.
[13] «Réflexions sur le moment présent», op. cit.
[14] Cf. note 10
[15] Ogden Th., «Travailler à la frontière du rêve», Revue française de psychanalyse, numéro hors-série, Paris, PUF, 2001, pp. 133-142.
[16] Renik O., « Playing Ones Cries Face Up in Analysis : An Approach to the Problem of Self-Disclosure » 1999), Psych. Anal. Quaterly 64, pp. 521- 539.
[17] Renik O., «The Patient’s Experience of Therapeutic Benefit », (2001), Psychoanalytic Quaterly, LXX.
[18] Lacan J. «intervention sur le transfert». Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 225.
[19] Lacan J., «Proposition sur le psychanalyste de l’École », Autres écrits, Paris, Seuil, 2001, p. 249.
[20] Lacan J., «L’acte psychanalytique. Compte rendu du Séminaire 1967-68». Autres écrits, op. cit., p. 376.
-
Collez votre texte...