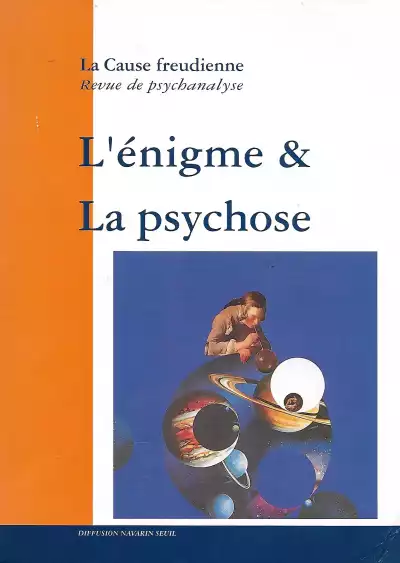-
Clinique ironique
Jacques-Alain Miller
Je me suis posé dans toute sa généralité le problème de la clinique différentielle des psychoses, et j’ai pensé clarifiant pour commencer de lui opposer une clinique universelle du délire[1]. Je propose à la clinique différentielle des psychoses, pour son fondement, une clinique universelle du délire. Rien de moins.
J’appelle clinique universelle du délire, celle qui prend son point de départ de ceci, que tous nos discours ne sont que défenses contre le réel.
Pour construire cette perspective clinique, il faudrait atteindre à l’ironie infernale du schizophrène, celle dont il fait une arme qui, dit Lacan, porte à la racine de toute relation sociale. La clinique universelle du délire ne peut trouver à se proférer, c’est-à-dire cesser de ne pas s’écrire, que du point de vue du schizophrène.
Comment allons-nous définir ici le schizophrène ? Je propose pour l’instant de le définir, après Lacan, comme le sujet qui se spécifie de n’être pris dans aucun discours, dans aucun lien social[2]. J’ajoute que c’est le seul sujet à ne pas se défendre du réel au moyen du symbolique, comme nous faisons tous quand nous ne sommes pas schizophrènes. Il ne se défend pas du réel par le langage, parce que pour lui le symbolique est réel.
Il s’agit de l’ironie du schizophrène, et non pas de son humour. Ironie et humour, les deux font rire, mais se distinguent par structure.
L’humour est le versant comique du surmoi, Freud le dit[3]. Le névrosé ne manque pas d’humour, le pervers en est tout à fait capable, également le philosophe de la maxime universelle[4], et aussi bien le surréaliste[5]. L’humour s’inscrit dans la perspective de l’Autre. Le dit humoristique se profère par excellence au lieu de l’Autre. Il saisit le sujet dans la misère de son impuissance. Songez à ce fameux humour juif qui se cultive au ghetto, ce lieu social par excellence puisque fait de ségrégation, où le Dieu terrible d’Abraham, Isaac et Jacob enferme ses enfants.
L’ironie au contraire n’est pas de l’Autre, elle est du sujet, et elle va contre l’Autre. Que dit l’ironie ? Elle dit que l’Autre n’existe pas, que le lien social est en son fond une escroquerie, qu’il n’y a pas de discours qui ne soit du semblant – titre d’un Séminaire de Lacan[6]. Le vrai masochiste atteint parfois à l’ironie, quand il fait la démonstration que l’Autre dont il se montre l’esclave, n’est que le guignol de sa volonté, à lui le masochiste. C’est par cette voie sans doute, que l’ironie convient au psychanalyste, non moins qu’au révolutionnaire. Lénine, comme Socrate, fait preuve d’ironie, même s’il la déguise au moyen de l’invective, et même si cette ironie pâlit quand il s’agit de sa cause[7]. L’ironie est la forme comique que prend le savoir que l’Autre ne sait pas, c’est-à-dire, comme Autre du savoir, n’est rien. Alors que l’humour s’exerce du point de vue du sujet supposé savoir, l’ironie ne s’exerce que là où la déchéance du sujet supposé savoir a été consommée.
C’est en quoi, selon Lacan, la psychanalyse, dans la voie prescrite par Freud, restaure l’ironie dans la névrose. Il serait formidable en effet de guérir la névrose par l’ironie. Si nous arrivions à guérir la névrose par l’ironie, nous n’aurions pas besoin de l’entretenir par la psychanalyse. Nous ne sommes pas encore guéris de la psychanalyse, en dépit de l’ironie de Lacan, et, sans aucun doute, de ce qu’était son vœu.
En attendant donc de guérir de la psychanalyse, le vœu que je forme est que notre clinique soit ironique.
Le choix est un choix forcé : ou bien notre clinique sera ironique, c’est-à-dire fondée sur l’inexistence de l’Autre comme défense contre le réel – ou bien notre clinique ne sera qu’une resucée de la clinique psychiatrique. La clinique psychiatrique est volontiers humoristique. Elle se moque souvent du fou, ce pauvre fou qui est hors discours. Mais se moquer du fou veut seulement dire que l’on construit sa propre clinique à partir des discours établis. Ce que je dis là n’épargne pas la clinique psychanalytique des psychoses quand celle-ci se borne à mesurer la psychose à l’aune du discours établi de l’analyste – cela veut dire la référer à la norme œdipienne. Je ne pointerais pas le doigt dans cette direction, si Lacan n’était allé dans sa clinique psychanalytique des psychoses, au-delà de la norme œdipienne. Il attend que nous l’y suivions. Ceci est de l’humour, bien entendu.
Dans ce que j’appelle la clinique universelle du délire, le schizophrène occupe une place que l’on pourrait dire d’exclusion interne. En effet, si le schizophrène est ce sujet pour qui tout le symbolique est réel, c’est bien à partir de sa position subjective qu’il peut apparaître que, pour les autres sujets, le symbolique n’est que semblant. La ronde des quatre discours distingués et formalisés par Lacan, est bien faite pour montrer qu’il n’y a pas de discours qui ne soit du semblant[8]. Et cette ronde elle-même, n’est concevable que sur le fondement du sujet hors discours.
J’appelle ici schizophrène, le sujet qui n’éviterait pas le réel. C’est le parlêtre[9] à qui le symbolique ne sert pas à éviter le réel, parce que ce symbolique lui-même est réel. S’il n’y a pas de discours qui ne soit du semblant, il y a un délire qui est du réel, et c’est celui du schizophrène. C’est de là que peut se construire l’universel du délire.
Remarquons que la thèse de l’universel du délire est une thèse freudienne. Pour Freud, rien n’est que rêve. C’est ce que Lacan dit que Freud dit. Si rien n’est que rêve, tout le monde est fou, c’est-à-dire délirant[10]. Voilà la thèse que je propose de mettre au fronton d’une clinique différentielle des psychoses : tout le monde est fou. C’est alors qu’il devient intéressant de faire des différences.
Tout le monde est fou – c’est-à-dire délirant – est une vérité qui appartient à la clinique différentielle de l’humanité et de l’animalité. Car les animaux ne sont pas fous, sauf l’âne, celui qui porte le Saint-Sacrement, et que cette charge, dont il attribue le mérite à sa personne, fait délire de présomption. Les animaux pourtant peuvent se suicider, pour peu que la domestication ait pour eux fait exister en l’Autre la cause du désir.
Simplifions. Le délire est universel du fait que les hommes parlent, et qu’il y a pour eux langage. Voilà l’abc d’où repartir : le langage a, comme tel, effet de néantisation.
En termes dialectiques, on dira : le mot est le meurtre de la chose. C’est une proposition du premier enseignement de Lacan[11]. Déjà tout est dit, car cela comporte que le symbolique se sépare du réel. Dans la perspective schizophrène, le mot n’est pas le meurtre de la chose, il est la chose.
C’est en ce sens que, si le psychotique ne croit pas à l’Autre, il est pourtant sûr de la Chose. Si vous savez entendre dans ce « la Chose », le das Ding freudien tel que ponctué par Lacan dans son Éthique de la psychanalyse[12], « le mot est le meurtre de la chose » veut dire : la jouissance est interdite à celui qui parle comme tel, ou encore, que l’Autre, comme lieu du signifiant, est le terre-plein nettoyé de la jouissance. Pour le paranoïaque, le mot n’est pas assez le meurtre de la Chose, puisqu’il lui faut à l’occasion frapper la Chose, le kakon[13], en l’Autre, dans un acte d’agression qui pourra lui servir, la vie durant, de métaphore, de suppléance, comme on le voit dans le cas Aimée[14]. Le mélancolique, c’est contre lui-même qu’il tourne l’effet mortifère du langage, dans l’acte suicide où il accomplit son destin de kakon.
« Le mot est le meurtre de la Chose » veut dire que le mot, c’est la mort. La « pulsion de mort », ainsi désignée par Freud, est inhérente au parlêtre. Sans doute le court-circuit mélancolique se rallonge-t-il chez le névrosé, dont le désir est moins décidé peut-être. Remarquons que la lettre se distingue du mot. L’instance de la lettre tue-t-elle la Chose ? Plutôt la lettre est-elle la Chose[15] ?
Ce que j’ai dit en termes dialectiques peut se dire en termes diacritiques, en passant de Hegel à Saussure[16]. Il n’y a pas de corrélation biunivoque du mot et de la chose : le mot ne représente pas la chose, le mot s’articule au mot. Cet axiome structuraliste n’est pas moins pathétique que le dit dialectique. Il implique une passion. Le seul fait, concernant le langage, de mettre la fonction de l’articulation à la place de la fonction de la représentation – comme fait le structuralisme[17]– a des effets parfaitement pathétiques de délire. Dire que le signifiant n’a pas rapport à la chose mais à un autre signifiant – on le répète comme une antienne – implique que le signifiant a une fonction d’irréalisation. Le signifiant irréalise le monde[18].
C’est seulement quand la relation du signifiant au signifiant est interrompue, quand il y a chaîne brisée, phrase interrompue, que le symbole rejoint le réel. Mais il ne le rejoint pas sous la forme de la représentation. Le signifiant rejoint le réel d’une façon qui ne laisse pas place au doute – voyez les phrases interrompues du président Schreber[19]. Dans la phrase interrompue, le signifiant ne représente pas le moins du monde le réel, il y fait irruption, c’est-à-dire qu’une partie du symbolique devient réel. C’est en quoi la « schizophrénie », telle qu’elle est ici redéfinie, peut être dite la mesure de la psychose.
Cette perspective ironique sur le langage, si je la recommande, c’est que, prendre les choses à l’envers de cette perspective, on voit où cela mène, par exemple à la théorie dite des descriptions, qui doit son nom à Bertrand Russel[20].
Russel commença cette théorie des descriptions en 1905, en même temps que Freud écrivait ses Trois essais sur la théorie de la sexualité. Il n’est pas excessif de dire que toute la philosophie anglo-saxonne contemporaine en procède. Cela se développe de nos jours sous le nom un peu ridicule d’ontologie formelle – il s’agit en même temps d’un héritage de la théorie médiévale des suppositions[21], dont Lacan lui-même s’est fait l’écho avec son sujet supposé savoir[22].
Cette théorie des descriptions s’occupe de la référence supposée du discours, ou, pour l’appeler par le nom que Frege lui a donné, de la Bedeutung[23]. Et quel est son souci ? Ce qui tracasse Bertrand Russel et les autres, c’est que l’on puisse parler de ce qui n’existe pas comme si ça existait. C’est la même question que Platon dans son Sophiste : que parler du non-être le fait exister en quelque façon[24]. La théorie des descriptions voudrait réduire la vérité à l’exactitude : que l’on dise seulement ce qui est, donc que le discours décrive le réel. Elle voudrait dépister le discours qui dit ce qui n’est pas. L’exemple princeps de Bertrand Russel est « Le roi de France est chauve »[25]. En 1905, et pour un Anglais – qui n’est pas royaliste français, il n’y a pas de roi de France. « Le roi de France est chauve » est délire. Évidemment il y a beaucoup de connotations autour de ce « roi de France est chauve», c’est un écho de la querelle franco-anglaise, ce n’est pas sans évoquer « le roi est nu ».
Ce qui échappe à Bertrand Russel, ce n’est pas que l’on puisse parler de ce qui n’est pas, mais que ce qui est, du seul fait qu’on en parle, devient fiction. Le roi de France existerait-il, sous les espèces d’un personnage qui porterait la couronne, il n’en serait pas moins une fiction. Ce qui est significantisé est du même coup « semblantifié ». Ça n’existe pas parce que l’on en parle. Alors il faut se taire, comme dit Wittgenstein[26]– ce dont on veut qu’il existe, il faut le taire. Et c’est ce que fait le psychanalyste dans sa pratique. La théorie des descriptions est vaine, non seulement parce que le roi de France n’existe pas, non parce que la parole fait exister ce qui n’est pas, mais bien parce que le langage fait inexister ce dont il parle.
L’axiome de Lacan que la vérité a structure de fiction, comporte que la parole a effet de fiction[27]. Le secret de la clinique universelle du délire, c’est que la référence est toujours vide. Si vérité il y a, elle n’est pas adéquation du mot et de la chose, elle est interne au dire, c’est-à-dire à l’articulation. En ce sens, le signifiant, en tant qu’il s’articule au signifiant, comporte que la référence est vide, et c’est ce qui constitue le symbolique comme un ordre, l’ordre symbolique comme Lacan l’a nommé. C’est le mouvement même qu’on observe chez Freud quand il passe de la séduction factuelle à la séduction fantasmatique, du fait au fantasme[28], de la recherche de l’exactitude à la scansion de la vérité, de l’inconscient comme savoir référentiel à l’inconscient comme savoir textuel.
La référence vide, comment l’incarner ? Rien n’est plus simple, si l’on se souvient que la clinique freudienne tourne toute entière autour d’un objet qui n’existe pas, à savoir le pénis de la mère. Le roi de France qui est chauve, c’est le pénis de la mère. C’est un fait que Freud a commencé par le rêve, qu’il a donné l’interprétation des rêves comme la voie royale de la psychanalyse, et qu’il a pris le rêve comme une articulation signifiante sans référence. C’est en cela que Freud a considéré le rêve comme une forme de délire. Et c’est aussi pourquoi Lacan ordonne toute sa clinique à un « il n’y a pas », que ce soit en l’écrivant par (-φ), ou en énonçant « il n’y a pas de rapport sexuel ».
Commençons par écarter tous les faits » dit superbement Jean-Jacques[29]. Une analyse débute ainsi. Tant que l’on n’y est pas, ce ne sont qu’entretiens préliminaires. « Associez librement, dites la vérité, allez-y franchement, n’omettez rien » veut dire : « Accolez le signifiant au signifiant sans vous préoccuper de la référence, de l’ontologie formelle ». Lacan réintroduit les termes qui devraient être proscrits, de représentation et de référence, mais ils changent de sens. Il y a représentation, mais en tant que le signifiant représente une référence nulle. Cette référence comme vide s’écrit comme la castration (-φ) ou comme ce qui se fait de la castration, à savoir le sujet, $. Le sujet de Lacan est en effet une entité non existante, celle qui motive et qui hante la théorie des descriptions.
Jusque-là, nous sommes encore dans l’espace freudien. L’idée d’une référence négative rend compte, à partir de la structure du langage, de l’importance pivotale de la castration freudienne. Mais ce qui est de Lacan à proprement parler, c’est l’introduction d’une référence de type nouveau, qui naît de l’articulation elle-même. Ce n’est pas une référence qui serait déjà là, et que l’on pourrait représenter, ou dont l’on pourrait dire « il n’y a pas ». Cette référence de type nouveau, née de l’articulation, c’est ce que Lacan a appelé « l’objet a ».
Comment, à quelles conditions, l’articulation signifiante produit-elle une référence ? De l’articulation, naquît un jour une référence... Il y a, en quelque sorte, une double référence. La première est négative, elle est absence, c’est (-φ), c’est $. Il y en a une autre qui est positive, et c’est a. C’est ce qui explique que, dans l’économie du discours de Freud, le fantasme puisse venir à la place du fait. Cela comporte que l’objet a, si c’est un être, est un être de fiction, qui dépend de l’articulation du signifiant. L’objet a est un semblant[30]. Si c’est un être, c’est un être qui dépend de la chaîne signifiante, et précisément de la consistance de celle-ci. Voilà pourquoi Lacan appelle l’objet a, une consistance logique. L’objet a est ce qui prend consistance quand on parle au fur et à mesure que l’on néantise. Donc, c’est aussi un reste, au sens de reste à dire. Mais il n’est pas le même quand une chaîne signifiante est développée, qu’à son départ.
Si a dépend de l’articulation signifiante, la seule ontologie formelle est celle de l’objet a. Pourquoi « ontologie » ? C’est que l’objet a, dans son repérage analytique, apparaît bien comme un être. C’est là, spécialement, qu’il est capital de ne pas le confondre avec le réel. L’objet a comme tel est un semblant d’être. Et le seul terme de consistance dit bien ses affinités avec l’imaginaire.
Sans doute, quand l’objet a trouve sa place dans le fantasme, le fantasme tient-il pour le sujet la place du réel. Cela ne veut pas dire pour autant que ce soit du réel. Le terme même d’axiome[31] que Lacan emploie concernant le fantasme, indique bien qu’il le place dans un système logique, et confirme que l’objet est dans la dépendance de l’articulation signifiante.
C’est pourquoi l’objet a en tant que semblant, a sa place entre le symbolique et le réel. C’est une consistance logique qui fait semblant d’être, et qui n’est que ce que l’on rencontre quand du symbolique on va vers le réel. L’objet a est une élaboration symbolique du réel qui, dans le fantasme, tient la place du réel, mais elle n’en est qu’un voile. Sa fonction propre est de complémenter la référence négative du sujet. L’objet a, comme consistance logique, est apte à incarner ce qui manque au sujet. C’est le semblant d’être que le manque-à-être subjectif appelle. C’est pourquoi l’objet a comme consistance logique, est propre à donner sa place à la jouissance interdite, à l’objet perdu.
Voilà qui nous permet de donner un sens nouveau à ce que nous appelons psychose. C’est là que Lacan nous emmène. La psychose est cette structure clinique où l’objet n’est pas perdu, où le sujet l’a à sa disposition. C’est en quoi Lacan pouvait dire que le fou est l’homme libre[32].
Du même coup, dans la psychose, l’Autre n’est pas séparé de la jouissance. Le fantasme paranoïaque implique l’identification de la jouissance dans le lieu de l’Autre. En court-circuit, nous pouvons faire valoir la différence de la paranoïa et de la schizophrénie – pour autant que le schizophrène n’a pas d’autre Autre que la langue – et faire valoir du même coup la différence de l’Autre dans la paranoïa et la névrose. Il y a l’Autre dans la paranoïa, et cet Autre est réel ; c’est-à-dire qu’effectivement l’Autre de la paranoïa existe, et qu’il est même gourmand de l’objet a.
On a beaucoup répété la métaphore paternelle et son échec dans la psychose. Pour la reprendre d’un autre biais, ne faut-il pas conclure de l’échec de la métaphore paternelle, que le désir de l’Autre, de la mère, n’est pas dans la psychose symbolisé, et que c’est pour ça qu’il est dans le réel ? Je dis : le désir de l’Autre dans le réel, et l’Autre avec lui, et la chaîne signifiante, le désir de l’Autre comme volonté de jouissance sans limite. Voie pour comprendre la connexion fondamentale entre la psychose et l’angoisse, et aussi bien la connexion de la psychose et de l’érotomanie suscitée chez l’Autre. Il y a l’Autre aussi dans la névrose, sauf que là, la meilleure preuve qu’il n’est pas réel, c’est qu’il faut le faire exister, par exemple en l’aimant. C’est ce qui se vérifie aux premiers pas de l’expérience analytique : le transfert veut dire qu’il s’agit de faire exister l’Autre, et cela, afin de pouvoir lui remettre la charge de la consistance logique de l’objet a. C’est ce que Lacan a appelé sujet supposé savoir. Faire exister l’Autre pour lui remettre l’objet a, fait de cet objet la cause du désir. La remise à l’Autre de l’objet, du même coup le fait, cet objet, perdu, et installe au cœur de la névrose, la demande – que ce soit demander à l’Autre l’objet qu’il recèle, ou se faire demander par l’Autre le règlement de la dette qui lui est due. L’Autre de la névrose demande, au moins que le sujet se justifie. Cela touche aussi le pervers quand il amène à l’analyse l’injustifiable de sa jouissance. C’est là que se situe enfin ce que, dans d’autres catégories que les nôtres, on appelle un borderline.
Demander à l’Autre l’objet qu’il recèle, se faire demander par lui le règlement de la dette, c’est-à-dire, en tous les cas, situer la consistance logique au champ de l’Autre, c’est le fondement de tout discours, le principe même du lien social.
L’Autre n’existe pas comme réel. Dire que l’Autre est le lieu de la vérité, c’est dire que l’Autre est un lieu qui a statut de fiction. Dire que l’Autre est le lieu du savoir, c’est dire qu’il a le statut de supposition. La névrose, c’est de le faire exister au prix, pour le sujet, de consentir à s’effacer devant l’objet. Là prend sens la notion que le désir est une défense, une défense contre le réel de la jouissance. Allons plus loin pour dire que la névrose est la structure clinique où la défense s’appelle le désir, tandis que la perversion est la structure clinique où la défense s’appelle le démenti.
Lacan proposait, comme définition de la clinique psychanalytique, « le réel comme l’impossible à supporter »[33]. Cela montre bien que les formes cliniques n’étaient pour lui qu’autant de modes de défense contre le réel, jusqu’au cas limite dit schizophrène, où le sujet apparaît sans défense devant l’impossible à supporter.
On a distingué, pour la psychose, le mécanisme de la forclusion. Pourquoi ne pas donner le même statut pathogène à la Bejahung freudienne, l’affirmation ou le consentement ? On pourrait alors saisir que dans la névrose, la défense prend forme de significantisation de la jouissance. Cela est radical dans la phobie, où le signifiant sert de rempart contre la référence vide, le manque de pénis de la mère. On pourrait ainsi apercevoir que dans la perversion, la défense prend la forme de la fétichisation de la jouissance. Le pervers lui aussi, pas moins que le névrosé, l’Autre le sépare de la jouissance. Le névrosé l’avoue, tandis que le pervers le dément.
Le terme de « démenti » prend sa valeur de son opposition à l’aveu du névrosé. Sans doute, comme le névrosé, le pervers fait-il exister l’Autre. Il fait semblant d’être l’objet a de l’Autre pour l’angoisser – en cela il réussit là où le névrosé échoue. L’hystérique voudrait faire son manque-à-être cause du désir de l’Autre, c’est-à-dire donner à son manque-à-être valeur de vérité du désir, mais le manque reste de son côté, tandis que le pervers le fait basculer dans l’Autre. Et du coup, pour le pervers, la demande n’a pas fonction d’objet dans son fantasme, mais bien l’impératif, l’ordre, le commandement...
Notons encore que ce que l’on appelle manie dans la clinique psychiatrique, c’est le cas où l’objet a ne fonctionne pas, c’est-à-dire un cas d’inconsistance logique, et qui va de pair avec l’inexistence aperçue de l’Autre – puisqu’il s’agit là d’un dit qui ne se pose pas en vérité. Et pourquoi ne pas y opposer, comme formule de la dépression, la consistance a-logique de l’objet, un objet qui n’est plus alors cause du désir de l’Autre ? Le manque-à-être du sujet n’y est plus qu’être-en-trop. Quant au mélancolique, son suicide soudain, s’il ne constitue pas un appel à l’Autre, même pas à son manque, traduit la conversion brusque du manque-à-être subjectif en a. Mais c’est pour mourir d’une mort physique qui n’est que support de la seconde mort[34].
Pourquoi Lacan a-t-il évoqué manie et dépression à propos de la passe, au point où l’Autre se découvre comme inexistant ? Pour indiquer peut-être qu’à celui qui va jusque-là, il faut la cause freudienne comme garde-fou[35].
La dernière clinique de Lacan[36] indique qu’en aucun cas, le père symbolique n’est une solution satisfaisante à l’impossible à supporter.
Le père symbolique, c’est le père du fou. Il n’est chez Lacan question que du père idéal, celui qui voudrait notre bien. Lacan n’a rien fait pour rester parmi nous comme un père idéal.
Il m’est arrivé, en inaugurant le premier service psychiatrique baptisé Jacques Lacan, de donner un petit vade-mecum élémentaire aux praticiens[37]. J’ajouterai ici un avis de plus : « Devant le fou, devant le délirant, n’oublie pas que tu es, ou que tu fus, analysant, et que toi aussi, tu parlais de ce qui n’existe pas ».
Une première version avait été établie par Juan Carlos Indart, que nous remercions. Cette version ainsi que le commentaire des notes bibliographiques ont été établis par Agnès Aflalo.
[1] Conférence d’ouverture de la Vème Rencontre Internationale du Champ freudien, Buenos-Aires, 1988.
[2] Lacan J., « L’Étourdit », Scilicet 4, Paris, Seuil, 1972, p. 31.
[3] Freud S., « L’humour » (1927), Le mot d’esprit et ses rapports avec l’inconscient, Paris, Gallimard, 1930.
[4] Kant développe la maxime universelle dans les Fondements de la métaphysique des mœurs (deux premières sections). Puis, à partir de ce postulat, il fonde l’existence de la loi morale dans sa Critique de la raison pratique. Lacan revient souvent sur la maxime universelle dans son enseignement et il en propose une nouvelle lecture, à partir de Freud, dans son écrit Kant avec Sade.
[5] Breton A., Anthologie de l’humour noir, Paris, Pauvert, 1966.
[6] Lacan J., Le Séminaire, Livre XVIII, « D’un discours qui ne serait pas du semblant » (1970-1971), inédit.
[7] De Lénine, on peut consulter notamment Un pas en avant, deux pas en arrière, Œuvres complètes, Éditions sociales. Quant à l’ironie de Socrate, elle est toujours présente, en particulier dans les premiers dialogues de Platon.
[8] Lacan J., Le Séminaire, Livre VXII, L’envers de la psychanalyse (1969- 1970), Paris, Seuil, 1991.
[9] Sec hablante, en espagnol, ne fait pas tout à fait l’usage de parlêtre en français (note de l’auteur).
[10] Freud S., La science des rêves et Abrégé de psychanalyse, Paris, P.U.F., 1949, chapitre IX.
[11] Lacan J., « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse » (1953), Écrits, Paris, Seuil, 1966 et Le Séminaire, Livre I, Les écrits techniques de Freud (1953-1954), Paris, Seuil, 1975.
[12] Lacan J., Le Séminaire, Livre vii, L’éthique de la psychanalyse (1959-1960), Paris, Seuil, 1986, chapitres II à V.
[13] Lacan reprend cette idée de P. Guiraud dès sa thèse puis dans les « Propos sur la causalité psychique », Écrits, op. cit., p. 175.
[14] Lacan J., De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité (1932), Paris, Seuil, 1975.
[15] Lacan J., « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud » (1975), Écrits, op. cit., pp. 493-528.
[16] La dialectique de Hegel ou logique hégélienne est d’abord développée dans la Science de la logique – dite grande logique. Elle est reprise dans la première partie du Précis de l’encyclopédie des sciences philosophiques – dite petite logique.
[17] On peut citer ici entre autres : Lévi-Strauss C., Les structures élémentaires de la parenté (1947), Paris, Mouton, 1967.
[18] Jakobson R., Essais de linguistique générale, Paris, Minuit, 1963. in L’irréalisation retient Lacan dès l’« Introduction théorique aux fonctions de la psychanalyse en criminologie », à propos du crime. Il reprendra cette fonction d’irréalisation du signifiant à propos du phallus dans son écrit « La signification du phallus », p. 694. On pourra en suivre la construction avec « L’instance de la lettre dans l’inconscient ou la raison depuis Freud » et « La métaphore du sujet ». 18. Cf. Écrits.
[19] Scherber D.P., Mémoires d’un névropathe, Paris, Seuil, 1975, notamment le chapitre XV. Les phrases interrompues sont reprises par Lacan dans deux de ses Ecrits : « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose » et « Subversion du sujet et dialectique du désir dans l’inconscient freudien ».
[20] Russel B., « On denoting », 1905, recueilli dans Logic and Knowledge, Londres, 1956.
[21] Voir par exemple Dun Scott et la théorie médiévale des suppositions.
[22] Le sujet supposé savoir apparaît pour la première fois dans Le Séminaire Le Transfert. Il devient concept dans « La proposition... sur le psychanalyste de l’École » en 1967, Scilicet I.
[23] Frege G., « Sinn und Bedeutung », (1892), traduit au Seuil.
[24] Platon, Le Sophiste, Oeuvres complètes, La Pléiade, Gallimard, tome II.
[25] Op. cit.
[26] Wittgenstein L., Tractatus logico-philosophicus, Paris, Gallimard, Proposition 7.
[27] On peut consulter Le Séminaire XVIII, D’un discours qui ne serait pas du semblant » (1970-1971), inédit, et l’écrit qui en est contemporain, « Radiophonie ». Et en 1973, Télévision.
[28] Freud S., Lettre à Fliess du 21. 09. 1897, La naissance de la psychanalyse, Paris, P.U.F., 1956 ; « Je ne crois plus à ma neurotica... ».
[29] Rousseau J.-J., Discours sur l’origine de l’inégalité entre les hommes, Œuvres complètes, Paris, Pléiade, Gallimard.
[30] Cf, le cours de l’année 1991-1992 que l’auteur a consacré à « La nature des semblants » (inédit).
[31] Lacan J., Compte-rendu du Séminaire « La logique du fantasme », Ornicar ?, n°29, Paris, Navarin, 1984, p. 16.
[32] Miller J.-A., « Sur la leçon des psychoses », Actes de l’École de la Cause freudienne, XIII, Paris, 1987.
[33] Lacan J., « Ouverture de la Section Clinique », Ornicar ?, n°9, Avril 1977.
[34] La seconde mort fait l’objet d’un long développement dans Le Séminaire VII, L’éthique de la psychanalyse, op. cit.
[35] Lacan J., « Proposition du 9 octobre 1967 sur le psychanalyste de l’École », op. cit., p. 14.
[36] Le schizophrène n’a pas le signifiant du manque, rien n’empêche qu’on puisse essayer de l’aider à l’obtenir dans le réel. C’est la leçon que je tirai du cas Robert, de Robert et Rosine Lefort.
[37] Miller J.-A., « Allocution », De près montré, Revue de clinique psychanalytique, Paris, juin 1988, Éditions Borromée. El Servicio, Jacques Lacan, Malentendido, n°23, Buenos Aires, juin 1988.