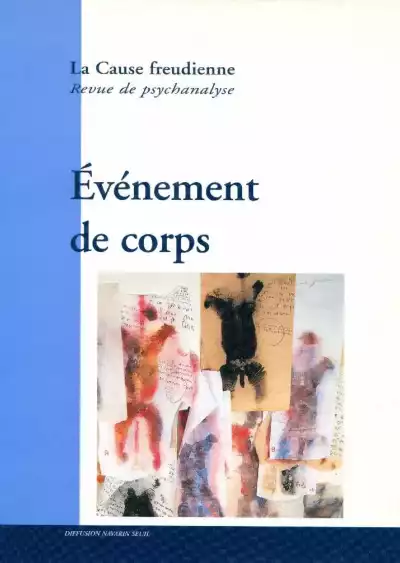-
Biologie lacanienne et événement de corps[1]
Jacques-Alain Miller
I- LA MISE EN OEUVRE DES ALGORITHMES DU VIVANT
Le concept de la vie
Je me suis aperçu que, depuis que j’essaie de m’y retrouver avec l’œuvre de Freud, celle de Lacan, la pratique de la psychanalyse, j’avais soigneusement contourné d’aborder ou d’exposer les coordonnées du concept de la vie. Il faut dire que c’est un concept éminemment problématique, et dont Lacan pouvait dire, dans son Séminaire de 1955 : «Le phénomène de la vie reste dans son essence complètement impénétrable, il continue à nous échapper quoi qu’on fasse».
On peut se demander si Lacan était informé à cette date du pas décisif de la découverte vraiment épocale de la structure de l’ADN par Watson et Crick. Leur article princeps, très bref, est paru dans le magazine Nature en 1953, «Structure moléculaire des acides nucléiques», et a inauguré les années triomphales de la génétique. Nous sommes aujourd’hui à l’aube du siècle qui va voir les sensationnelles conséquences pratiques de ce pas.
A partir de la découverte de cette structure, le phénomène de la vie est-il désormais pénétrable ? Tout au contraire. En 1970, un des artisans des triomphes de la génétique moléculaire, François Jacob, pouvait écrire, dans son livre La logique du vivant : «On ne s’interroge plus sur la vie aujourd’hui dans les laboratoires, on n’essaye plus d’en cerner les contours, on s’efforce seulement d’analyser des systèmes vivants». C’est un fait que, lorsqu’on analyse l’être vivant, non pas dans sa superbe stature, son unité évidente au niveau macroscopique, mais au niveau de la molécule, les processus qui sont en jeu relèvent de la physique et de la chimie et ne se distinguent pas du tout des processus qui se déroulent dans la matière inanimée, dans les systèmes inertes.
Le dit de Lacan reste donc parfaitement exact en dépit des progrès de la biologie moléculaire. Comme le dit François Jacob, le déclin du concept de la vie ne date d’ailleurs pas du milieu de ce siècle, mais de l’événement de la thermodynamique : «La valeur opératoire du concept de vie n’a fait que se diluer depuis la naissance de la thermodynamique».
Cette perspective est parfaitement cohérente avec celle qu’expose Lacan dans les premiers chapitres de son Séminaire Le moi, où il fait apparaître que la biologie freudienne est d’abord une énergétique. C’est sur cette même voie qu’il s’engagera à sa façon lorsqu’il reprendra cette année-là et par la suite les leçons d’«Au-delà du principe de plaisir».
C’est parce que la biologie freudienne est d’abord une énergétique que Lacan s’autorise à dire que la biologie freudienne n’est pas une biologie. C’est exact si l’on entend par biologie une discipline qui aurait la vie pour objet, mais c’est certainement moins exact maintenant que nous avons en quelque sorte une biologie sans la vie, une biologie qui a pour objet – c’est une expression de Jacob, mais on croirait du Lacan – «les algorithmes du monde vivant».
Cette expression traduit le fait que la notion de programme, qui reste marquée d’un certain vague, est désormais centrale dans la biologie.
C’est dans ce contexte que Lacan en est venu à formuler, en 1972, dans Encore, ce qui pourrait passer pour le concept analytique de la vie et qui semble définir la vie par la jouissance : «Nous ne savons pas ce que c’est que d’être vivant sinon seulement ceci qu’un corps, cela se jouit».
Est-ce là une définition de la vie ? C’est plutôt le contraire. Nous ne savons pas ce qu’est la vie. Nous savons seulement qu’il n’y a pas de jouissance sans la vie. Et pourquoi ne pas formuler ce principe sous cette forme que la vie est la condition de la jouissance ? Mais ce n’est pas tout. Il s’agit précisément de la vie sous la forme du corps. La jouissance elle-même est impensable sans le corps vivant, le corps vivant qui est la condition de la jouissance.
Ce point de départ justifie de rouvrir le dossier biologique.
1.LA VIE ET LE UN DU CORPS
Dans notre discipline, qui est clinique, la vie se présente pour nous sous la forme du corps individuel, et nous pouvons nous en tenir là. Nous sommes même poussés à nous en tenir là.
C’est là que l’on peut faire une distinction entre la vie et le corps, ce que l’on fait passer dans l’expression du «corps vivant». La vie ne se réduit pas au corps dans sa belle unité évidente. Il y a une évidence du corps individuel, du corps en tant que Un, qui est une évidence d’ordre imaginaire.
Prenons soin là de nous assouplir un petit peu en questionnant le statut de l’individu par rapport à la vie et précisément le statut de cet Un qui paraît en quelque sorte naturel.
Tout le Séminaire de Lacan qui s’appelle Encore est parcouru par cette interrogation insistante : sous prétexte de cette évidence imaginaire de l’unité du corps, faudrait-il penser que le Un nous vient de là ? D’où la valeur de la position qui accompagne cette insistance, la thèse que le Un nous vient du signifiant et non pas du Un du corps.
Lacan a fait beaucoup pour bouger cette évidence-là. Il a en particulier écrit une phrase qui mérite l’attention et le développement, et qui prend pour cible la zoologie : «La zoologie peut partir de la prétention de l’individu à faire l’être du vivant, mais c’est pour qu’il en rabatte à seulement qu’elle le poursuive au niveau du polypier».
Lorsqu’on s’occupe de l’animal, le vivant, c’est l’individu, le corps un. On peut dire en cela que l’être du vivant se réalise dans un individu. Mais que fait-on alors de ce qui a passionné nos matérialistes du dix-huitième siècle : les polypes, les polypiers, le fameux polypier de Trembley qui était conçu comme à la fois minéral, végétal et animal ? Que fait-on de la colonie de coraux où l’individualité corporelle devient éminemment problématique ? On se trouve au contraire devant une sorte d’être collectif semi-individualisé et qui a l’air en effet d’être là pour combler les trous dans la chaîne des êtres.
Le rêve de d’Alembert
Toute une pensée s’est adonnée à cette notion que tout était continu dans la matière sans solution de continuité et nous conduisant de l’inanimé au vivant. Le rêve de d’Alembert de Diderot est tout écrit pour montrer à quel point la vie déborde le pauvre Un du corps et apparaît au contraire comme une extraordinaire puissance de prolifération.
Le rêve de d’Alembert proprement dit, après l’entretien de Diderot et d’Alembert, commence par l’image d’un essaim d’abeilles décrit comme une grappe qui apparaît comme un être, un individu, un animal. C’est évidemment une illusion. C’est un assemblage, mais, si l’on amollit les petites pattes par lesquelles se tiennent les abeilles, si l’on passe ainsi insensiblement de la contiguïté à la continuité, on va former un tout, et un animal un. On le sait, non de d’Alembert, puisqu’il rêve, mais du médecin Bordeu qui raconte à Melle de Lespinasse les délires oniriques de d’Alembert. Donc, il imagine l’essaim d’abeilles transformé en un véritable polype et en vient à rêver, dans la même veine, de polype humain. Cela vous met dans l’atmosphère du rêve de d’Alembert où vous voyez progressivement le Un devenir multiple dans la nature et le multiple être un, enfin une réversibilité perpétuelle de l’un à l’autre. Cela tangue énormément à la fin dans le rêve de d’Alembert, puisque tout se trouve dans le flux général : tout change, tout passe, il n’y a que le tout qui reste. Cela culmine dans l’Un-tout qui s’arrête aux frontières du monde. En définitive, il n’y a plus qu’un grand animal vivant qui est la nature elle-même : «Et vous parlez d’individus, dit-il, pauvres philosophes. Laissez-là vos individus. Que voulez-vous dire avec vos individus ? Il n’y en a point, non. Il n’y a qu’un seul grand individu, c’est le tout.»
Il est arrivé à Lacan, justement dans les années où il essayait de donner son statut à la jouissance, d’aller, au gré de ses lectures ou de ses achats de livres anciens, chercher dans cette littérature matérialiste. Il a évoqué Maupertuis.
Cela fait bien mesurer la distance où nous sommes de ce monisme de la matière, d’une matière qui inclut la vie. Diderot, c’est une sorte de spinozisme vitaliste où tout se révèle ou est supposé sensible, depuis la pierre. C’est ainsi qu’il commence son entretien avec d’Alembert, qui lui dit : «Mais vous n’allez pas me dire que la pierre est sensible. – Mais pourquoi pas ? Elle crie, seulement on ne l’entend pas.» De proche en proche, il fait la démonstration, par la nutrition, que le minéral contribue à la croissance du végétal, et le végétal avalé par l’herbivore se retrouve aussi bien dans le corps vivant. Donc, une continuité extraordinaire de la sensibilité qui est le principe même des philosophies de la nature, qui oblige sans doute à distinguer deux états de la sensibilité : une sensibilité inerte et une sensibilité active, mais la sensibilité inerte de la pierre peut passer à la sensibilité active.
Cela nous donnera aussi bien les élucubrations sensationnelles de Schelling au dix-neuvième siècle sur les âges du monde, où la conscience est traquée déjà dans les données de l’inanimé, de telle sorte que, dans ce monde, la mort de l’individu se réduit à n’être qu’une illusion.
Hylozoïsme
Je cite Diderot : «Et la vie ? La vie, une suite d’actions et de réactions. Vivant, j’agis et réagis en masse» – masse de mon corps, des animalcules qui me composent. «Mort, j’agis et réagis en molécules. Je ne meurs donc point. Non, sans doute. Je ne meurs point en ce sens, ni moi, ni quoi que ce soit.» C’est une vision de la vie éternelle si l’on ne s’arrête pas à la forme imaginaire du corps, mais si l’on admet que les animalcules, les fibres, les molécules continuent leur petit bonhomme de chemin.
De ce fait, la vie est partout dans la nature et aussi bien la jouissance. La jouissance est coextensive à la vie omniprésente. Je cite Diderot : «Pas un point dans la nature qui ne souffre ou qui ne jouisse.» Voilà la jouissance étendue à toute la nature et à chacun de ses points.
C’est d’ailleurs de l’Encyclopédie de Diderot, de 1760 et quelque, que date le mot «hylozoïsme», un mot savant forgé à partir de hylé (matière) et zoé (vie), pour qualifier cette doctrine de la matière vivante faite Dieu. Et, comme disait Lacan, pour les matérialistes du dix-huitième siècle, leur Dieu c’était la matière.
Il est frappant que l’idée du grand Tout vivant et immortel ait été la doctrine des stoïciens, ceux-là même qui ont inventé la différence du signifiant et du signifié. Comment d’un côté, pour ce qui est du langage, ils l’ont articulé, désarticulé, tandis qu’ils s’adonnaient simultanément à cette doctrine de la vie partout et du monde grand animal. C’est bien la preuve que c’est au niveau du langage qu’ils attrapaient eux l’unité de l’élément, du signifiant Un, parce que, dans la nature, ils n’attrapaient que l’unité du Tout. Ce qui viendrait à l’appui de la thèse de Lacan que l’on attrape le Un à partir du signifiant et non pas à partir de la nature. Dès que l’on s’approche, allez savoir ce qui fait vraiment Un !
L’hylozoïsme a toute raison de nous servir de référence dans la question dans laquelle nous nous avançons, puisque c’est évidemment, bien qu’il ne le signale pas, le soubassement de la théorie de Sade que Lacan expose dans le Séminaire de L’éthique, et qui est là à sa place de son élaboration de la transgression et de la jouissance de la transgression. Il expose le système du pape Pie VI, ce pape criminel dont le postulat est que la nature elle-même veut la destruction, la mort. Il distingue à ce propos deux morts : celle de l’individu, qui est déjà la jouissance d’en finir avec l’autre, et celle de la matière même du cadavre qui résulte de la première. Vous trouvez le texte de Sade pages 249-250 de L’éthique de la psychanalyse. Le criminel radical veut atteindre non seulement l’autre au niveau de la vie, du corps individuel, mais dans la matière qui subsiste après le premier crime. C’est l’hylozoïsme de Diderot et de bien d’autres du dix-huitième qui est le soubassement de la théorie des deux morts.
L’idée des deux morts est comme l’envers et l’endroit de la double vie de Diderot : «Vivant, j’agis et je réagis en masse. Mort, j’agis et je réagis en molécule.» Diderot est là comme l’envers exact du système sadien. Il y a la première et la seconde mort chez Sade, mais il y a la première et la seconde vie chez Diderot.
2. LE DEVENIR MORCELÉ DU CORPS
Puisque j’en étais à Diderot, passons à Descartes.
Descartes et la substance jouissance
En effet, la référence de Lacan pour introduire la vie-jouissance, ce qu’il appelle la substance-jouissance, c’est Descartes, tout à l’opposé de l’hylozoïsme, parce que, là, pas question de matière vivante. Il ne va pas du tout chercher, pour situer la jouissance, cette jouissance partout, cette jouissance universelle, cette jouissance qui est en chaque point de la nature, que l’on trouve chez Diderot. Là, on ne manquerait pas de matière à différents niveaux de l’œuvre de Diderot : on a un éloge continué des possibilités infinies de la jouissance, depuis les plus minuscules et insensibles jusqu’aux plus vastes. Descartes, lui, réduit la matière à l’étendue, et cette réduction exclut par principe la jouissance du corps, en tant que le corps relève de l’étendue.
C’est pourquoi Lacan peut dire, dans son texte sur «La psychanalyse dans ses rapports avec la réalité» que le corps a été profondément méconnu par Descartes, pour avoir été réduit à l’étendue. Bien entendu. La méconnaissance constitutive de cette réduction de la matière et du corps à l’étendue, c’est de disjoindre de sa jouissance le corps. Mais il faut constater en même temps que cette méconnaissance est la condition même des opérations auxquelles nous soumettons le corps toujours davantage.
Cela a une valeur de prophétie de lire ce que Lacan pouvait écrire en 1967 à ce sujet : «Il faudra à ce corps les excès imminents de notre chirurgie pour qu’éclate, au sens commun, que nous n’en disposons qu’à le faire être son propre morcellement.» Ce n’est pas seulement que l’être du vivant n’est pas le Un de l’individu, mais aussi que l’être du vivant, lorsqu’il s’agit du corps de l’être parlant, c’est le morcellement de ce corps. Ce n’est pas seulement là cette profusion qu’un Diderot peut montrer à sa façon : «Nous sommes tous des polypiers, nous sommes tous des colonies d’animalcules mal individués». C’est le Un mis en question par le morcellement.
Un essai d’inspiration swiftienne
Le corps morcelé, nous le connaissons au niveau fantasmatique. C’est d’ailleurs l’expression que Lacan avait forgée pour prendre dans sa parenthèse les phénomènes imaginaires sur lesquels Mélanie Klein avait tant insisté.
Il s’agit ici du morcellement en tant que réalisé par l’opération chirurgicale. C’est là que la biologie qui a passé dans son cours toute une période, la plus longue période, à célébrer l’unité du vivant, s’accomplit tous les jours dans le morcellement de cette unité.
Pas plus tard qu’aujourd’hui, voilà que je tombe sur un essai extraordinaire dans le numéro de cette semaine du magazine Time.
Vous savez qu’on sait transplanter les plus importants des organes, depuis l’opération épocale de la transplantation du cœur par le Dr Barnard. Le problème aujourd’hui, c’est que l’on n’a pas assez de ces organes à transplanter. 62 000 Américains attendent des organes pour survivre ! Qui leur donnera ces organes ?
Eh bien, l’auteur de cet article a une idée : il faut les acheter. Donc, il faut qu’il y en ait qui les vendent. Et donc, proposition sensationnelle : autoriser les familles à vendre les organes des décédés.
Il y a une objection : ce sont les plus pauvres qui seront tentés de vendre le rein et le cœur du cher disparu pour 300 $ - c’est une évaluation de l’auteur. Il y a une réponse à cela : de toute façon, tout ce qui est pénible dans la vie affecte toujours plus les pauvres que les riches. Les pauvres vivent moins bien, ils s’habillent plus mal, ils travaillent plus dangereusement, et ils ont des petites voitures. Alors, si l’on insiste, on peut payer 3000 $ plutôt que 300.
L’audacieux admet tout de même une limite, et il ne propose pas d’acheter les organes des vivants, parce qu’il considère que là ce serait une atteinte à la dignité humaine.
Ce petit texte qui m’est tombé dans les mains par hasard est d’inspiration swiftienne. Vous connaissez le texte de Swift «Modeste proposition concernant les enfants des classes pauvres» : «Comment soulager de leur charge les parents et la nation et utiliser ces enfants pour le bien public ?». Le texte de Swift consiste à proposer que les enfants d’un an contribuent au bien public, à l’alimentation et en partie à l’habillement de nombreux milliers d’hommes. Il propose qu’on les mange. C’est sous la plume de Swift une satire du cynisme des riches de son temps, et il est saisissant de voir une plume américaine afficher une problématique dont on se demande si elle restera ainsi seulement au niveau de l’essai ou si elle passera à l’acte.
Pour le bien public et le bien individuel
Voilà ce qui s’annonce du devenir morcelé du corps. On peut d’une certaine façon dire bye bye à ce qui a été la célébration de l’unité du corps, puisque ce qui est au contraire en marche, c’est son devenir morcelé, évidemment pour son plus grand bien.
Des nouvelles du morcellement, on en a tous les jours. Il y a un morcellement qui se fait sous une forme plus aimable, permise par le génie génétique. On arrive maintenant au génie génétique parce qu’on ne s’est pas arrêté à l’image de la belle forme du corps, mais que l’on sait opérer sur le réel du corps. On en est à l’engineering des tissus. On fabrique de la peau, on la vend, depuis mai 1998. L’année dernière, à cette date, a été approuvée pour la mise en vente la peau fabriquée. On produit, avec l’aide de matières semi-synthétiques des cartilages, des os. On s’apprête à produire des ligaments et des tendons, mais la grosse chose qui est à l’étude, c’est la création d’organes internes complets, les néo-organes.
Cela donne une densité spéciale à ce que l’on peut articuler de notre rapport au corps, qui n’est évidemment pas trans-historique, et il sera de plus en plus conditionné par ce devenir morcelé du corps. Il ne s’agit pas là du méchant marquis de Sade qui va découper la pauvre Justine. C’est évidemment pour le bien public et le bien individuel, c’est-à-dire c’est irrésistible.
Voilà ce qui rend utile de rassembler quelques éléments de biologie lacanienne. C’est cela la mise en œuvre des algorithmes du vivant.
Le corps-machine
Qu’est-ce qui est ici cartésien ? C’est ce qui est anti-aristotélicien. Cela procède de la perspective qui décompose l’unité du vivant, alors que la perspective aristotélicienne met l’accent sur l’unité du vivant, de l’âme comme forme du corps. C’est précisément pour faire contraste à cette perspective que Lacan se réfère répétitivement dans son Séminaire Encore au De l’âme d’Aristote, pour en mesurer à la fois que cela a prescrit le développement de la biologie, que c’est en quelque sorte la forme philosophique de notre imaginaire du corps, mais que c’est déjà périmé tous les jours par la mise en œuvre des algorithmes du vivant.
Cette perspective aristotélicienne est invinciblement périmée. Lacan considérait d’ailleurs qu’il y avait toute une part de la philosophie contemporaine qui n’était que des efforts pour regonfler, remettre au goût du jour cette perspective aristotélicienne. Le gestaltisme, la psychologie de la forme, le goldsteinisme, et même l’être-dans-le-monde, ou la phénoménologie de la perception, ont été autant de tentatives de faire retour à l’harmonie de l’âme et du corps. On considère en effet que Descartes était un abruti d’en avoir fait deux substances séparées et que, nous, nous allons nous occuper à recoudre cela pour retrouver l’unité du vivant.
Lacan, qui n’est pas progressiste, comme il dit, mais qui n’est pas nostalgique, sait qu’on ira toujours davantage dans le sens cartésien, c’est-à-dire d’opérer sur le corps, de le décomposer comme une machine. Dès son Séminaire il souligne le caractère décisif de la référence à la machine pour ce qui est de fonder la biologie. Cette décomposition, ce morcellement procède essentiellement de se mettre à distance de ce qui est la merveilleuse harmonie de l’organisation vivante avec son milieu, pour opérer et démantibuler, décomposer, désarticuler.
Il est frappant que François Jacob, dans son ouvrage, peut écrire : «La biologie moléculaire correspond à un nouvel âge du mécanisme.» Ce n’est pas parce que l’on est passé aux références à l’information, ce n’est pas parce que maintenant on opère au niveau moléculaire que conceptuellement on n’est pas dans le schéma mécaniste. Il y a à la fois des changements sensationnels dans la biologie, mais il y a en même temps des phénomènes en quelque sorte de longue durée, et celui-ci en est un. Il y a quelque chose qui procède de l’animal-machine de Descartes.
On verra de la même façon, pour ce qui est de la biologie de Freud, à quel point elle a été bien orientée dans sa référence essentielle. Les faits de morcellement mettent en question l’identité du corps d’une façon beaucoup plus probante que les élucubrations hylozoïstes, et par là même l’âme aristotélicienne qui n’est, comme le dit Lacan page 100 de Encore, que l’identité supposée au corps.
Le corps parlant relève de l’avoir
Cela nous dit quelque chose de fondamental sur le statut du corps, de ce corps qui donne le modèle imaginaire du Un. On identifie en quelque sorte spontanément, imaginairement, le corps et l’être du vivant. Lacan le dit en passant lorsqu’il parle du rat dans le labyrinthe au dernier chapitre du Séminaire Encore. On en identifie là le corps et l’être. C’est une identification qui est au principe du premier abord de l’être, si on le classe à Aristote. Aujourd’hui, on entreprend au contraire de détraquer le pauvre petit rat en le plongeant dans le savoir de l’expérimentateur, un savoir dont il n’a que faire pour sa vie.
S’il est licite, pour l’animal, d’identifier l’être et le corps, ce ne l’est pas pour l’espèce humaine. Cela
concerne le statut du corps parlant : le corps ne relève pas de l’être, mais de l’avoir.
C’est l’accent tellement surprenant que Lacan met sur la formule «l’homme a un corps», qui est incarnée dans le droit anglais sous la formule de l’habeas corpus. Il abonde sur «l’homme a un corps» dans un de ses derniers textes, «Joyce-le-symptôme», mais vous le trouvez déjà dans le Séminaire II, page 93. Il note d’ailleurs que, toujours, on a eu un corps, mais que c’est encore plus clair aujourd’hui, car nous avons poussé extrêmement loin l’identification de l’homme avec son savoir.
C’est là que trouve son sens la référence et l’appui qui est pris au dualisme cartésien. Ici, c’est un dualisme du savoir et du corps. La question de l’être pour «l’homme», entre guillemets, se pose du côté du savoir, alors que le corps est du côté de l’avoir. Cette identification de l’homme avec son savoir est celle que Lacan a fait culminer dans le concept ou l’algorithme du sujet. Sa position est de l’ordre de l’être, même si elle est formulée comme manque-à-être.
On peut dire encore plus simplement que le sujet, à partir du moment où il est sujet du signifiant, ne peut s’identifier à son corps, et c’est précisément de là que procède son affection pour l’image de son corps. L’énorme boursouflure narcissique, qui est caractéristique de l’espèce, procède de ce défaut d’identification subjective au corps. C’est spécialement dans l’hystérie que le défaut d’identification corporelle a été mis en évidence.
Voilà un principe directeur, qui est d’ailleurs le principe de la critique constante que Lacan a pu faire, implicitement ou explicitement, de la phénoménologie de Merleau-Ponty qui essaye de restituer la co-naturalité de l’homme au monde, qui se centre sur la présence corporelle, qui étudie la présence au monde dans, par, à travers un corps. C’est aussi sensible dans la philosophie du Dasein de Heidegger, d’où il s’est déplacé, par rapport à quoi il a tourné. La présupposition, comme dit Lacan, pour Merleau-Ponty, c’est qu’il y a quelque part un lieu de l’unité, qui est l’identification de l’être et du corps, et qui a comme résultat d’effacer le sujet.
Si l’on prend les choses dans cette perspective, le behaviorisme est susceptible de la même critique. Même si les phénoménologues et les psychologues gestaltistes se sont gaussé de Watson, l’idée de décrire le comportement en termes de stimulus-réponse en laissant de côté toute introspection repose finalement sur une équivalence de l’être et du corps.
C’est dans la faille de cette identification entre l’être et le corps, c’est en maintenant dans tous les cas que le sujet a un rapport d’avoir avec le corps que la psychanalyse ménage son espace.
3. LA BIOLOGIE DE FREUD
Freud a mis beaucoup d’espoir dans la biologie. Je le cite : «La biologie est vraiment un domaine aux possibilités illimitées. Nous devons nous attendre à recevoir d’elle les lumières les plus surprenantes, et nous ne pouvons pas deviner quelles réponses elle donnerait dans quelques décennies aux questions que nous lui posons.»
L’au-delà de la vie ouvert au corps parlant
Lacan, dans le contexte où il a pris la parole, a posé que la biologie freudienne, ce n’est pas la biologie. En effet, la mort dont il s’agit dans la pulsion de mort, ce n’est pas la mort biologique, ce n’est pas le simple retour du corps vivant à l’inanimé. C’est une mort où il s’agit d’un au-delà de la vie. Une biologie qui inclut la pulsion de mort est une biologie d’au-delà de la vie, mais d’un au-delà qui est ouvert à l’être parlant par le langage. Cet au-delà de la vie est matérialisé par la sépulture, puisque l’espèce humaine est la seule où le corps mort garde sa valeur.
Cet au-delà de la vie qui est ouvert au corps parlant, Sade en est lui-même l’exemple. Il a rêvé de la mort des molécules. Il a rêvé d’un criminel qui pourrait, au-delà de l’individu, tuer les molécules, mais, pratiquement, il a demandé par testament, comme on sait, que son nom propre sur la pierre tombale soit effacé.
Ce qui est spécifique à l’homme c’est de durer, non pas sous forme de molécules, mais sous forme de signifiants. C’est dans cette marge signifiante d’au-delà de la vie que Sade a voulu s’atteindre lui-même et disparaître. La demande de Sade, et même son injonction, sa pulsion de mort porte sur le signifiant, et par là il ne s’agit pas en effet de biologie.
Le schéma conceptuel de Weismann
Mais la biologie freudienne, c’est tout de même la biologie. Au moins a-t-il appuyé sa spéculation sur la biologie, et il n’a pas si mal choisi avec Weismann et sa théorie du plasma germinatif. La grande référence, c’est le chapitre VI d’«Au-delà du principe de plaisir».
Il faut reconnaître qu’il y a une parenté entre le germen de Weismann et le génome actuel. Sans doute le germen et le génome sont-ils inscrits dans des discours différents. C’est une pure spéculation chez Weismann – et Freud s’est intéressé aux tentatives de démontrer la théorie de Weismann de façon expérimentale. Chez Watson et Crick, c’est vraiment inscrit dans une science, la génétique moléculaire. Cela donne lieu à une pratique et débouche sur le génie génétique. Il n’empêche que, entre le germen de Weismann et le génome à partir de Watson et Crick, il y a le même schéma. Le même schéma conceptuel est à l’œuvre entre la référence que Freud a choisie en biologie et ce qui nous occupe de la biologie la plus actuelle et cette biologie future.
Je l’ai trouvé heureusement confirmé dans l’ouvrage d’une lecture très plaisante d’un épistémologue un peu iconoclaste, André Pichot, L’histoire de la notion de gène. Il y a à propos de Weismann, la notion que, mutatis mutandis – Weismann n’avait pas la notion que la substance qui transportait l’hérédité, c’étaient les chromosomes –, c’est le même schéma conceptuel qui reste à l’œuvre dans la biologie quelques décennies après. A partir de considérations purement physiques sur les lois statistiques, Schrödinger, en 1944, dans un petit ouvrage de vulgarisation, Qu’est-ce que la vie ?, a pu anticiper exactement le concept de la génétique moléculaire. Pichot peut dire qu’il en donne les bases théoriques dix ans avant qu’on élabore la structure de l’ADN. C’est dire la force de ce schéma conceptuel. Il est chez Weismann, enrichi par la théorie chromosomique, il permet à Schrödinger de déduire à sa façon ce qui prendra forme en 1953 de la double hélice de Watson et Crick, et qui nous met dans les perspectives où nous sommes pour le siècle prochain où le rapport au corps et à son morcellement va connaître tout son épanouissement.
Freud s’est vraiment rapporté à l’axe central de la biologie comme par divination. Même les néo-darwiniens d’aujourd’hui se réfèrent à Weismann. Ce vulgarisateur de talent qui s’appelle Richard Dawkins, l’auteur de ce livre inénarrable, Le gène égoïste, écrit en toutes lettres : «L’idée centrale que j’ai utilisée a été esquissée par Weismann». Ce que Freud a prélevé, c’est vraiment au point de départ de l’autoroute centrale de la biologie d’aujourd’hui.
Au chapitre VI de l’«Au-delà du principe de plaisir», Freud expose la théorie des deux catégories de pulsions : pulsion de mort cherchant à rétablir l’état inanimé et pulsion de vie, pulsion sexuelle, tendant à la conjonction sexuelle et «à la fusion de deux cellules germinales différenciées, tendant à assurer la reproduction, à prolonger la vie et à lui donner l’apparence de l’immortalité». C’est sur la base de ce qu’il a élaboré de pulsion de vie/pulsion de mort qu’il trouve une analogie chez Weismann : «Nous trouvons le plus grand intérêt à la façon dont A. Weismann, dans ses travaux, a traité le thème de la durée de la vie et celui de la mort des organismes. C’est ce chercheur qui introduit la distinction entre une moitié mortelle et une moitié immortelle de la substance vivante. La moitié mortelle est le corps au sens étroit, le soma ; lui seul est soumis à la mort naturelle, tandis que les cellules germinales sont potentiellement immortelles dans la mesure où elles sont capables de se développer en formant un nouvel individu ou, en d’autres termes, de s’entourer d’un nouveau soma.»
Quelle est la notion en question ? Il y a deux ensembles de cellules différenciées, les unes spécialisées dans la reproduction, les autres qui se développent en corps individuels. D’un côté, les cellules germinatives de la reproduction persistent et se transmettent comme une lignée en quelque sorte autonome. Et même Jacob va dire : «C’est la reproduction des êtres unicellulaires par simple fission, et chacune est capable de donner naissance à un corps, de s’entourer d’un corps individuel, d’un soma, mais qui est en quelque sorte sa fin en lui-même.» C’est ainsi que se perpétue une lignée tandis que le corps individuel vient en quelque sorte se greffer latéralement sur cette lignée.

C’est l’intuition et le schéma conceptuel de Weismann, avec l’idée que la reproduction dépend entièrement de la nature et des propriétés du germen et que tout ce qui arrive au corps individuel du point de vue de l’hérédité est tout à fait indifférent à la descendance et disparaît avec lui, tandis que «la sélection naturelle opère sur les dispositions cachées de la cellule germinale». L’hérédité apparaît ici séparée de tout incident, et même, ajoute François Jacob, «de tout désir».
C’est de ce schéma, si simple qu’il soit, que procède la voie royale de la biologie. C’est entouré de toute une philosophie chez Weismann, une philosophie des biophores – il pense qu’il y a des particules porteuses de vie dans le germen –, mais tout cela ce sont des fioritures qui n’enlèvent rien à la force de ce schéma. En effet, dans un tout autre contexte, ce que l’on va trouver comme structure de l’ADN vient à la place du germen de Weismann.
Le germen narcissique
Qu’est-ce qui intéresse Freud ici ? C’est l’analogie qui lui fait superposer les pulsions de vie au germen et les pulsions de mort au soma. Il resitue sa théorie des pulsions à partir de là. Certes, il note que la psychanalyse ne s’intéresse pas à la substance vivante mais aux forces qui opèrent dans la substance vivante, et ce sont les pulsions. Il présente donc la théorie des pulsions comme la dynamique qui complète la morphologie de Weismann.
Il s’est intéressé en détail aux essais de démonstrations expérimentales de cette thèse. C’est surtout ce qui l’a dérangé qui est très frappant. Ce qui le dérange, c’est que Weismann montre que les organismes unicellulaires où le soma et le germen ne seraient pas distingués sont potentiellement immortels. C’est une conception qui est soutenue aussi bien aujourd’hui : l’immortalité de la bactérie et même l’hypothèse de la bactérie initiale, de la mère de toutes les bactéries. Ce qui dérange Freud, c’est que la mort somatique n’intervienne que chez les pluricellulaires, c’est-à-dire que la mort ne soit qu’une acquisition tardive. Il dit : «Il n’y a plus lieu de faire état de pulsion de mort remontant à l’apparition de la vie sur terre.» Lui voudrait que les pulsions de mort et les pulsions de vie soient vraiment à l’origine même de la vie.
Il faut suivre dans ce chapitre un raisonnement vraiment tiré par les cheveux de Freud pour essayer de montrer que les protozoaires pourraient très bien subir les pulsions de mort dès le début sans que l’on arrive à le percevoir. C’est une démonstration vraiment raffinée, mais qui montre que ce qui compte pour lui, c’est de doctriner sur la vie comme telle. La question de la jouissance qui habite cette affaire de pulsion de mort doit être liée, pour lui, à la vie comme telle. D’où l’importance de rappeler que, avec Lacan, nous nous intéressons à la jouissance comme liée à la vie mais sous la forme du corps.
Tout l’effort de Freud est pour que ces pulsions soient déjà présentes indépendamment de la constitution, non seulement d’un corps, mais même d’un organisme pluricellulaire. Il arrive finalement, en se tortillant de cette façon-là, à valider son analogie avec Weismann. Et même, il invente le gène égoïste. Il invente déjà le néodarwinisme. L’idée du germen potentiellement immortel qui utilise les corps individuels pour se perpétuer – la poule apparaît comme le moyen que l’œuf a trouvé pour produire un autre œuf, selon une phrase du philosophe Butler cité par Jacob –, frappe tellement Freud qu’il va jusqu’à parler du narcissisme du germen : les cellules germinales se comportent de façon absolument narcissique au sens de la psychanalyse. La notion du germen narcissique est déjà la préfiguration du néodarwinisme contemporain du succès de librairie qu’a fait Dawkins avec Le gène égoïste.
Qu’est-ce que l’idée du gène égoïste ? Dawkins fait parler le gène. Le gène essaye de survivre et de se reproduire, donc il programme les corps dans lesquels il se trouve à cette fin. Cela, encore, on peut admettre. Mais, là où cela devient saisissant, c’est que, comme la population génique est dispersée chez de nombreux individus, il y a une solidarité génique. Il étudie donc le comportement du corps en le déduisant de l’égoïsme du gène. Par exemple, si les parents protègent les enfants, c’est pour protéger les gènes. Et puis, de là, la vie amoureuse, la vie sociale. Tout, tout, c’est le gène qui gêne tout le monde pour se perpétuer et arriver à ses fins. Dans le même fil, vous avez, à partir du milieu des années soixante-dix, la sociobiologie.
En court-circuit, dans son introduction à ce qui devait devenir le Département de Psychanalyse, Lacan qualifie curieusement de «lieu de la vie» l’imaginaire et le réel : «Mon imaginaire et mon réel, par quoi se distinguent deux lieux de la vie que la science à cette date sépare strictement». En quoi peut-on dire que l’imaginaire et le réel sont des lieux de la vie ? Cela s’appuie sur cette distinction germen/soma. L’imaginaire est là lié au corps individuel, alors que le germen, et bien plus le génome, est le lieu de la vie, le réel de la vie.
Plus saisissant peut-être comme court-circuit est l’analogie de Lacan que vous trouvez page 89 d’Encore : «La fonction que je donne à la lettre est celle qui fait la lettre analogue d’un germen». Lacan réutilise ce schéma en faisant, lui, la lettre analogue du germen. C’est bien le germen de Weismann, bien que Lacan le rapporte à la physiologie moléculaire – qui se passe bien de ce terme de germen –, puisqu’il parle du germen séparé des corps auprès desquels il véhicule vie et mort tout ensemble.

Cette analogie de la lettre et du germen est évidemment faite pour nous donner la notion d’une reproduction de la lettre, mais qui suppose l’extériorité du savoir par rapport à l’être, par rapport au corps. C’est une transmission de la lettre, mais en position d’extériorité. Ce qui fait que Lacan dit : «Le savoir est dans l’Autre. C’est un savoir qui se supporte du signifiant et qui ne doit rien à la connaissance du vivant.»
II- LA VIE EST CONDITION DE LA JOUISSANCE
Je ne m’intéresse à la vie que dans sa connexion avec la jouissance et pour autant qu’il se pourrait qu’elle soit ce qui mérite d’être qualifié de réel. Il me semble que les propositions de Lacan ne font pas objection à formuler que la vie est la condition de la jouissance.
Si la vie est condition de la jouissance, c’est une condition nécessaire, mais non pas suffisante.
J’ai en effet pris soin de distinguer la vie comme telle, pour ne pas dire comme puissance, et le corps. La vie déborde le corps. C’est ce qui oblige à préciser qu’il n’y a jouissance qu’à la condition que la vie se présente sous la forme d’un corps vivant.
1. CONDITION DE CORPS ET CONDITION DE SIGNIFIANT
C’est bien cette expression qu’il s’agit d’évaluer. Le corps vivant, qu’est-ce à dire ? Cela dit qu’il ne s’agit pas seulement du corps imaginaire, du corps sous la forme de sa forme. Il ne s’agit pas du corps image, de celui que nous connaissons, auquel nous nous référons parce qu’il est opératoire dans le stade du miroir, ce corps spéculaire qui double l’organisme. Il ne s’agit pas non plus du corps symbolique, celui qui à plusieurs reprises fait venir sous la plume de Lacan la métaphore du blason. Les armoiries sont un code. Des parties du corps peuvent certes y être représentées, d’ailleurs avec d’autres éléments naturels, mais elles ont valeur de signifiants. Ce sont des signifiants imaginaires, des signifiants dont la matière est empruntée à l’image.
Lorsque nous disons «le corps vivant», nous écartons ce corps symbolisé comme aussi bien le corps image. Ni imaginaire, ni symbolique, mais vivant, voilà le corps qui est affecté de la jouissance. Rien ne fait obstacle à ce que l’on situe la jouissance comme un affect du corps, et la question est de donner son sens à cet adjectif que l’on ne peut pas élider, vivant, qui a pour nous évidemment beaucoup moins de précision que l’adjectif imaginaire ou l’adjectif symbolique. Ceux-ci résonnent de tous les échos de l’enseignement de Lacan et peuvent après tout se fonder sur l’épistémologie et même sur les travaux d’histoire des sciences sur lesquels Lacan s’est appuyé pour faire cette distinction d’imaginaire et de symbolique, alors que vivant passe là dans notre discours sans être doté le moins du monde de cette précision comparable.
La question est de donner son sens à cet adjectif de vivant et aussi bien de saisir par quel biais, de quelle incidence l’affect de jouissance advient au corps. Il y a donc, si l’on admet cette perspective, la condition de corps.
Je peux tout de suite ajouter qu’il y a une seconde condition qui s’ajoute à la condition de corps pour que l’on obtienne quelque chose comme la condition suffisante. C’est la condition de signifiant, si l’on se règle sur cette formule de Lacan que le signifiant est cause de la jouissance.
Voilà la perspective – la vie condition de la jouissance, la condition de corps, la condition de signifiant – où je compte m’avancer dans cette biologie lacanienne.
Il y a au bout de cette perspective une clinique qui prendrait pour pivot une définition qui me semble avoir été négligée du symptôme et qui est pourtant fondamentale, incontournable. C’est celle du symptôme comme événement de corps, qui figure au moins une fois chez Lacan.
Si elle a été négligée, c’est sans doute qu’elle semble partielle. Le symptôme comme événement de corps semble négliger l’évidence, par exemple du symptôme obsessionnel qui se présente comme symptôme de la pensée par excellence, bien que le symptôme obsessionnel de la pensée ait toujours son cortège de symptômes corporels. Et puis, la définition du symptôme comme événement de corps semble faire l’impasse sur tous les symptômes qui, dans les différentes structures cliniques, affectent par excellence la pensée, l’énonciation, le langage. C’est pourtant une définition logique du symptôme, à quoi on ne peut pas échapper dès lors que l’on saisit le symptôme comme jouissance, dès lors même qu’on le saisit dans les termes que propose Freud dans Inhibition, symptôme, angoisse, comme une satisfaction de la pulsion. Si le symptôme est une satisfaction de la pulsion, s’il est jouissance conditionnée par la vie sous la forme du corps, cela implique que le corps vivant est prévalent dans tout symptôme.
Voilà ce qui est à l’horizon de ce que j’appelle «biologie lacanienne» : la reprise de la symptomatologie à partir des événements de corps. Cela nous demandera évidemment quelques redéfinitions, quelques précisions qui font apparemment obstacle à ce que cette définition soit considérée comme opératoire.
2. DU BINARISME DES PULSIONS AU MONISME DE LA PULSION
Dédoublement de la mort
Pour faire bonne mesure à ce dont j’ai parlé à propos de la vie et des mythes matérialistes de la vie, je dirai quelque chose de la mort.
Concernant la mort, c’est le moment ou jamais de se régler sur le dit de Lacan que la biologie freudienne n’aurait rien à faire avec la biologie. Réglons-nous sur le dit de Lacan qui distingue la biologie freudienne et la biologie proprement dite.
C’est bien ce qui a conduit Lacan à distinguer deux morts à partir du système du pape Pie VI qui figure dans l’histoire de Juliette de Sade. La première mort, dans cette spéculation, est celle qui frappe la vie du corps individuel et le transforme en cadavre. La seconde est celle qui frapperait les molécules du corps réduit à ce cadavre.
Il faut relire ce dédoublement de la mort. Le dédoublement lacanien n’est pas le dédoublement sadien. Il s’étaye sur le dédoublement sadien, mais il ne s’y réduit pas.
L’existence de ces deux morts suppose l’existence de deux vies ou deux formes de vie, dont la première se réalise sous la forme du corps et la seconde s’accomplirait sous une forme infra, infra-corporelle, une vie qui serait en effet moléculaire ou fibrillonnaire. C’est sur ce matérialisme vital que la spéculation de Sade s’appuie et aussi bien qu’elle anime de ce qu’il appelle «le crime», ce crime qui serait le désir de frapper non seulement la première vie mais aussi la vie moléculaire.
Si l’on se met un peu à distance de la passion criminelle qui anime cette spéculation, le schéma que comporte ce dédoublement se dessine ainsi : une mort au-delà de la mort, une vie au-delà de la vie. Seulement, chez Diderot comme chez Sade, la double vie comme la double mort sont du registre biologique. C’est une biologie rêvée.
La dichotomie ainsi introduite répercute la différence qu’il y a en définitive entre la vie et le corps. Ce dédoublement sur lequel Lacan fait fonds dans son Éthique de la psychanalyse repose sur le fait que la vie comme telle déborde la vie du corps individuel et que le corps n’est qu’une forme transitoire, une forme périssable de la vie. Le Wunsch de Sade, que Lacan appelle finalement pulsion de mort, vise la vie comme telle au-delà du corps.
Lorsqu’on parle de Sade, qui porte le nom de Sade ? C’est le sujet qui assumerait, qui prendrait à son compte la pulsion de mort, qui la subjectiverait comme un crime, et qui l’étendrait jusqu’aux éléments du corps décomposé dont il désirerait la disparition, l’anéantissement.
Trouve-t-on quoi que ce soit d’équivalent chez Freud ? Si Lacan est allé pêcher ce dédoublement biologique chez Sade, c’est qu’il n’y a pas trace chez Freud d’un tel dédoublement. Freud ne distingue pas entre la vie et le corps.
La répétition, facteur d’inadaptation
Allons voir le chapitre V de l’«Au-delà du principe de plaisir», où Freud développe ce qu’il appellera lui-même ultérieurement, en 1925, une ligne extrême de sa pensée, susceptible d’être amendée et corrigée.
Quelle est cette ligne extrême ? Elle consiste – premièrement, à imputer la compulsion de répétition, cliniquement saisie, au corps vivant, à l’organisme vivant comme tel, voire à la substance vivante – deuxièmement, à concevoir cette répétition comme tendance à rétablir tin état antérieur – troisièmement, à identifier cet état antérieur à la mort conçue comme non-vie, c’est-à-dire la mort biologique pour autant que le non-vivant était là avant le vivant. La démonstration que tente Freud dans ce chapitre V et qu’il prolonge dans son chapitre VI isole un mouvement vers la mort qui affecterait le vivant en tant que tel. Le corps individuel obéit pour Freud à la même logique que la vie en tant que telle. C’est d’ailleurs ce qui le conduit à chercher les manifestations de ces pulsions dès l’origine de la vie.
Ce qui se présente chez Freud comme l’état initial, l’état naturel, c’est l’état inanimé, pour autant que c’est un état sans aucune tension, et la vie apparaît comme une perturbation extérieure qui est survenue à l’inanimé. Freud le dit en toutes lettres dans cette spéculation extrême :«Les propriétés de la vie furent suscitées dans la matière inanimée par l’action d’une force.» Il dit lui-même que cette force est à vrai dire pour nous impensable.
Lui est encore en discussion avec le vitalisme qui hante la biologie de son temps. Lacan a nié d’emblée et nécessairement, étant donné son point de départ, la pertinence biologique de la mort conçue comme retour de l’animé à l’inanimé. Il l’a développé dans son second Séminaire.
Qu’est-ce qui force Freud à penser à la mort comme destin du vivant saisi par une répétition qui est une tendance vers la mort ? Qu’est-ce qui le force à introduire cette conception ? Ce qui force Freud à penser à cela, dit Lacan, ce n’est pas la mort des êtres vivants, mais le vécu humain, expression qu’il précise plus ou moins comme étant l’échange humain, l’intersubjectivité, le fait du langage. D’un côté, Lacan admet la répétition comme phénomène clinique, mais, d’un autre côté, il donne un tout autre sens à la connexion de la répétition à la mort.
Là où Freud, dans sa spéculation extrême, tient à voir un phénomène vital originaire dans la répétition, Lacan n’en fait pas un phénomène vital – la répétition lacanienne ne relève pas du comportement de l’organisme vivant –, mais un phénomène anti-vital, dans la mesure où, en regard de la spéculation freudienne, la répétition dans l’espèce humaine s’oppose à l’adaptation. Ces registres de la répétition et de l’adaptation sont deux grands registres qui sont suivis cahin-caha de temps en temps, mais de façon insistante dans cette lecture de Lacan.
Toute la psychologie animale célèbre l’adaptation de l’organisme animal au milieu. Une référence restera permanente pour Lacan, celle des recherches tellement divertissantes de Von Uexküll montrant comment, par exemple, la mouche a son monde à elle qu’elle prélève sur l’ensemble de l’environnement des lieux significatifs par rapport à quoi elle apparaît merveilleusement adaptée, appareillée pour son monde. L’adaptation culmine là dans l’harmonie. Donc, adaptation, emboîtement, ou, comme s’exprime Lacan, dans L’Etourdit, rapport trait pour trait entre Umwelt et l’Innenwelt, entre le monde extérieur et le monde intérieur de l’animal. Là, envers et endroit parfait entre l’organisme et son milieu.
C’est par rapport à ce concept fort, expérimental, au moins ce concept qui se prétend issu de l’observation, que prend sa dimension, par contraste, la répétition. C’est par rapport à cette adaptation merveilleuse, harmonique, que la répétition freudienne relue par Lacan prend son relief, dans la mesure où ce n’est pas très sorcier de montrer que la répétition est foncièrement, pour l’espèce humaine, un facteur d’inadaptation, que la répétition, telle qu’elle émerge dans la clinique, apparaît comme conditionnant un comportement foncièrement inadapté par rapport aux exigences de la vie, du bien-être du corps.
Ce que Freud appelle besoin de répétition, loin d’être un besoin comme les autres, apparaît au contraire comme une exigence dysharmonique quant à l’être vivant comme tel. À cet égard, Lacan admet le fait de la répétition. Il démontre que, par rapport à l’adaptation, la répétition est d’un registre qui n’est pas du tout biologique, mais qui n’est pensable que dans l’ordre du langage. C’est déjà dessiner, dans l’au-delà du principe de plaisir, la place du surmoi comme principe de la répétition anti-vitale.
La pulsion du surmoi
C’est pour cela que Freud a finalement été conduit à introduire son concept du surmoi exactement à la place du moi. Jusqu’alors Freud rapportait au moi tout ce qui servait à l’autoconservation du vivant. C’est pourquoi il parlait de pulsions du moi comme pulsions du vivant servant à sa subsistance. Si vous lisez le chapitre V, vous voyez l’embarras même de Freud avec ce terme de pulsions du moi, puisque, dans «Au-delà du principe de plaisir», on voit déjà, à travers son argumentation difficultueuse, les pulsions du moi devenir la pulsion de mort. Par une sorte de déformation, il commence à mettre des guillemets à pulsions du moi. Il continue de parler de pulsions du moi, mais il précise, dès 1925, date d’Inhibition, symptôme, angoisse, que c’est une dénomination provisoire qui est simplement enracinée dans la première terminologie freudienne. Même si la formule n’apparaît pas ainsi chez Freud, la pulsion de mort, telle qu’elle émerge dans son texte, c’est la pulsion du surmoi. Cette autoconservation qui serait l’apanage du moi, qui est une réédition de l’âme aristotélicienne, cela se dissout. Ce qui émerge à la même place, c’est une pulsion tout à fait contraire à l’autoconservation, une pulsion qui ramène le vivant à la mort, et par un certain nombre de détours que Lacan lit comme les détours du système signifiant, qui trouvera le nom freudien du surmoi.
Il y a, maintenu et valorisé comme tel chez Freud, un binarisme des pulsions. Il y a pulsion de mort, que je traduis ici comme pulsion du surmoi parce que cela me paraît sa définition la plus éclatante, et il y a les pulsions sexuelles qui seraient les pulsions de vie s’opposant aux pulsions qui conduisent à la mort, donc pas du tout des pulsions d’autoconservation, mais plutôt les pulsions de reproduction. C’est ce binarisme que Freud tente de fonder sur la biologie de Weismann, sur la différence entre soma et germen.
Une pulsion réunifiée
C’est là que l’on peut se poser la question de la place de la libido entre pulsion de mort et pulsions sexuelles. Cette place paraît singulièrement complexe, parce que, d’un côté, cette libido apparaît présente dans les pulsions soi-disant d’autoconservation référées au moi comme réservoir de la libido, mais également bien présente dans les pulsions sexuelles qui préservent la vie. Freud note à ce propos que l’opposition entre pulsions du moi et pulsions sexuelles s’est avérée inadéquate, et il pense parer à cette difficulté qui est finalement de localiser la libido dans ce binarisme en substituant à cette opposition celle de pulsions de vie et pulsion de mort.
Il faut s’apercevoir de la transformation saisissante que Lacan a opérée sur cette théorie des pulsions soi-disant fondée en biologie. Lorsque nous disons la pulsion, c’est bien que, contrairement aux avertissements répétés de Freud, nous ne tenons pas compte du binarisme des pulsions, et que la perspective de Lacan surclasse le binarisme des pulsions. C’est difficultueusement que Lacan a extrait la pulsion comme telle de ce que Freud a amené sous la forme de ce binarisme, en plus en entourant ce binarisme de toutes les précautions comme quoi il ne faudrait sous aucun prétexte y toucher parce que ce serait là tomber dans le jungisme, le pansexualisme, etc.
J’ai souvent parlé des pulsions chez Lacan sans souligner le fait évident et majeur que Lacan annule le binarisme freudien des pulsions. Il le dit à sa façon, discrètement, dans le Séminaire des Quatre concepts fondamentaux : «La distinction entre pulsions de vie et pulsion de mort est vraie pour autant qu’elle manifeste deux aspects de la pulsion. Mais les pulsions sexuelles font surgir la mort comme signifiant.» Encore plus clair, dans l’écrit contemporain de ce Séminaire, «Position de l’inconscient» : «Toute pulsion est virtuellement pulsion de mort». Qu’est-ce à dire sinon annuler le binarisme freudien ? Ce n’est pas autre chose que ce qu’il nous représente sous la forme de son mythe de la lamelle qui est une représentation mythique de la libido. Il s’inspire de la référence que Freud prend au Banquet de Platon pour construire son mythe à partir de celui d’Aristophane. Il nous représente la libido comme un organe, comme un objet, mais comme un organe qui a un sens mortifère. Il nous définit la libido, sous la forme du mythe, comme un être qui porte la mort. opération complexe de Lacan porte à la fois sur la mort et sur la libido. Elle consiste à montrer que la mort n’est pas du tout l’apanage de la pulsion de mort, mais qu’elle est présente dans les pulsions sexuelles et que, symétriquement, la libido est présente dans la pulsion de mort. Cette double démonstration, qui est éparpillée dans l’enseignement de Lacan, a finalement pour résultat d’annuler le binarisme des pulsions et de nous permettre à nous aujourd’hui de dire «la pulsion».
Que la libido soit présente dans la pulsion de mort, on en a tout à fait l’indice chez Freud, puisqu’il définit la répétition dans ce chapitre V comme la répétition d’une expérience de satisfaction primaire, et la répétition en quelque sorte échouée, la répétition insuffisante. Il pose d’emblée comme fondement de la répétition le ratage. La satisfaction obtenue par la répétition n’est pas équivalente à la satisfaction exigée. Il y a toujours un déficit, et c’est même là que Freud voit l’origine du facteur qui pousse en avant l’être humain, qui l’empêche de se satisfaire d’aucune situation établie et qui l’oblige à avancer dans son chemin vers la mort sans que le but d’une satisfaction complète puisse être atteint.
L’essentielle dichotomie freudienne est en quelque sorte résorbée par Lacan qui montre que la mort et la libido ont finalement partie liée. C’est le vrai sens de son mythe de la lamelle : la libido est un être mortifère. Cette formule, que l’on trouve dans le texte à peu de choses près, déforme, franchit la frontière que Freud avait établie de ce binarisme qu’il a trimbalé avec lui depuis la différence entre pulsions du moi et pulsions sexuelles et pulsions de vie et pulsion de mort.
Ce monisme de la pulsion est évidemment un moment essentiel de l’enseignement de Lacan. Son point de départ est éminemment binariste : langage et libido, symbolique et imaginaire. Le mouvement même de l’enseignement de Lacan est allé vers l’élaboration de catégories monistes. On voit en quelque sorte des pans entiers de l’enseignement de Lacan qui s’effondrent à partir du moment où surgissent ces catégories monistes, dont la première est celle d’une pulsion ici réunifiée.
3. LE SIGNIFIANT ANNULE LA VIE ET EN DÉTACHE LA JOUISSANCE
Le rapport subjectif à la mort
Disons un mot de la mort présente comme signifiant, à quoi Lacan se réfère. Qu’est-ce que la mort comme signifiant ? Cela traduit le fait après tout bien connu que l’être vivant dans l’espèce humaine anticipe la mort. Ce seul fait introduit un double statut de la mort. Ce n’est pas le double statut de la vie corporelle et de la vie moléculaire, et de la mort du corps et de la mort espérée des molécules. Ce double statut de la mort est celui de la mort naturelle et de la mort anticipée que, évidemment, Freud n’avait pas méconnue. Il faut pour cela se référer plutôt à son texte «Considérations actuelles sur la guerre et la mort» de 1915, dont le second chapitre est précisément dédié à notre relation à la mort. Freud y insiste sur ce que la mort propre n’est pas représentable, mais tout en n’étant pas représentable elle est pourtant anticipable. La mort comme anticipable, c’est tout à fait autre chose que la mort naturelle. C’est la mort en tant qu’elle exerce, comme il s’exprime gentiment, «une forte influence sur la vie», selon qu’on accepte de risquer la mort ou qu’on en exclut le risque dans une posture un rien héroïque. C’est cette pensée de la mort qui, selon Freud, amène à concevoir la division du corps et de l’âme qui donne l’idée d’une survie après la mort, qui ouvre l’espace d’au-delà de la vie. C’est le principe du dédoublement de la mort tel que Lacan l’a avancé. Il a mis en avant le dédoublement sadien entre deux formes de mort naturelle selon qu’elle porte sur le corps ou sur les molécules, mais la véritable double mort dont il s’agit, c’est la mort naturelle et la mort qui tient au signifiant.
Qu’est-ce que Lacan a appelé «l’éthique de la psychanalyse» ?
Il a appelé éthique de la psychanalyse, premièrement, une doctrine du surmoi, c’est-à-dire une exigence qui va contre l’adaptation, l’exigence du retour d’une satisfaction primaire, et donc l’exigence d’une jouissance. Sa formulation du surmoi comme «Jouis» s’inscrit déjà de son «éthique de la psychanalyse». C’est réunir le «tu dois» kantien et cette exigence du retour de la jouissance. Il a appelé «éthique de la psychanalyse» une doctrine du surmoi qui n’a rien à faire avec une morale qui finalement n’est jamais que l’emplâtre de l’adaptation. Lorsque Lacan se réfère à L’éthique à Nicomaque d’Aristote, c’est pour montrer que finalement la morale comme sagesse, c’est ce qui viendrait à nous donner le guide qui nous fait défaut dans le registre de notre rapport à Umwelt. C’est un tempérament de l’exigence de jouissance, une modération qui essaye de nous ramener à l’harmonie, alors que la doctrine du surmoi se centre sur le facteur dysharmonique.
Deuxièmement, «l’éthique de la psychanalyse» est une explication de la fonction de la mort dans la vie, c’est-à-dire d’une mort non pas en tant que rapportée à la biologie, mais rapportée à la logique du signifiant. Ici, la double mort dont il s’agit, c’est la mort naturelle d’un côté et la mort signifiante de l’autre.
C’est ce qui fait que Lacan peut poser la question, dans son Séminaire de L’éthique, question saugrenue apparemment : a-t-elle quelque chose à voir avec la mort ? Qu’est-ce que cela veut dire ? Que la mort n’est pas le complémentaire de la vie, parce qu’il s’agit ici de la mort en tant que nous avons rapport à la mort dans la vie, et ce ne peut être qu’une mort signifiante. Cela traduit l’empiétement de la mort sur la vie.
La question sur quoi débouche L’éthique de la psychanalyse, c’est de savoir comment un corps vivant, lorsqu’il relève de l’espèce humaine, peut accéder à son propre rapport à la mort. Ce que Lacan appelle le propre rapport à la mort, ou que Freud appelle notre relation à la mort, c’est ce que Lacan fait équivaloir à la pulsion de mort. Il n’y a pas seulement mort subie, identification subie à la mort qui s’effectue. C’est si l’on veut une déduction de l’être-vivant-pour-la-mort, et cela suppose en effet que, au moins dans L’éthique de la psychanalyse, la pulsion de mort est équivalente au rapport subjectif à la mort. Cela implique un petit bougé de notre notion de la mort. Cela implique que cette mort anticipée, cette mort qui empiète sur la vie, est équivalente à une disparition signifiante. C’est une mort qui est équivalente au sujet barré, au sujet en tant qu’un signifiant en moins.
C’est ce que Lacan appelle la seconde mort, la mort qui n’est pas la mort de tous, au sens où ce n’est pas la mort qui consiste à claquer du bec. C’est ce qu’il appelle la vraie mort, la mort qui a partie liée avec la vérité aussi bien, celle où le sujet est soustrait à la chaîne signifiante et en quelque sorte rejoint ou même épouse son propre anéantissement. Ce que Lacan appelle la seconde mort, c’est le manque-à-être signifiant du sujet, ce qui d’ailleurs implique, symétrique de la seconde mort, la seconde vie, la «vie signifiante» qui double la vie naturelle. Le vivant dans l’espèce humaine existe comme signifiant au-delà de la vie naturelle, il est en quelque sorte doublé par la «vie signifiante». J’y mets des guillemets parce que cette vie signifiante est avant tout présente dans le fil d’une chaîne signifiante où le sujet est saisi.
Il y a, dans ce que Lacan appelle l’éthique, deux faces du sujet. Il y a sa face de disparition, et c’est cette face-là qui s’identifie à la seconde mort, à la mort signifiante, et puis il y a – c’est un terme que j’amène pour rassembler les éléments qui composent cette autre face – le signifiant unaire comme signifiant du sujet de la seconde mort. Le terme qui revient là n’est d’ailleurs pas l’unaire, mais l’Unique.

L’unique, c’est ce que le signifiant convertit de l’être en dépit de toutes les transformations du vivant pour en faire un Un absolu. D’un côté, c’est par le signifiant que se produit l’empiétement de la mort sur la vie, et d’un autre côté le signifiant accomplit une éternisation du sujet dans son unicité. L’éthique commente le vers de Mallarmé «Tel qu’en lui-même l’éternité le change». C’est pourquoi d’un côté Lacan commente l’effacement signifiant du sujet et corrélativement ce que le sujet conserve d’ineffaçable, à partir du moment où le signifiant l’a épinglé comme ce qu’il appelle une chose fixe.
La pierre du vivant
C’est ici que s’introduit Antigone. Antigone est celle qui ne dit rien d’autre que le vivant humain a droit à la sépulture, c’est-à-dire qu’il persiste en tant que signifiant au-delà de la mort biologique. Cela met en cause à la fois cet S barré et la préservation du signifiant de celui qui a été un homme vivant. Elle maintient le droit de l’existence signifiante de l’Un au-delà de tous les attributs qui ont pu lui être décernés. La question n’est pas de savoir s’il a été bon, s’il a été méchant, et s’il est coupable ou non. Il a été sujet du signifiant. Antigone est le sujet qui vise le pur S1du sujet, c’est-à-dire le vise simplement dans son «il a été».
Cet S1 est la pierre du vivant, c’est ce qui réalise la pétrification signifiante, qui est d’ailleurs incarnée par ce qui est tout de même un rite presque universel, la pierre tombale. La tombe a presque toujours affaire avec la pierre, que ce soit même sous la forme de la caverne. C’est à cette place du S1 que Lacan situe le soi-disant retour à l’inanimé. C’est l’inanimé de la pétrification signifiante, c’est l’absolu du soi-même. C’est évidemment un signifiant détaché. Le Un ici n’ouvre pas à une série, c’est le Un de l’unique.
C’est pour cela qu’il y a cette boursouflure dans L’éthique. Pourquoi y a-t-il tout ce commentaire d’Antigone ? Parce qu’Antigone se voue à cette unicité du vivant humain et à ce qui, de lui, persiste au-delà de ce qu’a été sa vie biologique. C’est un signifiant séparé, absolu, et précisément séparé de l’Autre. Ce qu’illustre Antigone, qui est rebelle à l’ordre de la cité. Au point où elle se situe, comme visant l’unique, elle est vouée à l’Un-tout-seul. Ici, sa séparation de l’ordre de la cité veut dire qu’elle est en un point où l’Autre n’existe pas.
C’est pourquoi Lacan a pu glisser comme une représentation de la fin de l’analyse, c’est-à-dire comme une esquisse de la passe, le moment où le sujet s’accomplit en tant que celui qui n’attend l’aide de personne, et qui, dans l’ordre des passions, peut se traduire par la détresse ou par le désarroi absolu, par le fait de n’être plus arrimé à personne.
Structuralement, ce que vise L’éthique de la psychanalyse, si l’on représente la chaîne signifiante de cette façon élémentaire comme une succession d’éléments signifiants, c’est l’intervalle entre les signifiants, et c’est ce qui est représenté par ce sujet barré. Même cet entre-les-signifiants est susceptible de recevoir son signifiant spécial qu’ici je me suis contenté d’appeler S1.
Ce que vise L’éthique de la psychanalyse à cet égard, c’est en effet le rien dans son double aspect : le rien que fait surgir le signifiant et le rien qui fait surgir le signifiant. Toute l’ambiguïté du Séminaire repose sur cette différence. Le rien que fait surgir le signifiant, parce qu’il n’y aurait pas ce rien si le signifiant n’avait pas émergé, mais en même temps ce rien qui fait surgir le signifiant, et c’est ce que Lacan a traité comme créationnisme.
Il y a trois versions du rien qui s’articulent dans L’éthique : le rien en tant que la mort signifiante, la seconde mort, le rien comme signifiant de l’unique, et le rien comme vide de la vie. Cela se centre, se resserre, et en même temps cela échappe. Cela se resserre sur une antinomie du signifiant et de la vie, une antinomie du signifiant et de l’être vivant.
Lacan propose déjà là une représentation de l’incidence du signifiant sur la vie et une représentation qui va finalement être sous-jacente à nombre de ses élaborations, y compris les plus avancées des dernières. Cette représentation de l’incidence du signifiant sur la vie, c’est la valeur qu’il faut donner à ce qu’il évoque du vase à partir de Heidegger, que l’on peut représenter comme un U.
Ce serait le symbole et même l’objet représentatif du signifiant, parce que c’est le signifiant qui peut prétendre à être élevé au rang de signifiant premier façonné des mains de l’homme et que, comme tel, il crée le vide. À la fois il vient en plus dans le monde, et en même temps il amène un moins. D’où la valeur qu’il prend de représenter ce en quoi le signifiant annule la vie et par là même détache comme telle la jouissance de la vie. C’est bien ce qui introduit la problématique de ce qui vient remplir le vide qui a été ainsi ce qui se substitue à la jouissance perdue et initialement annulée.
Les substituts que Lacan peut énumérer sont ici autant de barrières. Il distingue spécialement deux barrières, celle du bien et celle du beau.
La barrière du bien, le substitut du bien, à cette place ainsi creusée, c’est la barrière de l’avoir, le bien que l’on possède et que l’on a à protéger. La barrière du beau, c’est celle qu’oppose la forme du corps humain, l’image du corps comme enveloppe de tous les fantasmes possibles du désir. D’une certaine façon, ces deux barrières n’en font qu’une pour autant que, par excellence, c’est le corps qui est l’avoir du sujet, c’est-à-dire qui n’est pas son être.
III- ÉVÉNEMENT DE CORPS ET AVÈNEMENT DE SIGNIFICATION
La définition du symptôme comme événement de corps que j’ai promue est nécessaire et inévitable pour autant que le symptôme constitue comme tel une jouissance. On admet que symptôme est jouissance, satisfaction substitutive d’une pulsion, comme dit Freud – son caractère substitutif n’enlève rien à son caractère authentique, réel, puisque la satisfaction substitutive n’est pas une satisfaction moindre. Pour autant que le symptôme constitue une jouissance au sens de satisfaction d’une pulsion, et pour autant que la jouissance passe par le corps, qu’elle est impensable sans le corps, le corps comme forme ou plutôt comme modalité, comme mode de la vie, la définition du symptôme comme événement de corps est inévitable. Je la ponctue, je la souligne, je le répète, et par là même j’en fais un index fondamental de notre concept du symptôme.
Si elle est nécessaire et inévitable, cette définition n’en a pas été pour autant distinguée. Elle a été négligée, et sans doute parce que notre point de départ, qui est celui de Lacan dans la psychanalyse, met en évidence une autre définition du symptôme qui a éclipsé celle-ci.
Cette autre définition est la suivante : le symptôme est un avènement de signification. C’est à ce titre qu’il est éminemment interprétable. Cette définition ne dit pas autre chose. Alors que la définition du symptôme comme événement de corps rend beaucoup plus problématique le statut de l’interprétation qui peut y répondre. Le symptôme comme avènement de signification est la définition qui s’impose de l’équivalence établie par Lacan entre symptôme et métaphore.
1.SIGNIFICATION ET SATISFACTION
Des événements qui ont une signification
Qu’est-ce que Lacan, si on y songe, a rassemblé sous le titre des formations de l’inconscient ? Ce sont des événements dont Freud avait montré qu’ils avaient une signification, alors même qu’ils semblaient en être dépourvus. Cela a été la bonne nouvelle apportée par Freud.
Pour en rendre compte, comme on le voit dans Les formations de l’inconscient, Lacan a mis en jeu un fonctionnement à vrai dire inédit entre code et message. C’était choisir de mettre en avant l’avènement de signification que constitue le symptôme. C’est ce qui lui a inspiré la construction de son graphe où l’avènement de signification est conçu à partir d’un message émis hors de la connaissance du sujet.
Mais la signification n’est pas le tout de la découverte freudienne concernant les formations de l’inconscient. Chez Freud au moins, la signification est constamment doublée de la satisfaction que ces formations sont censées apporter au fonctionnement de l’appareil psychique. Chez Freud, signification est inséparable de satisfaction, y compris dans son ouvrage du Mot d’esprit dans ses rapports avec l’inconscient. Une dialectique est ainsi ouverte entre signification et satisfaction, comme à l’intérieur de chacune de ces deux notions.
Il y a là un parallélisme qui mérite d’être isolé en tant que tel. D’une part, il y a des phénomènes, ou plutôt des événements, comme nous disons là maintenant – et il faudra faire la différence du phénomène et de l’événement – qui apparaissent dépourvus de signification et qui se révèlent par l’interprétation être au contraire dotés de signification. De la même façon, parallèlement, des événements qui se traduisent et même qui s’éprouvent comme déplaisir, comme insatisfaction, se révèlent aussi bien par l’interprétation produire de la satisfaction.
Il y a là un mouvement qui conduit de l’absence de signification à la signification, et que Freud conceptualisera à partir de l’insensé apparent du contenu manifeste permettant à l’aide de sa méthode de mettre en valeur la signification du contenu latent, et puis, le mouvement qui repère que l’insatisfaction cache une satisfaction inconnue au sujet. C’est là une double dialectique interne au terme de signification et de satisfaction.
L’opération freudienne a ainsi toujours une double incidence sur les événements sur lesquels elle porte. Cette incidence est pour une part sémantique et elle est également, comme on s’exprime dans l’analyse, économique. Il ne fait pas de doute que Lacan, pour les meilleures raisons du monde, a donné le pas au versant sémantique par quoi le versant économique est devenu problématique.
Le parti pris de ce que nous appelons l’enseignement de Lacan, qui s’inaugure avec son rapport de Rome, est que la signification l’emporte sur la satisfaction. Il a toujours évalué les concepts économiques freudiens à l’aune de la signification. Par exemple, lorsqu’il s’interroge sur le concept de libido dans ce second Séminaire, qui suit de peu son rapport de Rome, il se pose ce genre de question : la notion freudienne de libido est-elle adéquate au niveau où s’établit l’action de l’analyste, à savoir celui de la parole ? Ce type de question met en évidence le procédé de Lacan, qui est d’évaluer les concepts qui concernent la satisfaction par rapport à la signification.
Un concept moniste de la pulsion
Cette question, lorsque Lacan la pose, s’enlève sur le fond de la réponse qu’il avait apportée avant même d’établir l’action analytique au niveau de la parole, c’est-à-dire avant son rapport de Rome.
C’est là, si on revient dans cet en deçà, qu’il apparaît qu’avant d’être obnubilé par le structuralisme linguistique, il avait procédé à une déduction des pulsions de vie comme de mort à partir du narcissisme. Avant la césure introduite par le privilège donné au mécanisme du langage producteur de sens, il s’était dirigé dans le sens de rendre compte en même temps, et d’une façon moniste, du dualisme freudien des pulsions de vie et des pulsions de mort. Il avait l’idée – d’une intuition en quelque sorte initiale, préalable à son structuralisme – de rendre compte en même temps des pulsions de vie et des pulsions de mort, de construire un concept moniste de la pulsion. C’était sans doute au prix de réduire la pulsion de mort à l’agressivité, comme on le faisait d’ailleurs couramment à cette époque.
C’est dans cette ligne que s’est inscrite la première réflexion de Lacan qui le conduit à tenter une déduction simultanée des deux types des pulsions, comme on le voit dans son écrit sur «Le stade du miroir», où il pose que la libido narcissique a une relation évidente à l’agressivité. Cette jonction est développée dans le texte de 1948 sur «l’agressivité». Ce texte, qui s’inscrit dans le cadre de nos éléments de biologie lacanienne, tente de démontrer que les pulsions de vie et les pulsions de mort ne font qu’une. La satisfaction propre au stade du miroir, c’est l’identification du sujet conçue comme désarroi organique originel à ce que j’appellerai l’image corporelle complète. Cette satisfaction serait repérée dans l’expérience sous le nom de la jubilation du petit encore incoordonné ne maîtrisant pas son corps dans une forme de désarroi organique, la jubilation devant la complétude spéculaire qu’il obtient de sa présence devant un miroir.
C’est bien la satisfaction qui est au premier plan de cette expérience. Et quel est le trait caractéristique de cette satisfaction ? Elle se situe dans ce que Lacan appelle la dimension d’une déhiscence vitale constitutive de l’homme. La déhiscence est un terme technique, biologique, pour qualifier les phénomènes d’ouverture du corps, d’ouverture d’un fruit, par exemple.
Discordance et libido
Mais cette ouverture a ici le caractère d’une incomplétude, d’un défaut, d’un décalage. Elle voudrait traduire la notion que d’emblée l’organisme humain n’est pas corrélé à un milieu qui lui soit préformé. Le mot de déhiscence renvoie ici à ce qui serait un décalage originaire pour le corps vivant dans l’espèce humaine entre l’Innenwelt et Umwelt, pour reprendre les termes de von Uexhüll. Cette jubilation n’est pas une satisfaction d’une complétude naturelle, mais une satisfaction ancrée dans un manque et établie sur une discordance. D’emblée, et même là sur un fondement qui serait biologique, le sujet se trouve affecté de deux corps discordants. Dans son statut réel, l’organisme, distingué du corps proprement dit, lui image.

Cette discordance paraît si essentielle à Lacan que, tout en la fondant apparemment sur la biologie, il ne manque pas d’introduire à ce propos une référence au mythe de la discorde primordiale chez Héraclite. Cela revient constamment sous sa plume : page 96 des Écrits, page 116, page 318, et je ne prétends pas avoir ici révisé l’exhaustion de cette référence. Une discorde initiale qui, pour nos éléments de biologie, se centre sur ce clivage, ce redoublement décalé de l’organisme et du corps. Mais, bien qu’elle soit nimbée de cette référence mythique, elle n’en est pas moins, pour le premier Lacan – ou même pour l’anté-Lacan, pour Lacan avant Lacan, avant son rapport de Rome –, conçue comme biologique et justifiée par la notion empruntée au physiologiste Bolk, que l’homme naît prématuré. Il vient au monde désaccordé de son milieu et donc voué à une dépendance longue à l’endroit de puissances sans lesquelles il ne pourrait pas survivre.
Pour cet anté-Lacan, on trouve dans ce décalage initial le secret de la libido. Comme il s’exprime, nul besoin de chercher plus loin la source de l’énergie libidinale, nul doute qu’elle ne provienne de la passion narcissique. Ce que Freud nous laisse comme guide du moi, comme réservoir de la libido, Lacan en rend compte par l’insertion, dans le morcellement initial de l’organisme, de l’image totalisante du corps qui promeut l’image au centre de la vie psychique du corps vivant de l’espèce humaine. C’est là qu’il trouve, avant d’être structuraliste, le secret, la source de la libido freudienne. Il la trouve dans la discorde, dans la discordance, dans la déhiscence.
Cette libido narcissique est une libido qui est vitale, positive, qui tire en avant le développement, qui est la forme anticipée de la synthèse du corps, mais qui est en même temps agressive à l’endroit de l’image. La démonstration que Lacan accomplit au sujet de ce stade du miroir, c’est une libido qui inclut à la fois les valeurs de vie et de mort qui se trouvent scindées chez Freud. Rapporter la libido à ce clivage, c’est conjoindre les valeurs de vie et les valeurs de mort.
Il m’est revenu qu’on trouvait singulier l’accent que j’avais mis la dernière fois sur la libido mortifère, telle que Lacan s’est trouvé la développer, la construire dans son texte «Position de l’inconscient» qui est contemporain de son Séminaire XI. C’est un texte que lui-même met en parallèle – c’est un texte pourtant plus menu, plus réduit – avec le texte triomphant de son commencement dans la psychanalyse. Il faut s’apercevoir que l’esquisse de cette libido mortifère, de cette libido représentée comme un singulier organe supplémentaire de l’organisme, se trouve esquissée dès son texte sur l’agressivité sous le nom bien singulier de libido négative. Il qualifie cette libido de «négative» parce qu’elle inclut à la fois pulsions de vie et pulsion de mort.

Un statut ironique de la mort
C’est avec la promotion de la fonction de la parole et du champ du langage, avec la promotion de l’ordre symbolique, que commence l’enseignement de Lacan avec son rapport de Rome.
Quelle est son incidence sur la théorie des pulsions ?
Sa première incidence, c’est de découpler pulsions de vie et pulsion de mort, de rompre cette unité qui est exprimée d’une façon si singulière sous le terme de libido «négative». La première incidence du structuralisme de Lacan, c’est-à-dire du privilège donné à la signification sur la satisfaction, est de renvoyer les pulsions de vie à l’imaginaire tandis que pulsion de mort est affecté au symbolique.
C’est précisément à ce point qu’est consacrée la conclusion du rapport de Rome de Lacan, qui est faite pour montrer le rapport profond, comme il s’exprime, qui unit l’instinct de mort au problème de la parole. C’est sous l’influence de ce structuralisme qu’il découple pulsions de vie et pulsion de mort. Il renvoie les pulsions de vie à l’imaginaire, tandis qu’il fait de l’instinct de mort un concept anti-biologique. Il scinde ce qu’avant son structuralisme il avait réuni.
Le structuralisme de Lacan donne un statut exactement ironique à la mort plutôt qu’un statut biologique. Ironique veut dire ici que c’est un statut qui met en cause les fondements mêmes de l’être et qui les met en cause comme le Witz met en cause les solidarités qui nous sont proposées par la perception. Cela suppose sans doute que l’agressivité n’épuise pas ce dont il s’agit avec la mort freudienne. La jonction qui était auparavant réalisée supposait la réduction de la pulsion de mort à l’agressivité. Et si on réduit la pulsion de mort à l’agressivité, en effet, on peut l’inclure dans les phénomènes du narcissisme. Le rapport de Rome disjoint au contraire l’agressivité et la pulsion de mort. La mort dont il s’agit, c’est la mort anticipée ou, comme s’exprime Lacan, la limite de la fonction historique du sujet. L’adjectif historique s’oppose là à biologique. La mort freudienne proprement dite, ce n’est pas la mort biologique, mais la limite historique. C’est une version de l’être-pour-la-mort au sens heideggérien, mais conçue à partir de la fonction du signifiant, c’est-à-dire comme mort symbolique.
Qu’est-ce que cette mort symbolique qui est au fond la deuxième mort ?
Premièrement, c’est une mort qui est présente dans la vie, une mort qui double la vie à chaque instant sous les espèces du signifiant.
Deuxièmement, c’est la mort que porte le symbole comme tel. C’est là que s’inscrit la formule que j’ai de longtemps soulignée, symbole qui se manifeste d’abord comme meurtre de la Chose, et qui trouvera plus tard chez Lacan une version moins pathétique sous les espèces de la barre qui vient rayer tout objet destiné à être élevé à la dignité du signifiant.
Troisièmement, c’est une mort qui individualise par opposition à la mort naturelle, la mort animale, qui, elle, n’est pas individualisante. Comme s’exprime Lacan, rien ne distingue un rat d’un rat, sinon le passage inconsistant de la vie à la mort. Un rat, c’est la même chose qu’un autre rat, c’est un exemplaire du type de l’espèce. Tandis que la mort symbolique culmine dans l’acte suicide. Et la référence qui revient chez Lacan, aussi bien dans son rapport de Rome que plus tard dans «Position de l’inconscient», c’est le suicide d’Empédocle, le suicide comme acte symbolique, dont Lacan ne souligne pas en vain qu’il reste à jamais présent dans la mémoire des hommes.
C’est-à-dire, quatrièmement, c’est une mort qui éternise du même mouvement où elle fige le corps vivant. La mort symbolique dont il s’agit est une mort qui assure une survie signifiante, qui ouvre à une vie d’une autre sorte que la vie biologique. C’est pourquoi Lacan peut dire qu’elle transcende la vie héritée de l’animal. Je vous renvoie ici à la page 319 des Écrits qui exprime une perspective qu’il faut garder en mémoire pour éclairer les dernières élucubrations de Lacan qui sont directement rattachées à cela. Cette survie de l’au-delà de la vie biologique, cette survie signifiante que la sépulture matérialise – mais il n’y a pas de sépulture d’Empédocle et il y a la postérité qui se perpétue dans le souvenir et dans le discours –, il la qualifie dans les termes suivants : «La seule vie qui perdure et qui soit véritable, puisqu’elle se transmet sans se perdre dans la tradition de sujet à sujet.»
C’est exactement cette notion d’une vie qui perdure par le signifiant et qui est la seule véritable dans la mesure où elle ne meurt pas, dans la mesure où elle surclasse la mort, à laquelle Lacan fait référence dans son Séminaire Encore, vingt ans plus tard, lorsqu’il formule que la lettre est l’analogue du germen par rapport au soma, que la lettre a une fonction analogue de celle de ce germen qui se transmet comme par une lignée immortelle en dépit de la mort des corps. Cette analogie, qui a pu paraître à certains fantastique, et que Lacan dans son Séminaire Encore n’explique pas, est expliquée vingt ans avant par cette notion de la vie qui perdure au-delà de la vie biologique par le biais du signifiant.
La mort symbolique est conçue à cet égard d’un côté comme négation de la vie biologique, comme en témoigne l’acte suicide, mais aussi bien comme affirmation de la vie symbolique au-delà de la vie biologique. C’est même conçu par Lacan comme une affirmation de la vie symbolique en deçà de la vie biologique dans la mesure où l’existence du sujet prend son sens à partir de la mort.
Mais tenons-nous-en à ce que le structuralisme de Lacan fonde une co-appartenance du symbolique et de la mort et par là même exclut la jouissance du symbolique, en tant que la jouissance suppose la vie biologique et la refoule dans l’imaginaire. Les conséquences de cette position initiale concernant la satisfaction pourraient être développées en détail, mais je me contenterai de deux flashes, de deux élaborations essentielles de Lacan pour récupérer la satisfaction dans le champ du langage.
2. RECONNAISSANCE ET FANTASME
C’est l’élaboration de la reconnaissance empruntée à Hegel, que Lacan laissera rapidement de côté, et c’est l’élaboration du fantasme qui va au contraire marquer beaucoup plus durablement son enseignement.
L’élaboration de la reconnaissance répond à l’exigence de construire une satisfaction propre au symbolique, l’élaboration d’une satisfaction sémantique. C’est ce qu’il emprunte à la Phénoménologie de Hegel.
Je relève que Lacan introduit son concept du grand Autre, dans le Séminaire II, page 276, même si on peut supposer qu’il l’avait élaboré d’avant. Et c’est à propos de la satisfaction qu’il le glisse, précisément du fait que, chez l’homme, la satisfaction du sujet est toujours en rapport avec la satisfaction de l’Autre, d’un Autre qui ne lui est pas symétrique, qui est l’Autre dont il s’agit dans la fonction de la parole.
D’ailleurs, dans tout le long du Séminaire V, la satisfaction freudienne est ramenée à la satisfaction de la reconnaissance, c’est-à-dire de l’Autre du code qui valide les productions du sujet. C’est même à la satisfaction de reconnaître la signification des productions du sujet qu’est ramené l’essentiel de l’opération analytique. Voilà la première forme sous laquelle la satisfaction peut faire retour dans la construction de Lacan, la satisfaction par la reconnaissance.
Mais il y a une seconde élaboration dans la mesure où cette satisfaction par la reconnaissance n’est pas suffisante, n’est pas jouissance. C’est celle de la satisfaction par le fantasme. Tandis que le symptôme s’inscrit au registre de la signification, foncièrement et pendant des années durant de son enseignement, c’est le fantasme qui s’inscrira essentiellement dans la colonne de la satisfaction.

Le fantasme est le terme que Lacan a promu pour concentrer tout ce qui est satisfaction libidinale chez Freud. La densité de ce terme va rouler à travers l’enseignement de Lacan jusqu’à introduire chez lui un dualisme du symptôme et du fantasme qui répond au dualisme de la signification et de la satisfaction. C’est sur le terme de fantasme que s’est concentré chez Lacan ce qu’il a sauvé de la satisfaction freudienne.
On peut le présenter comme deux métaphores. D’un côté, la métaphore du symptôme, la substitution d’un signifiant à un autre, avec son effet sémantique. De l’autre côté, la métaphore de jouissance qui est celle de la substitution de petit a à moins (p. Et ces deux métaphores se répondent.

Ce que veut dire fantasme chez Lacan, c’est qu’un élément venu d’une autre dimension que du symbolique vient s’insérer dans le symbolique. Si l’on représente de la façon la plus élémentaire la chaîne signifiante par cette ligne rompue, morcelée, c’est une chaîne de morcellement, une chaîne de mort, puisque la mort recouvre tout ce qu’il en est du symbolique.
Toute la construction de Lacan, c’est d’amener d’une autre dimension un élément qui vient s’insérer dans le vide qui scande cette chaîne, et dans tous les cas c’est un élément de vie. Pour pouvoir introduire la jouissance, il faut introduire un élément de vie, ce qu’on pourrait même appeler, en rappelant le terme de Weismann, l’inventeur de la différence entre soma et germen, un biophore, un élément qui porte la vie.

La construction de Lacan l’oblige, dans la partie la plus classique de son enseignement, à insérer dans la chaîne symbolique mortifiée un biophore. Qu’est-ce que ce biophore ? C’est ce qu’il a appelé, avec les valeurs différentes qu’il a données à ce terme, petit a. Et la formule du fantasme ( S <> a) traduit l’insertion, au point d’intervalle de la chaîne signifiante, du biophore.
Ce biophore a évidemment reçu des valeurs différentes. Lacan l’a d’abord fait venir de l’imaginaire, ce qui a impliqué un changement de statut de l’objet imaginaire. Cela a obligé l’imaginaire à devenir élément, aussi bien élément unique. Ce qui va contre le statut de l’objet dans l’imaginaire comme tel où l’objet est toujours équivalent à un autre, toujours objet d’échange, aussi bien qu’au niveau de la pulsion où l’objet est indifférent. Tandis qu’inséré à la place récurrente de ce moins-un dans la chaîne, l’objet devient unique, irremplaçable. C’est ce que Lacan traduit en parlant de l’objet élevé à la dignité de la Chose. Tant que c’est un objet qui vient de l’imaginaire, c’est un objet représentatif, une Vorstellung, une représentation – il a une identité. Dans la suite de l’enseignement de Lacan, le biophore deviendra non représentatif emprunté au réel, et finalement un pur quantum de libido, ce qu’il appellera plus-de-jouir. La logique de l’enseignement de Lacan est tin tiraillement, en même temps que l’on peut recomposer une certaine chronologie. Il est d’un côté conduit à ramener la satisfaction à la signification. Il construira, dans ce mouvement, la logique du fantasme et produira la construction de la passe. Logifier le fantasme, c’est tenter de transformer le biophore en élément de signification, tenter de mettre l’accent sur ce que comporte de signification la satisfaction. En même temps, un second mouvement s’y oppose et succède au premier, qui est au contraire de ramener la signification à la satisfaction. Cela le conduit par exemple à passer du concept du langage à celui de lalangue, c’est-à-dire de poser que le signifiant comme tel travaille non pour la signification mais pour la satisfaction.
La direction qu’indique le dernier enseignement de Lacan, c’est finalement une tentative de surclasser le dualisme de la signification et de la satisfaction, c’est-à-dire de poser une équivalence entre signification et satisfaction. C’est précisément la valeur de son Witz à propos de jouissance décomposée en sens et joui. La catégorie du «sens joui», ce Witz de Lacan dont j’ai fait un concept à force d’en parler, traduit le rejet des catégories dualistes de Lacan, et il introduit le dernier enseignement de Lacan qui est fait d’une élaboration continue de catégories monistes, c’est-à-dire qui pensent l’équivalence de la satisfaction et de la signification.
Ces catégories monistes, c’est premièrement celle du discours au sens des quatre discours qui pensent en même temps la signification et la satisfaction. C’est aussi bien, deuxièmement, le concept du sinthome qui est justement fait pour réunir symptôme et fantasme. Troisièmement, c’est le fameux concept de la lettre, qui est fait pour surclasser la dichotomie du signifiant et de l’objet.
L’enseignement de Lacan est passé par un véritable effondrement de la conceptualisation dualiste. C’est ce qui a donné naissance à sa tentative borroméenne qui repose sur un ternaire, mais qui traduit foncièrement l’effort pour aller au-delà de ce dualisme initial.
3. LE RÈGNE DE LA PIERRE
Continuons maintenant l’exploration du concept de la vie, et par la limite, qui est l’inanimé, ce qui ne bouge pas. C’est ce que Lacan appelle le règne de la pierre.
Lacan introduit le règne de la pierre par la douleur dans L’éthique de la psychanalyse pages 73-74. La douleur, c’est ce que le vivant évite à condition qu’il puisse se mouvoir, et il ne peut pas se mouvoir quand la douleur vient de l’intérieur. Là, il est comme pétrifié. C’est pourquoi Lacan, dans un petit excursus, indique que l’être qui n’a pas la possibilité de se mouvoir nous suggère la présence d’une douleur pétrifiée. En effet, à l’opposé du corps vivant, nous trouvons la pierre et le règne de la pierre. L’architecture elle-même, dit Lacan, nous présentifie la douleur.
Je vous avais parlé l’année dernière de la pierre que l’on rencontre sur le chemin, et qui figurait dans un poème de Carlos Drummond de Andrade. J’ai trouvé une autre pierre, celle de Lacan, le règne de la pierre présentifiant la douleur, et j’ai trouvé une pierre qui n’est pas brésilienne, une pierre allemande qui se rencontre au détour du cours de Heidegger professé en 1930 qui s’intitule Les concepts fondamentaux de la métaphysique, un séminaire tout à fait exceptionnel où il fait en particulier un sort à la pierre.
«La pierre est sans monde»
La seconde partie du cours de Heidegger permet de rencontrer la phrase suivante : «La pierre est sans monde». Cette phrase ne se donne pas pour poétique mais pour une thèse philosophique, et elle ne désigne pas une pierre qu’il y a sur mon chemin, comme dans le poème, une pierre qui est cette pierre-ci et non pas une autre. Elle se réfère à la pierre comme telle, à ce qui est commun à toutes les pierres, disons à l’essence de la pierre. Heidegger s’intéresse à la pierre, comme tout le monde – sauf les minéralogistes –, pour faire la différence avec le vivant.
C’est une phénoménologie de la pierre, et en même temps le degré zéro de la phénoménologie puisqu’elle n’a pas de monde. Il ne s’agit pas du phénomène de la pierre telle qu’elle apparaît dans mon monde à moi, mais d’une phénoménologie où la pierre serait sujet, effectivement une expérience limite, puisque, comme dit Heidegger, on ne peut pas se transposer dans une pierre.
D’ailleurs, comme on est dans la philosophie, on n’est même pas sûr que cette thèse se réfère vraiment à quoi que ce soit qui soit une pierre. Heidegger ne se réfère à la pierre qu’au titre d’un exemple de ce qui est matériel par rapport et par opposition à ce qui est vivant : les plantes, les animaux, les hommes. Heidegger parle des animaux et des hommes. Curieusement, il ne parle pas des plantes, sans doute parce que l’individuation est en question concernant les plantes : elle fait problème dans le végétal, tandis que l’animal nous donne le Un du corps. Et la pierre, pas le rocher, pas la montagne, la pierre nous donne aussi finalement cet Un.
«La pierre est sans monde» est une thèse qui se formule pour Heidegger sur le chemin de faire la clarté sur ce qui constitue la nature du vivant, à la différence de ce qui est sans vie et qui, de ce fait, n’a pas la possibilité de se mouvoir. Cette thèse est par Heidegger conçue pour nous donner une première entente de ce qu’il appelle le monde – soit, pour ravaler un peu cela, l’Umwelt de l’espèce humaine. C’est ce qu’il vise en définitive, l’Umwelt sur lequel l’homme est ouvert, mais qu’il n’entend pas au sens de la déhiscence de Lacan.
Cette chose matérielle qu’il appelle la pierre, elle est sans monde, c’est-à-dire elle n’a accès à rien d’autre, à aucune autre chose. Être sans monde n’est pas pour la pierre une privation. L’absence de monde ne creuse pas dans la pierre un manque, elle est ce qu’elle est et elle est là où elle est. Si nous la jetons au fond d’un puits, elle tombe et elle reste au fond du puits, dit Heidegger... Mais il commence par dire, sans que cela n’ait rien de poétique : «La pierre se trouve par exemple sur le chemin».
Pierre aléatoire et naturelle
J’interromps ici la démonstration philosophique pour faire un peu de mauvais esprit. Il est bien trouvé cet exemple de la pierre philosophique. Il s’approprie vraiment bien à la démonstration. Entre toutes les choses matérielles, on ne pouvait pas choisir meilleur exemple. De ce fait même cet exemple n’est pas quelconque, c’est un exemple de démonstration, un paradigme. La pierre est là pour illustrer l’absence de monde de tout ce qui est matériel, mais encore fallait-il choisir cette matière pondéreuse pour qu’elle reste bien là où elle est, qu’elle ne se déplace pas comme l’animal.
Si elle était plus légère, la pierre, elle flotterait, une rivière pourrait l’entraîner dans son mouvement. Si elle était plus légère encore, elle serait entraînée dans le vent – Quale piuma al vento –, et elle se prêterait à évoquer l’être vivant, et précisément dans l’espèce humaine la femme, la donna è mobile.
Il se pourrait d’ailleurs que les connotations de la pierre lourde et immobile soient à chercher du côté de l’homme, du mâle. C’est d’ailleurs ce que signale Lacan dans son Séminaire IV, au troisième chapitre, à titre d’exemple aussi. Il signale qu’il suffit que la pierre soit érigée, dressée, pour qu’elle puisse devenir symbole du phallus. Cela veut dire que le signifiant sait s’emparer des pierres et les transformer à son image, je veux dire en signifiants. La pierre sur le chemin pourrait être simplement un caillou, un de ces cailloux du petit Poucet. C’est le caillou qu’il sème pour retrouver son chemin et celui de ses frères, alors que son père désirait les perdre et les avait conduits au cœur de la forêt vers nulle part, c’est-à-dire vers un lieu propice à les égarer. D’ailleurs, les chemins qui ne mènent nulle part sont très chers à Heidegger – vous connaissez ses Holzwege qui font le titre d’un de ses ouvrages. Le petit Poucet est un exemple qui montre précisément que le caillou n’est pas tout seul enfermé dans son être-en-soi, mais qu’il peut faire partie de la chaîne des petits cailloux, au croisement de deux projets issus d’un Dasein et d’un autre, du Dasein du papa du petit Poucet, et du Dasein du petit Poucet. Le projet de perdre et d’égarer est le projet contraire de s’y retrouver. Cet exemple montre déjà que la pierre – nous n’en sommes qu’à la pierre, pas au corps vivant –, dans cet exemple au moins, est engagée dans le signifiant.
La pierre est évidemment encore plus engagée dans le signifiant si elle est borne sur le chemin, qu’elle porte des noms et des chiffres qui indiquent les lieux dits et les distances.
Et que dire de la pierre, si elle ne se rencontre pas sur le chemin de Heidegger, mais dans le laboratoire de minéralogie ? Elle est prise à ce moment-là dans le discours de la science. Elle pourrait être aussi dans un musée. Et pourquoi pas se révéler une pierre précieuse sous la loupe d’un diamantaire. Il ne resterait plus alors qu’à l’offrir, l’offrir à une femme dans l’espoir que, lestée de ce poids, elle se révélera moins mobile.
La pierre peut marquer un territoire, un seuil, celui par exemple d’un espace défendu, sacré. Le philosophe serait alors bien mal avisé de la jeter au fond de son puits. La pierre peut être creusée, être peinte, on peut écrire dessus, la sculpter. Le philosophe a donc bien fait de choisir sa pierre naturelle, tombée sur le chemin par hasard, c’est-à-dire en un lieu déterminé par l’automaton de la gravitation, sans répondre à l’intention d’aucun être vivant, pas même d’une femme, pas même d’une fourmi qui ne déplace que des brindilles, ou d’un castor, qui s’intéresse au bois et non à la pierre.
Je veux souligner que le philosophe ne prend pas n’importe quelle pierre pour illustrer son propos de l’absence de monde. Il prend une pierre qui appartient à la nature, ce qui veut dire qu’elle n’est pas inscrite dans la culture, c’est-à-dire qu’elle n’est pas dans le monde de l’homme où la pierre devient un signifiant. La pierre est sans monde, sans monde qui soit le sien, mais le monde de l’homme n’est pas sans les pierres dont il fait grand usage pour ses projets.
Il est heureux qu’il ait rencontré sa pierre aléatoire et naturelle sur le chemin, car si elle était par hasard au-dessus de lui, elle pourrait être menaçante. C’est alors peut-être le philosophe qui aurait peur et qui s’irait jeter soi-même ailleurs. Le mot de menace vient justement de mince qui désigne la pierre qui surplombe et, de cette pierre qui surplombe, le philosophe ne pourrait pas en disposer à sa guise pour son expérience de pensée.
Peut-on dire, pour parodier Gertrude Stein :
«a stone is a stone, is a stone» ? Quand Heidegger énonce que «la pierre est sans monde», il ne s’agit pas de la même pierre que lorsqu’il ajoute aussitôt : «La pierre se trouve par exemple sur le chemin». La première est la pierre comme telle, l’essence de la pierre, qui ne se rencontre sur aucun chemin. On pourrait dire, pour parodier cette fois Mallarmé, que c’est l’absente de tout chemin, comme Mallarmé dit de l’essence de la rose, que c’est l’absente de tout bouquet. Tandis que la seconde, la pierre qui est sur le chemin, est une pierre. Pour qu’elle soit une pierre, il faut qu’elle soit Une.
Comment le Un vient-il à la pierre ? Vient-il de la pierre elle-même ? La Gestalt, la bonne forme de la pierre suffit-elle à produire le Un ? Faut-il deux pierres au minimum pour qu’il y en ait une et une autre. Non, dit Lacan. Jamais une pierre n’instaurera le signifiant Un. Pour qu’il y ait une pierre, il faut que l’ordre symbolique, le signifiant, soit déjà là dans le monde de l’homme extrait de sa langue. Pourquoi ne pas le dire à la Heidegger ? Il n’y a une pierre et aussi un chemin que par le logos.
IV APOLOGUES
Qu’est-ce qui fait la différence entre l’animé et l’inanimé, entre ce qui est matériel et ce qui est vivant ? C’est le point que prétend nous faire saisir la démonstration philosophique de la pierre qui est sans monde. Je vais faire devenir l’apologue de la pierre l’apologue du lézard, et je donnerai un peu plus tard aujourd’hui l’apologue au moins esquissé de la vie et de la vérité.
Quand viennent les beaux jours, je suis porté ou j’essaye de me laisser porter à l’amusement. C’est donc à prendre avec le grain de sel qui convient.
1. L’APOLOGUE DE LA PIERRE ET DU LÉZARD
La pierre, non pas philosophale, mais philosophique, que je suis allé chercher était là pour nous conduire au corps, au corps vivant. Il y a certainement de profondes affinités entre la pierre et le corps pour que la pierre soit tellement sollicitée quand il s’agit de donner une sépulture au corps quand celui-ci a été le corps d’un exemplaire de l’espèce humaine. La pierre est là toujours, qu’il s’agisse de la caverne, de la pyramide, ou de la pierre tombale. On retrouve toujours cet Un rigide, que ce soit sous la forme du trou dans le rocher ou sous la forme du plein, de la stèle. Et encore, lorsque le corps est livré à la flamme, on trouve l’urne, c’est-à-dire le vase dont j’ai tracé le symbole en attente.
La pierre n’est pas l’animal. Le philosophe fait tourner la différence qu’il y a entre l’une et l’autre autour du concept de monde, et deux formules résument cette différence : la pierre est sans monde, tandis que l’animal, lui, n’est pas sans monde, sans que le philosophe aille jusqu’à l’affirmation qu’il a un monde. Cette affirmation, il la réserve à l’homme. C’est donc un petit peu de monde pour l’animal, quelque chose du monde, mais un monde qui apparaît déficitaire ici parce qu’il n’est pas placé, réparti, il n’est pas saillant dans ses parties par défaut de logos.
Pour l’illustrer, Heidegger amène sur la pierre rien d’autre qu’un lézard, allongé sur elle au soleil. On croirait une fable. La pierre n’est pas sur le sol comme le lézard est sur la pierre. C’est là tout le nerf de la démonstration. La pierre repose sur le sol, elle est en contact avec le sol, elle exerce une pression sur lui, elle le touche. Mais qu’est-ce que ce toucher de la pierre ? Ce toucher de la pierre sur le sol n’est pas la relation que le lézard, lui, entretient avec la pierre, et encore moins celui, dit Heidegger, de notre main sur la tête d’un être humain. Je le cite : «La pierre se trouve sur la terre, mais elle ne la tâte pas. La terre n’est pas donnée à la pierre comme appui, comme ce qui la soutient, elle n’est pas donnée comme terre en tant que terre, et surtout la pierre ne peut pas rechercher la terre comme telle». On peut ajouter : elle obéit à une loi de la gravitation, mais elle ne cherche pas la terre comme le lézard la cherche. Le lézard, lui, a recherché la pierre, et il se chauffe au soleil. Pourtant on peut douter que le lézard se comporte comme nous lorsque nous sommes allongés au soleil. On peut douter que le soleil lui soit accessible comme soleil.
C’est de ces remarques de bon sens que le philosophe déduit la différence entre le genre d’être du lézard et le genre d’être de la pierre. Comment exprimer cette différence ? Le philosophe signale que le lézard a une relation qui lui est propre à la pierre, au soleil et à bien d’autres choses ; tandis que la pierre, elle, n’a aucune relation qui lui soit propre, avec rien de son environnement. Dès lors, tout ce que nous exprimons, tout ce que nous rêvons à propos du monde de l’animal, et qui s’exprime dans notre langage, est par là même douteux, et par là même inapproprié.
Heidegger propose ceci : «Nous devrions raturer ces mots» – le mot de terre comme le mot de soleil, comme le mot qui désignerait quelque objet que ce soit que nous reconnaissons dans notre monde, où nous pouvons observer que le lézard a une relation propre avec ces objets mais qu’il n’a pas la nôtre et qu’il ne les identifie pas comme nous le faisons en nous exprimant par ces mots. En les utilisant, si inappropriés qu’ils soient, nous voulons indiquer que ces choses lui sont données d’une façon ou d’une autre, mais qu’elles ne sont pas reconnues comme telles ainsi que nous le faisons dans notre logos.
Le philosophe reconnaît donc à l’animal un monde qui est le monde ambiant, celui dans lequel il se meut. C’est un monde qui comporte la nourriture qu’il cherche, qu’on lui apporte, les proies sur lesquelles il se jette, les ennemis qu’il fuit ou qu’il affronte, les partenaires sexuels qui se font reconnaître, ou dont il se fait reconnaître dans la parade. Voilà autant d’éléments qui constituent quelque chose d’un monde. De plus, dans la nature, il a un milieu précis qui est le sien, un Umwelt, et il a un comportement, alors que la pierre n’a pas de comportement. Il a une manière d’être qu’on peut appeler la vie, mais le philosophe lui-même met des guillemets, puisque le terme saisi dans cette phénoménologie est énigmatique.
Voilà ce qui justifie d’assigner à l’animal quelque chose du monde par rapport à la déficience totale de la pierre quant au monde et qui se prête à comparer alors le monde humain. Le monde animal est à cet égard un monde essentiellement pauvre qui est marqué par la fixité et par le nombre toujours limité et déterminé de ces objets.
Nous voilà passés de la pierre à l’animal, la plante restant entre parenthèses.
Il y a place ici pour deux divertissements que je ne ferai qu’esquisser. Le premier, dont on pourrait faire tout un développement concernant la pierre, ce serait celui de Deucalion, et le second celui du lézard.
Comment ne pas évoquer d’abord le mythe qui voit se transformer les pierres en êtres humains et qu’on trouve résumé par Robert Graves à partir d’Apollodore et d’Ovide.
Il y eut un déluge où toutes les créatures terrestres périrent. Ce n’est pas la Bible, c’est la mythologie gréco-romaine. Et resta seulement le couple, hétérosexuel, de Deucalion et Pyrrha. Et les voilà qui demandent aux dieux que le genre humain soit reconstitué. Zeus leur délègue Thémis qui leur dit : «Couvrez-vous la tête et jetez les os de votre mère derrière vous». Ils comprennent alors qu’il s’agit de la terre-mère dont les os étaient les pierres. Ils interprètent le message divin, ils comprennent que «les os de votre mère» désignent les pierres qui sont là, après le désastre de ce déluge qui a soustrait à la terre tout être humain et animal. Alors, ils firent, dit le mythe, comme il leur était commandé. Et chaque pierre jetée ainsi derrière, en se couvrant la tête, devint un homme ou une femme, selon qu’elle avait été jetée par Deucalion ou par sa femme Pyrrha. Et depuis lors, dit le mythe, un homme et une pierre sont le même mot dans beaucoup de langues : laos, laas.
Voilà ce qui pourrait être au principe d’un petit divertissement qui pousserait à chercher à partir de cette donnée, dans les mythologies et les religions, les histoires qui associent la pierre et l’animé.
2. LE LÉZARD ET LE SIGNIFIANT
D’avoir rencontré le lézard dans le cours de Heidegger, m’a fait revenir le petit poème de Lamartine qui s’appelle «Le lézard» et porte en exergue «Sur les ruines de Rome», 1846. C’est à la fois le même lézard et en même temps tout à fait un autre, puisque cela pourrait s’appeler «Le lézard et le signifiant».
LE LÉZARD SUR LES RUINES DE ROME
(1846)
Un jour, seul dans le Colisée,
Ruine de l’orgueil romain,
Sur l’herbe de sang arrosée
Je m’assis, Tacite à la main.
Je lisais les crimes de Rome,
Et l’empire à l’encan vendu,
Et, pour élever un seul homme,
L’univers si bas descendu.
Je voyais la plèbe idolâtre,
Saluant les triomphateurs,
Baigner ses yeux sur le théâtre
Dans le sang des gladiateurs.
Sur la muraille qui l’incruste,
Je recomposais lentement
Les lettres du nom de l’Auguste
Qui dédia le monument.
J’en épelais le premier signe :
Mais, déconcertant mes regards,
Un lézard dormait sur la ligne
Où brillait le nom des Césars.
Seul héritier des sept collines,
Seul habitant de ces débris,
Il remplaçait sous ces ruines
Le grand flot des peuples taris.
Sorti des fentes des murailles,
Il venait, de froid engourdi,
Réchauffer ses vertes écailles
Au contact du bronze attiédi.
Consul, César, maître du monde,
Pontife, Auguste, égal aux dieux,
L’ombre de ce reptile immonde
Éclipsait ta gloire à mes yeux !
La nature a son ironie :
Le livre échappa de ma main.
Ô Tacite, tout ton génie
Raille moins fort l’orgueil humain !
Lamartine
Je me contenterai d’un petit commentaire qui est à peine nécessaire, à peine utile.
La pierre et l’écrit
Nous retrouvons ici le lézard et la pierre qui font couple, comme dans la fable de Heidegger, mais la pierre est ici une pierre qui porte de l’écrit, précisément l’inscription d’un nom propre, celui d’un Auguste. L’Auguste est évidemment pour nous plutôt, aujourd’hui du moins, le nom d’un type de clown, mais c’est, dans le poème, le nom d’un César, un nom qui a fait fonction de signifiant-maître. Il n’y a donc pas ici seulement la pierre et le lézard dans le poème. Il y a en sus le signifiant, et il y a l’homme, Monsieur Lamartine, qui est un mâle en dépit des résonances de son nom.
Le lézard, c’est le lézard éternel. C’est le même lézard que celui de la Forêt noire – je suppose – que nous amenait Heidegger. C’est ce lézard qui a sa relation propre avec le soleil et avec la terre dont il faut raturer le nom, parce que le signifiant n’entre pas dans ce que le lézard a comme monde. Pour lui, cela ne fait aucune différence de se prélasser sur la pierre ruinée du Colisée à la place même du plus haut signifiant-maître ou d’être sur la pierre abandonnée de la Forêt noire. Le lézard est présenté ici en effet avec son monde, engourdi de froid et cherchant la chaleur, et par là même se dirigeant à une certaine place dans le monde, dans son monde. Et l’homme est ici aussi avec son monde, l’homme Monsieur Lamartine, et c’est un monde bien différent qui a une tout autre structure.
D’abord, l’homme ce n’est pas n’importe qui. Cet homme a un nom propre comme le nom qui figure sur la pierre. Le monde de l’homme, ce n’est pas le monde de l’homme éternel, comme pour le lézard. Il est précieux que le poème lui-même soit daté en exergue. À cet égard, il n’y a pas d’homme au monde éternel, comme le lézard. Ici, c’est exactement le monde romantique qui surgit en quelques phrases, en quelques vers, et bien daté de 1846.
Il y aurait beaucoup de choses à dire de cette année si l’on voulait. C’est un monde, celui-là, qui est tissé de signifiants et enveloppé par une signification dominante que nous appelons le romantisme. C’est un monde en particulier où l’on se déplace un livre à la main – non pas un guide touristique, pas encore. On se déplace avec un livre de Tacite qui rend présent ce qui a eu lieu dans l’histoire, et qui rend déjà par là la place de l’homme problématique. À l’aujourd'hui de 1846, il écrit pour les temps à venir. Il consigne les impressions de son monde et le fait durer par le signifiant. Il est aussi bien transporté par sa faculté imaginative dans le passé reculé qu’il se prend à décrire au présent. Il est sensible que, dans le monde de l’homme, le présent subit ses variations, est capable d’accueillir et la visée de l’avenir et la visée rétrospective, la visée du passé.
Ce livre qui est évoqué dans le poème et le poème lui-même sont là pour nous rendre présent ce qui se transmet à travers les âges pour les hommes. Il n’y a pas le lézard éternel, toujours le même à travers les âges, mais il y a ce signifiant qui a ces pouvoirs extraordinaires sur le temps. Le livre de Tacite, ici, l’inscription incrustée, le poème lui-même nous rend présent ce qui se transmet pour l’homme à travers les âges, tel le germen immortel de la lettre qui survit au corps vivant.
Nous trouvons là justifié ce qui pouvait paraître la mystérieuse analogie que Lacan a introduite dans son Séminaire Encore entre la fonction de la lettre et le germen. Une fois qu’on en a aperçu la pertinence, on ne manque pas de la retrouver.
Ruines
Ce monde romantique est daté, c’est un monde où l’on se souvient et où l’on médite sur les ruines de ce qui fut grand. Les ruines, c’est un bateau, un stéréotype, un lieu commun, un topos éminent de la méditation romantique. Les ruines ont commencé à retenir, à passionner à la fin du dix-huitième siècle, et puis cela n’a été que grandissant par la suite jusqu’à être vraiment le lieu éminent d’où ce poème est émis. Les ruines incarnent à la fois l’élévation et les grandeurs des civilisations et leur déchéance, leur mortalité. Ici, ce sont les ruines du Colisée, c’est-à-dire de l’édifice impérial le plus colossal que la civilisation ait produit dans notre aire géographique – il y a évidemment également les pyramides. Ce sont ces ruines colossales qui constituent ici le monde propre de cette méditation, et les ruines, celles qui ont fasciné les poètes et les peintres préromantiques et romantiques. Ce sont des phénomènes de pierre, et même précisément la pierre revenue à la pierre, rendue à l’inanimé après avoir été insérée dans une architecture, et puis, au-delà de l’architecture, insérée dans un mode de vie, insérée dans des modes-de-jouir dont le poète signale la barbarie : «Je voyais la plèbe idolâtre baigner ses yeux dans le sang des gladiateurs». Cette pierre a été au moins métaphoriquement animée par l’esprit d’une civilisation et, à l’état de ruine, la pierre est rendue à la pierre, à l’inanimé.
Le malaise dans la civilisation est d’ailleurs un thème éminemment romantique, et qui n’est pas développé ainsi avant qu’ait pris consistance le monde romantique. La notion de malaise dans la civilisation, cette sensibilité, est absente du siècle classique, du dix-huitième siècle – elle ne point que vers la fin. Le malaise dans la civilisation sera au contraire élaboré, dans toute la première partie du dix-neuvième siècle, comme le diagnostic par excellence des romantiques sur la civilisation qui leur était contemporaine. Et ce thème du malaise dans la civilisation est adossé à celui des ruines de la civilisation. Ce savoir de la mort des civilisations trouvera sa formulation au début du vingtième siècle dans la phrase devenue elle aussi lieu commun de Valéry : «Nous autres, civilisations, nous savons que nous sommes mortelles ».
Le poème est encadré par le même syntagme qui se retrouve au second et au dernier vers, l’orgueil humain. Qu’est-ce que cet orgueil humain qui, si peu euphonique qu’il soit, a une frappe notable ? Il s’inscrit exactement dans le clivage de la culture à la nature. C’est la culture édifiée sur la nature et finalement ruinée.
Un événement de vie
Tacite, mémorialiste des crimes romains, fait ici fonction de critique interne de la culture. Tacite en compagnie de l’ouvrage duquel Lamartine se rend au Colisée, c’est la culture critiquant la culture. C’est déjà ainsi d’ailleurs que, dans son discours de réception à l’Académie française, Chateaubriand évoquait Tacite : «Déjà Tacite est né dans l’Empire». Cela avait été fort bien décrypté par les services de l’Empereur qui avaient repéré que l’allusion à Tacite dans l’Empire visait le signifiant-maître du moment. La présence du nom de Tacite est codée dans le poème. Tacite veut dire objection faite au pouvoir absolu et raillerie de ses élévations. La présence du nom de Tacite est, au sein même de la culture, la critique de la culture. Le poème est fait pour montrer que la critique du lézard est plus puissante et plus pénétrante, et plus radicale que la critique de Tacite. Tacite le cède au lézard, qui est ici mis en fonction de nature annulant la culture sous les espèces du nom du César rendu illisible par son interférence.
Tout est fait pour mettre en valeur la terrible métaphore du lézard sur César.
On peut compter que ce que vous entendez d’assonance dans cette métaphore est aussi bien ce qui a pu amener ici le lézard à sa place. La leçon du poème – il y en a une –, c’est que le lézard toujours l’emportera sur le signifiant, et que la paresse du lézard qui se dore au soleil, puisque c’est cette signification que l’on donne volontiers à son comportement dans son monde, l’emporte ici sur les efforts gigantesques des sublimations circulaires.
C’est ce que Lamartine désigne très joliment comme l’ironie de la nature, une ironie qui vient comme innocemment du contraste de cette paresse naturelle, de cette pauvreté du monde de l’animal, et de tous les ors, les fastes de la civilisation engloutie.
Il faut aussi mentionner une seconde leçon qui est cachée dans ce poème. Ce monde nous est présenté au départ comme un monde qui n’est plus que poussière, retourné tout entier à l’inanimé, à la mort. Les ruines toutes seules incarnent, célèbrent le triomphe morbide de la pulsion de mort. Mais, justement, quelque chose bouge dans cet univers figé où, au début, seul s’inscrivait l’homme qui se pose sur le livre d’une façon bien différente que le lézard sur la pierre et sur cette ligne qu’il ne peut pas déchiffrer. Dans ce monde figé où il n’y avait comme mouvement que celui de l’homme qui tourne les pages, se produit – et tout l’effet du poème est là – un minuscule événement de vie qui fait contraste avec ce lézard venu dormir sur le signifiant.
La valeur que prend cet événement de vie dans ce contexte, est-ce cette signification que la vie triomphe finalement de la mort ? Cela pourrait être que, finalement, dans tout ce qui est écroulé, la vie est encore là. Lui pense à la plante. Il pense au végétal. Il y a l’herbe, il y a le lézard. Mais est-ce que cela représente le moins du monde le triomphe de la vie sur la mort ? Cela prend au contraire ici la valeur du triomphe de la vie naturelle, de la vie éternelle – son triomphe sur la vie humaine tout encombrée d’orgueil et de sublimation.
J’aurais pu suivre ce petit lézard. Je suis sûr qu’avec un petit peu d’attention, on le verrait courir dans la littérature, dans la philosophie, dans la culture, avec la pierre sur laquelle il se repose et avec laquelle il entretient une relation propre. Je n’exclus pas que tel ou tel se mette à suivre le lézard. Je libère ce lézard et passe pour ma part au second apologue, qui est à vrai dire plutôt ce qui reste d’un apologue qui se serait appelé, si je l’avais mené à bien, l’apologue de la vie et de la vérité.
3. L’APOLOGUE DE LA VIE ET DE LA VÉRITÉ
Si cet apologue a tourné court, c’est que vie et vérité vont difficilement ensemble, au moins dans la psychanalyse où je vois mal comment pourrait être surmontée la scission de la vie et de la vérité. Il en va autrement dans la religion. On pourrait même définir la religion par la solidarité, voire l’identification de la vie et de la vérité. Voici donc ce qui reste du projet de cet apologue. Vous verrez repris des éléments que j’ai jetés un peu épars et qu’ici je mets en scène.
La vie et la vérité, c’est un couple inédit qui n’a pas l’habitude de se promener main dans la main dans les jardins du champ freudien.
La vie et la vérité, est-ce un beau couple, un couple bien appareillé ? La vie et la vérité sont-elles faites pour s’entendre ? Au moins, elles ne se coupent pas la parole parce qu’elles ne parlent pas en même temps. Elles ne parlent même pas ensemble. C’est déjà ce qui ruine le projet d’un dialogue. Seule la vérité parle, à vrai dire. C’est même l’essentiel de ce qu’elle fait. «Tu causes, tu causes, c’est tout ce que tu sais faire», comme dit Zazie. Et c’est précisément parce que la vérité parle que l’on ne sait pas ce qu’elle veut.
Que veut-elle ? On ne le sait pas davantage de la vérité que de la femme, selon Freud. Et c’est pourquoi Lacan est porté à identifier les deux, la vérité et la femme, toutes deux aussi pas-toute l’une que l’autre.
La vie au contraire ne parle pas. Elle ne prend pas la parole. C’est peut-être pour cette raison qu’on sait ce qu’elle veut. Elle veut se transmettre, durer, ne jamais finir. Les corps vivants meurent. La vie, elle, ne meurt pas. Elle se perpétue à travers les corps qui sont le support, le logement, l’habitat transitoire du groupe de cellules spécialisées qui assurent la reproduction, la continuité de la lignée, et qui sont dotées de l’immortalité potentielle. Si la vie pensait, on pourrait dire qu’elle ne pense qu’à se reproduire. Ce serait son obsession. La vie serait obsédée par la vie.
En même temps, le fait de savoir ce qu’elle veut n’est pas répondre à la question du pourquoi. Quelle autre réponse appelle cette question sinon celle d’Angélus Silésius ? – «La vie est sans pourquoi». C’est pourquoi on peut très bien dire la vie futile. C’est pourquoi aussi on est porté à s’imaginer que Dieu aime la vie, la protège, et en particulier contre les êtres humains qui semblent ne pas aimer suffisamment la vie, qui semblent être volontiers rebelles à se mettre au service de la vie. C’est ce à quoi se consacre volontiers la voie majeure de l’Eglise : protéger la vie contre les dommages que lui causeraient les vivants, les humains vivants ; et ainsi la voix qui porte la vérité du monde est en même temps celle qui se consacre à la défense de la vie.
Est-ce que ces êtres humains aiment davantage la vérité ? Au moins, ils professent l’aimer. Ils la représentent volontiers comme désirable. Voilà le topos, le nouveau, la figure d’une femme sortant d’un puits dans son costume de nature, incarnant la gloire du corps vivant, et dénonçant les vêtements comme autant de semblants, d’oripeaux.
Jusqu’à Freud – parce que nous avons lu Lacan –, la vérité ne parlait pas. On parlait d’elle, et on pouvait penser parler vrai. En effet, on ne peut pas parler sans sous-entendre «je dis la vérité». C’est vrai même de celui-là qui dit «je mens». D’où les paradoxes dont on s’est embarrassé dans la logique.
À partir de Freud, la vérité elle-même a commencé à parler dans le corps parlant, à parler dans la parole et dans le corps. Et dès que la vérité a commencé à prendre la parole elle-même, à se dire dans les trébuchements de la parole – c’est le lapsus – comme dans les exploits de la parole – c’est le mot d’esprit – comme dans les faux pas du corps – c’est l’acte manqué –, le naïf «je dis la vérité» a cédé sa place jusqu’alors immuable. C’est bien parce que je ne dis pas la vérité que j’ai besoin que l’on m’interprète, c’est-à-dire que quelqu’un désigne dans l’inévitable mensonge de ma bonne volonté, dans son malentendu, dans sa méprise, le moment, l’instant où la vérité fuse, fulgure, et se fait éclair.
Jusqu’à Freud, la vérité était discrète, elle par lait bas, on ne l’entendait pas. Avec lui, elle a pris de l’assurance. Et avec Lacan, la vérité s’est mise à trompeter : «Moi la vérité je parle». C’est une citation que vous trouverez dans «La chose freudienne».
L’idée de faire parler la vérité, de la faire parler si fort, de la faire parler en première personne, l’idée de la faire tonitruer, était peut-être dangereuse. Elle était venue à Lacan à partir de l’Éloge de la folie d’Érasme, qui était un exercice de gai savoir où l’humaniste faisait parler la folie en première personne et lui permettait de se présenter comme la vraie sagesse.
En effet, la vérité à la voix tonitruante, c’est la vérité devenue folle, la vérité maniaque, mégalomaniaque, ivre de la puissance que Freud lui avait donnée. Peut-être Lacan fût-il déçu par cette vérité. Peut-être la vérité finît-elle, après son moment de manie, par se déprimer. Elle reconnut qu’elle ne pouvait pas parler si haut, qu’elle devait seulement se dire à moitié, se mi-dire, comme s’est repris Lacan. Elle dit surtout avouer qu’en parlant la vérité ne disait pas la vérité mais qu’elle n’était qu’un semblant.
Oui, dans l’expérience inventée par Freud pour donner la parole à la vérité, la vérité se révélait aussi variable, aussi peu fiable que le mensonge, docile aux effets du signifiant, vouée à une métonymie sans trêve, soumise à des rétroactions sémantiques, changeant constamment sa valeur. Bref, la vérité se révéla n’être qu’un semblant.
Lacan, qui l’avait fait parler en première personne et un peu fort, fit passer la vérité à l’écriture, et ce fut le déclin de la vérité. Dans l’écriture logique, la vérité n’est plus qu’une lettre, sa lettre initiale grand V. Enchaînée aux axiomes et aux règles de déduction, elle est esclave de savoir élaboré en vue de coincer un réel.
Ah ! Voilà un autre couple, le réel et la vérité. Le réel se moque de la vérité, et c’est au regard du réel qu’il y a sens à dire que la vérité variable n’est qu’un semblant. Le corrélat du réel ce n’est pas la vérité, mais la certitude, qui est, si l’on veut, une vérité qui ne change pas. On arrive à la certitude du réel seulement par le signifiant comme savoir et non pas comme vérité. Pour ce qui est de la vérité, elle n’est éternelle, croit-on, que par un Dieu qui ne voudrait que le bien.
Combien plus discrète, combien plus tranquille, combien plus certaine est la vie qui ne parle pas. La vie n’a jamais songé à frayer avec la vérité. Depuis toujours, la vie a partie liée avec le savoir et non pas avec la vérité. Elle produit des corps qui savent sans avoir rien appris ou dont l’apprentissage est programmé, au sens où un programme est un savoir.
Qu’est-ce que la zoologie, la physiologie en fait, sinon que les organismes savent ce qu’il leur faut pour survivre ? Fondamentalement, ils sont aptes, apprêtés pour, dit le philosophe, le même que celui que j’évoquai pour la pierre. Les aptitudes prennent les organes à leur service. L’animal est par essence, comme s’exprime ce philosophe, accaparé. Accaparé veut dire que l’animal ne dévie pas de ce qu’il a à faire, qu’il est poussé. D’ailleurs, c’est à propos de l’animal, et précisément de la poussée qu’il connaît, qu’il subit et qu’il suit, que Heidegger emploie le mot de pulsion – il l’emploie à propos du mouvement pulsionnel qui anime l’animal sans qu’il dévie. Chez Heidegger, cela veut dire que l’animal n’est pas un être du souci, qu’il ne connaît ni la nostalgie, ni l’ennui, ni l’angoisse. Voilà autant d’affects que nous réservons, d’ailleurs comme structurants, au monde de l’homme, tandis que le comportement animal est conditionné par une poussée invariable qui ne connaît d’hésitation qu’en raison de la multiplicité des mouvements pulsionnels qui peuvent le tirailler. Voilà donc finalement le beau couple : non pas vie et vérité, mais vie et savoir.
4. LE CORPS MALADE DE LA VÉRITÉ
Mais il y a tout de même une exception. L’exception dans le règne de la vie, ce sont les corps habités par le langage, qui font vraiment tache dans l’animé, les corps de l’espèce humaine. C’est la honte de la création parce que ce sont des corps malades de la vérité. Ils sont malades parce que la vérité embrouille. La vérité variable, la vérité qui parle, la vérité qui change, embrouille le rapport du corps avec le monde et avec le pur réel. L’homme, les exemplaires de l’espèce humaine ne retrouvent un rapport net et certain avec le réel que par le biais d’un autre savoir que le savoir du corps, et qui est le savoir de la science. C’est seulement à devenir sujet de la science qu’il parvient à ne pas se laisser embrouiller par la vérité et par son corps malade de la vérité.
Refus du corps
En quoi le corps est-il malade de la vérité dans l’espèce humaine ? La psychanalyse a commencé par là, par s’intéresser à ces corps là, aux corps qui cessent d’obéir au savoir qui est en lui, qui cesse d’obéir au savoir que l’on peut dire naturel. En effet, le corps est savoir et il obéit. C’est ce que François Jacob appelle très bien «les algorithmes du vivant». L’idée ou le songe de l’âme traduit le fait que le corps se présente comme Un et qu’il obéit. C’est pourquoi Lacan a pu imaginer formuler que l’âme était du côté du manche. C’est l’équivalent d’un signifiant-maître.
La psychanalyse a pu commencer parce qu’elle s’est souciée précisément de l’hystérie, et ce qui caractérise l’hystérie est que l’on y rencontre le corps malade de la vérité. Freud l’a exprimé dans les termes du refoulement et du retour du refoulé. Le corps hystérique est celui qui refuse le diktat du signifiant-maître, le corps qui affiche son propre morcellement et qui en quelque façon se sépare des algorithmes, du savoir inscrit dans sa substance. C’est le phénomène que Freud appelait curieusement complaisance somatique et que Lacan, dans sa perspective, nomme «refus du corps».
C’est un double refus dont il s’agit là dans le corps hystérique, par le corps hystérique. Cela veut dire – premièrement, que le corps refuse d’obéir à l’âme, au savoir naturel, refuse de servir la finalité de son autoconservation – deuxièmement, que le sujet de ce corps là refuse le corps de l’Autre. De ce fait, la relation sexuelle se manifeste comme problématique : le sujet refuse le corps dans son corps, c’est-à-dire l’enfant, la reproduction – le corps hystérique a tendance à s’embrouiller avec la reproduction de la vie –, et refuse son propre corps, refus connoté de l’affect de dégoût qui tient la place que l’on sait dans la clinique de l’hystérie.
Pour ce qui est d’illustrer ce refus du corps, c’est-à-dire l’objection que le corps fait au signifiant-maître, on ne peut pas manquer d’avoir recours à ce qui reste le paradigme de cette clinique, à savoir l’article de Freud de 1910 sur «Le trouble psychogène de la vision dans la conception psychanalytique». À le lire dans la perspective que je propose, c’est évidemment le paradigme du rapport des mots et des corps.
Freud prend son départ d’un exemple de cécité hystérique, une cécité partielle, d’un œil, qui n’a pas de fondement, c’est-à-dire de causalité organique. Pour resituer un peu le texte, il commence par poser le fait qu’il existe de telles cécités qui n’ont pas de causalité organique. Pour prouver le fait, il a recours à la cécité hypnotique induite par les mots de l’hypnotiseur, et il amène là les prodiges qu’ont réalisés dans ce domaine les tenants de l’École française qui produisaient des cécités hypnotiques en deux coups de cuillère à pot.
Il faut bien voir que, dans ce texte, Freud n’allègue ce fait d’hypnose que pour donner une référence de cet handicap qui est là artificiellement produit et n’a pas de fondement organique. Il écrit : «Si on plonge dans une profonde hypnose une personne capable de somnambulisme, et qu’on lui suggère de se représenter qu’avec l’un de ses yeux elle ne voit rien, elle se comporte effectivement comme une personne devenue aveugle de cet œil.» Il n’allègue la cécité hypnotique que comme référence, comme le fait qu’il existe des cécités qui n’ont pas de fondement organique et qui peuvent être produites artificiellement par la simple mise en scène de l’hypnose.
Il examine ensuite la possibilité que le mécanisme de la cécité hystérique soit identique à celui de la cécité hypnotique, c’est-à-dire que la cécité spontanée de l’hystérie obéisse et soit de la même structure que la cécité suggérée. Il discute le mécanisme qui serait celui de l’autosuggestion que proposait l’École française : à la place de la suggestion extérieure par l’hypnotiseur, une autosuggestion. Il n’amène cette possibilité que pour l’écarter, parce que le mécanisme que Freud propose à la place de l’autosuggestion, c’est le refoulement, qui vient, à la même place, répondre à la question «quel est le mécanisme ici en place ?». Il discute le refoulement d’abord en termes de représentation avant de venir à discuter le phénomène en termes de pulsion. Le texte est de 1910. C’est vraiment un moment d’élaboration de la théorie, et il vaut la peine de regarder dans le détail comment il procède.
Une guerre des pulsions
Le refoulement se prête à une représentation guerrière, puisqu’il s’agit que des représentations en empêchent d’autres de devenir conscientes. Le principe de ce que Freud appelle le refoulement, c’est d’abord une guerre des représentations, les Vorstellungen, et il y a des représentations régulièrement plus fortes qui l’emportent sur d’autres, qui les dérangent, les empêchent de devenir conscientes. Le groupe des représentations plus fortes, c’est, dit Freud, ce que nous désignons sous le nom collectif de moi. C’est une très jolie définition, qui n’est pas la définition par le narcissisme, qui n’est pas la définition de la tripartition du ça, du surmoi et du moi. C’est la définition du moi comme le groupe des représentations capables d’en refouler d’autres, le groupe des représentations refoulantes.
Seulement, comme il s’agit ici du corps, Freud passe de la guerre des représentations – qui est sa transcription du refoulement ou sa façon de mettre en scène le refoulement – à une guerre des pulsions. Ce n’est pas seulement que, chez Freud, il y a un binarisme des pulsions, mais que ce binarisme donne lieu à une dynamique opposée des deux groupes de pulsions. Il vaut la peine là de relever sa formule selon laquelle les oppositions entre les représentations – c’est-à-dire ce qui cause le refoulement – ne sont que l’expression des combats entre les différentes pulsions.
Quel rapport établit-il, dans ce petit texte, entre pulsion et représentation ? Il met la pulsion derrière la représentation. La pulsion, c’est la dynamique même des représentations. C’est par là qu’il établit un rapport étroit de la représentation et du refoulement. La pulsion donne vie aux représentations conformes à ses buts. La pulsion apparaît à cet égard comme ayant la forme d’une volonté qui s’impose aux représentations et qui les asservit à sa finalité.
À cette date, le binarisme freudien des pulsions dispose d’un côté les pulsions du moi et de l’autre les pulsions sexuelles. La théorie dans cet article n’est pas encore celle de l’opposition des pulsions de vie et des pulsions de mort. C’est celle des pulsions du moi et de ce qui y échappe. Ce qui est de l’ordre sexuel y est placé comme ce qui échappe à cette domination. Et ce sera une autre répartition à laquelle Freud procédera à l’occasion de sa seconde topique.
Il faut entrer dans ce binarisme parce que c’est la première façon de comprendre que ce que nous connaissons comme les deux corps du sujet chez Lacan – le corps spéculaire et le corps «organique», que nous voyons s’introduire à partir du «Stade du miroir» –, nous les trouvons chez Freud. Ce sont deux autres deux corps, mais tout cet article nous manifeste que Freud raisonne dans ces termes.
Qu’est-ce que les pulsions du moi ? Ce sont les pulsions animales. Au moins ce sont celles qui servent à la survie du corps individuel, à l’autoconservation de l’individu, celles qui relèvent du savoir du corps. Et l’organisme est fait pour obéir à ce savoir. Les pulsions dont il s’agit ordonnent à cette fin les représentations et ce savoir domine normalement le corps.
La deuxième catégorie, qui relève du sexuel, est située par Freud comme échappant à ce qui est là un empire, une ordonnance. On ne voit évidemment pas pourquoi la pulsion sexuelle en elle-même obligerait, échapperait ou serait en conflit avec ce domaine des pulsions du moi. Après tout, on pourrait très bien – c’est ce que Freud fera par la suite – faire entrer dans la même rubrique les pulsions qui ont pour finalité l’autoconservation du corps individuel et celles qui ont pour but sa reproduction. Ce serait simplement étendre l’autoconservation de l’individu à l’espèce. On pourrait admettre qu’il y ait là une extension mais non pas une antinomie.
Tout est dans le fait que Freud met en question le singulier de la pulsion sexuelle, et que régulièrement il emploie au contraire dans le texte le pluriel à propos du domaine pulsionnel sexuel. Il parle des pulsions sexuelles partielles au pluriel et dans leur multiplicité. La confrontation, c’est celle de l’unification sous le régime du moi et la multiplicité des pulsions sexuelles qui ne sont pas ramenées à la pulsion sexuelle totale, termes que Freud emploiera par la suite.
Autrement dit, la base de cette construction est que la pulsion sexuelle comme reproductive échoue à subordonner à sa finalité de reproduction les pulsions sexuelles partielles attachées aux diverses régions du corps. Freud nous présente d’emblée un corps qui est un champ de bataille pulsionnel entre le moi et les pulsions partielles.
Le corps hystérique que nous présente Freud est un corps disputé entre l’autoconservation d’un côté et la jouissance pulsionnelle morcelée. Les organes de ce corps, par exemple l’œil, sont revendiqués de deux côtés. La cécité est une perturbation qui s’introduit dans le bon fonctionnement du corps dans la mesure où la vision sert les intérêts de la survie. Or, on constate qu’un organe ici cesse de concourir à cette fin d’autoconservation, en quelque sorte qu’un organe s’émancipe de l’unité du tout et déjà nous impose la présence du corps morcelé.
Un plaisir devenu jouissance
Comment cette perturbation s’introduit, c’est ce que Freud essaye de communiquer, et en raison du refoulement entretenu contre la pulsion sexuelle partielle concernée par le fonctionnement de l’organe. Cette perturbation associe deux faces. La première face, c’est qu’il s’agit ici d’un phénomène de vérité, ce que Freud exprime comme un refoulement de représentation qui a une conséquence somatique, qui a pour conséquence une soustraction.
Le refoulement qu’accomplit le moi se paye pour lui d’une émancipation de l’organe hors de sa tutelle, hors de sa maîtrise. Une fonction vitale se trouve ainsi soustraite à la somme supposée de l’organisme, cette somme qui s’appelle l’âme. On pourrait dire que la cécité traduit ici le fait que l’âme cesse d’animer l’organe.
La première face est un phénomène de vérité que Freud commente en termes de refoulement ou de représentations, mais de représentations qui sont susceptibles d’une formulation – c’est une représentation «je vois», «je ne vois pas». Voilà ce qu’il appelle représentation, c’est mis en mots. D’un côté, un phénomène de vérité, et associé à ce phénomène de vérité, un phénomène de jouissance, puisqu’un organe destiné à servir l’autoconservation de l’individu est sexualisé, c’est-à-dire érotisé au sens élargi que Freud rapporte volontiers au divin Platon. Cela veut dire que cet organe cesse d’obéir au savoir du corps, lequel est au service de la vie individuelle, pour devenir le support d’un «se jouir», avec l’accent d’auto-érotisme que l’on peut mettre dans la formule «se jouir». C’est ce qu’infère Freud. Si l’organe cesse de fonctionner, c’est parce qu’il est venu à être habité d’un «se jouir», et tout se passe comme s’il était coupable de ce «se jouir», comme si ce «se jouir» était une infraction à son fonctionnement normé.
C’est là que l’éthique s’introduit dans la biologie, comme elle le fait régulièrement. C’est pourquoi on impliquera plus tard le surmoi à cette place. L’œil peut et devrait servir au corps à s’orienter dans le monde, à voir, et le voilà qui se met à servir ce que Freud appelle la Schaulust, le plaisir de voir. C’est non pas du tout un plaisir régulé, mais un plaisir qui déborde la finalité vitale, et même qui conduit à l’annuler. C’est pourquoi ici le Lust est le plaisir devenu jouissance, et que le plaisir au sens propre, dans notre usage des termes, devient jouissance au moment où il déborde le savoir du corps, où il cesse de lui obéir. Ce que Freud appelle le plaisir sexuel, c’est ce plaisir devenu jouissance. Ici, tout le texte de Freud démontre que, pour lui, la vérité et la jouissance ont partie liée, qu’elles travaillent les deux contre les algorithmes du corps.
C’est d’ailleurs dans cette même perspective que Lacan a pu dire que la vérité est la sœur de la jouissance. Il n’y a pas un texte qui montre cette sororité de la vérité et de la jouissance mieux que ce texte de Freud sur «Trouble psychogène de la vision». Il montre que c’est une affaire de maîtrise, une affaire de signifiant-maître. Il dit, pour traduire la façon dont il nous présente ce corps disputé : «Il n’est facile pour personne de servir deux maîtres à la fois».
Le même organisme doit supporter deux corps distincts, deux corps superposés. D’un côté, un corps de savoir, le corps qui sait ce qu’il faut pour survivre, le corps épistémique, le corps qui sait ce qu’il lui faut, et de l’autre côté, le corps libidinal. Comme le premier, c’est le corps qui devrait normalement être régulé et dont la régulation devrait être plaisir, d’un côté, le corps-plaisir qui obéit, et de l’autre côté, le corps-jouissance, dérégulé, aberrant, où s’introduit le refoulement comme refus de la vérité et ses conséquences. Pour le dire encore d’une troisième façon, d’un côté le corps-moi, et de l’autre côté le corps-jouissance qui n’obéit pas au moi, qui est soustrait à la domination de l’âme comme forme vitale du corps.
C’est dans ces coordonnées que nous pourrons donner vie à la définition du symptôme comme événement de corps.
V- LE SYMPTÔME COMME ÉVÉNEMENT DE CORPS
J’ai fait un sort à la définition du symptôme comme événement de corps, une définition qui se rencontre une fois dans un petit écrit de Lacan des années soixante-dix consacré à «Joyce le symptôme» : «Laissons le symptôme à ce qu’il est : un événement de corps, lié à ce que l’on l’a, l’on l’a de l’air, l’on l’aire, de l’on l’a. Ça se chante à l’occasion et Joyce ne s’en prive pas».
1.DES ÉVÉNEMENTS DE DISCOURS
Avoir un corps
Le contexte immédiat est un contexte homophonique et qui parodie, comme une bonne partie de ce petit écrit, la pratique langagière de Joyce. Je me contenterai de retenir ici l’indication théorique que recèle cette petite chanson. Le symptôme comme événement de corps est connexe à l’«avoir un corps» et souligne que l’homme, terme générique, est caractérisé parmi les espèces animales par le fait d’avoir un corps. C’est mentionné à sa façon par Lacan
«LOM cahun corps et nan-na Kun».
«Avoir un corps» prend sa valeur de sa différence avec «être un corps». C’est pour l’animal qu’il peut se justifier d’identifier son être et son corps, tandis que cette identification de l’être et du corps ne se justifie pas pour l’homme, pour autant que tout corporel qu’il soit, corporifié, il est aussi fait sujet par le signifiant, c’est-à-dire qu’il est fait du manque-à-être. Ce manque-à-être comme effet du signifiant divise son être et son corps, réduisant ce dernier au statut de l’avoir.
Du fait qu’il a un corps, l’homme a aussi des symptômes avec lesquels il ne peut pas davantage s’identifier. C’est même le défaut d’identification où l’on se trouve concernant ce qui en général se présente comme une dysfonction qui fait saillir le relief du symptôme. On ne peut pas s’y identifier, sauf à recourir à une psychanalyse, dont une des issues, quand on a renoncé à tout, est de s’identifier au symptôme qui reste. Cela suppose donc que, pour avoir des symptômes, il faut avoir un corps, il ne faut pas être un corps, et que, pour s’identifier au symptôme, il faut avoir un psychanalyste. Il y a dans «l’avoir» bien des ressources dont la langue témoigne dans son usage. Le symptôme à l’état naturel, le symptôme qui n’est pas dénaturé par une analyse, est bien ce qui manifeste que l’on ne saurait identifier l’homme avec son corps.
Des traces
Ce corps est un corps où il se passe des choses, des choses imprévues, des choses qui échappent, comme dans l’exemple de Freud qui mérite d’être princeps dans cette question, son fameux «Trouble psychogène de la vision». Ces choses imprévues sont des événements qui laissent des traces dénaturantes, dysfonctionnelles pour le corps. On doit pouvoir aller jusqu’à dire que ce qui singularise le corps de l’animal humain, c’est toujours qu’il s’est passé des choses avec ce corps. Ce qui singularise le corps de LOM, c’est que toujours il y a eu des événements qui ont laissé des traces.
Peut-être faut-il épiloguer, varier, préciser cette définition de l’événement de corps. Cette expression est une condensation. Il s’agit en fait toujours d’événements de discours qui ont laissé des traces dans le corps. Et ces traces dérangent le corps. Elles y font symptôme, mais seulement pour autant que le sujet en question soit apte à lire ces traces, à les déchiffrer. Cela a finalement tendance à se ramener à ce que le sujet puisse penser retrouver les événements dont ces symptômes se tracent.
On peut trouver de ces traces chez l’animal. On y trouve des ébauches de symptômes quand cet animal est domestique, ce que Lacan appelle des séismes courts de l’inconscient. On trouve également ces traces chez le pauvre animal de laboratoire, quand on essaye de l’éduquer, de lui enseigner un savoir supplémentaire par rapport à celui dont il est doté par nature par rapport à celui qui s’identifie à son être de vivant, et qui lui permet de survivre comme corps.
Le point est assez remarquable pour que ce soit sur le rat de laboratoire que Lacan ait conclu son Séminaire Encore. On met le rat dans le labyrinthe et on lui demande d’apprendre à s’en sortir, de se manifester auprès d’un certain nombre de trous et de petites barres, de clapets. C’est évidemment un tout autre rapport au savoir que celui qu’il entretient avec le savoir naturel dont il a l’usage dans sa vie de rat. On constate que si l’on organise l’éducation du rat, sa formation, si on l’oriente, il s’y prête. J’ai tort de dire qu’il a ici un tout autre rapport au savoir qu’avec le savoir naturel puisque, avec son savoir naturel qui lui permet de survivre comme rat dans son environnement de rat, il n’a pas de rapport, il l’est. Alors qu’on commence à séparer doucement son être et son corps lorsqu’on le prend dans un appareil, une unité, pour lui faire passer un savoir dont il n’a pas besoin mais qui peut éventuellement satisfaire l’expérimentateur, qui est aussi observateur.
Comment le rat peut-il satisfaire cet Autre en lui donnant quelque chose qui est de l’ordre de la réplique ? Et la réplique essentielle qui en est attendue est l’équivalent d’un «je suis là». Lacan le résume en disant : «Tout ce que l’unité ratière apprend en cette occasion, c’est à donner un signe, un signe de sa présence d’unité.» Cela se réalise en posant sa petite patte sur un clapet. C’est l’exemple idoine pour saisir ce qu’il en est de la différence du signe et du signifiant.
On peut admettre que le signe est à la portée du rat dans la mesure exacte où le signe est le véhicule d’une présence, le témoignage d’un être, ici au bénéfice de l’expérimentateur. Cela ne va pas plus loin que le fait d’admettre que l’animal est capable de parler. Il ne dispose pas du signifiant mais de la parole en tant que l’adresse de signes de présence. Le rat qui fait signe de sa présence corporelle parle dans ce contexte, et même il parle avec son corps, sa petite patte sur le clapet. Et parler avec son corps, c’est ce qui caractérise le parlêtre. Chez l’homme, un petit peu déshumanisé grâce à cette graphie – LOM –, c’est de nature qu’il parle avec son corps, tandis que chez l’animal, c’est un effet de l’art.
C’est sur ce point, cette tête d’épingle, que l’on saisit ce qui distingue très précisément le signe et le signifiant. Le signe, si l’on est rigoureux dans l’emploi du terme, est toujours corrélé à une présence, alors que le signifiant, lui, est articulation. Être articulation, cela veut dire qu’il vaut pour un autre signifiant avec lequel il fait système, et qu’il n’est pas signe de la présence d’un être. C’est même ce que comporte la définition à la fois élémentaire et paradoxale que donne Lacan du signifiant qui représente le sujet pour un autre signifiant, un sujet qui est précisément indiqué du signe de son absence. Dans cette même série, nous avons donc ici l’être et ici au contraire le manque-à-être.

Cette dichotomie vaut comme matrice et permet par exemple de réfléchir comment il se trouve que le signifiant puisse devenir signe. Ce qui n’est pas indiqué par sa définition, tout au contraire. Le signe dans son usage propre est corrélé à une présence d’être, alors que le signifiant est toujours corrélé à un manque-à-être. Cela explique la lecture que fait Lacan de l’adage «Pas de fumée sans feu». Il n’y lit pas que la fumée est le signe du feu, mais il joue à ce que la fumée soit le signe du fumeur. Quel est le sens de cette plaisanterie ? C’est d’indiquer l’usage strict qu’il fait du terme de signe rapporté à une présence, et même à la présence d’un être.
Dans ce que nous appelons l’ordre symbolique, là, les signifiants parlent aux signifiants. Les signifiants s’entendent comme larrons en foire avec les signifiants. Et puis – L’on l’a, l’on l’aire, de l’on... Voilà que ces signifiants font système, même si vous êtes largué et n’y comprenez rien. C’est bien là qu’on voit que le sujet, lui, pour le compte, est absent.
Donnons à cela sa valeur radicale. L’ordre symbolique se maintient très bien comme hiéroglyphes au désert sans personne pour les lire. Cela se maintient sans personne et garde sa consistance. Le sujet barré de Lacan écrit le sujet, mais en tant qu’il est déjà mort. C’est le sujet du signifiant qui est de logique pure. Ce que Lacan appelle le sujet se maintient parfaitement hors corps, hors la vie. On pourrait dire que sans cela la pratique de lire n’aurait pas de sens.
Quand il y a quelqu’un, alors il y a des signes. Dans la psychanalyse, il est hors de question de réduire le psychanalysant au sujet du signifiant si l’on est cohérent avec cette disposition. Il y a quelqu’un. Et dire qu’il y a quelqu’un veut dire qu’il n’y a pas seulement le sujet du signifiant.
Qu’est-ce qu’il y a en plus du sujet du signifiant, de ce sujet qui, s’il était mort, il ne le saurait pas ? Il y a aussi l’individu affecté de l’inconscient, que Lacan nous glisse à la fin de son Séminaire Encore, l’individu affecté des mots. Et c’est encore trop dire. L’établissement d’un lexique, le découpage des mots, c’est déjà toute une affaire d’élaboration. Il y a l’individu affecté de la langue et de ce que l’on peut y lire.
Nous voilà avec d’un côté notre logique du signifiant avec son sujet mort, et de l’autre côté l’individu lui palpitant, affecté de l’inconscient. C’est parce qu’il y a ces deux versants que Lacan introduit en pointe ce qu’il appelle son hypothèse, à savoir que le sujet du signifiant et l’individu, c’est-à-dire le corps affecté, ne font qu’un : «Mon hypothèse, c’est que l’individu qui est affecté de l’inconscient est le même qui fait ce que j’appelle le sujet d’un signifiant.
Cela implique que le signifiant n’a pas seulement effet de signifié, mais qu’il a effet d’affect dans un corps. Il faut donner à ce terme d’affect toute sa généralité. Il s’agit de ce qui vient perturber, faire trace dans le corps. L’effet d’affect inclut aussi bien l’effet de symptôme, l’effet de jouissance, et même l’effet de sujet, mais l’effet de sujet situé dans un corps, et non pas pur effet de logique. Quand il s’agit d’effet durable, d’effet permanent, on peut à juste titre les appeler des traces.
Ordonner, réordonner ainsi notre panorama permet de comprendre que Lacan a curieusement félicité Aristote d’avoir génialement isolé l’upokeimenon. L’upokeimenon, c’est ce qu’il y a dessous au sens de la supposition logique ou de la supposition dont on a fait grand usage dans la logique du moyen âge, et qui se retrouve dans le sujet supposé savoir. Aristote, qui a le premier isolé le sujet logique, le sujet comme supposé et non substantiel, la pure fonction logique du sujet, Lacan le félicite d’avoir plus génialement encore oscillé en récupérant par intervalle l’ousia dans l’upokeimenon. L’ousia est le terme grec que l’on a approximativement traduit par la substance.
Qu’est-ce que cette double félicitation ? Il félicite Aristote d’avoir d’un côté isolé le sujet du signifiant, mais par ailleurs de ne pas l’avoir totalement disjoint de l’individu affecté qui, lui, doit bien être substance corporelle, et d’un corps qui n’est pas seulement le corps des parties, hors des parties, mais une substance jouissante. C’est un repérage très délicat de Lacan de retrouver la trace de ce qui l’amène, lui, à devoir distinguer et ordonner le sujet du signifiant et l’individu affecté dans l’oscillation d’Aristote.
C’est d’ailleurs pourquoi Lacan s’est extrait de ce binaire pour nous amener le parlêtre. Le parlêtre est l’union de l’upokeimenon et de l’ousia d’Aristote, l’union du sujet et de la substance, du signifiant et du corps. Il y a être, mais être en tant que parlé, être décerné par le dit. C’est donc un mixte oscillant, pourquoi pas, du manque-à-être qui travaille et qui agite l’individu.
2. L’ÉVÉNEMENT TRAUMATIQUE
Après avoir fait le travail de déblayage dans Inhibition, symptôme, angoisse en 1925, Freud en donne un résumé fulgurant dans la première moitié d’une conférence de 1933, Nouvelles conférences sur la psychanalyse, quand il parle de l’angoisse, l’affect majeur, qui ne se conçoit pas du sujet comme manque-à-être, mais d’un corps habité. Freud n’en parle pas seulement comme d’un état d’affect défini par lui comme réunion de sensations déterminées de la série plaisir/déplaisir, mais il en parle exactement comme d’une trace d’affect, Affektspur, et ce, parce qu’il la rapporte à un événement antérieur, Ereignis. On trouve évidemment chez Freud, à propos de ce qui affecte, le couple de l’événement et de la trace. Un événement, ou plus précisément même, dit Freud – c’est sa saisie de l’affect d’angoisse –, il y voit le précipité d’un événement important incorporé par l’hérédité.
L’événement important que Freud travaille là, c’est la naissance comme le supposé prototype des affects d’angoisse. Comme dit Freud, on pourrait reconnaître dans le processus de la naissance les mêmes signes physiques que dans l’angoisse, c’est-à-dire l’accélération de l’activité cardiaque et de la respiration. Freud en rend d’ailleurs hommage à Rank, plus gentiment que dans Inhibition, symptôme, angoisse, mais il nie en même temps que le processus de la naissance soit le prototype de l’angoisse, puisqu’il développe au contraire que chaque âge du développement présente une angoisse déterminée. Mais, après avoir fait miroiter l’angoisse comme cet événement principiel dont l’affect d’angoisse serait une trace, donc après avoir fait miroiter la naissance dans cette position, on le voit défaire la chose, ce qui ne l’empêche pas de donner une formule générale de l’événement de corps qui détermine des traces d’affect.
La définition générale de l’événement produisant traces d’affect, c’est ce que Freud appelle le trauma. C’est le traumatisme en tant qu’il est un facteur devant lequel les efforts du principe de plaisir échouent, un facteur qui ne peut pas être liquidé selon la norme du principe de plaisir, c’est-à-dire qui met en échec la régulation du principe de plaisir. L’événement fondateur de la trace d’affect est un événement qui entretient un déséquilibre permanent, qui entretient dans le corps, dans la psyché, un excès d’excitation qui ne se laisse pas résorber. Nous avons là la définition générale de l’événement traumatique, celui qui laissera des traces dans la vie subséquente du parlêtre.
Le traumatisme au sens de Lacan, le noyau de l’événement traumatique n’est pas rapportable à un accident, ou ça l’est toujours, mais la possibilité même de l’accident qui laisse des traces d’affect au sens étendu que j’ai donné, la possibilité même de l’accident contingent qui se produit nécessairement toujours, mais tel ou tel, ouvre l’incidence de la langue sur l’être parlant, et précisément l’incidence de la langue sur son corps. L’affection essentielle, c’est l’affection traçante de la langue sur le corps. Cela veut dire que ce n’est pas la séduction, ce n’est pas la menace de castration, ce n’est pas la perte d’amour, ce n’est pas l’observation du coït parental, ce n’est pas l’Œdipe qui est là le principe de l’événement fondamental, traceur d’affect, mais c’est la relation à la langue.
Ce sera ramassé d’une façon peut-être excessivement logicienne par Lacan dans la formule «le signifiant est cause de jouissance», mais cela s’inscrit dans la notion de l’événement fondamental de corps qui est l’incidence de la langue. C’est d’ailleurs ce qui a fait le ressort de la référence de Lacan à James Joyce, et précisément à son Finnegans Wake, et qui se trouve tout à fait indéchiffrable à partir de ce qui serait les souvenirs infantiles de Joyce.
Lacan a-t-il vraiment si longtemps méconnu la nécessité d’en passer par le corps ? Est-ce qu’il a fallu la pointe de cette hypothèse pour qu’il révise les catégories les plus fondamentales de son orientation ou qu’il les complète ? Est-ce que cela a été une exigence méconnue ? Non, puisque, à côté du symbolique, où gambadait, tournait en rond le sujet du signifiant, il a toujours réservé la place du registre imaginaire qui a d’ailleurs été au départ le dépotoir à jouissance. Il n’a jamais négligé le fait que le symptôme, même conçu comme métaphore, prend des éléments corporels comme signifiants.
Mais Lacan a tenu compte du corps essentiellement au niveau du fantasme en tant qu’il intervient dans la formation des symptômes, ce qui se trouve relevé dans son graphe double. Jusqu’à ce qu’il amène le parlêtre, il a tenu compte du corps au niveau de la formule du fantasme, qui écrit en effet la nécessité de compléter par un élément corporel le sujet du signifiant – ce sujet du signifiant négatif, intervallaire, intérimaire perpétuel, et mort, mort-né –, la nécessité de lui donner un complément corporel, mais à petits frais, c’est-à-dire petit a. Et avec ça, ça fait le compte.
Lacan a conçu ce complément corporel comme imaginaire d’abord – c’était plutôt la forme du corps, l’autre type stade du miroir qui s’introduit à cette place pour animer le sujet mort-né –, et gouverné par l’articulation symbolique. Des années plus tard, il en a fait un objet petit a réel auquel il a donné la valeur de plus-de-jouir – le corps est là présent parce que sous les espèces de l’excès de jouissance, d’ailleurs traumatisant. C’est essentiellement sous cette forme menue que s’est introduit le corps par rapport au biais du signifiant, et non pas sous les espèces de l’individu affecté de l’inconscient.
D’ailleurs, d’une façon générale, dans l’enseignement de Lacan, si l’on décompose le spectre de l’objet petit a, il est lui-même à double face. D’un côté, l’objet petit a est écrit et élaboré par Lacan comme vide. Par exemple, comme objet de la pulsion, il est pris comme un creux autour de quoi la pulsion tourne, et Lacan insiste sur son côté insubstantiel, ou l’objet petit a a une consistance de logique pure, ou ce n’est qu’un objet topologique. Autant d’aspects de l’objet petit a qui là doivent rendre possible qu’il soit appareillé au sujet. Et puis, il y a une deuxième face de l’objet petit a qui est au contraire sa face pleine. Il y a son aspect de prélèvement corporel, parce qu’il doit obéir à la même structure que celle du symbole de ce sujet barré. Vous avez ainsi des textes de Lacan qui s’enroulent et qui vous présentent tantôt la face vide et tantôt la face pleine, tantôt la face logique et tantôt la face corporelle de l’objet petit a.
Le terme de parlêtre, lui, surclasse cette dichotomie. Il implique en quelque sorte que c’est l’ensemble du corps – non pas comme un tout –, l’ensemble du corporel qui est prélevé, qui est là considéré comme affecté.
3. L’ÉVÉNEMENT DE CORPS DANS LA PSYCHOSE
Pour fonder l’événement de corps, pour le rendre sensible, pour l’incarner, j’ai eu recours à la description d’un symptôme comme événement de corps, non niable, dans le cadre de la névrose, la cécité hystérique. Mais le symptôme comme événement de corps est hautement susceptible d’être mis en évidence dans la psychose. Puisque, dans le texte de 1910, Freud est encore à se référer à cette dichotomie des pulsions du moi et des pulsions sexuelles, on peut avoir recours à son texte sur Schreber qui relève de la même dichotomie des pulsions du moi et des pulsions sexuelles.
La libido dans la paranoïa
Ce que Freud appelait la libido à cette date, c’était l’énergie propre aux pulsions sexuelles. Lui-même dit, encore en 1933, qu’il a construit cette dichotomie à partir du fait biologique incontestable, inébranlable, que l’individu vivant sert deux intentions : l’autoconservation et la conservation de l’espèce.
À peine a-t-il défini la libido comme l’énergie propre aux pulsions sexuelles qu’il s’emploie à montrer qu’elle ne sert pas les finalités de la conservation de l’espèce, mais qu’elle anime au contraire les pulsions partielles multiples et disjointes. Au niveau des pulsions partielles freudiennes, non seulement les deux groupes de pulsions se disputent la maîtrise du corps, et même de chaque organe, mais on a un corps morcelé. Freud nous montre ce corps morcelé en zones érogènes et chaque partie du corps susceptible d’être soustraite à l’unité fonctionnelle du corps en raison des investissements libidinaux. Le corps libidinal freudien est un corps dont les parties sont susceptibles de s’érotiser et par là même de s’autonomiser.
Le mécanisme mis en jeu par Freud pour rendre compte du symptôme est le refoulement qui porte sur des représentations. Lacan a fait beaucoup fonds sur ces représentations qu’il a transformées et qu’il a fait entendre comme signifiants. Mais chez Freud derrière les représentations, il y a les pulsions. Les pulsions s’expriment par des représentations. C’est sa façon de nous présenter une connexion du signifiant et de la jouissance. Au sens propre, le refoulement porte sur des représentations mais aussi bien sur les pulsions, et Freud n’hésite pas à parler de pulsions refoulées.
Le refoulement a toujours deux faces chez Freud. D’un côté, il manifeste la puissance du refoulant – du moi, à cette date. Le moi refoule la pulsion, inhibe son développement psychique, lui interdit l’accès à la conscience, mais c’est aussi sa défaite. La conscience cesse de dominer l’organe, celui-ci est abandonné à la domination de la pulsion refoulée et cette domination s’intensifie.
Dans ce texte assez court, Freud nous montre la pulsion refoulée faisant retour dans un organe. En dehors de la cécité, il donne l’exemple des organes moteurs, de la main paralysée parce qu’elle a été investie dans des tâches coupables érotiquement. Quand il s’agit du refoulement, de cet événement de corps, le résultat par excellence, ce sont des limitations fonctionnelles et des inhibitions.
Et dans la psychose, comment faut-il concevoir le destin de la pulsion, de la libido ? C’est la question qui intéresse Freud au premier chef quand il étudie le cas Schreber. Dans la troisième et dernière partie de son écrit du mécanisme de la paranoïa, ce qui l’intéresse, c’est ce que devient la libido dans le refoulement spécial qui a lieu dans la paranoïa. Freud, en effet, n’a pas la notion d’un refoulement, il a la notion d’une multiplicité de refoulements qui sont à préciser pour chaque structure clinique, et pour lui, d’une façon similaire à la multiplicité des points de fixation qui organisent la régression de la libido.
L’interlocution délirante
Cette dimension-là, qui est celle qui est la plus proche de l’événement de corps, est en quelque sorte écrantée pour nous par l’écrit de Lacan de la «Question préliminaire», qui est une réélaboration des Mémoires du président Schreber. C’est un écrit qui se consacre essentiellement à la phénoménologie et à la structure de l’hallucination verbale, qui en offre un classement inédit en phénomènes de code et phénomènes de message. Le pivot de l’intérêt de Lacan n’est pas l’événement de corps, c’est l’irruption du symbole dans le réel. Sa question, c’est comment le signifiant vient-il à se déchaîner dans le réel. C’est une question qui est essentiellement du côté du sujet du signifiant. Ce qui est de l’ordre de l’affection corporelle est tout de même écranté par l’extraordinaire élaboration de ce signifiant en effet déchaîné que l’on voit obéir en même temps à des chaînes précises, se rompre à un endroit précis.
Ce phénomène d’écrantage est déjà présent dans le premier exemple que Lacan amène de sa pratique, celui de l’injure «truie», qui est en quelque sorte la cellule qui va se retrouver amplifiée et varier dans la suite du texte.
Il s’agit, cueilli dans une présentation de malades, de ce que la malade rapporte de ce que lui aurait été adressée cette jaculation injurieuse par l’ami de la voisine, elle passant devant lui, et que nous traitons comme une hallucination verbale. Lacan s’attache à reconstituer un dialogue où s’inscrit cette jaculation comme une réplique. Il obtient de la patiente qu’elle lui dise en effet qu’elle avait murmuré, juste avant d’entendre de l’ami de la voisine cette injure, à part elle-même et par un sens d’allusion qu’elle-même ne peut pas déchiffrer : «Je viens de chez le charcutier». L’injure apparaît comme appartenant à la même chaîne signifiante, et Lacan construit une structure de l’interlocution délirante en supposant que, au départ, l’attribution du «je» de la phrase «Je viens de chez le charcutier» oscille entre l’ami de la voisine et la patiente, dans une situation duelle où il n’y a pas de point de capiton pour fixer. Le mot «truie», trop lourd d’invectives, ne peut pas suivre cette oscillation, et l’hallucination, c’est que ce mot passe dans le réel et revient de l’extérieur.
Tout son effort est de construire l’hallucination comme phénomène de communication. Il s’attache à nous montrer les symptômes comme phénomènes de communication. Ce qui pourrait concerner le symptôme comme événement de corps n’est pas absent, mais est minoré. Le corps y est, mais Lacan laisse de côté. L’indication est dans son texte. La patiente s’était enfuie quittant son mari et sa belle-famille, persuadée qu’ils se proposaient de lui faire son affaire, précisément de la dépecer. Autrement dit, il y a sous-jacente à cette affaire l’idée délirante d’une atteinte précise à l’intégrité de son corps. Lacan le signale pour aussitôt le faire oublier. On voit vraiment l’écran se mettre sur le registre événement de corps : «Qu’importe qu’il faille ou non recourir au fantasme du corps morcelé pour comprendre comment la malade répond ici à une situation qui la dépasse. À notre fin présente il suffit que...» Et suit la construction de l’interlocution délirante.
On pourrait ici rapporter le symptôme à un événement de corps, et Lacan tient surtout à le construire comme une réplique. Privilège est toujours par lui donné à cette date systématiquement à l’articulation symbolique. C’est dans ce contexte que la thèse est formulée qu’aucune formation imaginaire n’est spécifique, aucune n’est déterminante, ni dans la structure, ni dans la dynamique d’un processus. C’est un privilège qui se recommande de Freud selon Lacan, Freud qui nous en signifierait la nécessité par sa référence à l’Œdipe.
On voit bien comment, sur cette base, procède Lacan dans les éléments qu’il retient du symptôme. Il analyse essentiellement la séquence de phénomènes qui commence par le miracle du hurlement qu’il prélève dans les Mémoires de Schreber. Quand Lacan structure cet exemple qu’il a lui-même choisi, il s’attache à nous présenter Schreber suspendu à un effort de réplique. Il cherche le symptôme comme phénomène de communication. Ou comme il dit, le signifiant s’est tu dans le sujet. Ensuite, quand il ordonne les phénomènes qui suivent, le miracle du hurlement et l’appel au secours, il les ordonne en termes de signifiant et de signifié, c’est-à-dire qu’il voit apparaître une lueur de signification à la surface du réel, et ensuite les créatures hallucinatoires qui elles se mettent à parler de façon développée. Il laisse tout à fait de côté la raison délirante de ces phénomènes, que Schreber doit penser pour que Dieu jouisse de lui. Lacan met en valeur que, lorsque se produit le penser-à-rien, Schreber est incapable de répliquer.
Lorsqu’il s’agit du miracle du hurlement, de l’appel au secours, qui sont des phénomènes éminemment de souffrance corporelle intense de Schreber, comment Lacan les situe-t-il ? Il dit : «Le miracle du hurlement, l’appel au secours, deux phénomènes où le déchirement subjectif est assez indiscernable de son mode signifiant pour que nous n’insistions pas.» Ce qui s’accomplit dans cette parenthèse, c’est : nous n’allons pas insister sur le déchirement puisque ce qui compte c’est son mode signifiant.
Sujet de la jouissance/sujet du signifiant
Lacan laisse de côté de façon systématique l’aspect de l’événement de corps. Dix ans plus tard, Lacan soulignera cet aspect dans sa présentation des Mémoires de Schreber. Il signalera, d’une phrase qui oriente cette reprise, que Schreber donne support à la jouissance que Dieu prend de son être passivé. Cette considération que si Schreber pense, c’est pour assurer la jouissance de Dieu et le petit dédommagement qui lui en revient, est strictement absente de la «Question préliminaire». Y compris dans l’explication que Lacan peut donner du laisser tomber qui est un déchirement subjectif et corporel intense. C’est pourquoi quand il y revient ensuite, Lacan fait appel à ce qu’il présente comme la polarité la plus récente de son enseignement : sujet de la jouissance/sujet du signifiant. C’est déjà en 1966 la recherche de complémenter de façon authentique ce que le sujet pur du signifiant ne peut pas délivrer. C’est vraiment, dans le cas Schreber, et à cette place précisément, que l’on a le paradigme que la pensée est jouissance. Cette proposition à laquelle Lacan viendra longtemps après est là délivrée en clair. Et même que la parole est jouissance, puisque ce penser incessant de Schreber est spécialement manifesté par une cogitation articulée, éventuellement exprimée.
On trouve au contraire, dans l’exégèse de Freud, les deux versants tout à fait présents. D’un côté, l’articulation symbolique, c’est sa proposition de dériver les principales formes de paranoïa des différentes façons de nier une seule formule, ce qui est une réduction signifiante sensationnelle à partir de la proposition «Moi, un homme, je l’aime, lui, un homme». D’un autre côté, il s’intéresse aux avatars de la libido et de la pulsion dans la paranoïa. Il élabore le mécanisme de refoulement propre à la paranoïa, c’est-à-dire il élabore ce que nous pourrions appeler la forclusion de la pulsion.
Schreber, dans ses Mémoires d’un névropathe, illustre très bien la proposition de Lacan que la jouissance du corps de l’Autre qu’il symbolise n’est pas le signe de l’amour. Il n’est curieusement pas question une seconde d’amour entre Schreber et le Dieu déréglé auquel il a affaire. Il n’est question que de souffrance et de volupté, parce que, à l’horizon il y a le rapport sexuel comme tel de Schreber féminisé et de la divinité complexe à laquelle il a affaire.
L’amour suppose qu’il n’y a pas le rapport sexuel programmé. C’est ce que mime l’amour courtois en suspendant la relation sexuelle. C’est ce qui fait qu’il n’y a pas d’amour animal, et c’est ce qui justement fonde l’expression du signe de l’amour, et même que l’amour est signe. Le signe est toujours corrélé à un «il y a», c’est-à-dire à une présence qui s’enlève sur le fond de ce «il n’y a pas» du rapport sexuel.
Si on reprend les catégories que j’ai amenées au début, l’événement lacanien au sens du trauma, celui qui laisse des traces pour chacun, c’est le non-rapport sexuel. Il laisse une trace pour chacun, précise Lacan, non pas comme sujet, mais comme parlant. Il laisse des traces dans le corps, qui sont symptômes et affects. C’est ce qui permet à Lacan de définir la rencontre de l’amour comme celle de la rencontre avec tout ce qui marque dans un corps la trace de son exil du rapport sexuel, c’est-à-dire les traces dans le corps de ce qui est l’intolérable majeur, soit que – je cite Freud – «le but interne de la pulsion ne soit que la modification du corps propre ressenti comme satisfaction».
VI- LE CORPS SCHRÉBÉRIEN
J’ai pu marquer que, dans le cas Schreber, l’événement de corps se manifestait par une évidence, celle du témoignage du sujet tel qu’il est recueilli dans ses propres Mémoires, mais aussi bien que cet événement de corps n’était pas isolé, identifié comme tel par Lacan dans sa «Question préliminaire».
Est-ce à dire qu’il n’y a pas le corps dans cette «Question préliminaire» ? Certainement pas. Le corps et ce qui s’y passe est tout à fait relevé, aussi bien dans les moments de déchirements dont témoigne le sujet que dans ceux qui méritent d’être qualifiés d’une certaine restauration de ce corps.
1. LE CORPS DU STADE DU MIROIR
Le corps schrébérien tel qu’il est situé par Lacan, dans cet écrit du moins, est le corps du stade du miroir. C’est un corps scopique, un corps visuel, et dont la restauration est par excellence située dans le champ visuel, à partir du champ visuel. Il n’intervient dans cette conceptualisation qu’en parallèle par rapport à ce qui tient à l’articulation signifiante. Nous avons ainsi, distingués par le symbolique et par l’imaginaire, deux registres qui fonctionnent parallèlement. Certes, ils sont noués par ce que Lacan appelle la métaphore paternelle, c’est-à-dire une métaphore dont l’opérateur est le Nom-du-Père, et dont le résultat dans l’ordre du signifié est placé comme phallus. Cette métaphore paternelle constitue un nœud du symbolique et de l’imaginaire qui est pensé à partir des catégories du symbolique.
Sans doute, la forclusion du Nom-du-Père, c’est-à-dire l’absence de production de la métaphore paternelle, est, dans la construction de cet écrit, conçue comme inhibant la production de la signification phallique. Il se produit alors de ce fait une disjonction. C’est ce que veut mettre en valeur l’écrit de Lacan. La conjonction est le fait de la métaphore ; lorsque cette métaphore échoue, on se trouve devant une disjonction du symbolique et de l’imaginaire. La jouissance supposée localisée, tempérée par la signification phallique, se trouve en quelque sorte dispersée dans différentes localisations volontiers douloureuses du corps. C’est ainsi que Lacan peut poser que le défaut de la métaphore paternelle se traduit par une béance dans le champ de l’imaginaire. Mais, de ce fait même, les événements de corps isolés comme affectant le corps sont tous rapportés à ce que Lacan appelle une régression topique au stade du miroir, c’est-à-dire une régression locale, une régression dans l’espace et non pas dans le temps.
C’est la référence élective du corps que ce stade du miroir dans la construction de Lacan à cette date. Cette référence établit une liaison fondamentale du corps à l’image. Tel qu’il figure dans la «Question préliminaire» de Lacan, le stade du miroir est une construction qui est faite pour marquer que, lorsque le nœud métaphorique fait défaut, l’imaginaire retourne à sa logique interne, à une logique qui lui est propre.
Sans doute, le stade du miroir comporte essentiellement une différence entre l’organisme biologique et le corps visuel, une différence que l’on peut qualifier de béance, comme le fait Lacan, en montrant le sujet divisé entre ses sensations organiques et sa perception de totalité formelle. Mais, tel qu’il est arrivé à Lacan de présenter son stade du miroir, l’image corporelle totale à laquelle le sujet s’identifie a valeur de vie. C’est une image qui incarne la puissance vitale qui sera dans l’avenir, mais là rendue présente, celle du sujet. Le stade du miroir, que Lacan introduit alors qu’il cédait à l’idéologie du développement, est présenté, dans le nom qui lui est resté, comme s’inscrivant à un moment du développement de l’enfant. Ce moment est censé indiquer comment il est là tiré en avant par l’imaginaire, qui est donc une matrice, une fonction essentiellement vitale.
Il faut s’apercevoir que lorsqu’il met en fonction le stade du miroir dans sa «Question préliminaire», il lui fait porter un accent inversé, l’accent sur la mort incluse dans ce fonctionnement.
Il l’introduit exactement comme favorisant chez l’animal humain l’imagination de sa propre mort. Il donne une autre valeur à cette béance, où cette déhiscence, cette discordance est virée au compte de Thanatos. Elle est destructrice. C’est comme si cette totalité visuelle, décalée par rapport à l’être-là de son organisme, était non pas image vitale mais déjà cadavre anticipé.
C’est un stade du miroir sur mesure pour la «Question préliminaire», c’est-à-dire qui réserve au signifiant du Nom-du-Père d’apporter, dans cette mortification imaginaire, la paix, la sécurité, le sens de la vie. De qualifier ainsi le stade du miroir permet de réserver au signifiant du Nom-du-Père ses fonctions éminentes et positives.
Sans doute Lacan le corrige-t-il page 552 des Écrits : bien entendu, seul le symbolique permet à l’animal humain de s’imaginer mortel. Seule la transcendance du signifiant permet à cet animal d’anticiper sa mort. Mais encore fait-il de cette béance mortifère le canal par où le signifiant, l’ordre symbolique, peut venir affecter l’animal humain. Ce serait cette béance qui permettrait à l’animal de cette espèce d’établir sa symbiose avec le symbolique, symbiose qui seule rendrait effective cette imagination de la mort.
Le stade du miroir ainsi revisité, un stade du miroir mortifère dans sa logique, permet à Lacan de marquer comment la forclusion du Nom-du-Père rend à son indépendance l’ordre imaginaire. Les phénomènes psychotiques qui affectent le corps de Schreber selon ses dires, sont ainsi réservés par Lacan à cette indépendance de l’imaginaire, coupés du symbolique. Il lit ce qui seraient les événements de corps chez Schreber, témoignant de l’imaginaire mortifère laissé à lui-même, et en particulier révélant la mortification intrinsèque du stade du miroir. C’est ainsi qu’il voit le témoignage de cette régression imaginaire. Il la signale dans la phrase devenue fameuse de Schreber : «Un cadavre lépreux conduisant un autre cadavre lépreux». Il croit retrouver dans ce dédoublement le couple du stade du miroir conçu comme mortifère. C’est essentiellement là-dessus que Lacan réunit les phénomènes qui, au dire de Schreber, affectent son corps. De la même façon, après la régression imaginaire, la restauration imaginaire est censée venir à terme pour Schreber, dans sa patience et sa force d’âme, rendre son monde vivable. Cette restauration imaginaire est mise en évidence par Lacan à partir de données des Mémoires comme une érotisation de l’image de soi. Correspondant à la forclusion du signifié phallique, et à sa place, on a une image de soi.

La libido cesse d’être attirée et enfermée dans la signification phallique, en raison du défaut de la métaphore paternelle, et après, les avatars de cette libido se trouvent attirés et concentrés dans l’image de soi ici revitalisée et figurant dans le texte même de Schreber sous le nom de la volupté d’âme.
La clef de ce qui concerne le corps pour Lacan à cette date, c’est le narcissisme conçu comme spéculaire. Lacan s’attache à mettre en évidence que la jouissance est d’ordre foncièrement narcissique, foncièrement imaginaire. Cela le conduit par exemple à ridiculiser ce qu’il appelle le pompage aspirant et refoulant de la libido par le moi. Page 542 par exemple, il brocarde ceux qui se servent de l’«Introduction au narcissisme» pour souligner le «pompage, aspirant et refoulant au gré des temps du théorème, de la libido par le percipiens, lequel est ainsi apte à gonfler et à dégonfler une réalité baudruche».
2. FORT ! DA ! DE LA LIBIDO
Sans doute cette critique, qui vise les théoriciens ou ceux qui se sont attachés à Schreber, et dont Lacan fait usage, a-t-elle sa pertinence, mais elle a pour résultat que, dans cette construction, se trouve oblitéré le mouvement propre de la libido qui est mis en évidence de façon sensationnelle par Schreber. C’est une libido qui ne se démontre absolument pas stagnante, pas inerte, ni non plus incohérente dans ses déplacements, mais strictement réglée par une logique qui paraît au contraire analogue au mouvement d’un véritable fort ! da ! entre le sujet et l’Autre. C’est une libido qui obéit à une logique qui n’est pas du tout celle du stade du miroir, mais dans laquelle est au contraire insérée la figure de l’Autre majuscule, la figure divine.
Je peux par exemple prendre les pages 226-227 des Mémoires de Schreber, qui décrit ce mouvement de la libido qui n’est pas du tout là à circuler entre les symétriques du stade du miroir, mais qui implique au contraire l’Autre et d’une façon parfaitement réglée par le signifiant. «Je dois ajouter que l’apparition sur mon corps de signes de la féminité est soumise à un va-et-vient dont la périodicité va, depuis peu, s’accélérant de plus en plus. Tout ce qui est féminin exerce sur les nerfs de Dieu un effet d’attraction ; de là vient que, dès que l’on souhaite se soustraire à nouveau à mon attraction, on s’efforce immédiatement de contenir par voie de miracle les symptômes de féminité qui fleurissent sur mon corps. Mais lorsqu’on se trouve derechef forcé de se rapprocher de moi sur la trajectoire de l’attraction, de nouveau les nerfs de la volupté affleurent, de nouveau mon sein se gonfle, etc. Le va-et-vient du phénomène se produit actuellement avec une alternance de phases de quelques minutes.»
Ce mouvement alternatif, ce mouvement de va-et-vient de la libido, qui n’est pas signalé par Lacan dans sa construction, est tout à fait essentiel dans la description que nous donne Schreber de la présence et du déplacement de la libido dans son corps. Il revient d’une façon permanente sur le gonflement et le dégonflement alternatif de ses seins, et ce mouvement réglé, que Lacan disqualifie comme un pompage alternatif, au moins par implication, traduit au contraire la jonction et la disjonction libidinale du sujet avec l’Autre.
On tend d’ailleurs vers une continuité de la présence libidinale. Il dit, page 230 : «Dieu est désormais indissolublement lié, depuis des années, à ma personne. Dieu exige un état constant de jouissance, comme étant en harmonie avec les conditions d’existence imposées aux âmes par l’ordre de l’univers ; c’est alors mon devoir de lui offrir cette jouissance, et en retour un peu de jouissance sensuelle m’échoit, et je me sens justifié à l’accepter à titre de léger dédommagement.» Nous avons ici comme une mise en scène de la jouissance qui devrait être permanente de l’entité divine et du plus-de-jouir qui est affecté à Schreber et qu’il se sent moralement, éthiquement, en droit de recevoir.
Cette continuité n’est pas réalisée, puisqu’il maintient que, même si elle va s’amenuisant, c’est l’alternation périodique qui est la loi propre de la libido : «La volupté d’âme, dit-il, n’est pas toujours surabondante ; elle reflue par alternances régulières. D’un autre côté, chaque fois que je suis sur le point de changer d’occupation intellectuelle, et plus encore chaque fois que je me laisse aller à un bien naturel ne rien-penser, cela entraîne pour moi un sacrifice plus ou moins considérable de mon bien-être corporel.» D’où la perspective là présente pour Schreber de ce qui devrait avoir lieu, ce qui lui éviterait ces incommodités, cette souffrance, à savoir le «penser sans cesse», et en parallèle «jouir sans cesse». Il dit, pages 231-232 : «Les impressions que j’ai recueillies me permettent même d’exprimer cette opinion : s’il m’était possible d’assumer sans cesse le rôle de la femme aux prises avec moi-même dans l’étreinte sexuelle, si je pouvais sans cesse reposer mon regard sur des êtres féminins, si je pouvais sans cesse contempler des images féminines, Dieu n’entreprendrait jamais plus de se retirer de moi, mais il se laisserait aller avec une régularité plus constante et sans aucune résistance à la force d’attraction.» Autrement dit, on peut souligner le parallélisme et l’équivalence qui s’établit entre le «ne cesse pas de penser» et le «ne cesse pas de jouir» qui est ici connecté et qui éviterait à Schreber toute défaillance et toute souffrance de son être.
Nous sommes ici évidemment dans une configuration qui excède la matrice du stade du miroir. Nous sommes au contraire tout près de ce que Lacan veut fonder, pour l’animal humain en général, dans son Séminaire Encore, page 66, à savoir une corrélation essentielle entre l’être, la pensée et la jouissance, comme mise ici en évidence. C’est la correction que Lacan cherche à apporter dans ce Séminaire XX au cogito cartésien qui établit une connexion entre la pensée pure et l’être. Lacan vise à apporter une correction à l’être tel qu’il est mis en valeur, tel qu’il se soutient dans la tradition philosophique, en tant qu’être qui se soutient dans la pensée. C’est ce qu’incarne l’axiome cartésien du «je pense, je suis». Ce qui y fait objection pour le Lacan qui ouvre son dernier enseignement avec son Séminaire XX, c’est la jouissance. C’est ainsi que Lacan la présente sous la forme de cette phrase : «Nous sommes joués par la jouissance». Ce «joués par la jouissance» se distribue en deux propositions tout à fait précises : premièrement, la pensée est jouissance et, deuxièmement, il y a jouissance de l’être. La position paranoïaque vient ici à l’appui de cette correction apportée à l’axiome cartésien et elle le développe même bien au-delà du stade du miroir.
Cela suppose de plus une éclipse du savoir du corps, une éclipse qui oblige à corriger ce qu’on dit trop vite d’habitude que, dans la psychose, l’Autre serait non barré. A suivre Schreber, ce n’est pas exact. Il y a là-dessus une note très précise de sa part, la note 79 du chapitre XIII, où il formule précisément que l’omniscience de Dieu en sa complétude absolue n’existe pas : «On pourrait dire que Dieu possède l’omniscience et que, sur ce qu’il en est de ma nature, a priori, il ne peut être question pour lui d’apprendre quoi que ce soit. Toutefois, ces explications me paraissent quelque peu sophistiqués, car justement l’omniscience de Dieu – surtout en ce qui concerne ses connaissances sur l’être humain vivant – en sa complétude absolue, n’existe pas.»
Schreber situe un trou dans le savoir de Dieu sur un point très précis concernant sa connaissance de la vie, sa connaissance du corps vivant. Ce qui est là éprouvé par Schreber, c’est ce qui, de la vie et du corps vivant, excède l’ordre symbolique précisément, excède le signifiant. C’est là une thèse essentielle de son délire : il y a cette faille en Dieu, le supposé omniscient. Il y a cette faille concernant la vie. Dieu ignore l’être humain vivant, il ne comprend pas les êtres humains vivants. Tout au long du délire de Schreber, et quels que soient les temps qu’il peut y indiquer et y marquer, cette thèse de la faille du tout-savoir concernant la vie reste constante, et elle est exactement corrélative de l’exigence à laquelle Dieu soumet le sujet d’avoir à penser tout le temps, c’est-à-dire qui oblige le sujet à être toujours sujet du signifiant, pour que Dieu puisse être le sujet de la jouissance. Le sujet Schreber doit démontrer sans discontinuité qu’il est habité par le signifiant. C’est à cette seule condition que la jouissance de Dieu est permise et que le corps de Schreber est, par dédommagement, dans le bien-être.
Les Mémoires de Schreber met en évidence par excellence que la pensée est la condition de la jouissance et que le savoir signifiant apparaît réellement comme moyen de jouissance – formule qui viendra à Lacan bien plus tard –, et la contre-expérience est précisément donnée quand apparaît le penser-à-rien, quand Dieu se retire ; et par là même la jouissance se retire également. Dans les moments aigus du délire, c’est alors que le corps de Schreber lâche un hurlement, avant ce phénomène de hurlement que Lacan commente en termes signifiants, mais qui est avant tout relatif à une logique libidinale invariable, très précise. Elle est invariable, même si les temps de l’alternation, du mouvement alternatif, ont tendance à se resserrer.
On pourrait aussi bien amener ici les phénomènes de l’obsession qui ne sont pas nécessairement liés au délire, bien que Freud les introduise par ce biais dans le cas de l’homme aux rats, mais où est présente l’exigence de penser toujours aux mêmes choses. Cette exigence demande à être théorisée à partir de la thèse que la pensée est jouissance. La névrose obsessionnelle met aussi bien en évidence cette thèse de la pensée-jouissance, pensée qui dérange l’âme comme maîtresse du corps, certes qui est, pour le sujet obsessionnel, jouissance confinée à la pensée, mais qui échappe en même temps au commandement. Nous avons là comme un refus de la pensée à l’endroit du signifiant-maître, et on peut ajouter qu’elle est corrélative d’un affect de mortification du corps.
3. LE CORPS ET LE SIGNIFIANT
Voilà qui demanderait de dessiner d’une façon plus ordonnée, plus systématique, synthétique, ce que je voudrais opposer à cette lecture que j’ai évoquée de Lacan en prenant un Lacan ultérieur à l’appui. Cela demande de réfléchir sur le rapport à poser entre le corps et le signifiant.
Il faut là, prendre pour thème et prendre en considération cette expression d’ordre symbolique que Lacan a empruntée à la linguistique via l’anthropologie structurale, qu’il a reçue et que seulement progressivement il a lui-même remaniée. Cet ordre symbolique s’affirme comme un ordre, une organisation, une ordonnance transcendante à ce qui est le cas, à ce qui a lieu, transcendante à l’expérience.
Est-ce une matière que le signifiant ? Est-ce que le signifiant est à proprement parler matériel ? Une équivoque persiste là-dessus dans la mesure où nous ne le saisissons que sous une forme qui se matérialise. Mais le signifiant comme tel, c’est-à-dire comme ordre, c’est pur formalisme. C’est pourquoi, dans la pointe que Lacan nous donne avec son écrit de «Lituraterre», il parle du signifiant comme matière en suspension, et qu’il va l’imager des nuages qui se déplacent au gré du vent, mais qui sont susceptibles en effet de précipiter en eau, et cette eau est susceptible d’avoir des effets matériels sur le sol, sur la terre. Dans cette imagerie, ce qui est en question, c’est le caractère matériel ou non du signifiant. Et là, la dernière réponse de Lacan fait tout de même équivaloir le signifiant et le semblant, c’est-à-dire met l’accent sur le caractère formel du signifiant, sur son caractère logique, que nous manions sans doute avec des petits signes que nous allons tracer, mais ce n’est là qu’occasion pour le signifiant de se matérialiser. Il se matérialise dans ce qui supporte le signifiant. C’est ainsi que l’on peut comprendre que le signifiant puisse emprunter sa matière, sans doute, au son, mais aussi bien au corps. C’est bien ce que l’on met en valeur dans le symptôme hystérique, que le signifiant est susceptible de se matérialiser dans le corps.
Élévation au signifiant
Nous n’y sommes pas encore. C’est là au contraire que se resserre la difficulté. Sans doute, nous pouvons dire que le corps offre sa matière, sa réalité au signifiant. Le paradigme du devenir signifiant du corps nous a été donné par Lacan dans sa construction du phallus. C’est spécialement à propos de cette partie du corps qu’il nous dessine ce qui est resté pour nous un repère, le passage au signifiant. Voilà, comme pénis, une partie qui appartient à la réalité du corps qui est susceptible d’une phénoménologie naïve où, dans cette réalité du corps, il s’isole organiquement. Il apparaît même comme plaqué sur le corps, comme amovible ; il est l’évidence de son unité. Lacan va jusqu’à le qualifier de phanère, c’est une partie apparente, saillante. Les phanères ce sont toutes les productions épidermiques qui sont apparentes à la surface du corps, comme les poils, les plumes pour les oiseaux, ou des écailles, ou des griffes, des ongles, les dents. Lacan inscrit le phallus dans la même série. On peut ajouter qu’il est érectile, c’est-à-dire qu’il se trouve là et pas là dans son aspect développé qui met en valeur son unité.
C’est à propos spécialement du phallus que Lacan a logifié la structure du passage au signifiant. Je vous renvoie à ce propos à «La signification du phallus». Comment est conçue la structure du passage au signifiant ? Elle est conçue comme une élévation. On trouve, au niveau du réel, au niveau de l’imaginaire, une entité plus ou moins isolée, et elle se trouve élevée de l’ordre symbolique, moyennant un certain nombre de transformations. Lacan ne cesse pas de nous écrire ce processus d’élévation au signifiant, pour lequel j’ai utilisé le terme de signifiantisation. Cela suppose une certaine annulation de la chose initiale et une certaine stylisation pour que s’opère la signifiantisation.
Lacan repère cette structure de signifiantisation dès le règne animal. En effet, en lecteur des éthologistes, il ne recule pas à reconnaître le comportement symbolique au niveau de l’animal, c’est-à-dire l’esquisse de cette transformation signifiante. Il admet qu’elle y est une opération effective. Ce qui n’est pas effectif, c’est l’articulation de ce signifiant avec d’autres. Il nous donne dans son rapport de Rome l’exemple détaillé des hirondelles de mer avec le poisson qu’elles signifiantisent. Normalement, les hirondelles de mer bouffent le poisson, et même, elles se le disputent pour le bouffer. Cela sert à la fonction de la nutrition et à l’autoconservation de l’hirondelle de mer. Mais il se trouve qu’on observe une fête des hirondelles de mer qui se fait au moyen d’un poisson que l’on s’abstient de bouffer : il devient l’instrument de la fête et les hirondelles de mer se passent ce poisson de bec en bec. Voilà qui suffit à dire que le poisson festif, ce poisson groupai, est symbole, c’est-à-dire qu’il est soustrait à la pulsion d’autoconservation. Il est en tout cas soustrait à ses fonctions naturelles, à son usage de nourriture, et il figure comme un témoin qui est passé de bec en bec. Cela suffit pour que les éthologues, et Lacan avec eux, qualifient cette fête des hirondelles de comportement symbolique. Lacan nous invite à étendre ce schématisme à tout ce qui a pu faire pour l’espèce humaine, comme symboles primaires, le symbole du vase qui devient symbolique à condition de rester vide, c’est-à-dire à ne pas fonctionner pour sa destination utilitaire. Il évoque de la Grèce antique les boucliers symboliques qui sont trop lourds pour être portés, qui sont là pour figurer le symbole du bouclier et non pas le bouclier d’usage. Ou encore, placées dans les tombes, les gerbes qui sont là destinées à se faner. On fait du symbole avec les objets retirés de l’usage qui demeurent comme les symboles d’eux-mêmes ou les symboles du lien. C’est là une certaine dévitalisation qui fait de la chose un symbole.
Lacan s’est attaché à montrer, par exemple tout du long de son Séminaire IV – c’est une structure permanente –, comment le signifiant trouve son support dans des objets matériels moyennant transformation, moyennant élévation. Il a d’ailleurs choisi pour le qualifier, dans son écrit sur le phallus, le terme hégélien d’Aufhebung que l’on traduisait à l’époque comme dépassement, comme un certain aller au-delà. C’est le schéma même du passage au signifiant.
Corporisation
Ce n’est pas la seule structure en jeu dans les rapports du corps et du signifiant. Il y a une seconde structure qui est à distinguer de cette structure d’élévation, qui est celle que Lacan étudie, examine, amène corrélativement à partir de son dernier enseignement. La seconde structure, que l’on pourrait appeler la corporisation, est en quelque sorte l’envers de la signifiantisation. C’est bien plutôt le signifiant entrant dans le corps.
C’est une structure tout à fait différente de la première. La première est élévation, sublimation de la chose vers le signifiant. Or, la corporisation est au contraire le signifiant saisi comme affectant le corps de l’être parlant, et le signifiant devenant corps, morcelant la jouissance du corps et en faisant saillir le plus-de-jouir, découpant le corps, mais jusqu’à en faire sourdre la jouissance, le plus-de-jouir qui y est virtuel.
Lacan a rendu hommage aux stoïciens d’avoir inventé le signifiant, et même la différence du signifiant et du signifié, et il note, pas par hasard, qu’ils ont en même temps inventé la notion de l’incorporel. C’est pour dire, premièrement, que le signifiant n’est pas du même ordre que le corps – on peut parler de corps signifiant, mais dans un sens formel, un sens mathématique comme de corps de nombre. Si le signifiant est en rapport avec le corps, c’est un rapport négatif, qui est précisément indiqué par le terme de l’incorporel. C’est ce qui nous demande de bien isoler le signifiant comme incorporel, le savoir comme incorporel. C’est précisément ce savoir incorporel qui permet aux mathématiques, à la topologie, à la logique, d’exister.
Par rapport à ce savoir incorporel, nous avons affaire, nous, au savoir incorporé, et ici le suffixe in, dans incorporel et incorporé, a une autre valeur. Dans incorporel, c’est un suffixe négatif, alors que dans incorporé ce suffixe signifie l’inclusion : le savoir passe dans le corps et il affecte le corps. Cela suppose, pour rendre compte de l’affect comme événement de corps, que l’on se déprenne de la figure sublimatoire de la signifiantisation pour lui substituer cette fonction de corporisation. Le savoir dans le corps, son effet propre, c’est ce que Lacan appelle affect, en un sens sans doute étendu, généralisé. Il appelle affect, à partir du Séminaire XX, l’effet corporel du signifiant, c’est-à-dire non pas son effet sémantique, qui est le signifié, non pas son effet de sujet supposé, c’est-à-dire non pas tous les effets de vérité du signifiant, mais ses effets de jouissance. C’est ce qu’il rassemble sous le terme d’affect, comme tel dérangeant les fonctions du corps vivant.
Lacan tend à corporiser, dans le cours de son enseignement, les principales fonctions signifiantes
qu’il a isolées. C’est ce qui le conduit à faire miroiter que l’on ne peut pas soustraire son corps au grand Autre. C’est le paradoxe qu’il introduit, en passant, dans son Séminaire de L’envers de la psychanalyse, où il formule à la fois que l’Autre n’existe pas mais que néanmoins il a un corps. «Qu’est-ce qui a un corps et qui n’existe pas ?» demande Lacan. Réponse «-Le grand Autre». Au moment où il doute de la consistance purement logique de la fonction du grand Autre, c’est là aussi bien qu’il introduit de biais, sans le développer, qu’il faut corporiser le grand Autre, que le corps du partenaire, et même du partenaire parlant, est inéliminable, et même si ce partenaire a la forme de Dieu aussi bien –, et là les Mémoires de Schreber en sont comme l’illustration. Ici, Schreber nous démontre un Autre qui n’existe pas comme tout-savoir, mais ce qui est sûr c’est qu’il a un corps, un corps qui veut jouir et qui a besoin de Schreber pour jouir.
La corporisation est susceptible d’illustrations anthropologiques. On peut mener ici à l’appui le corps comme surface sur laquelle on écrit, la surface que l’on décore, que l’on peint. C’est aussi bien le corps dont on entame la substance, que l’on mutile à l’occasion, autant d’opérations où nous voyons avec évidence la corporisation du signifiant. Il y a évidemment une différence à faire entre la corporisation codée, normée, la corporisation qui relève d’un discours et qui inscrit le corps individuel dans le lien social, sous des formes typiques. Il y a donc des mutilations traditionnelles qui ont cette fonction de corporiser le signifiant. On pourrait d’ailleurs étendre la corporisation traitée à partir de cette figure, de cette fonction, à toutes les normes du comportement social, du maintien, du ton. Ce sont des formes moins éclatantes de la corporisation, mais elles n’en existent pas moins, et on pourrait aussi bien alors s’intéresser à la corporisation contemporaine aujourd’hui où l’Autre n’existe pas et où le corps tend à être laissé à l’abandon par les normes, et donc est repris, est le siège d’inventions qui tendent à répondre à la question «que faire de son corps ?». Et on assiste, parfois ébahi, à ces inventions de corporisation que sont le piercing, le body art, mais aussi bien ce qu’inflige au corps la dictature de l’hygiène ou encore l’activité sportive, aidée à l’occasion par l’ingestion de substances chimiques. Sur des modes inventifs et d’ailleurs susceptibles d’un recodage sur des communautés spécifiques, ces pratiques nous démontrent la présence, l’activité de la corporisation.
Dans la théorie, nous avons suivi Lacan quand il élaborait sa dialectique signifiante du sujet et de
l’Autre en termes de message et de communication, et qui a toujours été pensée dans la structure de l’Aufhebung, dans la structure de la signifiantisation. Par exemple, la construction de Lacan besoin-demande-désir est un commentaire, une application de la structure de la signifiantisation. Elle prend son départ dans le besoin, c’est-à-dire dans une fonction du corps, dans la sensation d’un déficit ou d’un manque par rapport à des algorithmes du vivant, admettons. Et alors, la demande s’introduit. Cela veut dire que le besoin du corps doit passer par le signifiant, doit passer à la demande. C’est la structure de la signifiantisation. Et l’effet de cette signifiantisation est un effet négatif, une négativation qui est portée à son comble dans la demande d’amour, de telle sorte que le quelque chose, la chose donnée par l’Autre, devient signe de l’amour de l’Autre. Et reste en rade le désir comme un signifié entre les signifiants. Lacan, par après, y ajoute la cause, petit a, comme élément corporel.
Dans la seconde perspective qu’ouvre la seconde structure que j’ai distinguée et nommée corporisation, il s’agit de corporiser la dialectique du sujet et de l’Autre. On en a l’indication chez Lacan, par exemple dans le commentaire qu’il fait du fantasme «Un enfant est battu» dans son Séminaire de L’envers de la psychanalyse. C’est un fantasme, c’est-à-dire une phrase, une articulation signifiante. On peut dire, comme nous y autorise déjà le Séminaire V, que c’est un scénario, ou, comme Lacan le propose dans sa «Subversion du sujet», que c’est une signification absolue, ou encore que, logiquement, c’est une proposition. Mais la remarque déséquilibrante qu’introduit Lacan, et qui est pour nous une indication précieuse, c’est que son effet n’est pas un effet de vérité. La proposition «Un enfant est battu» n’accomplit pas, ne réalise pas un effet de vérité. On ne peut pas dire : c’est vrai ou c’est faux. Ce que Lacan traduisait sans doute en parlant de signification absolue. On saisit au contraire là que son effet est un affect. Nous avons là un élément signifiant, mais dont tout l’effet est de se corporiser comme affect, et cet affect c’est la jouissance. C’est pourquoi Lacan peut écrire – ce qui nous ouvre là le champ où nous avons à nous avancer : «Le sujet reçoit certes son propre message sous une forme inversée. Cela veut dire ici sa propre jouissance sous la forme de la jouissance de l’Autre.» C’est-à-dire ce qui ici accomplit, sous cette forme encore entrevue, non développée, la corporisation de la dialectique du sujet et de l’Autre, où c’est cette fois-ci l’affect de jouissance qui circule, comme nous en avons déjà un témoignage dans les Mémoires de Schreber.
[1] Ce texte reprend les leçons des 12, 19 et 26 mai, 2, 9 et 16 juin 1999 de L’orientation lacanienne 3, 1, enseignement prononcé dans le cadre du Département de Psychanalyse de Paris VIII. Texte établi par Catherine Bonningue. Publié avec l’aimable autorisation de J.-A. Miller.