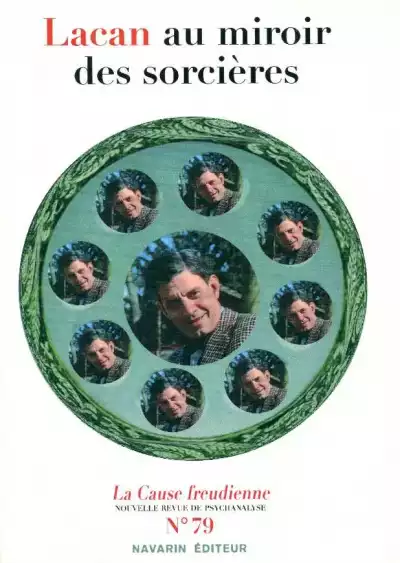Vie de Lacan
Jacques-Alain Miller
"Revue de la Cause freudienne n°79"
-
Vie de Lacan
Jacques-Alain Miller
I.
Paris, le 2 août 2011
La conversation de ces jeunes femmes roulait sur la diffamation dont il faisait encore l’objet trente ans après sa mort. La plus vive blâmait mon silence sur « un dégoûtant ramassis de saloperies » ; l’autre m’avait écrit, savante, pour me reprocher « une complaisance qui aura permis à la moderne Érinye de se sentir autorisée à dire n’importe quoi sur celui qu’elle poursuit d’une hainamoration aussi implacable qu’éternelle » ; on croyait entendre les messagères d’un Hercule se consumant sous la tunique. Elles me communiquèrent leur fièvre de l’arracher. Cependant, comment ce désir devenu mien aurait-il été sans perplexité ?
Lacan, je l’avais connu, fréquenté, pratiqué seize ans durant. Il n’avait tenu qu’à moi de porter témoignage. Pourquoi m’être tu ? n’avoir rien lu de cette littérature ? Ceci m’apparaissait : j’avais pris le sillage de sa pensée et négligé sa personne. Préférer la première, oublier la seconde, c’était ce qu’il souhaitait qu’on fasse, au moins le disait-il. Je l’avais pris au mot.
Sans doute avais-je toujours soin, par méthode, de référer ses énoncés à son énonciation, et de ménager toujours la place du Lacan dixit. Mais cela, ce n’était nullement faire cas de sa personne. La passer sous silence était la condition pour m’insérer dans sa pensée, me l’approprier, approprier ma pensée à la sienne. En fin de compte, je désirais que chacun pense de la même pensée que Lacan. Universaliser sa pensée demandait d’effacer sa personne – et la mienne.
Votre pensée, l’expression le faisait rire. Je parlais toujours de son enseignement, je m’attachais à élaborer et à prolonger ce qui en pouvait être transmis à tous, et que chacun pouvait faire sien. Cette voie était celle de ce qu’il appelait, d’un usage qui lui était propre, le mathème. Or, cette voie logicienne implique par elle-même une certaine disparition du sujet, plus radicale encore que « la disparition élocutoire du poète ».
Dans mes cours, ceci allait de soi : je faisais néant de tout ce qu’avait de singulier la personnalité de Lacan. Je la sacrifiais, pour ainsi dire, à la splendeur du signifiant. Ce faisant, je me sentais être partie prenante de ce temps futur que, de son vivant, il appelait de ses vœux, celui où sa personne ne ferait plus écran à son propos. Je voyais donc que choisir la voie du mathème m’avait conduit à garder le silence, quand j’aurais eu à faire quelque chose que mes jeunes amies appelaient le défendre, défendre sa mémoire.
Après tout, lorsque les deux frères de Witt furent assassinés, Spinoza se leva de son établi pour placarder sur les murs de La Haye son fameux Ultimi barbarorum. Mais le défendre, je l’avais fait de son vivant, et jusqu’au bout, quand il était aux abois, puis à la dernière extrémité. À quoi bon le faire, lui mort ? Mort, il se défendait très bien tout seul – par ses écrits, son séminaire que je rédigeais. N’était-ce pas assez pour faire voir l’homme qu’il était ?
II.
Sollers me tannait pour que j’obtienne de Lacan qu’il se laissât filmer à son séminaire. Là était pour lui le vrai Lacan ; ce pouvait être un document pour l’histoire ; ce serait aussi, me laissait-il entendre, un véhicule idéal qui propagerait la foi. Il avait raison. Mais je souriais : je savais à l’avance que, même relayée par moi, sa demande serait rebutée par Lacan.
Sur la scène du séminaire, il donnait certes quelque chose au théâtre, et même beaucoup, mais, à ses yeux, le spectacle était au service de son propos, ici et maintenant, au bénéfice de ceux qui avaient au moins fait l’effort de déplacer leur corps pour l’écouter. Il n’allait tout de même pas mettre ça en conserve pour le donner aux autres, à ceux qui n’étaient pas là, les fatigués, les occupés, les traînards, et encore moins à ceux qui naîtraient après lui : ceux-là, il n’en avait vraiment rien à faire, ils ne feraient jamais rien pour son bonheur à lui... Sollers est un catholique, ami des papes. Il est très émancipé, certes, mais j’imagine qu’il doit tout de même croire, sous une forme ou une autre, à quelque chose comme la survie de l’âme après la mort. Lacan, non. L’idée de l’éternité lui faisait horreur, et il la croyait très insidieuse et nocive.
Non, s’il se démenait sur scène comme un beau diable, et jouait de sa voix qui savait prendre tous les tons, comme Cyrano dans la « tirade des nez », c’était pour que ça passe. Mais il n’entendait pas graver dans le marbre, si je puis dire, ce numéro de haute voltige physique et intellectuelle, et le refaire à perpète en vidéo, pour le plaisir d’illustres inconnus, alors qu’il s’inquiétait déjà de ne pas connaître un par un tous ceux qui assistaient à son séminaire.
Il nous fit même une fois remplir des fiches, et déclara qu’il ne laisserait plus entrer désormais que ceux qui exposeraient à son entière satisfaction leurs raisons de venir l’écouter. Terreur dans l’assistance. On vit dans ce décret du maître une véritable « loi des suspects ». Il n’y renonça que quand il eut constaté combien lire ces copies l’assommait. Et puis, tous les récalcitrants, tous ceux qui, pour une raison ou une autre – par sentiment d’un droit acquis, sens de leur propre dignité, goût de la rébellion, ou simple négativisme destiné à l’enrager – ne voulaient pas faire comme il avait dit, et, bravant sa colère, lui en faisaient part, obtenaient aussitôt une dérogation. Dans ces conditions, la terreur fit place au « tour de farce », pour reprendre le mot de James Joyce dans Finnegans Wake, que Lacan aimait à citer.
Le Jupiter tonnant, qui lançait la foudre sur sa petite École, finissait le plus souvent par se prendre les pieds dans le tapis. Contrairement à la réputation qu’on lui a faite, ce n’était nullement un « homme de pouvoir ». Un homme de pouvoir, un légiste chinois par exemple, a des techniques uniformes d’administration, de surveillance et de contrôle, évalue la compétence de ses agents selon des critères quantifiables, et construit avec méthode une position de force. Lacan était bien trop impatient de tout pour cela. Il n’accéda jamais à la fameuse Richtigkeitsrationalität de Max Weber – rationalité et légalité, ou respect des règles – dont tout montre qu’elle lui faisait horreur dans sa vie également. Le désir, en tous les cas, n’est ni zweckrational, ni richtig, il est plutôt porté à avoir la berlue, nicht richtig. Mais ce n’était pas non plus, loin de là, un leader charismatique wébérien, car il n’avait, à vrai dire, aucun sens, ou très peu, du collectif : c’était, on vient de le voir, l’homme du « un par un ». Un athée social, en somme.
Son comportement montrait bien qu’à ses yeux, son École n’était pas, à proprement parler, une institution, comme ses adhérents le croyaient, ou feignaient de le croire, mais sa maison, ou le prolongement de lui-même. Il y était tyrannique, certes, par les colères qu’il se permettait de temps à autre. Comme le montre Diego Lanza dans son livre sur Le Tyran et son public, la colère est en effet, dans le théâtre grec antique, un trait caractéristique de cette figure mythique du tyran qui concentre en elle toutes les formes de transgression sociale. Pour ma part, j’étais ravi de voir bien vivant et agissant en plein xxe siècle un personnage auguste si haut en couleurs. Les colères de Lacan tenaient à un tempérament que l’on appelle familièrement « soupe au lait » : elles retombaient aussi vite qu’apparues, et il n’était pas du tout rancunier. Cependant, il avait une mémoire d’éléphant pour certaines phrases qui l’avaient touché : il les remâchait et les réinterprétait à son séminaire et dans ses écrits, des années durant.
Perpétuer sa semblance ? « Ces nymphes, je les veux perpétuer », déclare le faune de Mallarmé ; Lacan, lui, sa semblance, la perpétuer, cela ne le faisait pas du tout rêver. Le jeune d’aujourd’hui, qui se photographie pour un oui ou pour un non, et met aussitôt sa semblance sur Facebook, aura du mal à comprendre que ce Lacan était visiblement indisposé à l’idée qu’un inconnu allait prendre de lui – lui prendre – une image qui s’émanciperait aussitôt, et irait se promener toute seule dans le monde, sans lui, hors de son contrôle direct, un peu comme ces prétendus primitifs assez lucides pour anticiper les dangers que laissait présager l’enthousiasme de l’ethnologue à tirer leur portrait – les dangers mêmes que comportait pour la famille des éléphantidés le fait de recevoir un nom dans le langage des humains.
Lacan explique, dans son premier séminaire, que l’élévation (Aufhebung) de l’éléphant au rang de signifiant connote surtout le fait qu’on entend lui faire la peau en tant qu’être vivant. C’est d’autant plus exact, ajouterai-je, qu’une partie caractéristique de son anatomie – ces incisives supérieures allongées nommées « défenses » comme par antiphrase, et dont la longueur chez le mâle serait, aux dernières nouvelles, un signe de bonne santé et de vigueur sexuelle – appelle sur sa tête tous les malheurs du monde, en raison de l’objet très précieux (agalma) qu’elle recèle pour les êtres parlants. On se souvient que la croissance du commerce de l’ivoire au début des années 1970 justifia de massacrer cette population, jusqu’à la décimer : les morts se comptèrent par millions. Fort heureusement, les éléphants sont désormais une espèce protégée. Lacan était comme une espèce à lui tout seul, une espèce à un seul exemplaire, le dernier des Mohicans peut-être, ou plutôt des mammouths. Donc, il se protégeait, et se fermait dès qu’un démarcheur arguait auprès de lui de ses bonnes intentions pour lui promettre monts et merveilles – la conquête spirituelle des États-Unis, voire celle de la planète – si seulement il acceptait de faire dudit démarcheur son impresario.
Ce n’est pas un hasard si les photos qui restent de lui sont peu nombreuses ; la plupart ont été prises à la sauvette ; je n’en ai jamais pris qu’une ou deux ; les plus célèbres de ses portraits posés, qui sont presque les seuls où il est dans son cabinet du 5 rue de Lille, sont l’œuvre d’un photographe qui n’est autre que le fils de Serge Leclaire, lequel fut longtemps considéré comme son élève favori. Il n’apparaît que sur deux films : un documentaire où il lit et interprète un texte écrit pour la circonstance, et une conférence, filmée sans son aveu, je crois, où il porte une hideuse chemise à jabot, qu’il ne mit que cette seule fois, en l’honneur de la dame qui la lui avait offerte, et qui avait fait avec lui le voyage de Louvain. J’eusse aimé comme Sollers qu’il y eût davantage de représentations de Lacan, mais Lacan était Lacan et n’était pas Sollers, lequel, depuis lors, se fait filmer chaque fois qu’il prend la parole en public. Lacan était par bien des côtés un Antique, voire un primitif.
S’il abordait chacune des séances du séminaire comme une performance à réaliser, s’il faisait à chaque fois son numéro, et, aussitôt sorti, s’inquiétait des réactions du public sur le mode du fameux « L’ai-je bien descendu ? » qui fit la célébrité de Cécile Sorel au Casino de Paris dans l’entre-deux-guerres, ce n’était pour lui qu’une concession, faite à la « débilité mentale » de ce parlêtre qu’il fallait bien captiver par quelque « obscénité imaginaire », pour qu’il retienne quelque chose de ce qui était articulé « dans le symbolique ».
Ce n’était pas là une motivation très différente de celle qui inspira ce mouvement si hâtivement décrié qu’on a appelé – et qu’on appelle moins, parce que le terme déplaît aux historiens catholiques – la Contre-Réforme. L’aspect théâtral du séminaire ne répondait pas seulement au tempérament de Lacan, mais à une méthode très réfléchie, dont le principe pourrait s’énoncer, sur le modèle du proverbe latin Ad augusta per angusta, qui sert de mot de passe aux conjurés d’Hernani : « Vers le symbolique par l’imaginaire ». Le procédé est celui-là même des Exercices spirituels d’Ignace de Loyola, celui qui motiva le renouveau de la propagande catholique par le moyen du spectacle donné à voir dans les processions et les cérémonies, celui qui amena la papauté à promouvoir l’art baroque.
D’ailleurs, lorsqu’il apprit que, dans un exposé présenté un soir dans son École, j’avais fait de lui un baroque, il adopta l’idée, et donna dès le lendemain un séminaire éblouissant sur le thème de l’art baroque. C’est dans le même esprit qu’il multipliait les schémas au tableau, et les reproduisait avec insistance, tout en prodiguant aux auditeurs devenus spectateurs des avertissements sévères, comme quoi ils avaient à se déprendre de l’idolâtrie des images pour privilégier l’articulation signifiante. Moyen d’aller au-delà, l’imaginaire était aussi, bien entendu, obstacle à le faire. Il en vint à écrire une fois, comme un poète maudit: « On ne m’entendra que quand j’aurai disparu. » Il y avait là comme un très étrange vœu de mort porté contre soi-même – par exception, car l’autodestruction, vraiment, ce n’était pas son genre. Il se protégeait, ai-je dit.
En ce temps-là, les performances, on ne les enregistrait pas. Déjà, mobiliser une sténotypiste pour noter un cours, cela ne se faisait pas, c’était bizarre, on ne voyait pas ça en Sorbonne. Cependant, même quand on vit surgir les premiers magnétophones de poche, qui bientôt se multiplièrent autour du pupitre de Lacan, la sténo resta là, comme une butte témoin des siècles passés.
Déjà Xénophon, dit-on, avait fait usage de cet art pour noter les paroles de Socrate.
III.
La personne de Lacan était comme le résidu, le déchet, le caput mortuum de l’alchimie de mes cours. Je fus soudain enchanté à l’idée de la faire vivre, palpiter, danser, comme j’avais montré que je savais faire vivre, palpiter et danser ses concepts et mathèmes.
Était-ce désir de le défendre, de lui rendre justice, de le justifier, d’en faire un juste ? Lacan n’était pas un juste. Il n’était pas tourmenté par le devoir de justice. Il m’avait même dit, et dit à tous, à la télévision, l’indifférence qu’il vouait à la justice distributive, celle qui veut que, de chacun, il en soit selon ses mérites. Il avait même poussé le toupet jusqu’à prétendre passer inaperçu, comme le discreto de Gracián, alors que sa personne tirait l’œil depuis longtemps, qu’elle était devenue assez tôt dans sa vie une occasion de scandale, et qu’il était connu comme le loup blanc depuis la parution de ses Écrits.
Non, je n’avais pas le désir de le défendre. Il se peut bien, après tout, qu’il ait été indéfendable. J’avais le désir de le rendre vivant – vivant pour vous, qui après lui vivez. Mes deux amazones m’avaient fait comprendre que lire son séminaire, ce monologue prononcé sur scène toutes les semaines durant près de trente années, ne suffisait pas à le faire voir dans la densité de sa présence et les extravagances de son désir.
Mais alors, pourquoi le mot de justice s’était-il rappelé à moi ? C’était en raison, sans doute, du lien que la tradition établit entre jugement et résurrection. Et je me disais que c’était sans doute le désir de faire revivre Lacan qui, cheminant en moi à mon insu, m’avait inspiré de choisir pour emblème d’un congrès récent de l’École de la Cause freudienne, la fresque de Signorelli à Orvieto – celle de la résurrection des corps le jour du Seigneur – que Freud évoque dans la Psychopathologie de la vie quotidienne.
J’avais repris à cette occasion l’injonction fameuse du poilu de Verdun : « Debout les morts ! » C’était sans doute l’un de ces morts entre tous que j’entendais faire revivre, sans le savoir encore.
Donc, l’idée me vint d’une Vie de Lacan.
IV.
Ce titre fit lever en moi de multiples échos, et d’abord un souvenir.
Je me souvenais de m’être jadis demandé, lorsque Lacan était encore vivant, pourquoi je n’étais pas son Boswell. Pourquoi n’écrivais-je rien de ce que je voyais et entendais de lui tous les jours, surtout les fins de semaine où j’étais si souvent auprès de lui, dans sa maison de campagne de Guitrancourt, à une heure de Paris ? Je constatais que jamais je ne notais un seul de ses propos familiers, alors que j’aimais bien lire ceux de Martin Luther ou d’Anatole France. Jamais je n’inscrivais un dit, une date, un événement.
L’idée m’avait suffisamment intrigué pour que j’entreprisse la lecture de Life of Johnson, 1300 pages dont je ne connaissais jusqu’alors que des extraits scolaires. C’est à l’âge de vingt-trois ans que James Boswell, jeune Écossais, rencontra Samuel Johnson, alors la grande figure des lettres anglaises, l’arbitre de toutes les élégances littéraires. Rentré en Édimbourg, il prit l’habitude de descendre à Londres tous les ans pour consigner au jour le jour ce que le maître vivait et disait.
On ne lit plus Johnson, mais on lit encore la Life. Boswell l’écrivit à la fin de sa propre vie, alors que cet amateur de bordels était rongé par la syphilis, et bien amoché par l’alcool. Le livre fit sensation : jamais on n’avait ainsi reproduit, verbatim, des conversations aussi profuses, ni livré des informations si intimes sur le sujet biographisé. Selon Macaulay, historien toujours propre sur soi, et attaché à la respectabilité comme un Anglais peut l’être – mais aussi, je m’empresse de le dire, écrivain cicéronien, d’un style admirable d’éloquence et de correction, dont j’avais un peu pratiqué les écrits dans mes années de lycée dans l’idée de perfectionner mon anglais – l’originalité de la Life était précisément due au côté mal dégrossi de Boswell – un Écossais, n’est-ce pas ? – et à son manque de retenue, confinant à l’extravagance. Carlyle, en revanche, trouvait à louer ses qualités de cœur, ses dons d’observation, et sa dramaturgie.
Durant vingt ans, disait Boswell, il n’avait cessé de penser à écrire la vie de Johnson. Johnson, le sachant, répondait à ses questions pour nourrir le futur ouvrage, et que celui-ci donne de lui « une représentation exacte ». Il lui confiait ce qu’avaient été son enfance, son adolescence, ses années de formation, lui narrait les événements qui avaient eu lieu avant leur rencontre. Boswell notait tout de la conversation du docteur Johnson, laquelle se réduisait essentiellement, dit-il, à des monologues « d’une vigueur et d’une vivacité extraordinaires ».
Le docteur Lacan, on ne s’aventurait que très difficilement à le questionner sur sa vie présente ; sa vie passée, il ne l’évoquait jamais : elle semblait même l’indifférer profondément. Je l’avais interrogé deux ou trois fois à ce sujet, et j’avais tout de même obtenu des réponses, mais si lapidaires et surprenantes qu’elles me restaient en mémoire sans que j’aie eu besoin de les noter.
De plus, il faut avouer que sa conversation familière, à la différence de celle de Johnson, n’était pas marquée par beaucoup de vigueur et de vivacité. Cette vigueur et cette vivacité, il les gardait pour le long monologue de son séminaire, tandis que sa conversation était, à dire vrai, plutôt celle de ses familiers. Il nous dirigeait, au temps où je l’ai connu, vers la narration et le commentaire de petites anecdotes et de petits faits vrais sur toutes choses en ce monde, pourvu que ce fût original et piquant. Je lui disais qu’il nous faisait composer à table de nouvelles Nuits attiques. Aulu-Gelle est d’ailleurs cité par lui dans les Écrits. Disons que cela ressemble à du Macrobe, si cela vous renseigne. On ne pouvait donc trouver auprès de Lacan la même ressource que Boswell auprès de Johnson.
Johnson professait que la vie d’un homme ne saurait être mieux écrite que par lui-même. Boswell était évidemment soutenu et comme aspiré par le désir de se mettre à cette place. Life of Johnson était ce paradoxe, une autobiographie écrite par un autre. À moi, il était échu d’écrire, non pas la vie de Lacan, ni sa conversation, mais ses séminaires. Personne, certainement, ne l’aurait fait mieux que lui-même. D’ailleurs, saisi d’émulation après la parution du séminaire des Quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse, qui fut le premier à sortir, il s’était proposé de rédiger lui-même L’Éthique de la psychanalyse. Il n’alla pas loin avant de faire une longue interpolation, puis une autre ; il ne serait jamais venu au bout de se rattraper lui-même, étant ici Achille et la tortue à la fois ; il laissa le tout dans ses papiers ; c’est d’ailleurs pourquoi le premier séminaire que je rédigeai après sa mort fut celui-là.
Il avait été assez généreux pour me dire, du séminaire : « Nous le signerons ensemble » ; c’est moi qui reculai devant la signature double, « Jacques Lacan et Jacques-Alain Miller », qui me paraissait exorbitante ; je crus plus digne de moi de m’effacer, et de faire mettre par Mme Lescarmontier, alors responsable du design au Seuil, la formule qui était celle de la collection Budé pour les éditions de textes grecs et latins : « texte établi par... » Lacan ne manqua pas de relever ce trait de « modestie » – modestie bien orgueilleuse, il le savait – pour me le décocher dans la postface que je lui avais demandé d’écrire pour la première parution ; et il expliqua à son public que j’étais celui qui avait absolument tenu à mettre ses séminaires « dans son français à lui ». J’accueillis ce propos comme une interprétation : il est vrai que j’avais laissé entendre à Lacan que mes prédécesseurs, dont il avait laissé les tentatives dans son tiroir, avaient bousillé le travail, et que, moi, je saurais faire ressortir l’argumentation de son discours, là où d’autres croyaient souvent avoir affaire à des envolées, des vaticinations pythiques, des oracles sibyllins, de la Schwärmerei à la Swedenborg, exprimée sur un ton grand seigneur, pour parler comme Kant.
Johnson avait donc avec sa propre vie un rapport autobiographique. Ceci n’est pas permis par le discours psychanalytique. Dans la psychanalyse, on raconte sa vie, en effet, mais on la raconte dans des séances de psychanalyse, pour un autre qui l’interprète, et cet exercice est de nature à modifier tout ce qui s’est pratiqué dans le genre littéraire de l’autobiographie. Je veux dire que cela le rend impraticable. On pourrait dire en un sens qu’il n’y a qu’une personne analysée qui puisse raconter sa vie d’une façon plausible, puisque l’analyse est censée lui avoir permis de « lever les refoulements » responsables des blancs ou des incohérences dans la trame de l’incessant monologue du moi. Mais une fois complétée de cette manière, votre vie n’est plus racontable au tout-venant, et pour beaucoup de raisons. Le démon de la Pudeur se dresse : il faut mentir, ou être indécent. L’analyse fait éclater la biographie, elle polymérise la vérité, elle ne vous en laisse que des fragments, des éclats. La mémoire se révèle être moirée. Le réel ne se transmute pas en vérité, sinon menteuse par elle-même. Il y a cet obstacle irréductible que constitue ce que Freud appelait le refoulement originaire : on peut toujours continuer d’interpréter, il n’y a pas de dernier mot de l’interprétation. Bref, autobiographie est toujours autofiction.
Cependant, peut-être, après tout, Lacan aurait-il dû raconter sa vie. On le lui avait suggéré, et sous une forme qui est précisément la suivante. Son éditeur aux éditions du Seuil, qui était aussi un militant actif de la cause, François Wahl, lui proposa un jour d’être interrogé sur sa vie et ses opinions, et qu’un livre soit ensuite publié. Le nom était venu de l’un des intervieweurs les plus distingués des années cinquante et soixante, Pierre Dumayet. Il s’était entretenu seul à seul, devant les caméras de la télévision, avec Mauriac, Montherlant, Queneau, Ionesco, Duras. Pénétré, méditatif, tirant sur une pipe sempiternelle, l’hôte, assis en face du grand écrivain, s’exprimait d’un ton égal, un rien feutré, et posait une à une des questions toujours pertinentes, écoutant avec respect les réponses. Qui mieux que cet honnête homme, pensait l’éditeur, pouvait accoucher Lacan ? De surcroît, il venait d’interviewer Lévi-Strauss, un dimanche. L’idée de cette interview autobiographique, je l’appris de Lacan. Il accompagna l’information de son petit sourire malicieux et d’un haussement d’épaules qui voulait dire : « Bien entendu, je n’en ferai rien. » D’un autre sourire, j’acquiesçais, alors que je vois mieux aujourd’hui, par rétrospection, quels coups futurs l’ami Wahl voulait parer.
Peu après, Lacan accepta d’emblée la proposition d’un jeune inconnu : pour un documentaire télévisé, répondre aux questions de son gendre, non pas sur sa vie, mais sur la psychanalyse. L’allant de Benoît Jacquot tombé du ciel l’avait charmé. Mais d’autobiographie, point. Lacan ne manquait pas de prévoyance : il devait bien savoir qu’on écrirait un jour sa biographie, et que le portrait ne serait pas forcément flatteur. Pourquoi ne pas apporter son témoignage à la barre ? Il s’en moquait. Mais est-ce une raison pour que je fasse de même ?
Il était certes sous-entendu, quand on l’approchait d’un peu près, qu’on n’allait pas piapiater au dehors, et, tout compte fait, peu nombreux sont ses proches dont les déboires, les déceptions, voire les ressentiments, ont tiré quelques propos amers qui ont nourri la rumeur, et qu’on voit religieusement colligés dans des ouvrages sans acribie, voire dépourvus de simple jugeote.
Tout de même, trente ans après sa disparition, le temps est venu de lever le bâillon – « l’infernal bâillon », dit Lacan à propos de la princesse de Clèves. Je pense que j’ai quelque chose à dire de l’homme que j’ai connu, quelque chose qui mérite d’être dit, et qui n’est pas indigne de la haute tenue de ce que j’ai appris auprès de lui.
V.
Guitrancourt, le 7 août 2011
Mon texte circule sur le Net, la première version des chapitres que vous venez de lire ; j’ai mis un à suivre. Roxane, la lumineuse, m’écrit que je lui donne du bonheur ; elle a toujours eu un faible pour moi depuis que l’on se connaît : j’avais vingt ans, elle cinq de plus. Une étudiante de mon séminaire, qui, elle, doit bien avoir quelque quarante ans de moins que moi, a trouvé ce même texte : elle m’écrit qu’il la rend heureuse ; elle l’a d’ailleurs mis sur Twitter, qu’elle manie avec dextérité. Les mails affluent. On m’encourage à poursuivre.
Mon amie Catherine, qui était interne à Sainte-Anne quand Lacan y faisait ses présentations de malades, dit ceci : « Je vous lis de retour de Venise. Dans le fatras des productions montrées à la Biennale, une vidéo de Bruce Nauman m’a amusée. Elle montre un clown qui répète sans cesse: “I am sorry for what I did. I don’t know why I did it.” Vous ne m’en voudrez pas, j’espère, de vous dire que, en vous lisant, vous m’y faites penser, mais sur un mode inversé, car vous semblez dire : “I am sorry for what I didn’t do. I know why I didn’t do it.” »
Je suis enchanté de ce clown, Catherine, à ceci près que vous n’allez pas au bout de votre procédé d’inversion : « I am NOT sorry pour ce que je n’ai pas fait », voilà ce que je dis. « Il y a un temps pour chaque chose, enseigne l’Ecclésiaste. Il y a un temps pour se taire, et il y a un temps pour parler. » Ce clown qui s’excuse de sa bévue, et qui la met au compte de son non-savoir, j’en ai une interprétation dont vous verrez tout à l’heure où elle nous mènera.
J’attendais la réaction de Judith, car, comme son père, et comme Angèle, notre amie intimissime des année 1970, elle est de l’école « motus et bouche cousue ». Judith prend cela très bien ; elle me donne même des précisions sur un épisode dont je parlerai plus tard, et que nous contrôlons sur Google Maps. Pour Angèle, qui aimait à citer la maxime de Disraeli, Never complain, never explain, et avec qui je faisais jadis des parties acharnées de badminton sur le gravier de Guitrancourt, j’attendrai pour lui faire lire l’opus qu’il soit plus avancé.
Je reviens à mon propos. Si j’avais eu le moindre penchant à jouer au biographe, ce qui m’en aurait détourné, c’est ce que Lacan dit du « biographe comme tel » dans ses Écrits.
Le premier biographe de Freud fut Ernest Jones, sans doute celui des élèves du maître que Lacan avait le plus pratiqué et estimé. Cependant, je ne l’ai jamais vu faire l’éloge de personne sans y glisser une épine, et cela est sensible dans tout ce qu’on lit de lui. Quelques-uns y ont échappé, dont je dirai un mot un autre jour.
Jones, donc, il l’avait rencontré. La première fois qu’il était monté à la tribune de l’Association internationale de psychanalyse pour y présenter son « stade du miroir » – congrès de 1936, à Marienbad, il avait alors trente-cinq ans – Jones, qui présidait, lui avait retiré la parole au bout des dix minutes du temps réglementaire. Lacan, dépité, ne livra pas de texte aux actes du congrès, ni même de résumé, vida aussitôt les lieux, et s’en fut à 300 km de là, à Munich, où se tenaient ces fameux Jeux Olympiques dont Hitler présida la cérémonie d’ouverture. Il raconta à son séminaire qu’à cette occasion, il avait serré la main de Goebbels, et qu’en serrant cette main, il avait pensé, ou senti, que celui-ci avait été analysé. Il alla jusqu’à l’écrire : « L’on ne saura jamais vraiment ce que doit Hitler à la psychanalyse, sinon par l’analyste de Goebbels. »
Des années plus tard, quand il évoquait Jones, on voyait bien qu’il ne lui avait pas encore pardonné de lui avoir appliqué le règlement sans tenir compte de la nouveauté de ce qu’il apportait à la psychanalyse. Lacan consacra néanmoins à Jones, à l’occasion de sa mort, une longue étude sur sa théorie du symbolisme. Il y raconte qu’il alla le visiter dans les années 1950, alors que Jones, retiré à la campagne, se consacrait à écrire sa biographie de Freud, ne recevant plus que quelques patients. On sait par son séminaire que Lacan avait médité à plusieurs reprises ses travaux sur la sexualité féminine. Ce Gallois traînait d’ailleurs après lui une réputation de coureur de jupons ; il semble avoir eu des visées sur Anna, la plus jeune des filles de Freud, lequel prit soin, avant de la laisser partir pour l’Angleterre en 1914, de l’avertir, par lettre, de ne rien tenter sur son enfant chérie ; Anna avait alors dix-neuf ans, Jones trente-cinq. Enfin, c’est dans un texte de Jones sur « la phase phallique » que Lacan avait trouvé ce mot d’aphanisis qu’il a longtemps trituré, avant de le consacrer à dénoter la disparition du sujet sous le signifiant auquel il s’identifie.
Eh bien, c’est sans aménité aucune que Lacan stigmatise à son propos « la servilité qui appartient au biographe comme tel ».
Ce trait décoché, à travers Jones, à tout biographe, ne m’avait pas échappé. En effet, si j’étais entré dans la famille de Lacan, si j’étais l’un de ses familiers, si je m’étais chargé de faire passer « à travers l’écriture » ce qui pouvait se lire de ce qu’il disait à son séminaire, j’entendais n’être d’aucune façon amené à prendre envers lui une position servile. Mon aphanisis précoce sous des signifiants de la Rome antique, d’ailleurs élaborés sous notre Troisième République, me l’interdisait. Mais la question restait toujours en suspens, car on ne lui disait pas non impunément. Je m’entourais donc d’un noli me tangere si imperméable que, d’où je le vois maintenant, il m’amuse.
Ce souvenir me revient. Speak, Memory.
Lacan, qui était vouvoyé par sa fille, la tutoyait, et voilà qu’il lui prit un jour – lapsus, sans doute – de s’adresser à moi en commençant sa phrase par Tu. C’était un soir d’été, à la campagne, nous étions tous les trois, relax. Je lui décochai un regard si noir qu’il ne dépassa pas ce Tu. Docile, il revint aussitôt au Vous.
Quelle sensibilité ! – la mienne, je veux dire. Il y avait anguille sous roche. Cette anecdote me fait penser à la tirade désopilante que Gogol met dans la bouche du « personnage important », on n’en sait pas plus, à qui le pauvre Akaki Akakiévitch vient adresser sa supplique au sujet de son manteau volé. Parler à Son Excellence, c’est déjà lui manquer de respect, et elle ne saurait répondre à cet attentat qu’en faisant varier le thème : « Mais pour qui me prenez-vous ? », qui signifie aussi : « Pour qui vous prenez-vous ? », et bien d’autres choses encore. Bref, je lui disais en somme que je n’étais pas sa fille. Ce n’est pas dire que, servile, sa fille le fut : il ne lui avait pas donné le nom de Judith pour rien.
L’idée que tout biographe est serf est à méditer. Ce n’est pas dire qu’il faut aduler pour biographiser. C’est la position même de biographe qui vous asservit, parce que vous tissez votre discours autour d’un nom propre, qui est par excellence un signifiant-maître, noté par Lacan du sigle S1, où s’identifie le sujet. Vous voilà, pour tout potage, je veux dire pour réaliser votre propre aphanisis de biographe, réduit à la portion congrue : le signifiant-esclave, S2.
Ce sigle, dans l’algèbre lacanienne, désigne d’abord le savoir. Et c’est vous, en effet, biographe, qui êtes censé savoir, par trouvailles et déductions, ce que le malheureux sujet, lui, avait oublié, cachait au monde, voire à lui-même. Donc, vous êtes le signifiant-esclave du signifiant-maître, mais néanmoins son supérieur, comme Jeeves avec Bertie Wooster, comme tous ces esclaves de Plaute et Térence, tellement plus futés que leurs maîtres. Et quand on est esclave, que faire d’autre que dauber sur le maître ? Vous voulez le prendre sur le fait, lui en remontrer, vous cherchez la petite bête, et, par là même, vous négligez souvent l’éléphant dans la pièce, comme on dit en anglais, the elephant in the room, à savoir, ce qui crève les yeux et n’est pas vu, comme la fameuse lettre volée d’Edgar Poe. Et votre jouissance d’esclave à médire du maître trouve encore à se rehausser d’un devoir de véracité.
Ce qui est à se tordre, comme aimait à dire Lacan.
VI.
Par Vie de Lacan, j’entends tout autre chose qu’une biographie. Mais quoi, exactement ? Pour m’éclaircir les idées, je m’en vais chercher successivement les analogies de l’autobiographie 1) en psychanalyse, 2) chez Freud, 3) enfin, chez Lacan. Je verrai bien ce qui m’apparaîtra.
Dans la psychanalyse, je pars de ceci, que ce qui ressemble le plus à une autobiographie, c’est l’opération inventée par Lacan, dite de la passe. Quand vous pensez, ou avez résolu, que votre analyse est achevée et qu’elle vous a mis en mesure de pratiquer vous-même la psychanalyse, vous avez la faculté de vous engager dans une procédure originale, au terme de laquelle vous pouvez vous voir décerner le titre le plus estimé, le plus convoité, celui d’Analyste de l’École, abrégé AE. Il vous faut pour cela rendre compte de quoi, exactement ? – non pas tant de l’histoire de votre vie que du cours de cette analyse, et de ce qu’elle a changé à cette vie qui est la vôtre.
La passe ne se pratique pas partout dans la psychanalyse, mais seulement dans le courant lacanien. Elle est inséparable, que ce soit ou non perçu par le sujet, d’une précipitation de sa part. Cette modalité temporelle, la hâte, est à vrai dire fondamentale, parce que le sujet, dans le moment de la passe, joue sa partie par rapport au dit « refoulement originaire », c’est-à-dire la possibilité, encore et toujours, d’autres interprétations. On ne peut donc se déclarer passant que par un effet de « certitude anticipée », comme s’exprime Lacan dans son article du Temps logique. C’est ici, si je puis dire, le pari que les interprétations à venir seront inessentielles : du point où l’on est parvenu dans son analyse, on estime en quelque sorte que, plus ça changera, et plus ce sera désormais la même chose. Par exemple, pour vous donner une image, au bout d’un temps variable pour chacun, vous rencontrez dans votre analyse le clown de Nauman, et vous saisissez qu’il ne dira jamais rien d’autre que ce qu’il dit.
Cependant, cette certitude qui est la vôtre demande encore à être vérifiée. Après tout, rien n’empêcherait que, au bout de dix minutes, d’une heure, d’un an, ou d’une éternité, le clown, en ayant marre de faire le perroquet, décide de faire le Jacques, et se mette à chanter La Marseillaise. La probabilité est infime, peut-être, mais, du point de vue logique, la chose ne saurait être exclue, sauf ? – sauf si vous connaissez la loi de la série. En l’occurrence, si vous savez que c’est la même séquence-vidéo qui repasse en boucle.
C’est toute la différence entre les lawlike et les lawless sequences, inventées par Georg Kreisel, ce logicien si arrogant qui fut l’ami de Gödel, qui était membre de la Royal Society et professeur à Stanford, mais qui, par extraordinaire, était fasciné par Lacan – surtout par sa peau fraîche et sans rides, me dit-il quand il fut son hôte à Guitrancourt. Tant que vous ne savez pas la loi de la série, vous n’êtes assuré de rien : si longtemps qu’elle vous ait présenté un 0, rien n’empêche que vienne un 1.
J’ouvre ici une parenthèse, dont nous aurons quelque chose à faire plus loin. La notion de lawless sequence – qui vient en fait de la logique dite intuitionniste, que Lacan avait profondément méditée – condense tout l’argument de Hume, dont Kant a assuré le statut de pont aux ânes philosophique, en écrivant qu’il l’avait « réveillé de [s]on sommeil dogmatique ». Ce n’est pas parce que je vois le soleil se lever tous les jours que je peux en conclure qu’il se lèvera demain. Si je le fais, c’est que je crois que la nature obéit à des règles, qu’elle n’est pas un chaos. Et cette foi en l’ordre du monde, d’où me vient-elle ? Tout le monde croit au Père Noël, disait Lacan, et il mettait ses auditeurs du séminaire au défi de lui démontrer qu’ils étaient vraiment athées. Kant, pour sa part, imagina, pour répondre à Hume, la synthèse a priori, et cette merveilleuse dimension dite transcendantale où le monde, « les objets », tournent autour du sujet, toujours « libre », par définition. En définitive, la fable kantienne, si belle, n’a pas convaincu grand monde : beaucoup, et surtout nos épistémologues contemporains, empiristes, pragmatistes, ont préféré suivre Hume, qui, lui, faisait de l’ordre du monde une pure et simple croyance, inspirée par l’habitude et la vie en société. Popper est parti de là. Et Lacan, lui aussi, je le classe de ce côté. À mon sens, sa notion du réel, si étrange, en procède. Fermez la parenthèse.
Donc, votre anticipation de certitude est un pari, disais-je, et elle demande encore à être vérifiée. Mais comment faire ?
Votre pari porte, si je puis dire, sur l’état d’ordonnancement de ce réel qu’est votre inconscient ; comment le mettre à l’épreuve, sinon en passant par la voie humienne de la vie en société, ici celle des psychanalystes entre eux ?
Seulement, l’inconscient n’est déchiffrable que par la voie freudienne, qui, elle, passe par une parole émise dans la dimension de la confidence, et délivrée de toute entrave extérieure comme des prestiges du narcissisme. Du moins est-ce le principe.
Voici ce que l’esprit toujours fécond de Lacan a inventé pour rendre compatible ce premier et ce deuxièmement.
Vous dites ce que vous voulez dire, qui justifie votre pari, par exemple le point où vous estimez en être de vos rapports à l’inconscient, quels symptômes vous aviez, ce qu’il vous en reste – il y a toujours, dit Freud, « des restes symptomatiques » – etc., ce que vous voulez, dis-je. Ce récit est écouté par deux autres analysants qui en sont au même point que vous, mais dans la modalité du « pas encore ». Ils n’ont pas encore décidé d’anticiper pour leur propre compte la fin de leur analyse ; ils vacillent sur la ligne de crête, s’interrogent sur ce qu’il en est ; ils seront d’autant plus suspendus à vos lèvres.
Ces deux passeurs transmettent le témoignage qu’ils ont, séparément, recueilli de vous, à un aréopage choisi de décideurs, issu de l’École. Ce jury ne connaîtra de vous, le passant, que ce rapport indirect de vos dires, à lui présenté par les passeurs. Ainsi, quand vous êtes passant, vous n’êtes pas là quand se plaide votre cause devant le jury : comme en Cour de Cassation, ce sont d’autres, à savoir vos deux passeurs qui vous représentent auprès de lui, non dans votre semblance, mais dans votre pure signifiance, en votre absence obligée. Selon que votre performance devant eux les a ou non convaincus, ces passeurs seront, ou vos avocats, ou vos procureurs – ou encore ils se partageront les rôles, ou enfin ils passeront chacun d’un rôle à l’autre. Rien de cela n’est programmé. Enfin, informé par vos passeurs, le jury de passe délibérera, et vous estimera digne ou non de devenir ae.
Je sais : c’est tordu. Mais la motivation de ce procédé retors, qui conjoint psychanalyse et société, est simple à saisir. L’objectif est de réduire à néant, ou au moins de minimiser, l’incidence de la personne du passant, qu’elle joue à son avantage ou à son détriment. L’imaginaire faisant écran au symbolique, il s’agit d’effacer l’image pour dégager le signifiant ; c’est d’ailleurs ce pourquoi, en analyse, on use volontiers du divan. Freud avait commencé d’employer cette méthode parce qu’il ne supportait de voir ses patients scruter son visage à longueur de journées, mais son procédé personnel a été senti comme exemplaire, et jugé conforme à la logique de l’exercice, non pas spirituel, celui-là, mais discursif, que constitue une analyse.
Il y a toujours, pour le sujet, forçage quand il se décide à faire la passe. La fin de l’analyse exige, en effet, je l’ai dit, de mettre un terme à la dynamique de l’interprétation, qui est en elle-même grosse d’infini, et ce terme ne peut être fixé que dans la dimension du risque, sans garantie préalable de triompher lors de l’épreuve de validation.
VII.
Du côté de chez Freud, maintenant.
Ce chapitre VII étant maintenant écrit, j’insère ici, après coup, un avertissement aux lecteurs. J’aime autant vous prévenir. Vous allez être chahutés. Il va être question de Freud, c’est entendu, mais, en sus, de bien d’autres choses. Une première version de ce texte se précipitait sur sa « Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique », qui est maintenant expédiée en trois mots à la fin de la tirade. C’est qu’une verve m’a saisi à la relecture, et je l’ai chevauchée. J’avais commencé cette Vie de Lacan en focalisant sur mon personnage, caméra à l’épaule. Je voulais maintenant poser l’appareil, le paramétrer à la distance la plus lointaine, et dézoomer, afin de l’inscrire dans le tohu-bohu de l’histoire universelle, ses contingences, mais aussi ses rémanences, ce tournage en rond, ce piétinement de l’espèce, seulement rompu de loin en loin par l’émergence si rare d’un désir inédit, seul capable d’introduire un bougé dans la routine du discours courant – Lacan se plaisait à détacher : disque ourcourant.
Est-il bon ? est-il méchant ? est-ce un charlatan, un escroc avide, vivant de ses dupes ? ou un gourou authentique, un vrai sage, un mazda ? est-ce un illusionniste ou un illuminé ? un super-malin ou un demi-fou ? un faiseur ou un génie ? un danger public ou un bienfaiteur, sinon de l’humanité, du moins de quelques-uns ? Cette nuée de questions a enveloppé Lacan durant sa vie adulte comme un essaim d’abeilles, tout comme elle a accompagné bien des grandes figures inscrites au patrimoine ou marquées du sceau de l’infamie.
Enfin, j’ai vu ici l’occasion de vous inoculer en douceur – on ne sent pas la piqûre, d’abord à cause du bruit – des notions dont j’aurai sans aucun doute à faire usage par la suite.
Cette parenthèse étant close, le texte reprend.
Nous n’avons pas d’autobiographie de Freud. Si nous en savons long sur lui, c’est d’abord par ce qu’il livre de son inconscient dans ses ouvrages et sa correspondance, rêves, lapsus, actes manqués, et les interprétations qu’il en donne lui-même. Freud a-t-il fait une analyse ? C’est le vieux problème de l’œuf et de la poule. Oui, il a fait une analyse. Il l’a faite tout seul, c’est entendu, mais ce n’était pas pour autant une autoanalyse : il n’a pu la faire que parce qu’il faisait couple avec un autre.
Cet autre, son bon ami Fliess, n’était pas psychanalyste, bien sûr, puisque le premier psychanalyste, et créateur de ce personnage inédit dans l’histoire, était Freud lui-même. Mais Fliess était néanmoins un déchiffreur tous azimuts, au point d’être visiblement subdélirant : en particulier, il était acharné à démontrer l’analogie du nez et des organes génitaux. Ce type avait suscité chez Freud une amitié passionnée sur laquelle on n’a pas fini de gloser. En tous les cas, il s’empressait de lui confier les progrès qu’il faisait dans l’exploration de la nouvelle dimension de l’être qu’il avait découverte, et qui allait donner naissance, pour le meilleur et pour le pire, à la psychanalyse. Et il attendait avec impatience les réactions ou les jugements de son alter ego.
Freud, un des grands génies de l’humanité, suspendu aux édits et fariboles d’un personnage aussi azimuté, un « chatouilleur de nez », disait Lacan ? Il n’est pas illégitime de se poser à ce propos la question que suscitent les couples apparemment mal assortis. Pour ne pas prendre un exemple trop actuel, et impliquant un personnage considérable, je dirai, en puisant dans mes souvenirs de jeunesse, de Sophia Loren et Carlo Ponti : « Qu’est-ce qu’elle peut bien lui trouver ? »
Il y a à cette question des réponses, celles du docteur Helen Fisher, par exemple. En sa qualité de Research Professor, Rutgers University, elle a fait passer un scanner à 49 personnes pour étudier « les circuits cérébraux de l’amour romantique » ; elle en a déduit que c’était là un « drive » plus puissant que le « drive » sexuel. Comme conseillère scientifique du site Chemistry.com, où chacun peut trouver en ligne sa chacune, et chacune son chacun, elle dit avoir pu disposer de données concernant 28000 personnes, ce qui lui a permis de construire une typologie caractérologico chimique, où l’humanité entière se trouve répartie en quatre rubriques. Ce tour de force fait de son dernier ouvrage, Why him ? Why her ?, paru fin 2009, un best-seller comme les précédents. Quels sont ces types scientifiquement établis par la Biological Anthropologist ? Les Explorateurs ; les Constructeurs ; les Directeurs ; et les Négociateurs. Vous m’en direz tant ! Et voyez comme cela tombe pile pour le couple Freud et Fliess : « Explorers are often drawn to others Explorers. » Tout s’explique.
Après tout, Lacan ne disait pas autre chose, et ce, malgré une base de données bien moins fournie, puisque constituée essentiellement par les gens qu’il avait en analyse, complétée, il est vrai, par une bonne connaissance de la littérature universelle. Lacan lui, imputait l’attirance ressentie par Freud à l’endroit de Fliess à un fait qui lui paraissait décisif. En effet, il n’est pas douteux que Freud voyait dans l’ami Fliess un sujet supposé savoir. Selon Lacan, cette seule imputation avait suffi à susciter et impulser en lui ce que les analystes ont coutume d’appeler un transfert. Cette théorie avait toute raison de m’intéresser, sur un plan très personnel, dans mes rapports avec Lacan lui-même.
Avant Lacan, dans la psychanalyse, on tenait le transfert pour un phénomène imaginaire : identification de la personne de l’analyste à un personnage important de l’histoire infantile, en général les ascendants, père ou mère, ou leurs tenant-lieu ; sentiments éprouvés d’affection ou de haine, jugés par l’analyste excessifs au regard d’une saine appréciation des choses – c’est-à-dire de son sens de la réalité, comme si c’était là un critère sûr ; importance prise par la relation à l’analyste dans la vie, la conversation, les pensées, de l’analysant, voire ses rêves. Ces phénomènes sont là, c’est observable, mais leur ressort est, selon Lacan, à chercher au niveau dit symbolique. Tout ce qui s’éprouve découle de la supposition de savoir.
Je vous ai donné l’idée de départ. Cela se complique dès que l’on s’aperçoit que l’ascendant du symbolique sur l’imaginaire implique que la personne de l’analyste n’est nullement en cause : on peut très bien le trouver insuffisant, peu cultivé, négligent, pas à la hauteur. En fin de compte, à travers lui, c’est l’inconscient même du sujet qui est visé, c’est l’inconscient qui est supposé être un savoir – un savoir à déchiffrer.
Ce disant, on ne s’éloigne pas de Freud, on le retrouve au contraire, car il introduisait l’inconscient au titre d’une hypothèse. Et que faire d’autre, puisqu’aucune aperception directe de son existence n’est concevable ? Par définition, l’inconscient n’est, comme tel, ni éprouvé, ni vu, ni perçu, mais seulement supposé, interprété, conclu. « Nous ne savons même pas si l’inconscient a un être propre », écrit Lacan, et il va jusqu’à dire que, plus il est interprété, et plus il est.
C’est souligner par là même la relativité de l’inconscient dit freudien à l’endroit du désir, ne serait-ce que le désir d’interpréter et celui d’être interprété. La formule qui se rencontre dans le Séminaire xi ne veut pas dire autre chose : « le statut de l’inconscient est éthique ». L’inconscient n’est certainement pas ontique ; il n’est ontologique que pour autant que l’être est une forgerie de savoir sur certaines langues, non pas toutes ; il est éthique : son être même repose sur le désir du sujet d’y accéder, sur le désir de l’analyste de lui en ouvrir les voies.
Faute du désir de l’analyste, la psychanalyse ne tient pas une seconde. Faute du désir du sujet, aussi, bien entendu. Il faut que vous ayez le désir de retrouver votre chemin dans l’inconscient, d’accéder au lieu où se trame votre destin, dans la forge où un Vulcain inconnu a façonné vos armes, l’atelier où votre blason fut peint, la messagerie d’où partent ces fichiers cryptés que sont vos lapsus, vos actes manqués, vos rêves et vos symptômes. Pas d’analyse si ce désir n’est pas éveillé, alerté, stimulé. Il l’est par la rencontre de n’importe quoi faisant office de sujet supposé savoir.
Qu’est-ce que c’est, en somme, un sujet supposé savoir ? C’est, disais-je, n’importe quoi : quelqu’un, quelque chose, existant ou non existant, une entité x, fictive ou réelle, véridique ou mensongère, qui est nimbée de cette signification : « Là est inscrit, là peut se lire, mon destin, mon être, ce qui de moi est caché à moi-même. » Ce qui compte, c’est le nimbe, du latin nimbus, « nuage », l’éclat, le halo, la mandorle, l’aura, l’auréole, que l’on retrouve dans bien des religions.
Sous cet angle, les prémisses, les ébauches, les anticipations de l’analyse, sont partout dans l’histoire des civilisations. Je vous demande de songer à toutes les pratiques de la divination, voyance ou mantique, des oracles, des prophéties, auxquelles on sacrifia sous toutes les latitudes, à l’importance avérée que revêtit, et revêt toujours, la consultation des mages ou des voyantes. Sans remonter jusqu’à Girolamo Cardano (1501-1576) et à son rôle de conseiller politique, je me contenterai de rappeler, par exemple, que feu le président Reagan ne prenait pas une décision importante, ne fixait jamais une date sans consulter son astrologue. De même, nous savons par Cicéron, éclairé par Dumézil, qu’aucune décision ne se prenait à Rome sans consultation du sujet supposé savoir – que nous, nous interrogeons par sondages, parce que nous sommes à l’âge de la science, nous autres. « Quelle est la nation, quelle est la cité, écrit Cicéron, dont la conduite n’a pas été influencée par les prédictions qu’autorisent l’examen des entrailles et l’interprétation raisonnée des prodiges ou celle des éclairs soudains, le vol et le cri des oiseaux, l’observation des astres, les sorts ? [...] quelle est celle que n’ont point émue les songes ou les inspirations prophétiques ? »
Voyez tout ce que l’histoire du monde doit aux émois suscités par la parole, la voix, le prestige d’un voyant, d’un maître, d’un sage, d’un saint homme – bref, le charisme d’un supposé savoir. Non, ce n’était pas l’enfance de l’humanité, et l’avènement de l’âge de la science n’y a nullement mis fin. « L’état positif » qu’appelait de ses vœux un Auguste Comte reste une chimère de ce grand esprit, lui aussi sensiblement azimuté, qui finit en grand prêtre de la Religion de l’Humanité, vouant aux grands hommes un culte qui aurait été exclusif si ne s’y était joint celui de sa bien-aimée, dont le deuil l’avait laissé inconsolable. J’habitais, enfant, à deux pas du « Temple » de cette religion, sis rue Payenne, orné d’un buste de Clotilde de Vaux.
D’où surgissent-ils, ces agrégats d’êtres parlants traversant les âges, et parvenus maintenant au XXIe siècle, que sont les grandes religions de cette humanité si peu « positive » – sinon du tourbillon spontané que provoque, de proche en proche, un seul, par sa prédication, son exemple, et, disons-le, son désir – ? Voyez :
– Aménophis IV, pharaon, qui bénéficia de l’appui de l’appareil d’État pour répandre son invention du monothéisme, laquelle devait se révéler si funeste ; plus tard, l’Empereur Constantin à Byzance fera de même au profit du christianisme ;
– Moïse, si bel homme en Charlton Heston, qui inspira à Freud une véritable interprétation analytique de sa statue à Rome, par Michel-Ange, puis un bon petit délire interprétatif dans L’homme Moïse, sorte de biographie, parue en 1939 ;
– Zoroastre, nom grec pour Zarathoustra, ce chamelier persan dont Nietzsche devait faire sa marionnette kitsch ; il inspira un passionnant délire au président Schreber, auteur de ces Mémoires d’un névropathe dont Freud et Lacan furent les commentateurs ; Luther du mazdéisme, il le réforme en le monothéisant ;
– Siddhartha Gautama, dit Shakyamuni, ou encore le Bouddha, soit « l’Éveillé », son contemporain ;
– Confucius ;
– Jésus ;
– Manès, fondateur du manichéisme, du nom de celui qui le surclassa, Mani ; les manichéens, hérétiques du zoroastrisme, furent persécutés par ses tenants, qui dominèrent la Perse sassanide, jusqu’à ce que l’Islam les convertisse ;
– Mazdak le jeune, mobed (prêtre) zoroastrien, qui répandit un manichéisme à visage humain, un communisme souriant, prônant le partage des biens et des femmes ; certains prétendent qu’il prit la suite de Mazdak l’ancien, et d’un certain Zardusht ;
– Mahomet ;
– Luther ;
– Smith junior, né dans le Vermont en 1805, à la veille de Noël, qui reçut la révélation de l’Ange Moroni en 1823 dans l’état de New York, au village de Palmyra, ainsi nommé en hommage à l’antique cité syrienne (ceci ne s’invente pas) ; le E. G. Grandin Building où s’imprima en 1830, à 5 000 exemplaires, son Livre de Mormon se visite.
J’en passe, et des meilleurs. Je simplifie beaucoup. Je me limite à ce dont j’ai lu quelque chose, et aux doctrines dont le fondateur a un nom propre.
Comment ! Pas de Français sur cette liste ! – à moins d’y faire figurer Auguste Comte, qui sortit d’Esquirol sous le sigle « NG », non guéri. Pourquoi pas, après tout ? Cela m’en fait douze.
« Glisse là-dedans pour rire, me souffle mon Malin Génie, Freud ou Lacan, et tu pourras faire appel à la voyance de Nerval. » En effet, « La Treizième revient... C’est encore la première. » Nerval fut aimé des surréalistes, et André Breton ne serait pas indigne de ma liste. « Ceci est un dîner de têtes », dirait Borges : il soutiendrait que c’est toujours le même qui se déguise.
L’existence de la plupart de ces grands hommes est avérée, celle des autres est sans doute légendaire ; certains ont acquis un statut divin, ou d’émissaire de la divinité, non pas tous ; leur message, qui est de paix, sauf celui des futurs Iraniens, passe dialectiquement par une prédication, qui, étant nouvelle, suscite le combat, voire la guerre. Cependant, sous des formes diverses, le même effet est présent, du charme d’un seul, et de sa chanson.
Cette phrase du Télémaque fait rêver, qui décrit Apollon berger, gardant les troupeaux du roi Admète : « Il jouait de la flûte, écrit Fénelon, et tous les autres bergers venaient à l’ombre des ormeaux sur le bord d’une claire fontaine écouter ses chansons. » Mettez la même flûte dans les mains d’un attrapeur de rats von Hameln, toute la jeunesse du village lui emboîte le pas, et disparaît à jamais.
Sans doute nombre d’imposteurs ont-ils exploité ce filon. Lucien de Samosate, ce sacripant de Syrien, en a dézingué quelques-uns, qui sévissaient de son temps, sans plus d’indulgence pour Peregrinos qui s’immola par le feu pour prouver sa bonne foi, que pour Alexandre, dit « le faux prophète », sectateur du serpent Glypon et émule d’Apollonios de Tyane. La Vie de ce dernier, dit le « Christ païen », par Philostrate d’Athènes, au IIIe siècle apr. J-C., a eu les honneurs de la Pléiade, et d’une préface de Grimal, dans le recueil des Romans grecs et latins ; elle faisait mes délices dans mon jeune temps. Isaac Bashevis Singer et Gershom Scholem ont chacun consacré un livre, roman pour le premier, étude historique pour le second, à Sabbataï Tsevi, natif de Smyrne, qui se déclara messie à vingt-deux ans, fut dûment excommunié (il tomba sous le coup du Herem vers 1650, six ou sept ans avant Spinoza), ce qui ne l’empêcha pas de bouleverser le judaïsme de son temps, avant de tomber aux mains des Ottomans, et de se convertir à l’Islam, pour mourir solitaire dans une ville de ce qui est maintenant le Monténégro.
Mais imposteurs, c’est vite dit. Qui sont les imposteurs ? Voltaire, émule de Lucien, en décelait bien davantage que nous. Sans doute un mouvement fondé par la prédication d’un nommé Smith à New York, au moment où débutait la révolution industrielle, ne jouit-il pas du respect universel que valent aux grandes religions une origine qui se perd dans la nuit des temps comme leur adéquation à la structure du parlêtre. Mais qui vous dit qu’avec la patine des siècles, le mormonisme ne prendra pas le dessus, et n’étendra pas sa domination hors des frontières de l’Utah où il fut confiné par la persécution des chrétiens ?
Certaines des doctrines de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours – Jésus de Nazareth vit toujours, renaissant à volonté comme le phénix ; il y a trois royaumes, le plus élevé étant lui-même divisé entre trois paradis ; ceux du haut de l’échelle sont promis à devenir, le jour venu, des dieux et des déesses, comme Jésus, qui fut jadis un homme ; etc. – vous apparaîtront comme des élucubrations hérétiques. Cependant, elles ne sont pas sans fondement aucun : elles s’appuient point par point sur des interprétations originales du signifiant biblique ; de plus, on discute pour savoir si Joseph Smith avait lu ou non l’inévitable Swedenborg. Tout cela se tient parfaitement au niveau discursif ; c’est consistant. Après tout, n’est-ce pas, si l’on demande à chacun de ma liste « Et cela, d’où le sais-tu ? », il vous répondra, sous des formes diverses : « De mon sujet supposé savoir, pardi ! »
Dans le cas de la LDS Church, la solidité de la doctrine est illustrée par les vertus du mormon lambda au XXIe siècle, voyez le site Mormon.org : il n’est plus polygame, a l’esprit de famille, l’esprit d’entreprise, l’esprit missionnaire, il est abstème et stakhanoviste, et se voue à un lifelong learning. Ils sont comme ça. Tout à fait moi, plus ou moins. Avez-vous vu The Aviator, de Scorsese, cette biographie filmée de Howard Hugues, dont le rôle est interprété par Leonardo Di Caprio ? Eh bien, au dernier stade de sa schizophrénie paranoïde, que même le réalisateur de Shutter Island n’a pas osé porter à l’écran, Hughes, qui se méfiait de tout et vivait nu, dans une chambre d’hôtel, obsédé par les microbes et la poussière, ne se fiait, pour le garder, qu’à des Mormons. C’est une référence.
Enfin, le chef de la majorité démocrate au Sénat est mormon, et deux Mormons concourent en ce moment pour l’investiture républicaine à l’élection présidentielle de 2012, dont l’un a une bonne chance de remporter la compétition, malgré le léger malaise qu’induit sa personnalité d’empty suit. Bref, tous les espoirs leur sont permis. Je lis d’ailleurs sur le site mormon français : « Bien que l’Église soit restée très petite de son vivant, Joseph Smith savait que c’était le royaume de Dieu sur la terre, qui avait pour destinée de remplir la terre entière des vérités de l’Évangile de Jésus-Christ. » Bon courage, frères mormons !
Au temps où Saint-Germain-des-Prés bravait la morale dit bourgeoise, et dite morale, Queneau démontrait, dans un essai publié aux Temps modernes, que la qualité de philosophe et celle de voyou n’étaient pas aussi exclusives l’une de l’autre qu’il pouvait paraître depuis que les philosophes sont des fonctionnaires, et que Sartre n’était pas le seul à qui l’on imputait les deux, mais Diogène aussi, et même Socrate. Entre saint homme et imposteur, peut-on toujours faire le départ ?
À côté d’autres talents, la maîtrise de, disons, « l’effet Apollon », qui est aussi bien à l’occasion « l’effet Dionysos », est avérée dans la vie de bien des chefs de guerre, fondateurs d’États et bâtisseurs d’Empires, d’Alexandre, César, et Napoléon, à Bismarck, Lénine ou Atatürk. Je les laisse de côté, mais voyez celui qui déchaîna, avec son ramassis de ratés et de crapules de la pire espèce, le phénomène immense du nazisme, dont le discours universel est encore hanté près de soixante-dix ans après que la force matérielle surpuissante qu’il fut brièvement dans l’histoire a été dissoute « par le fer et par le sang », dans un juste retour à l’Allemagne du message de Bismarck sous une forme inversée.
Dans les 2000 pages de sa magistrale biographie de Hitler, Ian Kershaw ne consacre qu’un paragraphe ou deux, si je ne me trompe, à pointer la minuscule origine du tourbillon prodigieux qui sembla menacer d’engloutir le monde. Un capitaine de l’armée allemande vaincue, appartenant aux services de renseignements, recrutait des orateurs pour prêcher l’anticommunisme aux miliciens des Corps francs et au tout-venant de la tourbe munichoise issue de la défaite. Parmi d’autres, il essaya un jour un petit caporal originaire de Bohème. C’était un débris de la guerre. The Castle in the Forest, le dernier roman de Norman Mailer, publié l’année de sa mort, 2007, en fait le produit d’un inceste. Toujours est-il qu’il était, en 1919, orphelin et fauché comme les blés. Peintre raté, il avait vécu en mendigotant, le ventre creux, dans les rues de Vienne. Il était de constitution débile, et sans doute impuissant. Mais c’était aussi un grand lecteur et autodidacte passionné. Il avait lu notamment cette Psychologie des foules de Gustave Le Bon dont il devait se révéler l’avisé praticien ; exactement au même moment, ce livre inspirait à Freud sa géniale et prophétique Massenpsychologie.
Les ténors du capitaine se produisaient notamment dans une brasserie, où venait les écouter une centaine de membres d’un groupuscule ultra. Le lendemain du jour où sa nouvelle recrue s’exprima pour la première fois en rabrouant un orateur, le public quadrupla. Le capitaine comprit qu’il tenait là une star.
Modèle de toute institution en Occident, l’Église, dans sa sagesse, n’a eu de cesse de capter et domestiquer les charismes spontanés, dont elle s’est toujours méfiée, quitte à canoniser le ou la charismatique en question, quand il ou elle avait fini de s’agiter, pour cause de décès. De même, les universités, nées d’abord à l’initiative des maîtres ou des étudiants, à Bologne (1088), à Paris (1150), puis à Oxford (1166), passèrent sous contrôle étatique au XIVe siècle. Rien qui chatouille davantage l’ordre établi que la peregrinatio du signifiant errant, lequel, laissé à lui-même, finit toujours par trouver une destination imprévue. Lacan dit très bien qu’une lettre arrive toujours à destination. Derrida ne l’a pas compris : Lacan ne dit pas que le circuit est prédéterminé, même s’il peut l’être – dans les lawlike sequences dont j’ai déjà parlé – mais qu’il y a toujours quelqu’un pour se faire son destinataire, même si sa trajectoire est marquée au sceau de la contingence – dans les lawless sequences. Les difficultés des régimes autoritaires à se maintenir à l’âge d’Internet et des réseaux sociaux, illustrées par les « révolutions » arabes de 2011 comme par les émeutes qui se déroulent à Londres au moment où j’écris, ou les contorsions des autorités de Pékin, pourtant si réfléchies par ailleurs, autour du bon usage de Google, devraient enseigner aux plus réticents des lecteurs de Lacan quel est en effet le pouvoir du signifiant, marteau sans maître.
Une fois enrégimenté au service du maître, le discours universitaire n’a strictement rien à voir avec le discours de la science, surgi avec Galilée, aussitôt emprisonné, comme narré par Brecht dans sa Vie de Galilée. On assiste au XVIIe siècle à un processus de floculation, comme en dérivation de la République des Lettres, elle, plus tôt apparue. On voit les signifiants nouveaux, d’abord dispersés, et comme en suspension, s’amasser comme autant de micelles hydrophobes sous l’action d’un floculant qui ne saurait être ici qu’un « désir inédit » (Lacan), et former des flocons, puis se coaguler en flocs. Ce processus me semble avoir été distinct en Angleterre, où c’est de précipitation des particules que je parlerai plutôt, favorisée par l’insularité – le « collège invisible » des philosophes qui se rencontraient de manière informelle dans les années 1640 aboutissant très vite, dès le 28 novembre 1660, à la formation d’un solide, je veux dire la Royal Society of London for the Improvement of Natural Knowledge.
Sa célèbre devise, si caractéristique de ce désir inédit, Nullius in verba, soit Ne croyez personne sur parole, ne doit pas égarer : bien entendu, les douze fondateurs, apôtres du discours scientifique, ne pouvant refaire aussitôt l’expérience du voisin, étaient bien forcés d’avoir foi les uns dans les autres. D’où l’importance du fait que Steven Shapin mit en lumière dans un ouvrage qui fit date, et se lit comme un roman, A Social History of Truth, de 1994 : ils étaient tous des Gentlemen, hommes d’honneur, bien élevés et propres sur eux – le mot civility est proprement intraduisible – qui n’auraient jamais falsifié un résultat pour tout l’or du monde. Les mœurs du milieu scientifique ont sensiblement évolué depuis lors.
Autour de Freud, ah non ! ce n’était pas des gentlemen, à Dieu ne plaise. Un jour qu’il était monté sur ses grands chevaux à son séminaire, ce qui lui arrivait périodiquement, et même à chaque fois, à un moment ou un autre, Lacan compara « la bande de Freud », qui se réunissait chez lui le mercredi, dans la salle d’attente, à la compagnie sale-dégoûtante, comme disait ma mère, qui se fait photographier à la fin de Viridiana, tas de clochards alcooliques, pervers et vérolés, à faire peur à Beckett, ici fleurons de ce Lumpenproletariat espagnol dont l’énergie vitale sans foi ni loi ravissait Buñuel. Je ne sache pas que l’on ait fait le rapprochement avec ce que Lacan a pu écrire de sa « bande » à lui, à savoir qu’elle était « la même » que celle de Freud.
Le pouvoir d’agglomérer autour de soi une « bande », c’est-à-dire de détacher de la routine des jours et du discours commun un petit nombre qui adopte vos signifiants et les obsessions qui vont avec, puis fait boule de neige, atteint une masse critique, à partir de quoi tout devient possible, le sociologue l’a repéré : Max Weber le situe comme un troisième type de domination, Herrschaft, distinct de ceux qui reposent sur l’autorité de la tradition ou sur le couple rationalité et légalité : « la domination charismatique ». Mais ces termes sont descriptifs, ils n’expliquent rien. Lacan prolonge ici le combat des Lumières, dont il se prévaut dans le volume de ses Écrits, quand il assigne la causalité en jeu dans le prétendu charisme au sujet supposé savoir. Il ne l’a jamais mieux rendu sensible que dans sa lecture du Banquet de Platon, à laquelle il consacra pas moins de douze leçons.
Socrate est moche comme un pou, vieux et chauve, avec son nez camus. Alcibiade, lui, est la coqueluche de la jeunesse dorée d’Athènes. Il traîne tous les cœurs après lui. Les hommes comme les femmes n’ont d’yeux que pour lui. Il multiplie les canulars et les déprédations, en hooligan cultivé, qui se croit tout permis ; il finira d’ailleurs, peu après, par se faire bannir pour avoir mutilé les Hermès. Cependant, c’est Socrate qu’il poursuit de ses assiduités : il le suit, l’épie, se glisse dans son lit. Et toute la ville de s’interroger : qu’est-ce qu’il lui trouve ? À la fin du banquet, où tous les convives se sont succédé pour exposer leur théorie de l’amour – et c’est là qu’Aristophane lâche sa fable de l’être fendu dont les deux moitiés se cherchent et s’emboîtent, qui fera florès à travers les âges, jusqu’à Freud qui l’adopte en n’y voyant que du feu – voilà qu’Alcibiade déboule, avec sa suite de fêtards avinés qui semble sortie de La Dolce Vita de Fellini, ou de son Satyricon. On le presse de dire ce qui l’attire dans ce Socrate si laid.
C’est qu’il est, explique le jeune gandin, comme ces boîtes à figure de Silène dont font commerce les marchands de rue : leur aspect extérieur est repoussant, mais, quand on les ouvre, on trouve à l’intérieur la figurine d’un dieu, une agalma. C’est le mot grec qui veut dire une chose sainte et précieuse, et Louis Gernet, qui fut le maître de Vernant, avait déjà pointé en passant, avant Lacan, sa fonction dans le texte du Banquet. L’exemple d’Alcibiade devint un pont aux ânes humaniste à la Renaissance ; Érasme en fit un de ses adages, que son commentaire éblouissant rendit célèbre ; la « substantifique moelle » de Rabelais, dans sa préface au Pantagruel, vient de là. Mais cet usage humaniste du Silène et de l’agalma fait litière de la dimension érotique de l’affaire. Il s’agit pour Alcibiade, écrit Lacan, « d’obtenir ce dont il pense que Socrate est le contenant ingrat », et qui est quoi ? rien d’autre que le savoir qu’il lui suppose sur le désir et l’amour. Socrate, en effet, se vantait de ne s’y connaître en rien, sinon en matière d’éros. La chose précieuse qui irrésistiblement attire Alcibiade dans le sillage de Socrate et le retient auprès de lui, c’est, pour ainsi dire, le sujet supposé savoir fait objet, soit agalma.
J’écrirai, pour fixer les idées, le morphisme suivant :
Je donne ce foncteur, au sens de la théorie des catégories, pour la cause déclenchant, dans ce que nous appelons l’histoire de l’humanité, ces forces matérielles qui créent et ébranlent empires et discours.
Cependant, le sujet supposé savoir, lui, non plus que α, n’est rien de matériel. Ce n’est rien de plus que l’effet de signification d’un discours. Cet effet prend consistance d’objet, de « cause du désir » (Lacan), quand s’y mêle quelque chose de votre corps, à savoir la jouissance que suscite en vous la voix de l’Autre. Il fut un temps où tous les peuples de l’Europe et du monde se blottissaient autour du poste de radio pour entendre, qui dans la terreur, qui dans le ravissement, les hurlements du chancelier du Reich, dont le caractère hors sens fut, de façon si convaincante, parodié par Chaplin dans son immortel Dictateur. Je sais bien ce que je blesse en toi, lecteur humaniste, mon frère, par ce parallèle de Hitler et Socrate, mais la structure ici commande.
Faut-il entendre, me diras-tu, que Freud et Lacan firent de même ? – l’un avec sa petite Société du mercredi qui devint l’Association internationale de psychanalyse, le second avec son séminaire, qui se tint d’abord dans le salon du 3, rue de Lille, avant de donner naissance à l’École freudienne de Paris, et enfin, dix ans après sa mort, par mon office, à l’Association mondiale de psychanalyse. Je réponds : oui et non.
1) Oui, parce que je maintiens que l’équation que j’ai dite est, avec la « pulsion de mort », le seul principe de causalité universellement soutenable dans l’histoire des êtres parlants, « remue-ménage », disait Lacan, livré à la contingence qui est le régime même de l’amour. Et donc, oui, nos deux petits médecins partis de rien, ou de pas grand-chose – Lacan se présentait à la télévision, non sans une arrogance à l’américaine, comme un self made man – ; l’un, neurologue viennois, l’autre, psychiatre bien parisien, doivent à leur seul discours, et à l’agalmatique supposition de savoir qu’il engendre, les triomphes qu’ils connurent de leur vivant, et la place qu’ils ont gagnée dans la mémoire des hommes, sans aucune reconnaissance de l’appareil universitaire. Comparez avec un Max Weber, par exemple, né de la cuisse de Jupiter. Tu verras pour Lacan, cela ne fait que commencer : il donnera pour 300 ans du fil à retordre aux universitaires – comme c’était le vœu de Joyce, d’ailleurs, non le sien.
2) Mais, non, point du tout, le psychanalyste se distingue de tous les personnages glorieux ou infâmes que j’ai évoqués, en ceci, qui ne s’était jamais vu jusqu’alors, qu’il se refuse, s’il agit de façon conforme à la logique de son acte, à exploiter la sujétion où l’effet de transfert met le sujet analysant. Une analyse accueille le plus souvent un transfert déjà là, manifeste dans la demande d’analyse, sinon elle le suscite ; elle l’intensifie, le porte à l’incandescence ; mais c’est aux fins, disait-on, de « le liquider », d’éteindre à grandes eaux l’incendie. Lacan montre précisément qu’il s’agit de détacher l’analysant du sujet supposé savoir, de faire se dissoudre l’irréel salvateur, de manière que la supposition se dissipe, et emporte avec elle l’agalma merveilleuse, devenue le déchet de l’opération. Ce déchet, c’est l’analyste même qui l’incarne : il travaille à ce qu’on le quitte, qu’on le lâche, même si le transfert, une fois activé, ne revient jamais à zéro. Dans les termes peu châtiés dont Lacan usa une fois dans un discours plein de verve qu’il prononça devant les hiérarques de son École qui résistaient comme des perdus à l’introduction de la procédure de la passe : « être de la merde, c’est vraiment ce qu’il veut (l’analyste), dès lors qu’il s’est fait l’homme de paille du sujet supposé savoir ».
Si Socrate anticipe Freud, c’est par ceci, qui fait autant énigme pour ses contemporains que la passion dont il est l’objet de la part d’Alcibiade : c’est qu’il ne baise pas avec l’éphèbe sublime qui, apparemment, n’attendait que cela. Il lui indique l’objet véritable de son désir en la personne d’Agathon, qui, lui, n’est pas supposé savoir grand-chose : c’est un enflé.
Mais c’est faire apparaître, par après coup, que, dans le cours même de l’analyse, l’analyste, qui se mure dans le silence pendant que l’analysant l’enveloppe d’une parole de part en part jouissante, fait déjà le déchet, pour permettre à l’analysant de le prendre pour l’agalma, cause de son désir. Lacan eut le chic d’expliquer ceci à la télévision. C’était en d’autres temps, 1974, on ne vendait pas encore du temps de cervelle humaine aux marques de lessive, comme devait le dire plus tard, dans notre XXIe siècle bien parti pour battre tous les records d’abjection, un monsieur Le Lay, si bien nommé, alors patron de TF1. Mais quoi ? cet employé cynique ne faisait que manger le morceau. Le créateur de la publicité moderne, et de l’art des Public Relations, fut le neveu de Freud, Edward Bernays, arrivé aux États-Unis à l’âge d’un an, qui mit à profit ce qu’il avait saisi de la trouvaille du tonton. À ne pas oublier.
Le psychanalyste, qui s’emploie à ce que son patient le laisse tomber de la bonne façon, est dans une position objectivement masochiste. Mais ce masochisme tient à la structure de son acte. C’est dire qu’il lui faut se garder de la subjectiver, je veux dire d’en jouir. L’abnégation dont il lui faut faire preuve lui valut d’être, par Lacan, à la télévision toujours, assimilé au saint.
Saint Lacan des Analystes ! Mais oui !
Quant à l’amour, Freud en resta au loufoque « deux en un » d’Aristophane. Il voyait ses rapports avec ses élèves par le prisme du complexe d’Œdipe et de Totem et tabou: ils veulent ma place, ma peau, me faire mon affaire, parce que je suis leur paternel. Résultat : quand il écrit quelque chose qui pourrait ressembler à une autobiographie, cela s’appelle « Contribution à l’histoire du mouvement psychanalytique », et c’est un règlement de comptes, Gunfight at O.K. Corral, ou plutôt Le Train sifflera trois fois. Freud, Gary Cooper, descend Jung et Adler, et fait valoir ses titres de propriétés sur la psychanalyse. Je suis avec lui, bien entendu, mais c’est court. Pas touche à la femme blanche !
On en apprend plus sur lui en lisant le témoignage de ses analysants, comme pour Lacan d’ailleurs.
VIII.
Quelle fresque j’ai peinte la nuit dernière, et dans quelle fièvre ! quelle Pythonisse sur son trépied je fais ! C’est une fresque baroque de l’histoire du monde, avec pluie ruisselante de corps, de noms, et de concepts. Indigeste pour les anorexiques, amateurs du style classique, qui ne fut jamais classique que par une illusion d’optique, générée par des professeurs compassés, c’est le cas de le dire, à la solde de l’État. Je dis baroque parce que je me suis plu à rapprocher des hommes illustres dignes de Plutarque, mais pris par leur côté « vies minuscules » (Michon), et des phénomènes collectifs gigantesques. J’admire « l’effet de sourdine » des tragédies raciniennes (Leo Spitzer dixit), mais il se trouve que le signifiant ne vient pas « naturellement » à mon esprit, et sous ma plume, sous cette forme. Quand je me laisse aller, c’est plutôt la grosse caisse, les galipettes, les acrobates, le trapèze volant, l’entrée des clowns et des éléphants savants, plus la femme à barbe. Bref, le cirque, le carnaval de Rio, sur un rythme de samba, ou l’opera buffa.
Me relisant, je m’admire d’avoir pu expliquer comme en me jouant, autant de points chez Lacan qui sont abscons, même pour le lacanien moyen. Je suis évidemment, depuis le temps que je triture Lacan, devenu un lacanien supérieur, qui ne s’évertue pas à imiter le style du maître, et fait feu de tout bois avec son bois à lui. Il me semble que n’importe qui ayant un brin de lecture peut s’y retrouver, ou du moins sent qu’il pourrait ne pas se perdre dans Lacan avec un peu d’application. Il y a là une manière de procéder, logique et associative à la fois, que je cultive dans mes cours, qui a fait mon succès dans l’institution analytique, et qui convient à ce que j’appellerai sans fausse honte mon génie propre. Je me relis pour savoir par où ma muse m’a fait passer. Ma muse m’amuse, même si vous, pas. J’en ai une autre, mélancolique et dure.
Chez Lacan, ce que l’on trouve qui ressemble le plus à une autobiographie, et qui est à la fois plus pacifique et plus personnel que l’article de Freud, ce sont ces quelques pages des Écrits que, non dupe, usant du nous de majesté, il intitule glorieusement « De nos antécédents ». Il y expose d’où il vient, sa formation de psychiatre, sa rencontre avec l’analyse. Il y présente un par un ses principaux travaux d’avant 1953.
C’est à cette date, en effet, qu’il écrivit pour un congrès psychanalytique à Rome le rapport intitulé « Fonction et champ de la parole et du langage en psychanalyse », qui marque à ses yeux, si je puis dire, sa naissance à l’enseignement de la psychanalyse, son coming of age doctrinal. Il y a ici, pour lui, une coupure, impliquant rejet, où le simple « antérieur » chronologique passe au rang de « l’antécédent », plus complexe, car supposant une coupure temporelle, qui fait de Lacan une sorte de born again, qui dirait : « Enfin, je deviens moi-même. »
Cette pseudo-biographie scande en fait une Aufhebung du sujet. La difficulté à traduire en français ce terme « spéculatif » de Hegel, qui utilise ici une ressource propre à la langue allemande, est bien connue ; Lacan laisse toujours le mot en allemand, et s’en sert dans son premier enseignement pour désigner l’opération-clef du signifiant, qui nie, raye, dépasse, élève, symbolise, métaphorise, ce qu’il y avait là, au départ, d’imaginaire ou de réel, et qui, bien que dépassé, est néanmoins conservé, ne cesse pas d’exister. C’est aussi dans ce rapport de Rome que, pour la première fois, Lacan ordonne la psychanalyse au triptyque du symbolique, de l’imaginaire, et du réel, dont il usera tout au long de sa vie. Il y « met en question le sujet », c’est-à-dire fait du sujet analytique une question comme telle. « Je n’est pas un autre », peut-on dire, c’est un point d’interrogation, un x, une place vide.
Or, il y a manifestement en 1957 un ressaut de la coupure de 1953. À la fin de son écrit de « L’instance de la lettre... », Lacan inscrit une mystérieuse suite de lettres : « T.t.y.e.m.u.p.t. » On sait maintenant ce que cela veut dire, mais on ne le savait pas, je crois, avant que je le demande à Lacan et que je le répète à tout vent. Je me souviens encore de son regard de commisération lorsque je l’avais questionné : « Vous n’avez pas compris... ? » – puis, dans un souffle – « Tu t’y es mis un peu tard. »
Pourquoi cette admonestation à soi-même ? Et, d’abord, pourquoi à cette place ? Je conjecture qu’avec « L’instance de la lettre... », la mise en question du sujet trouve, trois ans plus tard, à se compléter d’une doctrine du signifiant enfin apte à formaliser les effets de sens de ce signifiant. Il y aura encore comme une troisième naissance de Lacan, en 1964, quand il réussira à introduire son fameux objet petit a sous une forme assez logifiée pour considérer qu’il donne enfin au texte de 1953 la suite qu’il méritait. Cependant, en un autre sens, c’est tous les ans que renaissait Lacan, phénix de la psychanalyse, chaque fois qu’il reprenait le monologue de son séminaire, mais sous un angle nouveau, dépassant-conservant les résultats précédemment acquis.
Ce T.t.y.e.m.u.p.t. n’est pas sans rappeler les signaux que Stendhal se laissait à lui-même dans ses marginalia. C’est, par exemple, dans La Chartreuse de Parme, l’inscription d’allure cabalistique dont il fait le mémorial personnel de sa rencontre avec les deux sœurs charmantes dont la cadette sera l’impératrice Eugénie. Lacan a donc laissé en colophon de son « Instance de la lettre... » la trace d’un regret qu’il avait eu : celui de s’être rejoint, d’être devenu lui-même au moment où c’était déjà, sinon trop tard, du moins « un peu tard ». Je m’explique par là cette hâte qui l’animait, ce sentiment d’urgence qui certainement l’habitait, et qu’il diffusait autour de lui, comme c’est aussi le cas de ceux dont je parlais, qui franchissent la fameuse passe. Il l’a dit d’ailleurs, une fois, que cette passe, il la faisait sans cesse. Il était, pour ainsi dire, un passant considérable, et qui s’est incrusté à sa place plus longtemps qu’un Rimbaud, ce drop-out de génie.
« Le sérieux, c’est la série », disait-il à son séminaire : ne pas lâcher, ne pas dire stop ; toujours penser aux conséquences, les peser à l’avance, mais les assumer vaille que vaille, quoi qu’il en soit, et boire la coupe jusqu’à la lie : un analyste qui s’excuse au nom de ses bonnes intentions, c’est à se tordre.
Cela, cette suite de lettres, ce message secret envoyé à soi-même, je l’avais déjà évoqué dans mon cours, jadis, avec bien d’autres détails, infimes d’apparence, et si révélateurs. Mais je le faisais toujours en passant, dans les marges de mon propos. Le mot « urgence », par exemple, figure dans la phrase pénultième, métalangagière, du dernier texte que j’ai pu recueillir dans le volume de ses Autres écrits : « Je signale que comme toujours les cas d’urgence m’empêtraient pendant que j’écrivais ça. » Et la phrase ultime déclare qu’il écrit pour être « au pair avec ces cas, faire avec eux la paire » – c’est son devoir, dit-il.
C’était aussi son désir – son désir et son urgence, son désir est urgence.
IX.
Vie de Lacan. Si cette formule m’est venue, c’est qu’elle résonne en moi de ce genre littéraire qu’on appelle la vie des hommes illustres, qui prit naissance dans l’Antiquité, se poursuivit à la Renaissance, et vint à ma connaissance en 1953, quand j’étais en classe de sixième, sous la forme du De Viris illustribus... de l’abbé Lhomond, puis, quelques années plus tard, avec les Vies parallèles de Plutarque.
L’érudit nous apprend que l’écriture de la Vie est une tout autre discipline que l’histoire. Il y a à l’origine comme une bifurcation entre le registre de l’histoire, sa postulation vers l’exactitude – rapporter l’événement – et l’écriture des Vies, qui, dans l’Antiquité, était du registre de l’éthique. C’est ainsi que j’entends Vie de Lacan : relever ce qui, du registre de l’éthique, peut être pointé dans son être et dans son existence.
L’éthique n’est pas la morale. Par beaucoup de traits, et même par un trait essentiel, Lacan n’était pas et ne se croyait pas un homme de bien. « Je n’ai pas de bonnes intentions », dit-il une fois à son séminaire, moquant les préjugés de ceux qui pensent bien. Cela ne rend que trop aisée la tâche de qui s’avance vers sa mémoire déguisé en porte-parole des gens honnêtes, ceux dont le rêve, dit Alphonse Allais, est de pouvoir tuer en état de légitime défense. Lacan pensait mal, et ne s’en cachait pas. Il ne s’en cachait pas, mais enfin, il ne le disait pas trop fort non plus.
Au début de la Vie d’Alexandre, Plutarque, distinguant le registre de l’histoire et celui de la Vie, semble, par un effet de rétrospection, annoncer Freud : « Nous n’écrivons pas des histoires, mais des vies, et ce n’est pas toujours par les actions les plus illustres que l’on peut mettre en lumière une vertu ou un vice. Souvent un petit fait, un mot, une bagatelle, révèlent mieux un caractère. Comme les peintres, qu’on nous permette à nous aussi, de la même manière, de nous attacher surtout aux signes qui révèlent l’âme. » Cela s’ajuste fort bien à Vie de Lacan. Il n’en va pas de même de l’idée de ce qui s’appelle, dans la tradition classique, les grands hommes, dont la Vie serait un monument écrit sous le regard de la postérité, et destiné à les donner en exemple.
Le statut de cette postérité est bien discutable. Diderot, par exemple, l’a discuté, dans sa correspondance avec Falconet, le sculpteur. La postérité, Queneau l’envoie paître, et s’y reprend à trois fois, car ça dure longtemps, la postérité : « et à la postérité / j’y dis merde et remerde / et reremerde ». Lacan me paraît avoir été au diapason. La postérité n’avait absolument pas de consistance pour lui ; il ne lui serait pas venu à l’idée d’en faire un sujet supposé savoir, ni de lui rien sacrifier. Toute forme de survie au-delà de la mort lui paraissait une fiction, et il s’en passait. C’est du réel qu’il avait le goût. S’il a pu évoquer le temps où l’on reprendrait ses écrits pour y chercher les clefs des impasses croissantes de notre civilisation, c’était une déduction plutôt qu’un vœu à proprement parler. J’attristais Judith quand je lui disais que, s’il m’avait installé dans la position de rédiger ses séminaires, je voyais tout de même chez lui un petit côté après moi le déluge.
À la Renaissance, on s’enchantait de Plutarque ; au XVIe siècle, l’écriture de la Vie des grands hommes passa même, si je puis dire, au stade industriel. En ces temps-là, quand on était prince, et qu’on cherchait à avoir son petit retentissement médiatique, on faisait écrire une bonne petite Vie de soi par le scribe de service, c’était tout ce dont on disposait. Montherlant, qu’on ne lit plus, l’a peint dans Malatesta d’une façon si amusante et pertinente que je ne résiste pas au plaisir d’ouvrir ici une parenthèse.
Nous voyons le terrible seigneur de Rimini, devenu vieux, cultiver son biographe, le couvrir de bienfaits, tout en l’humiliant, jusqu’à ce que ce dernier, à la toute fin de la pièce, se venge. Une fois assuré que son maître, qu’il a empoisonné, ne peut plus se lever de son fauteuil, il entreprend, sous ses yeux, de jeter au feu, page après page, le manuscrit, en cours de rédaction, de la fameuse Vita, qui était ce que son maître avait de plus cher. Malatesta impuissant en appelle aux mânes de Jules César, du Grand Pompée, des Gracques, et de Scipion, son cousin ; leurs spectres apparaissent ; il les supplie de lui envoyer un signe : « Dites-moi que mon nom palpitera encore à côté des vôtres ! » ; devant le silence de ces Autres, dont la semblance soudain s’efface, il prononce un vœu de mort contre lui-même : « Alors, que je m’efface moi aussi. » « Il s’écroule ». Sur cette didascalie, rideau.
Grand Guignol peut-être, mais de même structure que l’acte de Médée répudiée, égorgeant les enfants de Jason, ou celui de Madeleine jetant au feu les lettres d’André (Gide). Madeleine et Médée, la comparaison est de Lacan.
Toujours est-il que l’écriture des Vies n’a rien à voir avec ce que nous appelons maintenant une biographie. Une Vie se place plutôt sous l’égide de la figure magnifique qu’Aristote a dressée dans son Éthique à Nicomaque, celle du magnanime, megalopsuchos : elle agalmatise le sujet, le convertit en objet très précieux. Seulement, Lacan, si versé dans Aristote, n’était pas magnanime. Il ne voyait là qu’une de ces façons de se pousser du col qui ne l’impressionnaient pas.
On était, en ces temps, assez loin de ce que l’écriture de la vie de quelqu’un deviendrait au « stupide » XIXe siècle, quand elle fut incorporée au genre historique, et aspirée par le discours de la science, alors que la structure de celui-ci emporte forclusion du sujet. De là le caractère souvent croquignolesque des portraits d’écrivains chez Taine, dans son Histoire de la littérature anglaise par exemple, qui fut si fameuse en son temps : sa phrase si claire, courte et bien frappée, a toute l’efficacité de celle du jeune Sartre. Pour lui, une œuvre n’était pas « le caprice d’une tête chaude » ; c’était le « fossile » d’un monde disparu, à reconstituer dans toute son ampleur, par tous moyens documentaires. Dans le nouveau genre de la biographie érudite et pseudo-scientifique, pour quelques chefs-d’œuvre littéraires, dont la Vie de Jésus de Renan, à laquelle Lacan se réfère dans ses Écrits, il y a d’innombrables et innommables barbouillis.
La psychanalyse entrant dans la danse par le biais du Léonard de Freud, qui est bien autre chose qu’une biographie, on a vu naître au siècle dernier la « psychobiographie », où l’auteur s’installe sans façons dans le for intérieur du sujet pour détailler ses motivations. C’est un ouvrage de ce genre que Roquentin, dans La Nausée, s’efforce d’écrire, et il renonce. Mais Sartre n’y a pas renoncé, lui. Son Baudelaire a été visiblement lu par Lacan dès sa sortie dans les Temps modernes en mai 1946 ; l’ouvrage l’avait assez impressionné pour que, dans un texte de septembre de la même année, il assigne la causalité psychique de la folie à une « insondable décision de l’être », voire à un « insaisissable consentement de la liberté ». Ce sont là, en effet, des variations sur la formule du philosophe imputant à un « choix originel » du poète, le ratage de sa vie comme le triomphe de son œuvre. Ladite formule conjoint génialement le Heidegger de Sein und Zeit au Freud du « choix de la névrose » par le sujet. Sartre, de son côté, mentionnera Lacan, mais plus tard, dans son Flaubert.
Au reste, les biographies qui se lisent, se lisent comme des romans, parce que ce sont nécessairement des romans. Les meilleures l’avouent ; les autres cachent leur absence de style en faisant mine de faire de la science. Bravo, Sollers ! qui écrit ses Mémoires à l’enseigne du genre «roman». Napoléon n’écrit pas, mais s’écrit, montrant bien par là qu’il ne se prenait pas pour Napoléon, comme le fait croire Las Cases, que dévorait Julien Sorel : « Quel roman que ma vie ! » C’est aussi le cas du cardinal de Retz, que je mets au-dessus de tout pour la langue, le seul qui se compare avec Stendhal, et les personnages de Stendhal. Et Chateaubriand ? Je l’ai longtemps détesté – poseur, puant, faux, réac, du toc, pour la lyre ou la harpe je préfère Harpo Marx, etc. – jusqu’à ce que Barthes me fasse lire la Vie de Rancé. Mais c’est mon très cher François, Regnault du nom, qui changea tout, en me récitant par cœur la dernière phrase de la troisième partie des Mémoires d’outre-tombe, alors que nous écrivions ensemble, au printemps 1971, un texte hyper-gauchiste pour les Temps modernes – « La vie quotidienne dans l’empire du Fer » qui ne fut pris que sur les instances de l’ami Badiou, bien en cour en ce lieu.
Au reste, c’est Thomas de Quincey qui m’a appris à ne jamais craindre les digressions.
X.
Le choix originel... Comment ne pas se demander quel fut celui de Lacan, sa « décision insondable » à lui ? celle qui présida à sa vie, qui aurait peut-être commandé l’orientation de son enseignement, qui expliquerait aussi l’image si contrastée qu’il a laissée de lui à ses contemporains.
Selon les principes de Lacan lui-même – qui ne fait sur ce point, comme sur beaucoup d’autres, que reprendre, éclairer, et prolonger Freud – un analyste est par excellence l’homme qui ne saurait plaider l’innocence. Il est, en effet, censé croire à l’inconscient, c’est-à-dire à l’existence d’un savoir dont le statut est paradoxal, puisqu’on le suppose faire l’objet d’un refoulement de la part du sujet. C’est donc un savoir, mais dont le sujet ne veut rien savoir, un savoir, mais à l’état d’insu.
La double négation que contient la phrase « n’être pas sans savoir » exprime bien ce dont il s’agit : c’est-à-dire d’un ne rien vouloir savoir ce qui le fait responsable de ce qu’il se sait vouloir, mais aussi bien de ce qui se trame en lui à son insu, « à l’insu de son plein gré », selon la formule qui monta aux lèvres du cycliste Richard Virenque alors qu’il était accusé de s’être dopé, et cherchait à se dédouaner. « De notre position de sujet, écrit Lacan, nous sommes toujours responsables. Qu’on appelle cela où l’on veut, du terrorisme. » Il ajoute, et c’est propre à faire frémir les bonnes âmes : « l’erreur de bonne foi est de toutes la plus impardonnable ».
Essayez de l’entendre, prêtez attention. Le sujet de mauvaise foi fait le maître : il a l’idée de maîtriser l’autre en le manœuvrant, et, pour ce faire, il lui faut d’abord se maîtriser lui-même, c’est-à-dire tenir en lisière, et dominer, ce premier mouvement dont Talleyrand, grand coquin devant l’Éternel, disait qu’il fallait s’en méfier, parce que c’était le bon. Il s’efforce de ne pas se trahir. C’est donc qu’il conçoit au moins qu’il n’est pas tout d’une pièce, qu’il peut travailler contre ses intérêts, se dénoncer lui-même par une gaffe, que ce soit lapsus ou acte manqué. C’est au moins un sujet qui se sait divisé, fendu, et qui se tient en garde contre son inconscient. C’est précisément ce que veut ignorer le sujet qui fait fond sur sa bonne foi pour excuser et couvrir ses erreurs et ses errements. Lui croit savoir ce qu’il en est de lui, et qu’il est bon, tout uniment ; il ne se méfie pas de lui-même, ne veut rien savoir de sa division subjective ; ses fantasmes ont dès lors tout loisir de le mener par le bout du nez sans qu’il n’y voie que du feu. Or, le sujet n’est pas seulement en ce lieu où il s’assure que « moi, c’est moi », mais aussi là où il est de part en part déterminé par son inconscient. N’attendez dans ce cas aucune indulgence de la part de l’analyste, qui imputera toujours votre « erreur de bonne foi », votre bévue, à ce qui de vous prospère, à l’abri du refoulement, dans cet insu que vous n’êtes pas sans savoir, c’est-à-dire à l’inconscient. Lacan a tenté l’Une-bévue à partir de l’Unbewußtsein freudien, ce jeu de mots inter-langues est de lui. Pour l’analyste, votre intention joue sur deux plans à la fois. Il y a ce que vous voulez bien connaître de votre intention, à savoir, ce qui vous permet d’être bon, innocent, voire impeccable, à vos yeux, de préserver ce que psychologues et psychothérapeutes appellent à l’occasion « l’estime de soi » : ils s’offrent à vous la remettre en état quand ils la jugent trop détériorée pour vous permettre de vaquer à vos occupations. Mais il y a aussi l’intention mauvaise, qui est refoulée, celle qui fera retour dans vos rêves et dans votre conduite tant que vous ne consentirez point à la reconnaître comme vôtre. Les psychanalystes, eux, nomment cela le désir inconscient. On ne le voit pas en clair, il est crypté comme un message secret que vous vous adressez à vous-même sans le savoir, et on ne l’atteint qu’à condition de l’interpréter : « le désir, c’est son interprétation », disait Lacan, et il recommandait à chacun d’être plus voisin de sa propre méchanceté – plutôt que de se persuader de sa bonté.
Freud ne dit pas autre chose quand il souligne que le sujet ne saurait se tenir quitte de ses rêves, et de leur contenu immoral, sous le prétexte qu’ils seraient l’expression de son inconscient, et non de « lui-même ». Ce que la psychanalyse vous apprend, c’est justement que le sujet de l’inconscient conditionne votre moi.
Cela est à mesurer au plus juste, puisque les traits ici mis en valeur sont susceptibles d’avoir sur beaucoup d’analystes un effet d’identification, positive pour certains, pour d’autres en sens opposé – « contre-identification », dit-on.
Il y a des rois, des généraux, des philosophes... exemplaires, la bibliothèque universelle en déborde. Il n’y a pas d’analyste exemplaire, s’il est vrai que les analystes sont disparates, qu’ils sont, selon l’heureuse expression du dernier écrit de Lacan, des épars désassortis. Chacun arrive à l’analyse par une voie qui lui est propre. Il fut un temps où les psychanalystes américains, immigrés d’Europe pour la plupart, qui cherchaient à se faire bien voir – comment ne pas les comprendre ? – et à se fondre dans le melting-pot, s’efforçaient de répandre de Freud le portrait d’un homme en tous points exemplaire, au sens des Puritains de la Nouvelle-Angleterre. Entreprise herculéenne.
À la différence du projet classique de la Vie, on ne peut vouloir faire de Lacan un exemple, ni un contre-exemple. C’est un cas singulier, ne répondant à aucune règle générale, une exception. Mais comme « tous » les analystes sont des exceptions, et que Lacan en est une beaucoup plus évidente, plus incandescente, que les autres, celle-ci en devient exemplaire, paradigmatique. Un paradigme ne veut pas dire que tous les cas sont pareils, ou s’efforcent de l’être : j’entends par un paradigme un cas différent de tous les autres, mais qui les éclaire de sa différence même. Nous sommes là sur une ligne de crête.
Il est clair que Lacan voulut être une exception, et s’assumait comme tel. « Ensemble, tous ensemble, ouais ! » – ce slogan bien français, très peu pour lui. Le sien, ce serait plutôt la devise qu’il avait lui-même forgée pour le névrosé : « Tous sauf moi ». Il a fini par le dire ouvertement à son séminaire, peu après sa lettre du 5 janvier 1980 qui indiquait son intention de dissoudre l’École qu’il avait fondée. Il évoquait sa vie, écoutez bien, comme une vie passée à vouloir être Autre malgré la loi.
Cet aveu sensationnel fait écho pour moi à ce que Lacan m’avait dit dix ans auparavant, et qui fut noté le soir même, ou le lendemain, par François Regnault, mon ami à la mémoire d’éléphant, qui se trouvait là, avec Sylvia et Judith, dans la salle à manger du 3, rue de Lille. C’était trois ans après mai 1968, alors que j’étais moi-même un garçon révolté, et Lacan, à qui j’avais annoncé certains projets que je nourrissais avec des camarades, me parlait de sa révolte à lui, il me la donnait en exemple. Lui, disait-il, sa révolte – celle d’un bourgeois, il assumait ça, sans fausse honte, à la différence des « gauchistes » –, il l’avait fait passer dans la psychanalyse. Non pas que la psychanalyse lui eût fait passer sa révolte, mais il l’avait mise en œuvre dans la psychanalyse, et, de même, il m’invitait à faire quelque chose de ma révolte, qui ne soit pas de se battre contre des moulins à vent, ou de courir sus au chiffon rouge, comme le taureau sacrifié dans l’arène. Il me prédisait une mort certaine si j’affrontais des gens d’une autre espèce : « Vous ne serez jamais un tueur », me disait-il.
Si Lacan prête le flanc à la calomnie, à la différence de Mère Teresa – en fait, on dit pis que pendre de Mère Teresa, bien entendu –, si on diffame si facilement Lacan, c’est en raison de sa révolte contre ce qui vaut pour tout x, sa révolte contre un universel paresseux. Un homme révolté contre l’universel, sa position n’est pas sans affinités avec celle des femmes. Cela se démontre dans l’algèbre de Lacan.
La vie des femmes illustres, on l’a surtout écrite sur le mode libertin d’un Bussy-Rabutin, ou en les couplant avec Les Dames galantes, comme Brantôme. Lacan le pose en principe, universel justement : « La femme, on la diffame. » C’est de structure. De fait, pendant longtemps, pour qu’on s’intéresse à une femme, il fallait en effet qu’elle fût plus ou moins perdue de réputation, et les choses ne commencèrent de changer, lentement, qu’au tournant du XVIe, puis au XVIIe siècle. Mme de Scudéry n’est pas seulement l’auteur de la Clélie où figure la fameuse Carte du Tendre, mais d’un recueil des Femmes illustres. Lacan, contre Molière, était du parti des Précieuses ridicules et des Femmes savantes. Depuis lors, le « deuxième sexe » a pris le mors aux dents. Mais la figure de la femme illustre n’en est pas pour autant devenue un pilier de la culture humaniste, qui, en vérité, promeut l’homme comme le féminisme promeut la femme. L’humanisme est tout animé de ce que Lacan appela, visant Montherlant à qui Lévi-Strauss succédait à l’Académie française, une « éthique de célibataire ».
Que veut dire ce « malgré la loi », à le prendre au sérieux ? Lacan s’avoue fièrement transgresseur, et joue au délinquant, au vaurien, au voyou. Genet, ou même Rimbaud, avaient tout de même d’autre titre à cela. Lacan est donc à la fois le théoricien qui invente d’emblée, au début de son enseignement, le « Nom-du-Père » comme pivot de la loi de l’Œdipe, et, d’autre part, celui qui, à la fin de sa vie, assume d’avoir voulu se différencier du reste de l’humanité, en infraction de la loi commune. À le mettre dans sa bouche au futur antérieur, temps du verbe dont il avait le goût, il ne veut pas disparaître sans l’avoir dit : « J’aurai donc été dans ma vie un malgré-la-loi ».
Un malgré-la-loi n’est pas un hors-la-loi, un outlaw. C’est quelqu’un qui ne se laisse pas intimider par la loi de médiocrité. Lacan bravait la loi, en effet, et dans les plus petites choses.
Il ne vous est pas arrivé de conduire une voiture avec Lacan à vos côtés pour passager, mais il faut que vous sachiez que, s’il y avait une chose qu’il trouvait « absolument intolérable », c’était d’avoir à s’arrêter aux feux rouges. Je n’allais pas jusqu’à brûler le feu pour lui, comme lui le faisait à tout coup quand il conduisait, j’essayais d’avoir toujours le feu vert. Mais, une fois, sur les quais, non loin de la rue de Lille, voilà que je tombe tout de même sur un feu rouge. Lacan avait alors soixante-quinze ou soixante-seize ans. Il ouvre la portière, met pied à terre, monte sur le trottoir, et continue d’avancer seul, fonçant tête baissée, comme à son habitude. Il était du signe du Bélier, et la description des natifs de ce signe, dans tel ouvrage d’astrologie, lui va comme un gant. J’ai obtenu, de l’autre côté du feu, qu’il remonte dans la voiture. Mais ce comportement apparemment irrationnel montre bien que son « malgré-la-loi » n’était pas qu’une formule : il y avait chez lui comme une intolérance pure et simple au signal stop en tant que tel. Là était, aurait-on dit, son impossible à supporter, son réel à lui.
Voici ce que m’a raconté sa fille.
Un jour, elle le conduit du nord de l’Italie à Stockholm, où doit avoir lieu le congrès de l’Association internationale de psychanalyse. Nous sommes à l’été 1963, le congrès porte sur la sexualité féminine, Lacan a contribué par un texte à sa préparation. Il est soucieux : son cas sera examiné en séance administrative, avec le cas Dolto, tenue également pour déviante ; l’Exécutif tranchera. Ce sont trois jours de route. Ils partent juste à temps pour arriver à l’ouverture. Lacan manie les cartes, Judith conduit. Son petit coupé-cabriolet Renault file à vitesse soutenue, régulière, son père s’en satisfait, il est content. Elle sait qu’il ne supporte pas les feux rouges, et donc, elle s’arrange pour ne pas en rencontrer. Pendant 500 kilomètres, miracle : pas un seul feu rouge ! Elle est ravie. À la sortie de Langres, elle tombe sur un passage à niveau : le train va passer, la barrière descend. Et Lacan : « Je n’aurais jamais dû te faire passer par là. »
Voilà une anecdote qui dénote un mode d’être très singulier. Ai-je à craindre que l’on aille faire comme Lacan ? Un tel rapport à l’Autre, à ses interdits les plus légitimes, un tel rapport d’impatience, n’est pas donné à tout le monde. Lacan a conté publiquement que, durant son internat de médecine à Sainte-Anne, il avait mis aux murs de la salle de garde une formule de son cru : « N’est pas fou qui veut. » Être médecin, psychiatre, professeur, pompier, on peut en effet le vouloir, mais être fou, c’est une autre dimension de l’être. Eh bien, être Lacan, aussi.
N’est pas Lacan qui veut, c’est heureux. Mais n’est pas Lacan qui veut, et beaucoup ne le lui ont pas pardonné. Et puis, c’était un autre temps. Aujourd’hui, pour trouver pareil comportement de rupture, il faudrait regarder du côté des rockstars ou des top-modèles. Une Naomi Campbell, peut-être. Encore Lacan ne s’est-il jamais drogué, même pour voir – je lui ai posé la question. Il ne frappait pas non plus les employés, s’il houspillait parfois la malheureuse Paquita, un peu sourde il faut dire, et peu alerte, qui, le soir après 18 heures, remplaçait à son cabinet la fidèle Gloria, dont il lui coûtait de se dispenser. Il ne rudoyait jamais les femmes. Il ne les appelait pas non plus « les bonnes femmes », comme on faisait chez les Sartre-Beauvoir.
Il faut tout de même que je conte encore ceci.
Au restaurant ou au café, quand le garçon négligeait son appel, passait sans voir, avec ce regard fixe et vide à la fois qui trahit la volonté bien arrêtée de ne pas sembler voir ce que l’on voit en effet, Lacan ne restait pas sans mot dire. Il ne se contentait pas de claquer des doigts, d’agiter le bras, de murmurer un « S’il vous plaît », ou encore de se lever pour tirer le garçon par la manche. Carrément, il hurlait. Il lançait d’un seul souffle un « OOOOhhhh ! » si sonore, si puissant, si prolongé, que tous dans la salle sursautaient et se retournaient sur lui, sur nous, l’air effrayé ou l’œil furibond. Le garçon de café, n’ayant plus le loisir, comme dans L’Être et le Néant, de jouer au garçon de café, accourait, démontrant par là les pouvoirs de la parole dans le discours du maître. Encore fallait-il que le maître, en l’occasion, y mette le ton et paye de sa personne. Lacan se souciait comme d’une guigne des réactions du public – tranquille comme Baptiste dès qu’il avait ce qu’il voulait.
Je ne le donnerai pas en exemple de la politesse française, mais vous essayerez de pousser un cri à la Lacan, et vous verrez comme c’est difficile. Il savait très bien se tenir très mal. Moi qui l’aimais bien, je considérais que l’urgence dont il était habité ne lui permettait pas de prendre son mal en patience. Ses manières en souffraient ; mais aussi, comme elles simplifiaient et stimulaient la vie de tout le monde ! Y compris celle du garçon : il se voyait légitimé dans son être, voyait qu’il comptait pour quelque chose en ce monde, puisqu’il avait pu être, ne serait-ce qu’un instant, ce qui manquait à ce personnage important, qui s’était démené pour attirer son attention et sa bienveillance. Et puis, que d’anecdotes à raconter, pour les uns et pour les autres ! Quelle plus-value de plaisir, et si libéralement distribuée ! Lacan, en définitive, payait de sa personne pour ré-enchanter le monde, déserté par les dieux depuis que la Richtigkeitsrationalität prétendait y régner en maîtresse absolue.
Au reste, c’étaient des éruptions. Comme je l’ai connu, il passait le plus clair de son temps à travailler, calme et concentré.
Des anecdotes où il tempête, écume, fulmine, contre tout obstacle quel qu’il soit, ou grince devant tout ce qui lui résiste – et qui est quoi ? sinon peut-être ce que lui-même appelle le réel –, il y en a à foison. Pour que Lacan tourne vers vous ce visage, il suffisait que vous ayez, à un moment ou à un autre, fait fonction de ce feu rouge ou de ce passage à niveau qui arrête le sujet dans l’élan de son désir, ou encore de ce regard vide qui ignore sa demande. Cependant, qu’on ne s’y trompe pas : il faisait cela, la plupart du temps, avec discernement. Il ne montrait ce visage que s’il avait chance, ce faisant, d’obtenir ce qu’il demandait. En somme, il ne se découvrait qu’au bénéfice de ceux qui n’attendaient que ça. Il y a, comme ça, des gens qui ont besoin, pour que leurs inhibitions tombent, que l’Autre manifeste son désir avec puissance et insistance.
Pensez-y. Si vous faisiez autant souffrir Lacan en lui refusant ce qu’il vous demandait, c’est donc que vous aviez en vous de quoi lui faire un plaisir immense. Dès lors, la distance paraissait infinie entre votre chétive personne et ce qu’elle recélait de bonheur possible pour ce mastodonte, par ailleurs si méritant. Donc, il aurait fallu que vous fussiez très meuchant pour maintenir votre refus au-delà du temps nécessaire pour que l’objet atteigne manifestement une valeur plus grande pour Lacan, qui le désirait de plus en plus, que pour vous – qui le lui refusiez de si mauvaise grâce que vous en deveniez de plus en plus indéfendable à vos propres yeux. Donc, au bout d’un temps variable tn, vous cédiez, très généralement.
Je conçois fort bien que ceux qui ne regardaient pas Lacan avec affection, quand ils étaient confrontés à ces manifestations d’un désir hors normes, aient pu penser qu’ils avaient simplement affaire à un rustre, un malappris, une sorte de tyran domestique et politique, voire un frénétique, ou même un fou. Ce fou, néanmoins, avait l’air de savoir très bien ce qu’il voulait, comme Lacan le dit d’Hamlet. Le problème était pour les autres, de ne pas arriver, en fin de compte, à savoir quoi exactement, d’où un certain soulagement quand ce désir errant s’arrêtait sur ça, et le réclamait à hauts cris.
Certains se plaisent à lui prêter des passions basses, qui sont, j’en jurerais, les leurs : fortune, notoriété, pouvoir. Mais tout cela va de soi pour l’homme de désir, ce sont des moyens de son désir, ce n’est pas son désir. Lacan incarnait au contraire ce qu’il y a d’énigmatique, de peu rassurant, voire d’inhumain dans le désir, et il reste encore aujourd’hui une énigme. Il incarnait quelque chose comme ce Que veux-tu ? dont lui-même fait dans son graphe le point-pivot du désir.
C’est ainsi que j’ai toujours vu que c’est soi-même qu’on juge en condamnant Lacan. Qui reconnaît en lui une figure ennemie dessine la sienne propre. Il est tout particulièrement insupportable à ce qu’on nommait jadis l’esprit petit-bourgeois. Cette expression, centrale dans l’existentialisme, et dont les intellectuels de gauche de l’après-guerre ne pouvaient se passer pour stigmatiser ce dont ils se croyaient émancipés, s’est depuis lors perdue, effacée par l’alliance improbable de la « moraline » et du « bling-bling », au point que je vois sur Google que La petite-bourgeoisie est aujourd’hui le nom d’une ligne de prêt-à-porter glamour. Toutefois, ce que représente Lacan, même vaguement, ce que l’on désigne sous son nom, reste encore de nos jours honni de tous les courbés pour faire carrière, les forcenés du conformisme, identifiés jusqu’à l’os à leurs insignes, médailles en chocolat, fonctions sociales ou simulacres cool, sans parler de ceux qui se travestissent en porte-parole de l’humanité, de son bon sens, ou de l’esprit incréé du monde, pour vitupérer les vices supposés de Lacan, acharnés qu’ils sont à lui faire la pire des mauvaises réputations. Au reste, bien entendu, quelques timides adoraient en lui un surhomme, alors que lui se voyait plutôt comme un malheureux aux prises avec le réel, notamment le réel des autres. Seulement, il y a ceci, qu’il ne s’y résignait pas. Cependant, si vous comptiez pour lui, pour un moment ou pour toujours, que ce soit par le quelque chose que vous pouviez faire, ou aviez fait, pour lui, ou, tout simplement parce qu’il avait du goût pour vous, Lacan savait être charmant, délicat, prévenant, il vous traitait fort bien, excessivement bien, avec des grâces et des salamalecs, comme un objet très précieux.
J’aime beaucoup le Lacan intraitable au quotidien. Si on le regarde avec plus d’indulgence que les petits-bourgeois, et un peu d’affection, on voit bien que braver comme il le fait les préjugés, les bonnes manières, voire la loi – mais laquelle ? je le dirai – c’est, à proprement parler, héroïque. C’est, en somme, mettre en question l’ordre du monde. « Tâcher toujours plutôt à changer mes désirs que l’ordre du monde », la belle maxime cartésienne qui résume tout ce qui est sagesse, antique et moderne, n’était pas pour Lacan. Il était du parti contraire. Il entendait, lui, changer autour de lui le train des choses, leur train-train, et avec une obstination, une persévérance, une constance, qui faisaient mon admiration, et qui m’incitaient, non pas certes à l’imiter, mais à le seconder. Et, ici, je pense à ce qui fut son avant-dernière parole avant de sombrer dans le coma : « Je suis obstiné. »
Les anecdotes lacaniennes sont toutes vraies, même celles qui sont fausses, car, en saine doctrine, la vérité se distingue de l’exactitude, et elle a structure de fiction. Tout ce qui court sur le personnage de Lacan, de vu, d’entendu, ou de forgé, inventé, ou simplement de mal entendu, qui le diffame ou qui l’encense, converge à peindre l’homme de désir, et même de pulsion, qu’il était. Comment ne pas se dire : « En voilà un, au moins, qui ne s’en laissait pas conter » ? Il était révolté, insurgé, exigeant, jusque dans les plus petites choses de la vie. C’est peut-être cela, le plus difficile, une insurrection quotidienne, de tous les instants, pour avancer sur son chemin, ne pas s’en laisser distraire, ne pas se laisser arrêter par les autres, par l’autre, l’indifférence de l’autre, sa sottise, sa maladresse, sa mauvaise foi, c’est-à-dire quoi, en définitive ? – ses symptômes. Et, en fin de compte, son inconscient. L’insurrection vigilante, perpétuelle, de Lacan, faisait voir par contraste à quel point nous sommes à chaque instant résignés, moutonniers. On attend son tour, on fait comme on nous dit, on ne veut pas être la tête qui dépasse, ou alors seulement si c’est aux applaudissements de la foule ou des médias. La révolte de Lacan n’était pas celle d’un simple asocial, elle était bien plus radicale. C’était, pour ainsi dire, celle d’un extra-terrestre, un qui, venant d’un autre univers, aurait été vraiment jeté dans le monde, selon le poncif heideggérien, et qu’impatienteraient les limites prescrites aux humains par l’esthétique transcendantale, celle de Kant, c’est-à-dire les formes a priori de la sensibilité, l’espace et le temps, voire la table des catégories, ce genre de choses, vraiment basiques.
Moyennant quoi, dans l’ensemble, on ne peut pas dire qu’il ait été téméraire. Il a mesuré ses audaces. Il n’a jamais eu la moindre complaisance pour les prestiges de la cause perdue. Il n’a pas tellement pâti de la rétorsion de l’Autre.
Oui, bien sûr, l’Association internationale, Vatican de la psychanalyse, alors basée à Chicago, persécuta celui qu’elle voyait comme un nouveau Luther, entré en dissidence, et le chassa – ou plutôt voulut l’émasculer comme analyste, en lui interdisant, par une directive sans appel émise de Stockholm le 2 août 1963, de former dorénavant des analystes. Cela fut sans doute bouleversant à l’époque : le groupe analytique auquel Lacan appartenait disparut ; la moitié se réfugia sous l’aile de l’Internationale ; les autres entrèrent dans l’École que fonda Lacan le 21 juin 1964. Aujourd’hui que les passions sont apaisées, n’en faisons pas toute une histoire : en définitive, cette Internationale se révéla n’être qu’un tigre de papier ; elle faisait peur, mais pouvait peu, sinon contribuer par sa grosse caisse et ses tambours au rinforzando de la calomnie.
Lacan, de son côté, avait de la ressource, ne se laissa pas intimider, et manœuvra comme un chef. C’est alors que je fis sa connaissance, janvier 1964, et je fus le témoin direct, et aussi l’un des instruments, de sa brillante contre-offensive. Il triompha en France, au prix de devoir y rester enfermé comme dans son pré carré, car coupé du milieu analytique international, qu’il fréquentait depuis des décennies – hormis le groupe de ses élèves belges, et quelques pseudopodes qui poussèrent en Italie dans les années 1970. La peine que lui causait l’éloignement de ses collègues étrangers fut toutefois adoucie par le succès littéraire et universitaire du volume de ses Écrits, sorti en 1966 sur les instances de Wahl, et aussitôt traduit en plusieurs langues. Mais tout cela resta insensible au Quartier latin et à Saint-Germain-des-Prés. À cette époque, quand on humait l’air des 5e et 6e arrondissements de Paris, on se sentait encore au centre du monde intellectuel, ou du moins sa composante la plus précieuse et rare. Pour ma part, ce n’est que très peu avant 1981 et la disparition de Lacan, que je m’aperçus que sa théorie, et ceux capables de la véhiculer, étaient impatiemment attendus dans le monde, au moins le monde latin.
Lacan se tenait à carreau du pouvoir politique, et des grands engagements collectifs. Sylvia et lui avaient caché des Résistants. L’un d’eux, devenu puissant homme politique à la Libération, leur offrit, me conta Sylvia, de leur faire attribuer la médaille de la Résistance. Ils dédaignèrent le cadeau, car, en ce temps-là, dans ce milieu-là, être décoré, voire nobélisé, c’était pouah ! Lacan n’avait pas songé à entrer dans un réseau de ladite Résistance. « Pourquoi ? », lui dis-je un jour. Réponse : « Je voyais bien sur mon divan qu’il suffisait d’un joli minois qui passe pour leur faire perdre la tête. » La réponse me parut légère, mais il connaissait ses limites, me disais-je. Cette aventure n’était pas pour lui : pas assez optimiste, pas du tout idéaliste, trop peu confiant en son prochain, et trop habitué à ne compter que sur ses propres forces pour faire dépendre des autres sa vie ou sa liberté, indemne enfin du narcissisme des élites, même héroïques et combattantes. Et puis, s’il était fort courageux dans le combat singulier, et savait faire à l’occasion le coup de poing – il ne se déplaçait jamais sans un coup de poing américain dans la poche du veston – il était en fait si maladroit de ses mains, en vrai bourgeois selon Alain, que son abstention durant l’Occupation avait sans doute mieux valu pour tout le monde : « Un instant plus tard, la bombe éclatait » – alors qu’il la tenait encore entre ses doigts. Je mets des guillemets parce que c’est un exemple qu’il aimait à citer, du linguiste Gustave Guillaume, pour illustrer les ambiguïtés de l’imparfait en français.
Il ne croyait pas le moins du monde à la Révolution. Ceci n’est pas une interprétation. Il citait toujours à ce propos, et cela m’irritait – m’irrite toujours un peu, pour être honnête – l’étymologie du mot : une révolution est un mouvement circulaire qui revient au point de départ. Il l’a dit, écrit, clamé, et dans les années qui suivirent immédiatement 1968, devant un public qui comptait nombre de gauchistes avérés, comme moi-même. Il ne se gênait pas pour préciser qu’il n’était pas non plus progressiste. C’est assez évident. Il n’empêche qu’on l’a classé assez sottement parmi les inspirateurs de la révolte de mai 1968. Il est vrai qu’il partageait avec la jeunesse révoltée la détestation de quelques semblants. Et puis, entre révoltés, on se comprend.
Mais, avec le sens de la révolte, il y avait chez lui ce « tact dans l’audace » dont Cocteau a donné la formule : « savoir jusqu’où on peut aller trop loin », et donc, en dépit de sa position d’être « Autre malgré la loi », ou plutôt à cause d’elle précisément, il n’était jamais téméraire, mais prudent – au sens d’Aristote, commenté par Aubenque. Cette vertu de prudence s’accompagnait chez lui d’une pratique constante de la ruse.
Entendons-nous bien. Je ne dis pas qu’il était faux. C’est tout le contraire. Si, dans la dimension de la Vie, le public et le privé se rejoignent, chez Lacan ils se confondaient, car, jusque dans l’intimité, il restait le même. Il n’y a pas un Lacan secret que seuls quelques privilégiés auraient eu l’avantage de connaître. Il était secret, je veux bien, mais alors, il l’était tout le temps. Grand rusé, dépistant son monde, ses femmes, grand comédien à ses heures, lisant si bien les grands textes classiques et modernes à haute voix, pour nous, à Guitrancourt, je ne trouve d’autre mot que celui-ci, qui relève selon Adorno du jargon existentialiste, pour dire qu’il était authentique. Rien de spécieux en lui, ce qui tranchait, « au temps où les faux-culs sont la majorité » (Brassens), comme toujours, d’ailleurs. Cependant, je ne puis m’empêcher de penser à son propos à l’Épître aux Corinthiens – « Je me suis fait tout à tous, pour les sauver tous. »
La formule a inspiré Ignace de Loyola. Voltaire, dans son Ingénu, baptise du nom de Tout-à-Tous le père jésuite à qui Mademoiselle de Saint-Yves se confesse et demande conseil. Lacan, dans son enseignement, était tout à tous, très caméléon. Plus précisément, il offrait un double visage. Sa langue était fourchue, auraient dit les Indiens de Fenimore Cooper.
D’un côté, il avançait imperturbable, avec son cortège de mathèmes, le grand A, l’objet petit a, le couple S1 et S2, le A et le sujet, tous deux décorés d’une barre de bâtardise, barrés, l’agalma merveilleuse et le palea qui pue, toute la smala, plus les schémas, le graphe, les bandes de Moebius, les unes indemnes, les autres coupées en long ou en travers, les surfaces se traversant elles-mêmes, le triskell, les tresses d’Artin, et puis, fermait la marche sa garde prétorienne de nœuds borroméens, à 3, 4, 5, n, ronds de ficelle. Ce n’était qu’à lui, c’était lui, sans concession, et il ramenait tout à cette grammaire, cette algèbre, cette topologie, si plastique, si tordue, cette fleur carnivore qui avalait tout, et vous le restituait aussitôt, mis en ordre, lumineux, avec des rapprochements inédits, transversaux, des fulgurances.
Mais par ailleurs, il était vous. Il venait vous chercher là où vous étiez, vous, avec votre smala à vous, vos bagages de préjugés et vos valises d’ignorances, et vos quelques résidus de notions vaguement acquises sur les bancs de l’école. Il ne voyait pas dans son auditoire un Autre idéal, il s’adressait à ceux qui étaient là, comme ils étaient, avec leurs poux, aux fins de conduire tout ce petit peuple, et lui permettre de comprendre ce qu’il avait compris, non par altruisme – il s’en méfiait comme de la peste, car fondé sur le stade du miroir – ni par charité – qui a toujours, disait-il, des « contrecoups agressifs » – mais parce que cela entrait dans son bonheur à lui, Lacan.
Spinoza ne dit pas autre chose dans son Traité de la Réforme de l’entendement, §14 : « Voilà donc la fin vers laquelle je tends : acquérir cette nature supérieure et tenter que d’autres l’acquièrent avec moi ; cela fait partie de mon bonheur de donner mes soins à ce que beaucoup d’autres comprennent comme moi, de sorte que leur entendement et leurs désirs s’accordent avec mon entendement et mes désirs ». Et Lacan : « Disons que je me suis voué à la réforme de l’entendement, qu’impose une tâche dont c’est un acte [l’acte analytique] que d’y engager les autres. » [1967]. Aussi, parlant de l’analyste, à la télévision, en 1973, comme d’un saint : « Moi, je cogite éperdument pour qu’il y en ait de nouveaux comme ça. C’est sans doute de ne pas moi-même y atteindre. Plus on est de saints, plus on rit, c’est mon principe, voire la sortie du discours capitaliste, – ce qui ne constituera pas un progrès, si c’est seulement pour certains. » Avais-je raison de lancer comme ça, en commençant cette Vie, que le collectif n’était rien pour lui ? Je me le demande. C’est plus compliqué. J’y réfléchirai.
Pour ce faire, ce pêcheur d’hommes jouait les Zelig. C’est le personnage de Woody Allen qui a la faculté de se transformer de manière à ressembler à n’importe qui. Un adage classique exprime très bien ce dont il s’agit : Uti foro, ce qui veut dire : « prendre le marché tel qu’il est, faire pour le mieux avec ce qu’on a ». Plutôt que de se fracasser sur la masse des préjugés de l’Autre, mieux vaut en tenir compte, pour contourner l’obstacle. La ruse est nécessaire à qui a pris la mesure de ses forces, et de celles de l’Autre, et ne s’abaisse pas à aboyer contre le Ciel.
Le sceau de Spinoza, qu’il imprimait parfois sur le cachet de cire rouge qui fermait ses lettres – l’enveloppe étant alors inconnue – portait comme devise, en latin, le mot Caute. C’est un adverbe. La racine se retrouve dans précaution et dans caution, qui veut dire prudence en anglais. Caute, et aussi bien caute cautim, veut dire : « précautionneusement ; en toute sécurité », comme dans Iter caute faciat : « Qu’il voyage en toute sécurité ! » Les spécialistes disputent de la traduction la meilleure pour l’usage du mot comme âme de la devise : Prudence !, ou Sois prudent, ou encore, comme mémento, N’oublie pas d’être prudent.
Lacan, de son côté, démontrait que, pour des raisons de structure et non de circonstance, la vérité ne peut se dire toute, mais seulement se mi-dire. Mais les circonstances peuvent faire que ce mi-dire obligé soit aussi opportun. Ainsi, la référence de Lacan à La Persécution et l’art d’écrire, de Leo Strauss, lue sitôt parue, grâce à Kojève, éclaire sa méthode discursive, d’énonciation métonymique. Il y a des choses qu’il faut faire entendre sans les dire, parce que les dire serait provoquer l’ire et la persécution de l’Autre. Et donc, on parle entre les lignes, de façon à n’être entendu que de ceux qui doivent entendre. Et quand personne ne doit entendre rien, on ne dit rien.
Sur quoi se taisait-il ? – sur ce qui, bon pour lui, ne l’était pas forcément pour les autres, sûrement pas pour les autres.
Cette image me vient, gréco-romaine, hellénistique : Lacan en Harpocrate, nu comme Éros, l’index sur les lèvres, me regarde. J’obéis au dieu, et me tais.
13 août 2011 (à suivre)

NB : Ce texte constitute le début de Vie de Lacan, à paraître courant 2012 aux éditions Grasset.