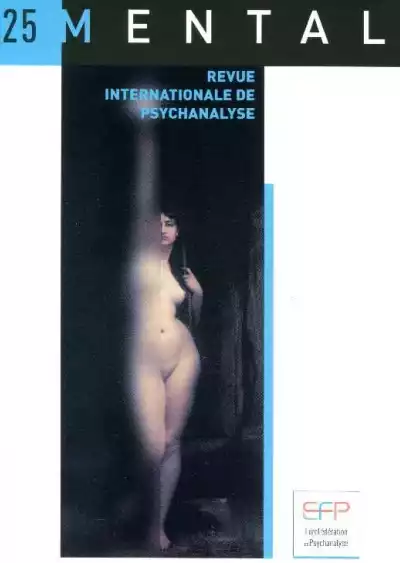-
Du neurone au nœud
Jacques-Alain Miller
Je m'acharne à chercher ce que le moment cognitiviste peut nous apprendre sur le discours analytique[1].
Si on voulait, « Du neurone au noeud », pourrait résumer, en prenant faveur de l'assonance des mots, la trajectoire de la théorie psychanalytique du tout premier Freud au tout dernier Lacan.
La visée matérialiste habitant la psychanalyse
Le neuroréel que nous rencontrons aujourd'hui, Freud l'avait en effet déjà élaboré autour de 1895, avec les moyens qui étaient alors à sa disposition, dans son brouillon-projet L'esquisse d'une psychologie scientifique[2]. Ce texte – resté longtemps non publié – a inspiré au moment de sa parution les commentaires de physiologistes, de neurophysiologistes, tout comme il a sollicité les analystes à prendre position à l'endroit de cette première tentative.
Il part, d'une façon parfaitement explicite, de deux théorèmes que nous retrouvons en jeu dans les neurosciences qui se sont développées et imposées à partir de 1970. Ces deux théorèmes, Freud les place sous les espèces de la conception quantitative et sous le titre de la théorie des neurones.
Le point de vue quantitatif freudien d'activité
Le point de vue quantitatif - il vaut la peine de s'en souvenir – s'impose pour Freud à partir de la psychopathologie, de l'observation clinique des pathologies mentales, qui mettent en jeu, selon lui, l'intensité excessive de certaines idées. Dans cet excès, il trouve le ressort qui fonde son recours à un principe dont il fait le principe de base de l'activité neuronale, en relation avec ce qu'il symbolise du sigle Q – initiale de quantité, définie comme ce qui différencie l'activité du repos.
Sa référence, l'étalon, c'est donc ce concept d'activité – d'activité psychique, d'activité neurale, d'activité neuronale – que nous avons vu en action dans les descriptions cognitivistes du cerveau. Cette quantité, ce repère, ce symbole quantitatif, Freud prend soin d'indiquer –ce qui est considérable – qu'il désigne une quantité soumise aux lois générales du mouvement. Il s'agit donc d'une réalité d'ordre physique, traitable selon les exigences du programme physico-mathématique. C'est sans aucun doute, pour lui, quelque chose de matériel.
Cette visée matérialiste habite la trajectoire de la théorie psychanalytique du neurone au nœud. Certes, la matière nodale que Lacan manie dans son tout dernier enseignement n'est pas susceptible d'être désignée par le sigle Q. Sans doute, si les nœuds obéissent à des lois, ce ne sont pas les lois générales du mouvement prescrites par la physique mathématique. Mais on pourrait dire que les nœuds tiennent la place de cette quantité matérielle qui est, par Freud, posée d'emblée lorsqu'il essaye de donner, d'élaborer une psychologie qui soit scientifique. Pour qu'elle soit scientifique, il faut qu'elle traite de quelque chose de matériel.
Se pose la question de ce qui fait la corrélation – est-elle fondée ou non ? entre science et matière.
Ce quelque chose de matériel se présente sous deux aspects bien distingués par Strachey dans le commentaire qu'il a appendu à ce texte dans la Standard Edition. Il faut y avoir recours puisque Freud, lui, n'explicite pas cette dichotomie. D'une part, cette quantité matérielle est qualifiée de flux ou de courant, qui passe à travers un neurone ou d'un neurone à l'autre, mais elle est – deuxième aspect – également susceptible de demeurer dans un neurone. Cette description semble d'autant plus métaphorique que, si je puis dire, ce Q reste un x dans l'abord de Freud. On a pu vouloir y reconnaître l'électricité, mais rien dans le texte de Freud ne vient valider cette traduction. Sa nature reste inconnue.
On peut, par la suite, la retrouver sous les espèces de ce que Freud appellera, sans thématiser le terme : l'énergie, l'énergie nerveuse, voire l'énergie psychique ; la question dès lors se pose de savoir en quoi cette énergie psychique se distingue d'une réalité physique. Avec son invention de la pulsion, Freud sera amené à mettre en jeu un terme dont l'être même apparaît comme limite entre psychique et physique.
C'est déjà, sous les espèces de ce sigle Q, une entité paradoxale, puisque c'est une quantité qu'on ne peut pas mesurer – les efforts quantimétriques de Reich sur l'énergie sexuelle resteront une déviation pour l'ensemble du discours analytique. C'est une quantité qu'on ne peut pas mesurer et qui pourtant vaut qu'on dise qu'elle augmente, qu'elle diminue, qu'elle se déplace, qu'elle se décharge. Sous sa forme développée, cette conception quantitative inspirera ce qui est resté dans l'enseignement de la psychanalyse comme le point de vue économique qui n'en dissipe pas, à vrai dire, le mystère et le paradoxe.
La théorie freudienne des neurones
Ce que Freud appelle la théorie des neurones – où il trouve le second principe de base de sa Psychologie scientifique –, s'appuie sur ce qui était alors une découverte récente de l'histologie, qui apprenait au monde que le système nerveux consiste en neurones distincts, qui ont même structure, qui sont en contact et qui trouvent à se ramifier.
La Psychologie scientifique de Freud se développe à partir de ces deux principes : référence aux neurones et à une quantité x qui circule ou qui stagne entre neurones, dans un neurone ou un ensemble de neurones. Retenons que la découverte à proprement parler de l'inconscient a été précédée par cette assignation d'une base matérielle aux phénomènes psychiques et à l'ensemble de la psychopathologie.
Le matérialisme lacanien du signifiant
Faisons là un court-circuit pour nous apercevoir que Lacan a, lui aussi, cherché une telle base matérielle et opéré avec cette référence. Ce n'est pas la base matérielle neuronale que Freud y avait apportée. Disons – je l'ai déjà dit comme ça jadis – que la référence biologique de Freud a été remplacée par Lacan par une base matérielle qui est linguistique – précisément, le signifiant. Le matérialisme du signifiant, dont Lacan pouvait se prévaloir à la fin des années 50 et dans les années 60, était bien approprié à satisfaire les élucubrations de ceux qui se voulaient être matérialistes dialectiques ou pour qui la dialectique ne faisait pas oublier le matérialisme.
On ne peut donc pas prétendre que la recherche d'une base matérielle au mental soit étrangère à la psychanalyse. Au contraire ! Elle est là au début. Elle est là à la fin. Et elle traverse l'œuvre de Freud, comme l'enseignement de Lacan.
J'ai souligné, la dernière fois, à propos de la causalité psychique, que Lacan opposait à la causalité physique, organique – que promouvait alors Henri Ey –, une causalité sémantique, à chercher dans le registre du sens. On n'a certes pas tort de le dire. Mais là aussi, il y avait néanmoins l'idée d'un analogue de cette base matérielle, puisque Lacan considérait alors que le registre imaginaire comme tel était susceptible d'avoir des effets réels sur le psychisme et sur l'organisme. Il cherchait ses témoignages dans l'éthologie animale, c'est-à-dire dans un registre où le langage n'était pas en fonction. Il avait donc une certaine postulation d'une base matérielle qu'il n'a trouvée et développée que lorsqu'il est passé comme ressort des transformations psychiques du mode imaginaire à l'ordre symbolique – un ordre symbolique qu'il a resserré sur une réalité matérielle, à savoir le signifiant. Même s'il n'en a pas fait le décor principal de son enseignement, le mot était là comme la base matérielle de ses constructions et, si l'on veut – allons jusque-là –, la base matérielle de l'inconscient.
L'abîme du raisonnement cognitiviste
J'ai parlé la dernière fois de ce concept d'activité qui est en fonction dans la conception cognitiviste et qui, en effet, me paraît crucial.
Cette conception marque déjà la distance où elle se trouve d'avec l'acte. Tout ce qui est rapporté à l'activité implique certes, mais suture ou forclot tout ce qui est du registre de l'acte. La référence à l'activité psychique, cérébrale, mentale, obéit au postulat que le psychisme double le cerveau, que le psychisme est le double du cerveau et que ce qu'on repère comme activité cérébrale vaut donc ipso facto pour le psychisme.
On doit constater, me semble-t-il – je dis me semble-t-il parce que je déchiffre la littérature de nos cognitivistes, je suis loin d'en avoir fait le tour, je n'y suis pas porté par le goût, je dois l'avouer, mais par le sentiment du devoir —, une problématique permanente, présente à travers les auteurs ; une problématique à deux pôles : la multiplicité et la synthèse.
Je prends par exemple deux phrases qui se suivent de mon ami Jean-Pierre Changeux, dans le dernier texte qui soit venu à ma connaissance : son introduction à l'ouvrage de son élève Dehaene sur Les Neurones de la lecture[3].
Changeux y écrit d'abord cette phrase : Le développement fulgurant des méthodes d'imagerie cérébrale a rendu accessible l'identification des bases neurales de notre psychisme. Premier point, il souligne la dépendance de cette investigation à l'endroit de la technologie. Il ne cache pas que ce qui est développé tient à l'apparition d'un instrument d'investigation : l'imagerie cérébrale, l'imagerie magnétique, qui a donné accès à quoi ? À de nouvelles perceptions, avant tout attestées – si je voulais employer leur langage – dans le système visuel. Il souligne, en effet, ce qu'on sait déjà – que les promesses du cognitivisme se sont faites plus insistantes et plus glorieuses depuis une quinzaine d'années. Ce développement, dit-il, a rendu accessible l'identification de bases. Nous sommes en effet – soulignons-le – au niveau des bases, au niveau basique. Les auteurs rapportent un certain nombre d'observations que, sauf contre-preuve, on n'a pas de raison de mettre en doute : des observations sur l'activation de zones neuronales dans le cerveau qui sont des bases nerveuses, des bases neurales. Je souligne l'aspect basique, dans la mesure où il y a un abîme entre ce qu'il appelle l'identification des bases neurales – là, on ne peut pas dire l'identification, il ne s'agit pas d'identification – et des hypothèses portant sur les sommets de l'activité psychique. On peut donc valider la phrase de Changeux, à condition de souligner ce terme de base et d'expliquer que le terme d'identification doit être pris au sens exact du mot localisation, terme que Changeux évite soigneusement, me semble-t-il, parce qu'on lui opposerait qu'il ne s'agit là que de la reprise, avec une technologie supérieure, de l'ambition de Broca. Il dit donc identification.
Moi, je suis d'accord avec cette phrase très simple : le développement de la technologie a été fulgurant, il a permis de percevoir et de localiser les bases neurales du psychisme. Pourquoi pas ?
Cela se corse avec la deuxième phrase.
Je ne les rapproche pas de façon arbitraire. Elles sont jointes dans son texte et témoignent du mode de raisonnement. Elles creusent, à mon sens, un gouffre.
Je le cite. Il reste cependant encore – donc ça, c'est un ajout: nous n'avons pas tout fait – à relier entre eux les multiples niveaux d'organisation emboîtés – ce sont les niveaux qui sont emboîtés – les multiples niveaux d'organisation emboîtés de notre cerveau – autrement dit ce qu'on a, ce sont des modules localisés séparément, le petit détail qui reste encore à régler c'est qu'il faut les relier entre eux – et en faire une synthèse pertinente – ici, il y a une équivoque puisque ce dont il s'agit c'est la question de savoir comment ces modules, qui sont localisés séparément, nous donnent une activité de synthèse, qui est ici en quelque sorte confondue avec la synthèse pertinente que nous, savants, nous aurions à faire de ces niveaux multiples – et en faire une synthèse pertinente qui nous permettra de comprendre les fondements neuronaux de la sensée consciente ou de la création. D'un seul coup, sous prétexte que ça reste encore à faire, nous avons comme sauté des bases neuronales du psychisme aux fondements neuronaux de la pensée.
La logique multiplicité-synthèse
Cet abîme entre multiplicité et synthèse me paraît caractériser l'ensemble du style cognitiviste. La promesse cognitiviste est bien d'englober, dans son enquête, la pensée, la création et ce qu'ils appellent désormais la culture.
Ils pensent, à partir des modules où ils localisent les bases neurales, réussir à se développer jusqu'à embrasser l'ensemble de la culture, en caractérisant comme culture l'essentiel de l'environnement de l'espèce humaine. Ils se promettent donc d'étudier l'interaction du cerveau et du monde extérieur.
La culture entre dans le programme cognitiviste, au fond pas si mal puisqu'elle est caractérisée comme un ensemble de signes, de signes matériels, avec références astucieuses à Ignace Meyerson : « Il n'y a pas de signe sans matière ». Dans la veine de Changeux, on a isolé un ensemble particulier de signes, qui est l'écriture. La recherche porte sur la reconnaissance de l'écriture et sur le pourquoi de la standardisation relative des signes écrits à travers les cultures, rapportés aux propriétés, le plus souvent supposées, des modules neuraux.
Nous avons donc une ouverture. Nous n'avons pas l'idée d'étudier le cerveau coupé de la vie de l'individu. Au contraire, le cerveau est situé dans un Umwelt caractérisé avant tout comme culture et comme ensemble de signes.
On trouve là, dans cet espace abyssal, il faut le dire une extraordinaire floraison d'hypothèses épigénétiques. L'épigenèse, c'est l'apparition, dans un être vivant, d'une forme nouvelle qui n'était pas contenue en germe dans cet être, c'est-à-dire qu'on ne prétend pas que ça ait été préformé.
On promet d'étudier les interactions du cerveau et de la culture – disons, les interactions du cerveau et du signifiant, pour employer notre terme, que n'ignore pas Changeux ; il le mentionne –, les interactions du cerveau et à signifiant, qui expliquent le développement extraordinaire des capacités de penser de l'être humain.
Je vois la même logique multiplicité-synthèse dans tel passage de Stanislas Dehaene, où il rappelle la modularité du cortex, qui se subdivise en multiples territoires spécialisés, dit-il, avant de faire appel à une synthèse, q serait le propre de l'espèce humaine par rapport aux espèces animales – il dit quelque part : une synthèse des contenus. Il faut dire qu'il postule cette synthèse, puisqu'il la marque lui-même du conditionnel : l'espèce humaine disposerait, poursuit-il, d'un système évolué de connexions transversales q augmente la communication et – donc, au niveau supérieur, pour l'instant hypothétique – brise – c'est son mot – la modularité cérébrale. Bien qu'elle soit posée au conditionnel, cette zone de synthèse est célébrée presque avec poésie. On lui défère toutes les capacités supérieures de la pensée : c'est là que s'accomplirait le rassemblement des perceptions et des souvenirs, c'est là que ces capacités seraient rassemblées, confrontées les unes aux autres, recombinées, et enfin synthétisées, de façon, dit Dehaene, à éviter le fractionnement des connaissances.
Nous avons, à plusieurs reprises, dans ces ouvrages, un chant qui s'élève aux extraordinaires capacités de connexions transversales posées comme hypothétiques et conditionnelles, mais évidemment nécessaires, puisque ce sont, entre guillemets, des facultés que nous avons. Il faut donc bien que, quelque part, elles existent.
L'antienne de la synthèse mentale et critique de l'atomisme
On a pu identifier la zone, là où d'ailleurs on l'a à peu près identifiée depuis toujours – sauf que maintenant on a l'œil dessus : le lobe frontal, le cortex frontal. Ce serait lui qui nous donnerait ce que Dehaene appelle joliment un espace de délibération interne. Ce serait le lieu du for intérieur. Alors, ce merveilleux cortex frontal à la fois recueille l'ensemble des données sensori-motrices et des traces mémorielles – il fait donc le tout de cet ensemble – et il serait, en même temps, merveilleusement détaché des contingences du présent pour, je cite, se tourner vers l'avenir. Nous avons, là, la description d'un cortex frontal, qui fait en quelque sorte tout ce que nous faisons, et dont – au conditionnel, parce que nous sommes savants – ce serait la conscience, la conscience réflexive.
Cela n'est pas franchement nouveau, puisqu'au XIXè siècle déjà, on cherchait l'organe des synthèses mentales, on cherchait à identifier ce qu'Aristote appelait le sens commun. Dehaene cite Avicenne qui, dès l'an mil, localisait le sens commun pas très loin du cortex frontal – sans nos moyens d'investigation à nous. Cortex frontal ou préfrontal, selon les auteurs ou les moments.
Cela permet à Dehaene d'énoncer l'hypothèse que la compétence à la culture, a conscience réflexive et l'existence d'un puissant réseau de connexions dans le cortex frontal ou préfrontal sont des phénomènes liés. Il ne va pas au-delà de la liaison, il s'arrête sur les bords de la causalité.
Nous avons donc ici quand même un gouffre entre l'identification des bases a les hypothèses épigénétiques sur les sommets. Et il n'y a, pour combler ce gouffre, que des hypothèses. Il n'y a pas d'observations, sinon celles de la densité du réseau de connexions dans certaines parties du cortex.
On est donc censé faire la connexion entre l'être du cerveau, qui est foncièrement un ordinateur élémentaire – le mot y est : une machine de Turing – et les créations les plus élaborées de la culture. Ce qui, certainement, permet de faire la connexion, selon cet auteur, c'est que le cerveau peut bénéficier de l'accumulation et de la transmission culturelle qui s'est étendue sur des millénaires.
À vrai dire, pour un philosophe, on n'est pas très loin de cet atomisme que critiquait, il y a bien longtemps, Maurice Merleau-Ponty, dans son livre auquel il m'est arrivé de faire référence une fois dans ce Cours, La Structure du comportement[4] , où il notait déjà que, d'une main, on décompose en unités ou en modules, on isole des processus, on les juxtapose, et puis, on entend corriger cet atomisme par des notions, comme il disait en 1943, d'intégration et de coordination. Le maître-mot dont use Dehaene c'est la recombinaison des perceptions, du sensori-moteur et des souvenirs. On ajoute un accent de combinatoire, mais ça s'inscrit à la même place.
L'hypothèse rudimentaire cognitiviste d'autrui
Cela dit, cette référence à la culture est quand même extrêmement massive. Elle est précisée par Vidée d'ensemble de signes. Sans doute le structuralisme a-t-il sa part dans cette précision. On s'empare de certains passages de Lévi-Strauss pour aller dans cette direction. Les auteurs sentent bien l'insuffisance, le flou de cette implication. Ils dressent donc une hypothèse plus précise sur la porte d'entrée du petit enfant au petit cerveau, dont le développement va, évidemment, s'étendre sur plusieurs années. C'est l'hypothèse sur l'entrée du petit cerveau dans la culture. Il y a nombre d'hypothèses épigénétiques, que je ne vous mentionne pas, mais celle-là vaut la peine qu'on la souligne : Les enfants humains, je cite, commencent à comprendre que les autres personnes sont des agents intentionnels comme eux – voilà un facteur cérébral capital ! C'est cette compréhension qui leur donne accès à l'apprentissage culturel. Voilà très précisément l'hypothèse qui doit complémenter et en quelque sorte combler ce gouffre : le petit enfant comprend que les autres ont des intentions comme lui, et c'est cette compréhension d'autrui qui donne accès à l'apprentissage culturel.
C'est une hypothèse sur autrui. C'est une hypothèse sur la lecture, le déchiffrage de l'intention de l'autre, le déchiffrage de l'autre comme sujet intentionnel. On a donc ici, dans un développement cognitiviste, l'irruption d'autrui comme sujet intentionnel que le sujet comprend. Cela s'accompagne de l'hypothèse complémentaire qu'il doit y avoir, je cite, un module cérébral spécialisé dans la représentation des intentions et des croyances d'autrui, qui, pour l'instant, n'a pas fait l'objet d'une identification à la Changeux, mais, puisque tout a sa place dans le cerveau, dont on doit supposer qu'il y a un module cérébral spécialisé pour ça. On comprend comment tout cela fonctionne : vous mettez en valeur tel ou tel trait de la pensée ou du comportement ou de la création, et la réponse, c'est l'hypothèse qu'il doit y avoir un module spécialisé que nous finirons par voir à l'imagerie cérébrale.
On ne peut pas se défendre de l'idée qu'on a affaire à un balbutiement, que la phénoménologie du stade du miroir est déjà beaucoup plus riche pour ce qui est du rapport avec l'autre, et que le concept d'ordre symbolique est évidemment beaucoup plus précis que celui de culture dont fait usage le psychologue cognitiviste.
On s'aperçoit d'ailleurs de la fonction qu'avait le stade du miroir pour Lacan quand il l'a proposé : une solution de la problématique multiplicité-synthèse. La multiplicité en question, c'était alors celle du corps morcelé, et c'est par le miroir que la forme totale du corps venait à être perçue et, par là, pouvait symboliser la permanence mentale – ce sont les termes de Lacan – de ce qu'il appelait le Je. Il donnait à ce phénomène une place éminente dans le développement mental, puisqu'il caractérisait ce développement comme nécessaire vu la prématuration spécifique de la naissance dans l'espèce humaine.
Le bouche-trou de la construction cognitiviste
Si rudimentaire que soit l'hypothèse cognitiviste, elle désigne ce qui fait trou dans leur construction, à savoir qu'il faut bien une porte d'entrée du cerveau dans la culture, dans l'apprentissage culturel, comme ils s'expriment, puisqu'ils n'ont d'idée de savoir qu'à travers l'apprentissage. Cet abîme, ils le comblent en désignant un rapport de compréhension globale avec l'instance de l'autre. Dans leur langage, cela suppose qu'ils aient recours à une hypothèse supplémentaire, à savoir celle d'un module spécialisé pour l'accomplir.
Mais on sent que tout le discours sur la connexion avec le registre de la culture suppose déjà d'identifier le moment inaugural d'une entrée, présentée dans les termes de la psychologie la plus élémentaire, la psychologie disons positiviste le déchiffrage de l'intention de l'autre. Avec la supposition, soit dit en passant, que le sujet serait, déjà, pour lui-même, un sujet intentionnel. Je cite, exactement : Les enfants humains commencent à comprendre que les autres personnes sont des agents intentionnels, tout comme eux. Cette rencontre, qui paraît indispensable à l'apprentissage culturel, suppose donc que, déjà, pour lui-même, l'enfant humain soit un agent intentionnel.
On est là, dans une extraordinaire fantasmagorie. Sauf à avoir recours – je ne dis pas que c'est la réponse la plus développée – à la notion lacanienne d'ordre symbolique qui donne consistance au milieu où le déchiffrage et le vouloir dire sont concevables. Mais cela suppose une structure plus développée que celle de l'imitation qui est là sous-jacente. Cela suppose une structure dont le point de départ est déjà fait d'une rétroaction, et qui localise dans l'Autre – A – le site préalable, comme s'exprimait Lacan, du sujet du signifiant.
Pour le Lacan le plus classique, la base matérielle – avant qu'il l’a défasse c'était la structure du langage, celle dont il pensait pouvoir démontrer qu'elle soutient le symptôme au sens psychanalytique, là où le symptôme s'avère en relation avec une structure signifiante qui le détermine.
La causalité signifiante... et son ébranlement
On voit bien comment Lacan a pensé amadouer le discours scientifique ou ménager à la psychanalyse une place dans le discours de la science par un recours, qui est aujourd'hui beaucoup moins probant qu'au milieu du XXe siècle, par le biais de la linguistique structurale, qui s'est trouvée progressivement refoulée par d'autres abords de la linguistique. C'est en s'appuyant sur la linguistique structurale de Saussure et Jakobson, que Lacan pouvait penser et dire que le langage a conquis son statut d'objet scientifique. C'est resté le support intouché de son enseignement jusqu'à ce que, dans son tout dernier enseignement, par une phrase lapidaire que j'ai mentionnée l'année dernière, il ébranle cette base.
On aimait, à l'époque, reproduire son écriture de la différence du signifiant et du signifié, sous forme d'algorithme, disait-il.

Cet algorithme avait pour but de marquer que les liaisons internes au signifiant avaient les fonctions les plus amples dans la genèse du signifié. C'est ce qui a donné à son écrit « L'instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud»[5] sa valeur de point de capiton. Il a durci cette position par la suite en faisant du signifiant la cause, non seulement du signifié, mais du sujet. Autrement dit, à la vraie causalité psychique, il a pu donner la forme de la causalité signifiante et c'est sur cette base que la partie la plus classique de son enseignement a pu se développer.
Du sujet lacanien et de son abolition dans les neurosciences
Par réflexion, à partir du cognitivisme, le terme même de sujet que Lacan a apporté dans la psychanalyse prend sa valeur de rompre la relation de doublure entre ce qui est psychique et ce qui est organique.
C'est pourquoi Lacan pouvait dire qu'il admettait la définition aristotélicienne de l'âme comme forme du corps, et, d'une certaine façon, le stade du miroir est une genèse de l'âme au sens aristotélicien. C'est le paradigme illustrant l'émergence de l'âme.
Ce qu'on nous développe sous les espèces de l'activité neuronale – dans ses formes supposées les plus élevées, ses formes intégratives et combinatoires, voire réflexives – ne sont que des genèses de l'âme aristotélicienne. Dehaene croit valider son schéma en l'identifiant au schéma aristotélicien du sens commun. Il faut un lieu où ça se rassemble.
Par rapport à cela, il est sensible que le sujet est en position décomplétée. Le sujet dont il s'agit chez Lacan n'est pas le sujet psychique. De la même façon que le savoir dont il s'agit dans l'inconscient n'a rien à faire avec le savoir tel qu'il est mis en fonction dans le cognitivisme comme information – faisant l'objet d'un stockage de mémoire, d'un apprentissage ou d'une pédagogie. Le savoir dont il s'agit dans l'inconscient, est logé aiileurs : il est logé dans le discours, et dans un discours où on interroge l’inconscient sur le mode qu'il dise pourquoi, disait Lacan, c'est-à-dire sur le mode du déchiffrage.
Le sujet de Lacan, c'est un sujet purement et simplement aboli dans la neuroscience, puisque, pour elle, le postulat est aristotélicien: ce qui est psychique se déprend, est le double de l'organique.
On sent bien que, même si Freud a emprunté à la biologie, ce n'est, bien entendu, pas à partir de la biologie qu'on peut isoler la pulsion de mort.
On ne peut le faire que comme une fonction du discours, c'est-à-dire, précisément, sous les espèces de la fonction de la répétition.
Les intégrations toujours parcellaires
Ceci n'implique pas le moins du monde une négation du réel du corps. Cela n'implique pas une négation du réel du schéma mental, même s'il est imaginaire. Cela implique, dirais-je en généralisant une proposition de Lacan, que les intégrations sont toujours parcellaires.
Lacan l'affirme à propos de l'image du corps : l'accès à la forme totale du corps n'annule pas le morcellement initial du rapport au corps. L'intégration spéculaire n'est donc jamais totale, elle est contradictoire. De la même façon, on peut dire que l'intégration mentale, loin d'être une fonction de synthèse totale, est toujours parcellaire. Ce que nous appelons sujet, c'est justement ce qui est parcellaire dans cette intégration.
Quand Lacan traite du moi, c'est dans la ligne freudienne qui y voit un bric-à-brac d'identifications désassorties, à mille lieues du lieu de délibération interne et réflexive qui fait l'objet de l'hypothèse cognitiviste.
La fonction disjointe du sujet
Ce sujet, que Lacan recommandait de ne jamais incarner – même quand il le représentait sous les espèces de l'ensemble vide, c'était encore trop —, inutile de dire qu'il n'est certainement pas susceptible de s'incarner dans le cerveau. Il y a là une autre fonction, une fonction disjointe, qui ne peut être abordée – je ne dis pas connue, mais qui ne peut être abordée – que dans la référence au discours.
À partir du moment où on admet qu'on ne peut boucler la connaissance scientifique du cerveau sans faire appel à la culture, on est bien en peine de nier que le discours, le rapport à l'autre par le discours, constitue un ordre de réalité qui est propre. L'hypothèse, dont on ne peut se passer, du déchiffrage de l'intention de l'autre est déjà le témoignage qu'on ne peut nier la densité de réel qu'il y a dans le fait du discours, puisque, même dans cet exemple sommaire qu'on nous donne, dans cet appel sommaire qu'on fait à l'autre, il est question de déchiffrage.
Le sujet, nous prétendons donc qu'il est une fonction qui se déprend de cet ordre de réalité sui generis qu'est le discours.
La contingence à la place de la cause
C'est ce que Lacan, dans son enseignement le plus classique, a développé, jusqu'à ce point que j'ai signalé la dernière fois, où il rencontre une cassure de la causalité.
Tout le long de son enseignement, prêt à affronter sur son terrain le discours de la science, il a adopté, avec sa valeur de provocation, le langage causaliste. Jusqu'à isoler une cassure de la causalité, une cassure de la détermination, en rencontrant, en synthétisant – pourquoi ne pas le dire ? – un certain nombre de résultats sous les espèces de : il n'y a pas de causalité sexuelle. Il a dit rapport. Il a dit rapport pour dire qu'il n'y a pas là de causalité. Il n'y a pas de loi du rapport entre les sexes.
Il a pensé par là opposer au réel de la science – qui est un réel qui contient un savoir —, le réel propre à la psychanalyse – sous les espèces d'un réel qui ne contiendrait pas un savoir et que véhiculerait le savoir de l'inconscient. Il véhiculerait plutôt spécialement l'absence de loi, précisément le trou de ce savoir-là. Il n'y a pas de rapport sexuel, c'est la notion d'une absence de loi. La loi sexuelle ne peut pas s'écrire.
C'est alors que le terme de contingence devient un maître-mot à la place de celui de la cause.
Cette contingence est placée par Lacan au niveau de la constatation – validée par le discours analysant, par l'expérience analytique et par la multiplicité dont témoignent les modes sous lesquels les deux sexes entrent en rapport. Il y a là une multiplicité clinique qui permet – sous sa forme synthétique, du fait que cette contingence ne se dément pas – d'être prise comme démontrant l'impossibilité d'écrire une loi à cette place.
Le réel attesté par la psychanalyse
Ce qui pourrait être considéré comme une impuissance du discours analytique formuler le rapport sexuel est traité par Lacan comme une impossibilité. L’analyse devient le lieu propre où l'inconscient atteste de ce réel – un réel sans savoir.
Dans quelle mesure y a-t-il un mathème de ce réel ? C'est un réel sans mathème.
Si on en suivait toutes les étapes – ce que je n'ai pas fait –, on verrait finalement Lacan faire reculer la place de la psychanalyse : de celle de science à pelle de science conjecturale, puis à celle de science au bord de la science, et puis à celle de formation discursive sur le bord extérieur de la science. Il invente un réel sans mathème. Il fait du rapport sexuel un réel sans mathème, dont la question est de savoir dans quelle mesure il est transmissible. Lacan donne comme réponse qu'il n'est transmissible que par la fuite à laquelle répond tout discours. Il est essentiellement transmissible par l'expérience analytique elle-même, c'est-à-dire par l'expérience même de la fuite.
L'invitation faite aux analystes d' ek-sister
Quand Lacan formule dans son dernier texte écrit, comme je l'ai souligné, que l'inconscient est réel, il entend par là que l'inconscient n'est pas imaginaire – ce qui était la thèse à quoi conduisaient ses « Propos sur la causalité psychique » ; que l'inconscient n'est pas symbolique – au moins par sa phase la plus profonde; mais que l'inconscient est au niveau du sans loi. Il ne représente même pas le retour de la vérité dans le champ de la science, parce que la vérité, comparée à ce réel, n'est qu'un mirage. D'où le support qu'il a cru pouvoir prendre dans le nœud. Il en a fait une matière de l'inconscient, la base matérielle de la psychanalyse, mais sous condition. précisément, qu'il ne se développe pas dans les normes du discours de la science. Ce n'est pas le manque de savoir qui lui a fait éviter le symbolisme mathématique des nœuds, c'est avant tout, pour donner le paradigme d'un traitement d'une matière à quoi le discours scientifique était, au moins à ce moment, incapable de donner ses lois.
Nous avons à soutenir devant les avancées faites pour une part d'observations, mais pour une autre part d'hypothèses pour les croyants – on ne peut dire ça autrement —, nous avons à soutenir devant ces avancées l'invitation faite aux analystes par Lacan de s'efforcer d'ek-sister, d'exister hors de ces normes – n'étant pas interdit, par des opérations de commando, d'en miner un certain nombre d'assises. C'est ce que, avec mes moyens, j'ai essayé de faire aujourd'hui.
[1] Leçon du 6 février 2008 du Cours de Jacques-Alain Miller, « L’orientation lacanienne. Tout le monde est fou », [2007-2008], enseignement prononcé dans le cadre du département de psychanalyse de Paris VIII. Texte établi par Yves Vanderveken, à partir de la transcription de Michel Jolibois, parue sur liste électronique dans le Numéro extraordinaire de TLN 378. Non revu par l'auteur.
[2] Freud S., « Esquisse d'une psychologie scientifique», La naissance de la psychanalyse, Paris, PUF, 1956, 8è édition, 2002, pp. 307-396.
[3] Dehaene S., Les neurones de la lecture, Paris, Odile Jacob, 2007, p. 478.
[4] Merleau-Ponty M., La structure du comportement, Paris, P.U.F., 2006, p. 248.
[5] Lacan J., « L’instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison depuis Freud», [1957], Écrits, Paris, Seuil, 1966, pp. 493-528.